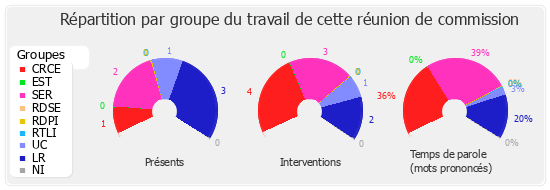Délégation sénatoriale à la prospective
Réunion du 26 mai 2016 : 1ère réunion
La réunion

Mes chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir ce matin James Kenneth Galbraith, professeur d'économie américain, francophone et, comme me l'a confié de nombreuses fois notre collègue Pierre-Yves Collombat, qui est à l'origine de cette rencontre, révolutionnaire devant l'éternel, hétérodoxe et très contestataire. Monsieur le professeur, je vous remercie vivement d'avoir accepté de venir débattre avec nous d'un sujet pour le moins compliqué. Je salue également la présence parmi nous de collègues membres des commissions des finances et des affaires économiques que nous avons conviés à cette réunion.
La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de l'étude que mène Pierre-Yves Collombat sur l'avenir et les risques du système financier et bancaire. Lors d'une précédente audition, Jean-Michel Naulot, ancien banquier, nous avait annoncé que la crise financière de 2008 n'était qu'une répétition générale, avant que ne survienne une crise encore plus dure dans les années à venir. Monsieur le professeur, vous êtes un universitaire et économiste reconnu, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages et vous êtes incontestablement l'un de ceux que l'on écoute, que l'on soit d'accord ou non avec vous, pour savoir ce qui risque de se passer.
Notre délégation a une mission importante au sein du Sénat : celle d'alerter et d'informer sur un certain nombre d'événements susceptibles de se produire à l'avenir. Je laisse à l'initiateur de cette rencontre, Pierre-Yves Collombat, que je remercie, le soin de préciser le contexte.

Je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le président, d'avoir permis cette audition. Nous ne sommes pas des pythonisses mais l'objet de notre travail est tout de même d'essayer de voir comment la situation peut évoluer. En particulier, se maintiendra-t-elle telle qu'elle est aujourd'hui ? Si oui, jusqu'à quand ? Après avoir misé sur la Chine et sur les « Brics », sans vrais résultats, pouvons-nous espérer des États-Unis une reprise et que faut-il en attendre ? Allons-nous au contraire vers un nouveau crash financier et une nouvelle crise généralisée ? Monsieur le professeur, vous êtes un observateur bien placé pour répondre à toutes ces questions.
Subsidiairement, j'ai cru comprendre que donner une priorité au redressement du système bancaire ne fera pas repartir la machine. Il faut au contraire d'abord faire repartir l'économie et mobiliser des moyens équivalents à ceux qui ont été utilisés au moment du New Deal avant de pouvoir redresser le système financier et retrouver un régime de croisière. Voilà l'opposé de la politique menée en Europe. C'est pourquoi j'aimerais connaître votre sentiment sur cette stratégie de fond.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis ravi d'avoir ce matin l'occasion de partager avec vous certaines idées, dont la plupart ont été développées dans un livre publié voilà deux ans et qui s'intitule, en français, La Grande crise. Comment en sortir autrement. Je dirai également quelques mots sur la situation en Europe, dans le prolongement de mon dernier ouvrage Crise grecque, tragédie européenne, qui paraît aujourd'hui et qui couvre mon travail du premier semestre de l'année 2015 à Athènes. Je vais commencer par la situation générale de l'économie et aborder notamment les conséquences de la grande crise financière de 2007-2009.
Tout d'abord, en quoi consiste cette crise ? Pour certains économistes et dévots de l'économétrie, elle n'est qu'un événement comme un autre, un choc de croissance somme toute classique, un déséquilibre temporaire que l'on n'aurait pas pu anticiper. Les promoteurs de telles idées n'ont pu qu'être déçus au cours des dernières années. Si l'économie retrouve un certain équilibre, la situation reste très inconfortable pour ceux qui ont la responsabilité du bonheur commun. La relance, s'il y en avait une, n'est pas satisfaisante, selon ce que l'on aurait pu attendre de notre expérience acquise depuis l'après-guerre.
Dès lors, cette crise a-t-elle une autre signification, signale-t-elle un changement profond dans les conditions de notre vie économique ? Auquel cas nous serions confrontés à des questions fondamentales. En tout état de cause, la prudence dicte de prendre en compte pareille hypothèse. Il existe une lacune dans la discipline d'économie conventionnelle : celle de la question des ressources, surtout énergétiques. Les économistes de l'après-guerre ont pris l'habitude de négliger cette question et de se comporter comme si les ressources étaient librement disponibles, de les considérer comme un don de la nature. Voilà la pensée qu'on inculque depuis quarante ans à l'université américaine aux étudiants en économie. On leur enseigne également la théorie de la « malédiction des ressources naturelles », selon laquelle, à l'inverse, les pays qui en sont dépourvus, comme le Japon, seraient par nature plus actifs, plus entrepreneuriaux, et donc plus riches. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, cette approche est obsolète. Si les États-Unis ont connu une relance supérieure à celle de l'Europe après la crise financière, c'est notamment grâce à la « bulle » de schiste qui a créé une différence sur le coût des ressources entre les deux continents. De plus, les difficultés du Japon proviennent en partie de la catastrophe de Fukushima.
Existe-t-il une règle générale sur laquelle nous pouvons nous appuyer ? Je pense pouvoir répondre par l'affirmative. De surcroît, elle est relativement simple. Les ressources deviennent plus chères car davantage de ressources sont nécessaires pour les extraire. Le haut niveau de développement que nous avons atteint s'explique par les investissements que nous avons consentis dans le passé. Il nous faut dépenser davantage en termes réels pour maintenir en fonction l'ensemble de ces investissements, c'est-à-dire l'ensemble de nos capitaux accumulés. Décarboner l'économie, s'adapter au changement climatique suppose de mobiliser les ressources nécessaires : capital, recherche et heures de travail. Il est donc inévitable de dépenser moins ailleurs, que ce soit pour les nouveaux investissements, le développement ou la consommation de masse. Pour les coûts de production, la différence n'est pas très grande. Cependant, une proportion même assez petite peut faire la différence entre une économie de croissance, une économie de stagnation, voire une économie en déclin.
Il faut choisir entre le renouveau et le maintien d'un certain niveau de consommation, c'est-à-dire la reproduction simple de la situation précédente, surtout dans un contexte d'accroissement de la population couplée à une hausse en proportion de la population hors travail - chômeurs, retraités, jeunes.
En pareil cas, d'aucuns entendent poursuivre une politique d'austérité. Cette approche est, à mes yeux, erronée, dans la mesure où elle mène au gaspillage des ressources actuelles dont nous avons besoin. Elle peut être assimilée à une politique de la passivité, de la non-action, au moment même où il faudrait agir. Il importe d'investir pour renouveler nos sources d'énergies et promouvoir les énergies soutenables et renouvelables. Cela n'est pas neutre financièrement, car, parallèlement, nous devons continuer à offrir aux populations un haut niveau de services, en termes de transport, de communication, de santé, d'éducation, d'enseignement. Il serait inconcevable d'en revenir aux normes de confort en vigueur au XVIIIe ou XIXe siècle.
Troisième point, il faut économiser sur les moyens de consommation qui ne sont pas strictement nécessaires, augmenter la consommation commune et minimiser les excès, surtout ceux qui sont dangereux, maintenir une distribution de la consommation qui soit plus égalitaire qu'avant. Parmi les activités considérées comme trop dangereuses, je citerai l'armement, les banques et le charbon.
Quatrième point, il faut protéger les plus vulnérables. Les assurances sociales deviennent encore plus importantes dans la situation actuelle. Souvenons-nous que ce sont elles qui nous ont aidés à sortir de la Grande Dépression des années trente. Les États-Unis n'ont pas attendu le retour à la prospérité pour mettre en oeuvre le New Deal et poser les bases de l'État providence.
Cinquième point, j'y insiste, il faut choisir de minimiser les dépenses les moins utiles et les plus dangereuses, comme l'armement. De même, le système financier est devenu depuis vingt ou trente ans beaucoup trop coûteux en ressources réelles, à l'image du charbon et du pétrole. Misons sur la musique, la science et la culture. Les politiques actuellement menées en Europe et aux États-Unis n'opèrent pas de distinctions pourtant essentielles. Elles entraînent une réduction du niveau de vie des individus sans protéger les plus vulnérables, sans préserver les systèmes essentiels et faire de provisions pour un avenir soutenable, pour une planète sur laquelle nos descendants pourront vivre.
En définitive, quelle est l'alternative à privilégier ? Ce n'est ni une politique de croissance à outrance ni le keynésianisme des années trente ; c'est une politique intelligente, adaptée à la situation actuelle, à nos besoins et à nos contraintes, une politique qui s'inscrit néanmoins dans l'esprit de John Maynard Keynes, qui a prononcé cette phrase célèbre : « Quand les conditions changent, il faut changer d'avis. » Je crois fondamental d'abandonner toute idéologie ou dogmatisme qui dirige la politique économique, notamment en Europe, avec pour résultat l'obligation, pour les pays du Sud, surtout la Grèce, de rembourser les dettes et la privatisation de tous les biens communs et publics, y compris les plages grecques. Cette politique renforce le chômage et l'émigration de la population active. Elle est promise à un échec fondamental qui va changer la nature de cette Europe qui s'est construite depuis cinquante ans.

Devant pareil optimiste, je donne sans attendre la parole à Pierre-Yves Collombat.

« Pessimisme de la raison et optimisme de la volonté », disait quelqu'un... Quand je lis Les Échos, j'ai l'impression que les États-Unis vont nous sortir de la crise, que tout est reparti, que le chômage a disparu, ou quasiment. Tout cela est-il fondé ?
Sur le plan structurel, la politique, menée notamment en Europe, donne la priorité au sauvetage du système financier, au motif qu'il n'y aurait pas d'autre possibilité. Vous semblez penser le contraire.
Les États-Unis ont aussi donné la priorité au sauvetage du système financier, et c'est problématique. Notre système financier est très concentré, trop puissant et sans la moindre responsabilité à l'égard de la loi et de la justice. Les fraudes incommensurables qui nous ont menés à la crise n'ont suscité aucune réaction. Malgré cette erreur de notre politique d'après-crise, les États-Unis ont profité de deux avantages par rapport à l'Europe : d'abord, la bulle de schiste, que j'ai déjà mentionnée, d'où un coût des ressources provisoirement allégé, mais, surtout, un système d'assurances sociales qui a fonctionné de façon très efficace juste après la crise, avec une augmentation rapide des dépenses du secteur public avoisinant 9 % du Pib en 2009. Je parle de la sécurité sociale, des assurances chômage, des assurances santé, tout ce système méprisé mais qui fonctionne depuis cinquante ans à une échelle continentale. En Europe, en revanche, la stabilisation automatique opérée par la protection sociale a joué dans les pays riches du Nord mais pas dans ceux du Sud - Espagne, Italie, Grèce -, ce qui plonge l'Europe dans une crise sans fin pour l'instant. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les pays menacés de banqueroute puissent soutenir l'activité économique de leur population. La Grèce a perdu un quart de ses revenus depuis cinq ans.

Après la crise de 2007-2008, un certain nombre de réformes ont été menées au niveau du système bancaire et financier international. Aujourd'hui, ce dernier est-il plus solide ou encore plus fragile, car toujours déconnecté de l'économie réelle ?
Il m'est un peu difficile de répondre. Je ne vois pas de résurgence de cette espèce de bulle complètement frauduleuse qui a touché le marché des hypothèques et des titres avant 2007. Cependant, il reste toujours des problèmes de dettes souveraines, de dettes dans le tiers-monde, dans le secteur énergétique et ailleurs. Nous pouvons également citer le problème des dérivés, des credit default swaps : nous avons du mal à les identifier et, partant, les institutions les plus vulnérables de ce point de vue.
Je crois que nous ne pourrons jamais dire que le système financier, tel que nous l'avons construit, est hors de danger. Dans la crise relativement profonde des marchés internationaux et des taux de change observée depuis un an, une grande banqueroute est certainement possible. Après 2008-2009, les États-Unis ont été confrontés à une difficulté supplémentaire, qui est l'impossibilité de considérer au niveau politique un second sauvetage financier. Il a déjà été extrêmement ardu de faire passer le projet de loi présenté à la fin de 2008. Le Congrès n'ira de nouveau dans cette direction que sous la menace d'une catastrophe totale.

À la suite d'un certain nombre d'auditions que la délégation à la prospective a réalisées, la conclusion que nous pouvons en tirer est que la crise financière de 2008 peut se répéter. Il s'agit juste de savoir où et quand. La réponse que vous venez de nous apporter semble aller dans ce sens. Selon vous, une possibilité d'accord politique au niveau international pour éviter cette financiarisation de l'économie, qui a atteint un niveau inédit, est-elle possible ? Deuxième point, la révolution numérique imposera probablement une évolution sociétale considérable. Pensez-vous que l'ensemble des politiques publiques prenne ce phénomène suffisamment en compte et comment faire pour que tel soit le cas ? Troisième point, il semble que le creusement des inégalités affaiblisse la croissance alors que leur diminution la soutient. Qu'en pensez-vous ? Enfin, vous avez cité Keynes tout à l'heure : « Quand les conditions changent, il faut changer d'avis. » Cette affirmation est vraie sur le plan économique mais pas sur le plan philosophique.
Mon père a eu cette phrase : « Les économistes économisent surtout leurs idées. Ils font en sorte que celles qu'ils ont retenues à l'université leur servent toute la vie. »
Je suis favorable à la mise en oeuvre d'un contrôle du système financier et d'une définanciarisation de l'économie. Cela a été fait une fois, entre les années trente et soixante-dix. Le système bancaire a alors été placé sous le contrôle des États, surtout ici en France. J'ai conduit une étude sur le système bancaire et financier dans la France d'après-guerre. Il intégrait les opérations des banques en visant des objectifs publics de reconstruction et de gouvernement du pays. Mis en place avec, notamment, la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit foncier et le Crédit agricole, il a fonctionné jusqu'à un certain point.
Dans un contexte où le développement de l'économie doit prendre une autre direction, ce genre d'instruments est utile. Les banques actuelles ne servent que les objectifs fixés par leurs dirigeants. Il est injustifiable que les gouvernements de nos pays, de nos continents, soient dirigés par nos banques. Cette situation mènera à la ruine.
Comment réformer le système ? Je ne prétends pas avoir toutes les solutions. Dans un monde bouleversé par la révolution numérique, les banques sont devenues, aussi incroyable que cela puisse paraître, des institutions conçues pour échapper au droit national, régional et continental. J'ai réalisé une étude s'échelonnant sur une vingtaine d'années sur l'évolution des inégalités dans le monde. Ma conclusion est que les inégalités sont liées de façon très étroite à l'évolution du système financier. Ce sont les industries de haute technologie, financées par les banquiers, qui ont donné les milliardaires de la Silicon Valley. Les statistiques aux États-Unis le montrent très clairement, ceux qui ont profité le plus sont ceux qui ont su capitaliser sur les innovations technologiques et sur le pouvoir financier.
Quelles sont les conséquences de cette révolution numérique ? Les économistes ont été beaucoup trop optimistes sur la capacité du marché privé à remplacer les emplois en train d'être détruits par les avancées technologiques. La situation actuelle fait penser à celle qu'a connue le transport à cheval au moment de l'arrivée de l'automobile. Sauf que, aujourd'hui, il s'agit de trouver du travail à des êtres humains, à ceux qui sont ou vont être déplacés. De nouvelles institutions dédiées à cet objectif sont à créer. Toute révolution technologique apporte des opportunités énormes à la population, du moins à celle qui est en activité et a une source de revenus personnelle. D'où la nécessité d'augmenter la proportion du revenu national dédiée à l'environnement, à la culture et aux soins des personnes âgées, autant de secteurs qui ne peuvent être automatisés avec les ordinateurs et les smartphones. Comme le secteur privé ne le fera pas spontanément, cette responsabilité revient à des institutions publiques ou qui relèvent du secteur non lucratif.

Vous soulignez l'efficacité de la protection sociale aux États-Unis, qui fonctionne très bien avec 9 % du Pib, et sa faiblesse en Europe, notamment en France, où près du double y est consacré. Est-ce parce que ce secteur est ouvert à la concurrence en Amérique du Nord quand il est régi par un État monolithique chez nous ? Ma seconde interrogation concerne les ressources naturelles. La recherche et l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste par fracturation ont permis aux États-Unis d'être exportateurs en ce domaine. Cet investissement répond-il à votre théorie ?
Je précise que les 9 % en question représentent l'augmentation des dépenses d'assurances sociales dans le Pib pour une année et pas le total du budget qui y était consacré en 2009-2010. Cette hausse a été décidée pour soutenir la population américaine, notamment les chômeurs et les retraités. Ainsi, la majorité d'entre elle n'a pas connu de chute profonde de ses revenus personnels, même si, bien sûr, elle a vu la valeur de ses biens immobiliers et de son épargne baisser. Cette décision a permis de stabiliser de manière assez efficace le niveau d'activité économique agrégé au niveau de l'ensemble des États-Unis, à la différence de l'Europe.
Quant à la fracturation hydraulique, on ne sait pas exactement où cette méthode va mener ni combien de temps elle pourra être utilisée. De nombreux problèmes sont à déplorer. La construction de nouveaux puits a, il me semble, presque cessé après la chute du prix du pétrole. De nombreux autres sont stoppés temporairement, mais pourront être remis en production dès qu'ils redeviendront rentables. Quant à savoir combien de temps cette bulle va durer, la question est d'ordre géologique. Je le sais d'autant mieux que j'habite moi-même le Texas. Je connais des personnes qui travaillent sur cette question mais elle reste sans réponse. Certains sont optimistes, d'autres pessimistes. Tout le monde le sait, il s'agit d'une solution limitée dans le temps, sur une échelle de quelques décennies.

Que pensez-vous de la séparation entre banque de dépôt et banque d'affaires ? Qu'en est-il aux États-Unis ? Au sujet des inégalités, quel jugement portez-vous sur le projet de revenu universel ?
Je suis favorable à la séparation des banques d'affaires et des banques commerciales, dont l'origine remonte au Glass-Steagall Act. Elle permet aux banques commerciales de bénéficier des assurances sur les dépôts et du soutien du gouvernement, et de « laisser tomber » les banques d'affaires si elles font banqueroute. Je ne pense pas que ce soit une solution complète au regard de la situation actuelle. Aux États-Unis, les banques sont trop grandes, ce qui rend inenvisageable une réelle régulation de ce genre de Béhémoth. Déconcentrer le système bancaire et réduire l'échelle de ces institutions seraient de bonnes idées. Le sénateur Sanders a d'ailleurs développé l'idée d'une concurrence entre petites institutions pour lutter contre la monopolisation du système financier. Je ne suis pas non plus convaincu par cette théorie. À l'âge informatique, que vous ayez un grand nombre de petites institutions ou un petit nombre de grandes, elles auront la même activité.
À la différence de mon ami Yanis Varoufakis, qui y est favorable, j'ai des doutes sur le revenu universel, à la fois d'ordre économique et politique. Économiquement, il importe de privilégier en priorité un système d'assurance pour les retraités, les malades, les jeunes ainsi qu'un accès universel à l'éducation et l'enseignement supérieur. Politiquement, une société qui fonctionne de façon satisfaisante doit imposer à ses membres d'exercer une activité, ce qui paraît difficilement conciliable avec une garantie de revenus. Cette idée circule depuis cinquante ans aux États-Unis. Je me souviens d'une discussion à ce sujet à la Convention nationale des démocrates en 1972. Elle rencontre de nombreuses résistances politiques et il est difficile de défendre ceux qui, bien que aptes au travail, ne font rien contre ceux qui travaillent. Je ne préfère pas mener cette bataille.

Je prolongerai le propos de notre collègue Philippe Dominati sur la protection sociale. Vous avez expliqué qu'au moment de la crise, en 2009, les États-Unis avaient apporté un soutien à ceux en difficulté en augmentant de 9 % du Pib les aides en leur direction. J'aimerais que vous soyez plus explicite : le système de protection sociale français est-il moins performant et moins réactif que celui des États-Unis ? L'image que nous avons, ici, en France, du système américain est celle d'un système beaucoup moins solidaire que le nôtre, donné souvent comme exemple dans le monde.

Il existe une différence fondamentale entre les deux systèmes : aux États-Unis, c'est l'État qui paye alors que notre système est paritaire, c'est-à-dire financé par les entreprises et les bénéficiaires.
Le paradoxe est apparent : notre système est moins performant mais il a répondu plus efficacement à la crise. M. Collombat vient de le mentionner, les dépenses de l'État en termes d'assurances sociales et de chômage n'ont pas été financées immédiatement par des impôts ni par des entreprises. L'État américain a consacré 9 % du Pib en plus pour compenser la chute de l'économie privée alors en cours. Il s'agit d'une injection assez radicale, destinée à stabiliser le malade puis à le récupérer. Toutefois, il n'existe pas, à mon sens, une très grande différence entre le fonctionnement du système aux États-Unis et celui de l'Allemagne et, peut-être, de la France. Le problème de l'Europe réside dans la construction d'une économie continentale complètement intégrée mais sans protection et stabilisation à pareille échelle. Toute une partie de l'Europe s'est retrouvée plongée dans la crise sans possibilité de se stabiliser. La Grèce est dans cette situation depuis 2010. Elle ne représente que 2 % du Pib européen, l'Espagne, presque 10 %, et l'Italie, 20 %.
La crise des institutions européennes doit ses origines à la domination des idées néo-libérales, ultra-orthodoxes, « néo-von-hayekiennes », promues, entre autres, par M. Schäuble, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de cette fameuse période s'échelonnant entre janvier et juillet 2015. Laisser ces idées diriger l'économie du continent est une invitation très claire à la catastrophe, qui ne tardera pas.

Sur la question de la place de la finance dans la gouvernance mondiale, la taxation des transactions financières, via la mise en oeuvre de la taxe Tobin, vous semble-t-elle un enjeu toujours pertinent ? Sinon, que pouvons-nous faire ?
Autre écueil fondamental : les paradis fiscaux, qui permettent l'extraction de sommes considérables hors des circuits officiels. Gabriel Zucman, professeur à l'université de Berkeley, propose la mise en place - utopique ? - d'un cadastre financier, qui permettrait de localiser les moyens financiers et de suivre leurs mouvements à la trace. Qu'en pensez-vous ?
Au sujet de la transition énergétique, considérez-vous que le nucléaire est un moyen d'y participer ? Qu'en est-il de la fixation du prix de la tonne de carbone sur le marché des quotas, qui reste le point nodal dont découlent nombre de décisions ?
Enfin, chacun sait que c'est la démocratie technique qui mène le monde, plus encore aujourd'hui qu'hier. Quid de la relation du citoyen à l'évolution des technologies, de son implication ?
Je le confesse, je ne suis pas un expert de la transition énergétique mais je considère que priorité doit être donnée à la décarbonisation. Pour la mettre en oeuvre, il faut prendre des risques. Le nucléaire en est certainement un. Quant à la démocratie technique, je ne vois pas à quoi cela correspond exactement.

La problématique est la suivante : comment associer les citoyens, sans qu'ils en soient forcément experts, à ces questions qui conditionnent leur vie en société et leur avenir ?
C'est une question très importante, mais la seule idée que je peux porter en la matière consiste à insister sur la nécessité de faire évoluer nos systèmes d'éducation et d'enseignement, pour permettre à la population d'appréhender les enjeux actuels. Aux États-Unis, les CV et les parcours scolaires ne sont pas du tout adaptés au monde moderne. Aussi curieux que cela puisse paraître, le Texas est toujours agité par le débat sur l'enseignement de l'évolution et de la création dans les écoles. Ici, vous êtes un peu plus avancés, du moins je l'espère. Tout ce qui peut permettre d'ouvrir la discussion et d'inviter au débat doit être encouragé.
Par ailleurs, j'ai passé une partie de ma carrière à militer pour l'ouverture de la Réserve fédérale américaine, la Fed. J'étais membre de l'équipe de la Commission bancaire de la Chambre des représentants aux États-Unis entre 1974 et 1980, au moment où ont commencé les auditions publiques ouvertes entre le Congrès et le Président de la Fed. Ce système perdure depuis maintenant quarante ans. Comme quoi des actions lancées à l'âge de vingt-trois ans peuvent parfois avoir des conséquences à la fois durables et remarquables. Je n'y aurais pas pensé à l'époque. Grâce à cette ouverture vers le Congrès et le grand public, la qualité des dirigeants de notre Banque centrale s'est grandement améliorée depuis lors.
En Europe, vous avez malheureusement construit une banque centrale complètement fermée sur elle-même, aux mains, si je puis m'exprimer ainsi, de quelques « mollahs », autour du « califat » de M. Draghi. C'est une invitation à être gouvernés par des personnes médiocres. Je ne dis pas que ce soit le cas de M. Draghi, mais force est de constater que les objectifs et motivations de toutes ces personnes ne sont pas clairs. En 2011, un certain président de la Banque centrale européenne pour faire plier le gouvernement d'Irlande, l'avait menacé en ces termes : « Une bombe explosera à Dublin. » Voilà qui aurait été inconcevable si la Banque centrale avait une responsabilité envers le Parlement européen et le grand public. Je crois que l'avantage d'une démocratie répandue, technique comme vous dites, c'est qu'elle oblige les dirigeants à être plus « responsables » ; ce n'est pas mauvais en soi.
Je connais bien James Tobin pour avoir été son étudiant. Je ne pense pas que la taxe Tobin, qui a pris depuis des décennies une importance symbolique, soit une solution. Contrairement à ce que certains pensent, elle ne pourrait résoudre que quelques-uns des nombreux problèmes actuels. Une régulation efficace du système financier ne passera pas par l'instauration de mécanismes automatiques. Il faut des personnes qui savent ce qu'elles font, indépendantes, autonomes et qui puissent intervenir auprès des banques pour empêcher les conspirations frauduleuses. Il est dans la nature humaine de chercher le profit. De plus, les banquiers ne sont pas des anges. Des policiers sont nécessaires dans ce secteur, comme dans les autres.

Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait adapter la production de ressources à l'accroissement de la population et des besoins, ce qui nécessite de focaliser les investissements sur ce delta entre ressources et besoins. Cette approche suppose-t-elle d'engager des investissements plutôt que de verser des dividendes ? Implique-t-elle une stabilisation des coûts salariaux dans l'entreprise, de façon à adapter la formation des individus à cette nouvelle gestion des ressources ?
Je répondrai par l'affirmative sur les deux points. Il faut avoir un planning des investissements et plafonner certains revenus. Depuis les années soixante-dix, profitant de modifications structurelles sur le plan fiscal, les dirigeants des grandes entreprises ont pu s'accorder des rémunérations extravagantes par rapport à celles de leurs prédécesseurs. Auparavant, les entreprises se finançaient par leurs propres moyens et la première tâche de leurs dirigeants était donc de maintenir les revenus entrepreneuriaux. Après 1980, aux États-Unis et dans le monde entier, les directions et les actionnaires ont été beaucoup mieux rémunérés, et les entreprises obligées de s'endetter pour investir. Cette construction institutionnelle est beaucoup moins stable et représente un aspect important du problème.

Monsieur Galbraith, le discours que vous nous avez délivré est assez inhabituel et il m'a beaucoup plu. Je pense, notamment, au dernier point que vous venez de soulever : le transfert en termes de financement qui s'est effectué au sein des entreprises, au détriment de l'investissement et au profit des actionnaires, lequel a complètement déséquilibré un système qui aurait dû permettre à tous de vivre décemment des richesses créées.
Je voulais aussi revenir sur la révolution numérique. Ne pensez-vous pas que les richesses qu'elle va permettre de dégager, ainsi que les nouveaux emplois qu'elle va créer, même si elle en détruira d'autres, peuvent permettre d'envisager une diminution du temps de travail ? En France, nous travaillons trente-cinq heures par semaine ; je crois possible d'aller jusqu'à trente-deux heures. La révolution numérique ne devrait-elle pas être mise au profit du progrès social et du plus grand nombre ?
C'est une question aussi intéressante qu'importante. La révolution numérique ouvre de nombreuses possibilités, notamment celle d'augmenter le niveau de vie en permettant à chacun de communiquer facilement et à moindre coût avec le monde entier. Parallèlement, les moyens de communication sont monopolisés et privatisés à un niveau inédit. Ainsi, les entreprises réduisent le coût du travail et le nombre des emplois dont elles ont besoin, d'où une réduction de l'activité économique et une augmentation du chômage.
Avant de penser à tirer avantage de la technologie, il importe de disposer d'institutions capables d'assurer des revenus suffisants aux ménages. C'est le problème que nous n'avons pas encore résolu et qui va s'approfondir. Les dirigeants des universités, des écoles et des services de santé sont soumis à la pression d'utiliser des moyens automatisés et de réduire leur personnel. Le loisir est-il la solution ? Cela dépend du type de société. En France, vous avez des villes très agréables. La population peut se consacrer davantage aux loisirs, sans risque de détérioration de ses conditions de vie. Pour les Américains, je n'en suis pas sûr. J'ai l'impression que, pour une grande partie de la population, le travail, c'est la vie sociale. Les Américains aiment être au bureau parce que l'alternative est de se trouver dans une petite maison en banlieue avec un chien, un chat et une voiture. En outre, aux États-Unis, les salariés ont à peine deux semaines de congés par an.

Monsieur le professeur, je tiens à vous remettre, au nom du Président du Sénat, la médaille du Sénat gravée à votre nom. C'est un grand honneur pour le Sénat de vous avoir reçu. Je laisse à Pierre-Yves Collombat le soin de conclure.

Même si tous les propos qui ont été tenus ce matin ne nous y incitent pas forcément, efforçons-nous d'être optimistes. Votre avant-dernier livre, s'intitule La grande crise : Comment en sortir autrement. Je vous pose donc la question !
Le seul fait de poser la question est déjà un signe de progrès. C'est un début. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce fut pour moi un grand honneur d'être parmi vous et de participer à cette discussion. J'ai fait mes études en français voilà quarante-huit ans en Bretagne. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'en servir un peu.