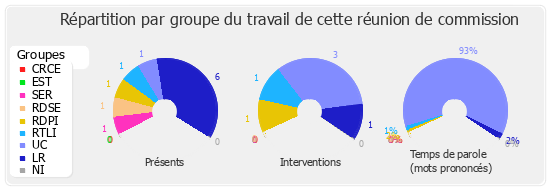Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 7 juillet 2010 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Quatre ans après le succès de « Brésil, Brésils, une année du Brésil en France », c'est la France qui a été mise à l'honneur au Brésil tout au long de l'année 2009.
En effet, le bilan de l'Année du Brésil avait été excellent. Plus de 300 manifestations ont ainsi marqué l'Année du Brésil en France en 2009, des milliers de pages dans la presse et des dizaines d'heures à la radio et à la télévision ont été consacrées à ce pays, à son peuple, à ses arts, à son histoire et à ses singularités et le public a pleinement adhéré à cette manifestation avec une participation active, témoignant d'une authentique curiosité pour cette culture et ce peuple.
Forts de ce constat, les Présidents Luiz Inácio Lula da Silva et Nicolas Sarkozy ont officiellement annoncé le 23 décembre 2008, lors de la signature du partenariat stratégique entre les deux pays, le lancement de l'Année de la France au Brésil.
L'idée était de proposer, du 21 avril au 15 novembre 2009, un ensemble d'événements culturels, scientifiques, économiques et sportifs, impliquant à la fois les institutions et la société civile, et couvrant l'ensemble du territoire brésilien, de Belem à Porto Alegre, et de Recife à Manaus, en passant par São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Salvador de Bahia, São Luis, Macapa... Autant de noms qui font rêver, autant de villes qui ont effectivement porté, tout au long de l'année, les ambitions de l'Année de la France au Brésil.
« L'Ano da França no Brasil » avait ainsi pour objectif de montrer les différentes facettes d'un pays fort de son identité culturelle mais aussi d'un pays en mouvement : une France moderne, une France diverse, une France ouverte.
Il s'agissait d'une opération de coopération bilatérale ayant pour objet de mieux faire connaître le pays partenaire et, par cette collaboration exceptionnelle, de transformer la perception que chaque pays avait de l'autre.
Dans cet esprit, la programmation de l'Année de la France au Brésil contenait des projets couvrant les champs de la culture, de la science, de la technologie et du sport, autant de domaines qui concernent notre commission, autant de sujets sur lesquels nous nous penchons tout au long de l'année.
L'Année de la France au Brésil a aussi réuni des artistes, des responsables politiques, des entreprises, les médias et bien sûr le public.
Plus de 500 projets ont ainsi été imaginés sur tout le territoire.
Notre délégation s'est rendue au Brésil du 13 au 20 septembre dernier afin de suivre le déroulement de cette saison culturelle et d'analyser les moyens de renforcer les relations entre le Brésil et la France.
Je souhaiterais en premier lieu vous livrer un court bilan de l'Année de la France au Brésil en décrivant les modalités de son organisation et les réalisations auxquelles elle a donné lieu.
L'organisation de l'Année de la France au Brésil a incombé, en France, au ministère des affaires étrangères et européennes. Nous n'avons pu, à cet égard, que constater l'implication quotidienne des équipes de l'ambassade, sous la direction de son Excellence M. Antoine Pouilleute, ambassadeur de France au Brésil, et des services de coopération culturelle dans les villes de Rio de Janeiro et de São Paulo. Les alliances ont pris le relais là où la présence des services de l'État français est plus limité, voire absente, comme à Manaus.
Les manifestations ont été mises en oeuvre par le commissariat français de l'Année de la France au Brésil et par des équipes de CulturesFrance. Je tiens à souligner, à cet égard, le très bon travail mené par l'opérateur délégué du ministère des affaires étrangères et du ministère de la culture, dédié aux échanges culturels internationaux. Une communication de grande ampleur a sans conteste été mise en place, preuve nous en a été apportée dans chaque aéroport où nous sommes arrivés, dans les couloirs desquels des affiches de l'Année de la France au Brésil étaient très visibles.
L'organisation de l'Année de la France a été prise en charge au Brésil à la fois par le ministère de la culture et le ministère des relations extérieures. La délégation a ainsi rencontré à Brasilia les grands organisateurs de l'Année de la France, notamment le directeur des relations internationales du ministère de la culture, Bruno Melo, le responsable de la gestion des projets dans cette même direction, Rodrigo Galletti, et la directrice du département culturel du ministère des affaires étrangères, Eliane Zugaïb. Ils nous ont dit avoir été surpris par le nombre de projets à labelliser et par la montée en puissance de la manifestation au fur et à mesure de son déroulement.
Cette Année de la France a également été soutenue par d'autres structures publiques fédérales, fédérées et municipales.
Nous avons, à cet égard, eu un contact extrêmement fructueux avec l'ancien ambassadeur Roberto Soares de Oliveira, commissaire général pour l'Année de la France au Brésil dont la mission de coordination a été véritablement capitale.
Mais à chaque fois, au niveau local, nous avons aussi constaté que les collectivités étaient fortement impliquées.
Á Manaus, c'est par exemple l'État de l'Amazonie qui a soutenu des projets, notamment des concerts français au légendaire théâtre Amazonas. Roberio Braga, secrétaire à la culture de l'État, nous a ainsi relaté le succès du cycle consacré à Saint-Saëns, Berlioz et Offenbach.
Á São Paulo, c'est le très puissant « SESC Pompeia » (service social du commerce de l'État de São Paulo) qui a financé des expositions, des concerts et des spectacles français dans toute la ville et tout au long de l'année.
La municipalité de São Paulo s'est aussi fortement impliquée, comme nous l'a démontré Carlos Augusto Calil, le secrétaire municipal à la culture. Les coopérations décentralisées entre collectivités françaises et brésiliennes ont été mobilisées, notamment à São Paulo, à la plus grande satisfaction de tous.
Des institutions publiques et privées se sont également inscrites dans le mouvement.
La fondation culturelle « Palmares » à Brasilia a monté des événements ponctuels. La pinacothèque et le musée de la langue portugaise de São Paulo ont respectivement mis en place une exposition très riche sur Matisse et une exposition particulièrement originale consacrée aux mots de la langue française.
Le centre culturel « Banco do Brasil » avec l'exposition « Saint-Etienne, cité du Design » et le musée historique national avec l'exposition « Tapisserie des Gobelins » ont également pleinement joué leur rôle de mise en valeur de la culture française.
Je n'ai parlé que des quelques manifestations que nous avons eu la chance de voir, mais plusieurs centaines ont été organisées. Une liste de ces projets vous a au demeurant été transmise afin que vous puissiez constater la diversité de cette Année de la France.
La programmation a été construite par les deux commissariats autour de trois axes :
- la « France aujourd'hui » symbolisée par la création artistique, l'innovation technologique, la recherche scientifique, le débat d'idées et le dynamisme économique. Á cet égard, nous avons rencontré à Rio les participants au symposium scientifique de l'académie brésilienne des sciences et du collège de France. Ils ont été unanimes : la présence universitaire française au Brésil est riche, fructueuse et dynamique. Réciproquement, un étudiant brésilien sur quatre recevant une bourse de son gouvernement choisit la France pour poursuivre ses études supérieures. Au final, la France est ainsi le pays avec lequel le Brésil mène le plus grand nombre de projets de recherche conjoints ;
- la « France diverse » : diversité de la société française, diversité des savoir-faire, et diversité régionale. Ce sont effectivement des troupes, des orchestres et des collections de toute la France qui ont fait le voyage pour le Brésil ;
- la « France ouverte » : avec la mise en place de partenariats franco-brésiliens, et de partenariats franco-brésiliens avec d'autres pays du monde (Afrique, Caraïbes, Amérique latine).
Le foisonnement des projets a été mis pleinement au service des objectifs fixés par les organisateurs, à travers la mise en place d'une labellisation soumise à l'approbation des commissaires généraux des deux pays, les projets des opérateurs français ayant été étudiés par le commissariat français installé à CulturesFrance, et les projets émanant des structures brésiliennes ayant été étudiés par le commissariat brésilien installé à la direction des relations internationales du ministère de la culture.
Les quelques 300 projets retenus ont respecté des critères en matière de contenu et de moyens, et ont comporté, chaque fois que cela était possible, une forte dimension d'échanges et de formations, permettant une pérennisation du projet.
Le financement a été réparti de manière équilibrée entre les différents volets de la manifestation (culture, universitaire, environnemental, économique, institutionnel). Les dépenses françaises se sont élevées à environ 10,7 millions d'euros, les ressources étant issues de plusieurs entités : CulturesFrance, différents ministères, des collectivités territoriales ou des mécènes. Vous trouverez un document de synthèse sur ce sujet dans le rapport.
S'agissant de la vitalité des actions entreprises et de l'effet d'entraînement qu'elles ont pu avoir, s'agissant des constats effectués au cours de notre déplacement qui a eu lieu à la toute fin de l'Année de la France, je suis convaincue - et je pense que l'ensemble de la délégation l'est également - que l'Année de la France au Brésil a été un succès et qu'elle aura des suites.
Au-delà de ce bref état des lieux de l'Année de la France au Brésil, le déplacement de la commission dans les principales villes du pays que sont Salvador de Bahia, Manaus, Brasilia, São Paulo et Rio de Janeiro, nous ont permis de rencontrer des responsables culturels, administratifs et politiques brésiliens et d'avoir un aperçu, d'une part, du succès de l'Année de la France au Brésil, et d'autre part, de la vitalité culturelle brésilienne, laquelle constitue un point d'entrée très pertinent pour notre coopération bilatérale. Car le Brésil n'est plus seulement « un pays d'avenir qui le restera longtemps », comme l'avait dit le Général de Gaulle. Sans être forcément « le nouvel eldorado » annoncé récemment par le magazine Le Point, et au-delà de ses 190 millions d'habitants et de ses 8,5 millions de km², c'est maintenant une puissance bien réelle, une puissance émergée avec laquelle la France se doit de dialoguer et de construire un avenir.
Á cet égard, la France est déjà considérée comme un partenaire privilégié soutenant l'ambition brésilienne d'obtenir un statut international digne du rôle que le pays peut jouer. Le président de la commission de la culture, de l'éducation et du sport du Sénat brésilien, Flavio Arns, que nous avons rencontré à Brasilia, en était pleinement convaincu.
La délégation s'est demandé si ces liens étaient éphémères ou durables, si les années 2005 et 2009 constituaient des parenthèses enchantées dans les relations franco-brésiliennes ou si elles ont posé les jalons solides d'une amitié et d'une coopération prolongées.
Si la réponse ne peut encore est apportée, force est déjà de constater que les graines semées par ces années croisées trouveront un terreau favorable grâce à l'action quotidienne menées par les trois lycées français brésiliens, par un réseau d'alliances françaises le plus dense dans le monde, et par une coopération universitaire et scientifique très active.
Á cet égard, je souhaiterais saluer au nom de la mission l'ensemble des défenseurs de la culture et de la langue française que nous avons rencontrés au Brésil. La seule préconisation que nous pouvons faire est en direction de notre ministère des affaires étrangères : la diplomatie culturelle ne peut pas être le parent pauvre de nos relations bilatérales avec le Brésil, elle doit en être l'un des moteurs, l'un des leviers les plus actifs.
Plus largement, les années croisées organisées jusqu'à présent ont rencontré un réel succès. Á nous, membres de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, de les encourager.
Vous trouverez dans le rapport d'information des développements sur le sport au Brésil dont nous avons pu mesurer l'importance, via notre visite au stade Maracaña où nous avons rencontré la secrétaire de l'État de Rio de Janeiro chargée du sport, et via la présentation qui nous a été faite de la candidature de Rio aux Jeux olympiques de 2016.

Le bilan positif de l'année de la France au Brésil constitue une bonne nouvelle. Mais quel est le poids de la langue française au Brésil et notre langue est-elle enseignée à l'école ?

L'enseignement du français à l'école est quasiment inexistant, sinon dans les lycées français et le pourcentage de brésiliens francophones se situe à un niveau très faible, autour de 0,5 %. La transmission de la langue française se fait principalement dans le réseau des alliances françaises.

Je remercie Catherine Morin-Desailly pour la manière dont elle a conduit la délégation. Par ailleurs, je voudrais dire qu'au-delà du succès de l'Année de la France, nous avons fait de nombreux constats et découvertes lors de ce déplacement. J'ai eu ainsi le sentiment de comprendre ce qu'est un pays émergent. Le Brésil est tourné vers l'avenir et vers l'extérieur : plus d'une cinquantaine d'ambassades brésiliennes ont été ouvertes pendant le mandat du Président Lula. La société brésilienne est multiculturelle et métissée, sans qu'aucune forme de ségrégation ne soit visible. La transformation économique et sociale est patente en dépit du nombre important de familles vivant sous le seuil de pauvreté (50 millions de Brésiliens). Le doublement du salaire minimum et la mise en place de la bourse familiale ont permis à une classe moyenne d'exister. Enfin, la culture est l'un des éléments majeurs de l'émancipation et du développement brésilien, comme le montre l'exemple des services sociaux du commerce (SESC), financés grâce à une taxe de 1,5 % prélevée sur la masse salariale des entreprises de ce secteur et dont la mission principale est de démocratiser l'accès à la culture.
Je ne peux terminer mon intervention sans parler de notre visite inoubliable au stade Maracaña de Rio de Janeiro où nous avons constaté la passion des Brésiliens pour ce sport et où nous avons assisté avec joie à la montée du club de Vasco en première division.

Le rapport présenté est de très grande qualité. En outre, je tiens à souligner la vitalité des alliances françaises, la relative bonne santé de la langue française, qui parvient à se maintenir dans ce pays d'Amérique latine, la puissance économique du pays, le courage et le dynamisme de la population, et, enfin, la sympathie qu'elle exprime à l'égard de la France.

J'ai pu constater lors du Forum urbain mondial qui s'est tenu en avril 2010 que l'Année de la France a laissé des souvenirs très positifs au Brésil. Je crois qu'il faut absolument encourager l'action quotidienne de ceux qui représentent la France dans ce pays, et notamment notre culture, à savoir les services culturels des ambassades et les alliances françaises. Ils font un travail remarquable et ont besoin de notre soutien. Ils doivent également pouvoir disposer de réelles perspectives de carrière et, à cet égard, la question du statut des personnels de l'actuelle CulturesFrance n'est pas neutre.

Au-delà de l'intérêt de ces déplacements pour le renforcement des relations interparlementaires, nous avons découvert un pays extrêmement riche de son métissage et de sa culture, pour lequel l'amitié avec la France n'est pas un vain mot.

L'appétence pour la culture française, je l'ai également constatée au Chili, pays dans lequel, pour autant, l'usage de notre langue est en régression. Par ailleurs, le Chili se projette très rapidement dans l'avenir, notamment grâce aux nouvelles technologies, dont le pays est très bien équipé. Qu'en est-il de ces deux questions au Brésil ?

S'agissant de la puissance du football au Brésil, je me demandais quelle était l'action de l'État dans ce domaine, et plus largement en termes de politique sportive. Par ailleurs, avez-vous rencontré des responsables de club ?

J'ai eu l'occasion de me déplacer au Brésil avec le groupe d'amitié et de visiter des entreprises, des exploitations agricoles, mais aussi des favelas. J'en ai tiré l'impression que le Brésil est déjà une forte puissance et que la politique sociale menée par le Président Lula, relativement bien acceptée par le patronat brésilien, est susceptible de donner une réelle solidité à ce décollage économique.

Je souhaite pour ma part évoquer l'importance de l'avenir sportif brésilien puisque, d'une part, la Coupe de monde de football y sera organisée en 2014, et, d'autre part, les Jeux olympiques s'y dérouleront en 2016.

L'équipement en nouvelles technologies est massif dans les grandes villes brésiliennes mais l'étendue du territoire rend la tâche très complexe. S'agissant de la politique sportive, la délégation a rencontré ceux qui ont monté le dossier de Rio de Janeiro pour les Jeux olympiques et a été impressionnée, avant que le choix ait été fait, par la qualité du projet.
Enfin, la commission a autorisé, à l'unanimité, la publication du rapport de la mission sous la forme d'un rapport d'information.
La commission nomme M. Alain Dufaut rapporteur du projet de loi n° 580 (2009-2010) ratifiant l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.
Présidence de Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente -