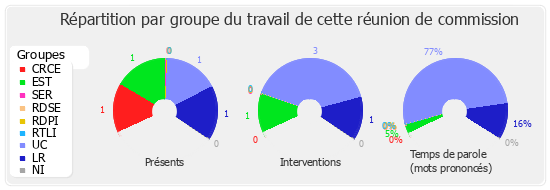Mission d'information Conditions de la vie étudiante
Réunion du 25 mars 2021 à 11h00
Sommaire
- Santé des étudiants
- Audition de mm. laurent gerbaud président de l'association des directeurs des services de santé universitaire christophe tzourio professeur d'épidémiologie directeur du centre inserm u 1219 bordeaux investigateur principal de l'étude i-share vincent beaugrand directeur général de la fondation santé des étudiants de france pierre-edouard magnan président du réseau national des mutuelles étudiantes de proximité emevia et abdoulaye diarra président de la mutuelle des étudiants lmde (voir le dossier)
La réunion
Santé des étudiants
Audition de Mm. Laurent Gerbaud président de l'association des directeurs des services de santé universitaire christophe tzourio professeur d'épidémiologie directeur du centre inserm u 1219 bordeaux investigateur principal de l'étude i-share vincent beaugrand directeur général de la fondation santé des étudiants de france pierre-edouard magnan président du réseau national des mutuelles étudiantes de proximité emevia et abdoulaye diarra président de la mutuelle des étudiants lmde

Les deux tables rondes d'aujourd'hui sont dédiées à la santé des étudiants. Ce sujet, qui sera abordé ce matin dans une perspective globale, a suscité un intérêt très fort.
Je précise que cette audition fait l'objet d'un enregistrement vidéo, qui sera disponible sur le site du Sénat.
Je rappelle que le Sénat a mis en place cette mission d'information, dont Laurent Lafon est le rapporteur, à l'initiative du groupe Union centriste. Les objectifs sont triples : dresser un état des lieux des conséquences de la crise sanitaire, qui se poursuit, sur les conditions de vie des étudiants ; réfléchir aux moyens de faire face à une crise future, en adaptant éventuellement des mesures qui ont montré leur efficacité ; enfin, parvenir à une compréhension systémique des difficultés de la prise en charge des étudiants par les acteurs publics ou privés.
Nous avons déjà entendu, dans le cadre des travaux de cette mission, de nombreux intervenants institutionnels, à commencer par la Commission Vie étudiante de la Conférence des présidents d'université (CPU), le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous), l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE) et des associations étudiantes qui nous ont remonté un certain nombre de témoignages ayant montré la pertinence de la problématique d'aujourd'hui.
Nous recevons ce matin : M. Laurent Gerbaud, président de l'Association des directeurs des services de santé universitaire, qui ont été très sollicités depuis le début de la crise ; M. Christophe Tzourio, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Bordeaux, principal investigateur de l'étude i-Share, destinée à étudier la santé d'une importante cohorte d'étudiants, notamment les déterminants précoces des maladies courantes qui surviennent plus tard dans la vie ; M. Vincent Beaugrand, directeur général de la Fondation Santé des étudiants de France, structure fondée en 1923 qui propose aux étudiants différents lieux d'accueil et d'accompagnement, dont les services sont extrêmement sollicités et continueront à l'être en raison du caractère chronique et des suites parfois très graves de la covid-19 ; M. Pierre-Edouard Magnan, président d'EmeVia, réseau qui rassemble onze mutuelles étudiantes ; enfin, M. Abdoulaye Diarra, président de La Mutuelle des étudiants (LMDE).
EmeVia et LMDE procèdent chaque année depuis 1999 à une enquête sur l'état de santé des étudiants. Ces données nous intéressent particulièrement.
Cette réunion est organisée en deux séquences : la première portera sur le bilan de l'état de santé des étudiants tel qu'il résulte des interventions de terrain ; au cours d'un second tour de table, vous serez invités à commenter les effets de la crise sanitaire sur la santé des étudiants et à formuler des préconisations afin d'en tirer des enseignements pour l'avenir.

Nous attendons beaucoup de cette table ronde, car la problématique de la santé a particulièrement émergé ces derniers mois avec la crise sanitaire. Nous avons besoin de bien cerner l'état de santé des étudiants et les éventuels phénomènes discriminants au sein des catégories très diverses d'étudiants, puis d'identifier les difficultés plus spécifiques aux étudiants. Nous avons aussi besoin de savoir si les organisations mises en place sont efficaces et si des améliorations peuvent y être apportées. Quel est votre point de vue sur les services de santé universitaire, dont le rôle est central au sein des établissements, et sur les passerelles visant à orienter les étudiants vers la médecine de ville ou la médecine hospitalière ? Enfin, la disparition du régime de sécurité sociale des étudiants est intervenue en 2019. Quels en sont les effets, positifs ou négatifs, pour l'organisation des services de santé, et, surtout, pour la couverture sociale des étudiants ?
Compte tenu du délai qui m'est imparti, je laisserai à Christophe Tzourio le soin d'exposer le constat épidémiologique à partir de l'étude i-Share et des enquêtes des mutuelles étudiantes. J'axerai mon propos sur la description du paysage des services de santé universitaire.
Premièrement, quels que soient les indicateurs, un quart, un tiers, voire la moitié des étudiants ont affirmé ne pas aller bien. Leur situation est certes meilleure que celle des apprentis ou des jeunes travailleurs, mais ils sont nombreux à connaître d'importantes difficultés liées à une fragilisation sociale et à la précarité étudiante. Le problème dure depuis longtemps, et la crise l'a simplement amplifié.
Deuxièmement, le périmètre des services de santé universitaire, en termes de moyens et de locaux, est inchangé depuis une quarantaine d'années, tandis que le nombre d'étudiants a augmenté. Ces services sont extrêmement sous-dotés, ne répondent pas à toutes les catégories d'étudiants et leurs actions présentent une grande hétérogénéité. Je réunirai tous ces chiffres dans un rapport écrit, mais une enquête publiée le 6 octobre 2020 par le ministère de l'enseignement supérieur et la Conférence des présidents d'université décrit les facteurs, historiques et matériels comme l'instabilité des postes de médecins-directeurs, qui sont à l'origine de cette situation.
Les services de santé universitaire sont avant tout conçus pour les étudiants d'université, qui représentent environ 60 % de l'ensemble des étudiants inscrits en formation post-baccalauréat. Les ingénieurs et élèves des grandes écoles ou qui relèvent du ministère de l'agriculture ou de la culture peuvent avoir accès à un service de santé universitaire si une convention a été conclue avec un pôle régional d'enseignement supérieur ou un établissement public expérimental d'enseignement supérieur. Ils peuvent parfois bénéficier de services en interne, ou alors être totalement dépourvus de toute offre de soins spécifique. Le même problème se pose pour les étudiants en BTS, qui ne relèvent pas obligatoirement de la santé scolaire et sont dépendants des éventuelles conventions conclues avec les universités.
Troisièmement, les antennes universitaires comptant peu d'étudiants ne disposent pas toujours d'un service de santé universitaire, qui se limite alors à la présence d'une infirmière à temps partiel.
Selon le rapport de l'Observatoire national de la vie étudiante, sur les 60 % d'étudiants à l'université, seulement 27 % fréquenteront un service de santé universitaire. Cela doit être mis en parallèle avec le fait que les services de santé universitaire se trouvent actuellement totalement débordés du 10 septembre à la fin du mois d'avril. L'offre est évidemment insuffisante, mais il n'est aucunement question que ces services détiennent le monopole de la santé des étudiants. À supposer que l'offre en médecine soit suffisante - c'est toujours là où elle est défaillante que les services de santé universitaire ne parviennent pas à se développer -, elle est alors confrontée à un travail considérable pour intégrer des étudiants souffrant de maladies chroniques, d'affections psychologiques ou d'un handicap. On constate d'ailleurs une forte augmentation, au cours des dix dernières années, du nombre d'étudiants handicapés, grâce à l'amélioration de l'éducation inclusive.
Je prendrai l'exemple de la santé mentale. D'autres offres, les bureaux d'aide psychologique universitaire (BAPU), sont venues compléter les services de santé universitaire. Ils y sont parfois intégrés, comme à Toulon ou à Clermont-Ferrand et bientôt à Lyon, mais leurs moyens n'ont pas été beaucoup renforcés depuis la fin des années 1960, avec une réduction du nombre de lits ou de la capacité d'ouverture des centres médico-psychologiques et des maisons des adolescents. Les réseaux sont de plus en plus saturés.
Concernant les étudiants étrangers primo-arrivants, nous avons subi de plein fouet les conséquences de l'adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui a supprimé l'obligation de visite médicale pour ces étudiants. Outre le rattrapage de vaccins, cette visite favorisait l'entrée rapide dans notre système de santé et d'assurance sociale. Nous avons dû gérer en urgence des demandes de couverture maladie universelle (CMU), d'aide à la complémentaire santé (ACS), jusqu'à la saturation des assistantes sociales des SSU ou des Crous.
Les services de santé universitaire se sont fortement adaptés au moment de la crise. Lors du premier confinement, ils ont tous maintenu leur activité, avec 89 % de l'activité en téléconsultation. Ils ont ensuite augmenté leur offre de soins de psychologues qui est passée à 156 % lorsqu'ils ne se sont pas heurtés à des refus liés à la maîtrise de la masse salariale, à des salaires trop faibles, ou encore à des manques de locaux. Mais dans certains cas, la présence du malade est indispensable, même en psychologie.
Les services de santé se sont donc beaucoup impliqués pour le traçage des étudiants. Ils ont développé un partenariat étroit avec les Crous pour qu'ils soient logés dans de bonnes conditions et ont participé au portage de repas, notamment aux étudiants handicapés, lors de la fermeture des restaurants universitaires.
Pour autant, la situation ne permet pas de répondre à tous les besoins, tant s'en faut. Les réseaux de prise en charge ambulatoire sont eux-mêmes saturés, et les étudiants, qui se trouvent souvent loin de chez eux durant de nombreux mois, connaissent des difficultés pour trouver un nouveau médecin traitant.
Pour conclure, la mise en place des 80 équivalents temps plein (ETP) de psychologues a souffert du décalage entre le temps administratif et le temps clinique. Quant à l'obtention du « chèque d'accompagnement psychologique », elle a été entravée, car les numéros des psychologues dans le répertoire Adeli sont faux à 40 % !
professeur d'épidémiologie, directeur du centre Inserm U 1219 (Bordeaux), investigateur principal de l'étude i-Share. - Je vous remercie de votre invitation à laquelle je regrette de ne pas avoir pu me rendre en présentiel. Je vous enverrai à l'issue de la table ronde les réponses écrites au questionnaire que vous m'avez adressé.
Quel est l'état de santé des étudiants ? On n'en sait rien, et cette première constatation sans nuances est déroutante pour un épidémiologiste comme moi. C'est la raison pour laquelle nous avons obtenu un financement au titre des programmes d'investissement d'avenir à l'issue d'un processus de sélection internationale très rigoureux. Lors d'une cérémonie au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée autour des projets « Cohortes » qui avaient été retenus - une dizaine -, la ministre Valérie Pécresse s'est réjouie de pouvoir « enfin » connaître l'état de santé des étudiants ! Il est vrai que des enquêtes sont réalisées par les mutuelles ou par l'Observatoire de la vie étudiante ; néanmoins, les taux de participation sont souvent faibles, ce qui biaise les renseignements recueillis. I-Share n'échappe pas à la règle, avec un taux de participation de 30 %. Pour pouvoir donner des chiffres qui ne soient pas trop éloignés de la réalité, nous procédons, comme d'autres institutions, à un redressement d'échantillonnage.
Nous sommes tous victimes de l'idée bien ancrée selon laquelle, à vingt ans, on n'a pas de problèmes de santé. On a la vie devant soi... Ce n'est pas exact, car à cet âge, les problèmes de santé mentale sont très fréquents et évoluent dans le temps. Nos jeunes sont soumis à de très fortes pressions qui aboutissent à des troubles du sommeil, du stress ou, pour certains, des symptômes dépressifs. C'est aussi, avec l'éloignement du cocon familial, le début des addictions, qui servent parfois au lâcher-prise : binge drinking, consommation de cannabis ou de benzodiazépines - 20 % des étudiants en consomment régulièrement, ce qui explique en partie la surconsommation de ces produits dans la population française par rapport au reste du monde. C'est à cet âge qu'apparaissent les maladies psychiatriques, indépendamment du mal-être psychique, qui est courant. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, après les accidents de la circulation. Mais c'est aussi à cet âge que se mettent en place de nouvelles représentations sur le capital santé et le bien-être. Cette période est donc une occasion formidable pour la prévention et la promotion de la santé. Près de 20 % des étudiants affirment qu'ils sont en mauvaise santé, alors que la majorité d'entre eux n'ont pas de réel problème physique.
Étant également directeur scientifique du service de santé universitaire (SSU) à Bordeaux, je confirme la fragilité des SSU, avec une trop grande hétérogénéité et des services de prévention uniquement, qui ne proposent pas de soins.
La prévention est, bien sûr, un sujet important, surtout à un âge aussi décisif pour la promotion des comportements de santé. Elle permet de diminuer de façon considérable le recours aux soins. Les SSU sont des lieux intéressants pour cela, ils symbolisent la santé au niveau des campus. Les étudiants peuvent s'y rendre, avoir accès à des soins ou des certificats, et un dialogue peut s'instaurer avec le personnel sur les questions de promotion de la santé et de prévention.
La Fondation santé des étudiants de France a été créée en 1923 pour permettre à de jeunes étudiants de suivre leurs études quand ils étaient atteints de tuberculose. Naturellement, de nos jours l'offre a radicalement changé. Aujourd'hui, nous avons 13 établissements de santé, auxquels s'ajoutent 13 structures ambulatoires, prenant en charge les adolescents et les jeunes adultes. Nous intervenons en complément des acteurs universitaires et sanitaires.
L'offre de soins à l'attention des étudiants apparaît complexe, peu lisible et atomisée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat. Certains facteurs sont liés aux jeunes eux-mêmes, avec une méconnaissance globale des problématiques de santé et, par exemple, comme dans une part importante de la population, une attitude de déni et une stigmatisation des soins psychiques. On observe également chez les jeunes une méconnaissance des structures de soins, et l'on retrouve des freins classiques liés à la question du coût, induisant des renoncements aux soins importants.
Il existe aussi des facteurs liés à l'offre, comme en témoignent le décalage entre les besoins et les moyens dans les SSU, ainsi que des difficultés rencontrées par les jeunes pour trouver un médecin traitant.
La sectorisation de la psychiatrie ne correspond pas aux besoins des étudiants, notamment quand le lieu de leur faculté diffère de leur domicile. Les structures intersectorielles comme les nôtres, qui interviennent dans la prise en charge de la santé mentale, sont saturées.
La « pair-aidance » est un outil très puissant, qui lui aussi nécessite des moyens ; il faut recruter des étudiants relais et ensuite les former, les accompagner, les superviser.
Je déplore le manque de lisibilité, l'isolement de certaines structures, ainsi que le lien compliqué entre deux mondes séparés - le monde universitaire et celui du soin. À l'enjeu du parcours de santé, important pour tous des Français, s'ajoute chez les étudiants le passage de l'enfance à l'âge adulte, avec des segmentations dans les prises en charge.
Tout cela rend l'accès aux soins difficile et inégalitaire. Le facteur social compte beaucoup, comme toujours lorsqu'il est question de santé, et plus particulièrement dans le cas des étudiants, touchés par une précarité importante. Cela provoque des retards de diagnostic, des chronicisations de pathologies pourtant évitables, des plongées dans les addictions, des risques suicidaires.
Investir en direction des jeunes, c'est la garantie d'un retour massif sur investissement pour notre système de santé. En intervenant tôt, on peut « changer le sillon ». Un problème de santé non traité peut avoir des conséquences graves, et la question de l'investissement à ces moments de la vie me paraît décisive.
La plupart des étudiants ne se perçoivent pas comme étant en mauvaise santé. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas de problèmes sanitaires et, si l'on ne traite pas ces problèmes à temps, surtout à un âge aussi crucial, les conséquences peuvent être lourdes et s'inscrire dans la durée.
La prévention et l'éducation à la santé sont des points essentiels. Dans ce domaine, la notion d'investissement est très importante. Je m'associe à tout ce qui a pu être dit concernant la santé mentale. Autre sujet important, lié lui aussi à la santé mentale : la question de la nutrition et des comportements alimentaires, avec beaucoup d'étudiants qui sautent des repas ou s'alimentent mal, en raison de problèmes psychiques ou à cause de la précarité.
J'alerte également sur le niveau de renoncement aux soins. D'après nos études, un tiers des étudiants déclarent renoncer à des soins. Au-delà des raisons économiques, la problématique de l'accessibilité et le manque d'information sont des facteurs importants. La situation se dégrade dans certains domaines ; en gynécologie, par exemple, plus d'un tiers des étudiantes ne consultent jamais.
Pour compléter sur un point qui concerne le secteur mutualiste, le reversement des étudiants dans le régime général a eu des conséquences négatives. Cela a provoqué une chute du taux de couverture complémentaire des étudiants - de 85 % à 65 % selon nos enquêtes -, avec des impacts dans l'accès aux soins. Cela a rendu plus délicate une partie des actions de prévention menée par nous - les mutuelles étudiantes - dans les universités et les lycées, et entraîné la disparition d'un interlocuteur dédié pour les étudiants.
La LMDE assure des étudiants et mène de nombreuses actions de santé ; nous avons été, par exemple, la première mutuelle à rembourser les protections périodiques des étudiantes.
La perception de la santé des étudiants est biaisée, car on la compare à des standards valables pour des personnes de 60 ou 70 ans. On ne tient pas compte des problématiques spécifiques liées au temps des études. Ce qui ressort beaucoup en ce moment, c'est le stress à l'approche des examens, après avoir suivi des cours à distance pendant six mois.
Nous avions des acteurs spécialisés et, avec la fin du régime étudiant de sécurité sociale, ces acteurs ont été écartés des établissements universitaires. Ils n'ont pas été remplacés dans l'accompagnement des étudiants. Désormais, les questions de santé passent à la trappe et, à la fin des années d'études, on observe une hausse de la consommation de santé, liée à un rattrapage de plusieurs années de non-recours aux soins.
Les problématiques de santé sont très différentes au sein de la population étudiante. Je souhaite évoquer le cas de l'étudiant « primo-entrant », qui a changé de ville et n'a eu, depuis six mois, aucun contact social. On a souvent une vision très parcellaire de la santé, alors que celle-ci concerne le bien-être à la fois physique, mental et social.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à une problématique particulière, avec des étudiants en master qui ont validé leur année, sont amenés à poursuivre leurs études pour ne pas se retrouver au chômage et se trouvent en situation de détresse. Beaucoup de ces étudiants, qui subissent une forte pression sociale, font la queue devant les banques alimentaires.

Je vous propose que notre temps d'échanges intervienne à l'issue du second tour de table. Je redonne donc la parole à nos intervenants, en leur demandant de nous éclairer sur la situation actuelle telle qu'ils l'éprouvent sur le terrain.
On ne bâtit pas sa maison sur du sable. Il faut vraiment se poser la question du non-investissement dans les SSU et les services Université-handicap. Ces services ont poussé leur adaptabilité au maximum, ils ne peuvent pas aller plus loin. La reconstruction des SSU doit se faire en lien avec l'ensemble des acteurs concernés par la santé des étudiants, c'est-à-dire les mutuelles étudiantes, mais aussi tous ceux qui contribuent à la sociabilité des universités, en incluant le sport et la culture.
Il faut avoir une vraie politique de santé des étudiants, en tenant compte de l'évolution des pratiques et des moyens. On a besoin de mieux connaître les pratiques et de développer massivement le dispositif des étudiants « relais-santé » qui doit être coordonné en fonction des objectifs de prévention.
La crise a des effets considérables sur la santé mentale des jeunes adultes. À cet âge, en pleine construction du cerveau social, il est essentiel d'être en contact avec ses pairs. Il y a une grande cruauté à leur interdire de se rencontrer. Le problème, en tout cas, n'a pas été appréhendé.
Un autre problème important concerne les ressources financières. Selon l'étude i-Share, 40 % des étudiants exercent de petits boulots au cours de l'été ou durant l'année pour agrémenter leur quotidien. Ceci n'étant plus possible, beaucoup ont connu une baisse brutale de leurs moyens, rencontrant par exemple des difficultés pour payer leur chambre au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous).
Je ne comprends pas pourquoi des fonds n'ont pas été débloqués en urgence, au moins durant le temps de la pandémie, afin de permettre aux étudiants de vivre dans des conditions décentes. Il n'est pas trop tard, cela peut encore se faire.
Les SSU se sont réorganisés à toute allure, avec la mise en place de téléconsultations pour le traitement des problèmes de santé mentale et pour l'organisation, complexe, du dépistage. Les équipes travaillaient déjà beaucoup, cela crée beaucoup de tensions.
Les SSU sont découplés du système de santé, et la crise a rendu visible cette séparation. On a vu un certain nombre d'agences régionales de santé (ARS) donner des injonctions aux SSU sans bien les connaître. Dans beaucoup d'universités, cela s'est mal passé, avec des attentes et des demandes irréalistes. On doit réfléchir à une meilleure articulation, peut-être une gouvernance commune ; le ministère de la santé doit peut-être également apporter une contribution financière aux SSU.
De manière générale, la société n'a pas suffisamment prêté attention aux étudiants. Ils risquent de se révolter, par exemple en organisant des fêtes comme le carnaval à Marseille, dans lequel j'ai vu une sorte de geste politique.

En tant que spécialiste de l'Antiquité, plutôt que de carnaval, je parlerai de Saturnales, quand les esclaves, pendant une journée, devenaient des maîtres...
Avec la crise, nous avons encore franchi une étape concernant la santé mentale. Dans nos établissements, arrivent massivement de jeunes victimes de troubles alimentaires, du type anorexie ou boulimie. Il ne faut pas oublier non plus les problèmes somatiques ; je pense à l'obésité, à l'hygiène bucco-dentaire, à des pathologies chroniques comme l'eczéma, l'asthme ou le diabète, aux problèmes de sommeil et d'addictions, à des sevrages plus difficiles, à des prises de risques sur le plan sexuel.
Tant que l'on ne rouvre pas les facultés, la situation restera compliquée. La précarisation des étudiants, avec des inégalités qui se creusent, est aussi un sujet de préoccupation.
Il s'agit également d'investir dans les nombreux dispositifs évoqués, en mettant l'accent sur le repérage précoce, en développant la pair-aidance et, au-delà des SSU, en donnant des moyens aux professionnels des universités - les Crous, les professeurs, les formateurs pour les premiers secours de santé mentale...
Je n'oublie pas la prise en charge du soin. Le risque aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, consiste à effectuer des repérages précoces sans être capable ensuite d'assurer la prise en charge. Pour cela, il faut des organisations adaptées.
Dernier point important : mieux articuler les dispositifs. Il faut rendre visible cette offre de soins pour les étudiants. Le lien entre la faculté, la ville et l'hôpital est aussi un enjeu de santé publique. Il y a une trop grande segmentation entre les acteurs institutionnels, avec les SSU, d'un côté, le ministère de la santé et les ARS, de l'autre, qui interviennent de manière non-coordonnée.
En conclusion, je souhaite insister sur la santé mentale. Nos professionnels sont de plus en plus inquiets. On atteint un tel niveau de saturation que beaucoup de prises en charge ne pourront pas être assurées. Cette question va être importante dans les prochains mois et aussi à plus long terme. Pour y répondre, il faudra sortir des modes d'organisation actuels, repenser les prises en charge, être capable d'offrir une offre graduée et organisée face à l'afflux.
Il faut le redire : la question des moyens, notamment humains, pour accueillir, soigner et éduquer à la santé les étudiants est primordiale.
Au prétexte qu'ils sont jeunes et seraient, par conséquent, en bonne santé, les étudiants et les jeunes en général sont souvent la cinquième roue du carrosse des politiques de santé publique. À ce propos, je ne supporte plus d'entendre dans les discours publics que les jeunes sont « irresponsables » et qu'ils « tuent des vieux ». La jeunesse n'est pas un problème, elle est une chance !
Pour agir, il est nécessaire de rassembler les acteurs et de réfléchir à de nouvelles articulations. Il est indispensable de redonner aux étudiants des interlocuteurs qui les connaissent. C'était le rôle des mutuelles étudiantes ; des choses se font encore sur le terrain, mais nous avons perdu cette accessibilité aux lieux d'enseignement supérieur, cette sorte de label. Dans la délégation du régime étudiant, des missions étaient dédiées à la prévention, à l'éducation à la santé ; tout cela a disparu. Il convient de rétablir un réseau de proximité par et pour les étudiants.
De plus en plus, les problématiques de santé des étudiants correspondent à celles de la jeunesse, étant entendu que la jeunesse ne sépare pas les étudiants et les salariés d'une entreprise. On pourrait également évoquer le cas de ces jeunes gens qui ne sont pas au chômage, comme on peut l'entendre, mais cherchent leur premier emploi ; ou encore, le cas de ces jeunes travailleurs indépendants qui se trouvent à l'écart des circuits d'accompagnement propres au salariat.
Peut-être est-ce aujourd'hui l'occasion de réfléchir à un régime de sécurité sociale dédié aux jeunes. Quand je parle de régime, je n'entends pas la jeunesse comme un risque, au même titre que la vieillesse ou les accidents du travail ; mais la jeunesse correspond à une période de la vie avec des problématiques sanitaires et des modalités d'intervention spécifiques ; c'est à cette période que l'investissement doit être le plus conséquent.
Le covid-19 est perçu comme un tsunami, avec, ensuite, un temps nécessaire à la reconstruction. En s'en tenant à la seule santé mentale, après avoir enfermé les jeunes aussi longtemps, la réparation prendra des années. Pendant cette période, les causes de stress et de souffrance des étudiants ont été multiples et risquent de se prolonger dans le temps. On a notamment fait peser sur les jeunes la santé de leurs parents. À cela s'ajoutent l'inquiétude liée aux examens, l'appréhension de l'insertion professionnelle et aussi la question écologique.
Si l'on ne réfléchit pas globalement au parcours de soins des jeunes, on ne pourra pas s'en sortir, car la problématique est trop large. Il faut prendre conscience de l'ampleur des difficultés. Pour la première fois, nous avons été submergés par les demandes des étudiants. Nous avons, par exemple, mis à disposition des psychologues gratuitement ; en moins d'une semaine, nous sommes arrivés à saturation.
Il s'agit enfin de revoir certains dispositifs ; je pense, par exemple, au « chèque santé mentale ». Ce dispositif ne fonctionne pas, avec seulement 754 psychologues à disposition des étudiants sur l'ensemble du territoire, soit 1 % de l'offre en France. On a besoin de réfléchir de façon coordonnée en vue d'une action globale.

Un SSU, dans une université, cela correspond à combien de médecins, d'infirmières, de psychologues ?
Entre un enseignement supérieur de masse, du type université, et un enseignement supérieur de plus petite taille, du type institut universitaire de technologie (IUT) ou grandes écoles, constatez-vous des différences du point de vue de la santé ?
Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de faire travailler les acteurs ensemble. Peut-on parler d'une spécificité étudiante, ou de problématiques liées à la jeunesse en général ? J'ai le sentiment que le sujet de la santé des jeunes doit être pris en charge en amont de l'entrée dans l'enseignement supérieur...

Il nous manque des chiffres pour bien comprendre les différences entre les structures.
Que pensez-vous des réponses apportées par le Gouvernement dans vos domaines ? Et qu'auriez-vous proposé à sa place ?

Vous avez abordé la question des étrangers primo-arrivants, avec des spécificités de santé et dans l'accès à l'offre de soins. Certains étudiants originaires d'outre-mer sont confrontés à des problématiques similaires ; je pense aux étudiants de Polynésie qui arrivent dans l'hexagone avec des problèmes d'accès aux mutuelles. Plus globalement, par rapport à ces publics particuliers, peut-on imaginer des actions spécifiques ?
Qu'en est-il de la santé des étudiants effectuant des études de santé ? On pourrait penser qu'ils sont épargnés par tous les maux que vous avez décrits ; mais d'après ce que j'en sais, la situation est parfois pire pour eux.

Je vous remercie d'avoir évoqué les problèmes gynécologiques. Ma première question concerne les avortements de jeunes filles. J'avais voté, avec plusieurs collègues, l'allongement du délai légal d'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) de 12 à 14 semaines de grossesse. Auriez-vous des chiffres précis à nous communiquer sur le sujet ?
Récemment, dans une école d'architecture, un collectif de 90 étudiants s'est créé après le suicide d'un de leurs camarades ; une enquête est en cours. De manière générale, les SSU sont-ils sollicités lors de telles enquêtes pour apporter des précisions sur le contexte pédagogique ?
Sur la question des moyens, pour donner une idée, on recense un équivalent temps plein (ETP) de médecin pour 15 800 étudiants, une psychologue pour 29 000 étudiants et une infirmière pour 10 000 étudiants.
Je souscris à l'idée d'une prise en charge spécifique des jeunes.
Concernant l'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie est un bon exemple, avec un fort accompagnement. Nous avons, en effet, constaté des problèmes de déracinement spécifiques à ces étudiants, notamment ceux en provenance de Mayotte ou de la Polynésie.
Deux points me semblent importants : garder les universités ouvertes et renforcer les aides sociales.
L'essentiel de la gynécologie est aujourd'hui assuré par des médecins généralistes. Par rapport aux besoins des étudiants, cela peut convenir.
Nous avons pris en charge des IVG sans constater d'augmentation de la demande étudiante. Pour information, certaines de ces étudiantes ont reçu une amende de 135 euros alors qu'elles n'avaient pas osé dire aux forces de police qu'il s'agissait d'une IVG.
Enfin, concernant les suicides, si l'acte ne se produit pas dans les locaux du Crous ou si l'université ne nous le signale pas, nous n'avons malheureusement aucun lien avec les services de prise en charge.
La plupart des étudiants ne sont pas actuellement sur les campus. Si le suicide n'est pas commis sur le campus, on n'en entend pas parler et on ne peut même pas le comptabiliser.
De même, concernant les avortements, à part les étudiantes qui viennent dans les SSU pour ces questions, on ne sait pas ce qui se passe actuellement. Voilà typiquement le genre de question que l'on pourrait aborder dans un dispositif longitudinal tel que la cohorte i-Share. Or, le financement de cette cohorte a été suspendu.
Il fallait et il faudrait rouvrir les universités, qui ne doivent pas être, une nouvelle fois, la dernière roue du carrosse. Il s'agit de donner aux étudiants un calendrier très clair, avec des conditions d'ouverture. Certes, le virus circule parmi les jeunes, mais les études épidémiologiques montrent l'absence de contagion des étudiants à l'université. Les règles, à l'intérieur des campus, sont bien respectées. Se pose la question de la contamination dans les transports en commun ; le président de la région Nouvelle-Aquitaine a proposé de mettre des cars à disposition : on peut donc trouver des solutions.
La crise qui secoue le système de santé et les services universitaires a révélé aux yeux de tous des problèmes structurels que les acteurs de terrain n'ignorent pas. Cette crise doit être une opportunité pour agir. Je pense, notamment, aux aspects liés à la prévention et à la promotion de la santé qui doivent être évalués.
Je ne suis pas complètement pessimiste concernant la santé des étudiants. Mais il faut garder un lien avec eux et leur redonner des perspectives.
Je suis convaincu de la nécessité d'une approche « jeunesse ». Notre prise en charge, par exemple, concerne les adolescents et les jeunes adultes, entre 15 et 25 ans donc. L'enjeu, c'est le continuum sanitaire entre l'école, la faculté et le monde du travail, qui est difficile à obtenir.
La recherche sur les adolescents et les jeunes adultes, très porteuse en Amérique du Nord, est encore à développer en France. Parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) de pédiatrie, on trouve peu de pédiatres s'occupant des adolescents. La segmentation entre la psychiatrie et la pédopsychiatrie est également un problème. Il n'y a pas d'interface avec l'adolescent et le jeune adulte.
Concernant la différence entre les universités et les écoles de plus petite taille, les moyens sont différents en fonction des politiques sanitaires mises en place par les écoles.
Cela dépend souvent d'événements ponctuels : une soirée qui finit mal, avec un jeune qui meurt alcoolisé, et d'un coup, on fait des politiques de prévention des addictions ! Les jeunes en études de santé subissent une forte pression, et peuvent être victimes de harcèlement, y compris sexuel, autant voire plus que les autres.
On sait que le recrutement d'une classe de BTS est géographiquement beaucoup plus restreint que celui d'une grande université ou d'une grande école. L'impact positif de l'entourage familial joue sur la prise en charge : le médecin de famille peut continuer de suivre le jeune.
J'ai beaucoup insisté sur la prévention et l'éducation à la santé. Certains établissements sont d'ailleurs très actifs sur le sujet. La question sanitaire concerne tous les jeunes, et pas seulement les étudiants. Il faut intervenir dès le lycée. Les étudiants en santé ressemblent à ce qu'ils seront plus tard, c'est-à-dire aux médecins. Et l'on sait que, comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, les médecins ne sont pas bien soignés, pour de nombreuses raisons. Des mutuelles ont étudié le sujet. Aller consulter un potentiel futur confrère est peut-être plus compliqué. En tous cas, ce n'est pas parce qu'on étudie la santé qu'on la possède ! Paradoxalement, c'est peut-être un endroit où il conviendrait d'intervenir fortement. De plus, dans ces études, le niveau de pression et de stress est considérable.
Vous nous interrogez sur les réponses du Gouvernement. Je ne suis pas encore Président de la République ! La situation est très compliquée à gérer. Le Gouvernement a estimé que les jeunes étaient plutôt en meilleure santé que les autres et qu'il y avait moins besoin d'intervenir. Sur la santé mentale, on voit que la situation se détériore dans l'ensemble de la population. Mais chez les jeunes, cela n'a pas été perçu, au début. Même si l'étudiant est « un jeune travailleur intellectuel », il n'est pas vu comme un travailleur, ni comme un producteur économique. Or les politiques publiques ont été ciblées sur le secteur purement économique. Quant aux étudiants, on s'est dit : « ils ne vont pas nous casser les pieds, ils vont étudier chez eux au lieu d'aller à la Fac, ce n'était pas bien grave ! ». C'était évidemment une erreur, et la réouverture des lieux d'enseignement supérieur est une priorité majeure, sous peine de briser une génération. Pensez à l'élève de terminale qui a passé son bac en juin 2020 et qui achève le deuxième tiers de sa première année d'enseignement supérieur : il part dans la vie avec un handicap massif dans son parcours de formation, son apprentissage de la santé et sa vie de citoyen, d'acteur économique et, plus généralement, dans sa vie personnelle.
Ce qui caractérise la réponse du Gouvernement, c'est qu'il traite les étudiants comme des enfants, responsables de pas mal de choses. Il y a eu tout un débat public sur le fait que les jeunes se comportaient de manière irresponsable et portaient le virus. Ce débat s'est un peu calmé, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde pouvait l'attraper, même en respectant les gestes barrières. Je note qu'on ne se demande pas pourquoi une ministre a eu le covid-19, alors qu'on a tendance, quand un jeune le contracte, à dire qu'il a dû être irresponsable !
Surtout, les aides apportées montrent bien qu'on refuse d'aider directement les étudiants : elles sont toujours indirectes. Le cas typique est celui des repas au Crous pour un euro, alors qu'on sait très bien que tous les étudiants n'ont pas tous la possibilité d'aller au Crous. Je pense aussi au chèque de santé mentale : il faut que l'étudiant démontre qu'il a besoin d'aller voir un psychologue pour en avoir le droit ! Tout cela pèse très lourd sur le mental des étudiants, car cela donne le sentiment qu'on n'a pas confiance dans la capacité des jeunes à faire leurs propres choix et à parler de leurs propres questions de santé.
Prenons la question du sport, par exemple. Les jeunes sont enfermés dans leur résidence universitaire, ou chez leurs parents, depuis un an et demi. Certains ont la possibilité, par leur bagage culturel ou social, de faire du sport. Mais l'impact est très lourd, sur une génération de jeunes qui n'auront quasiment jamais fait de sport pendant un an et demi. Et ils ne vont pas tout rattraper à la fin de la crise sanitaire ! La question est aussi économique car il s'agit d'un coût non négligeable pour les étudiants : s'inscrire à une salle de sport à distance, par exemple, ou consulter un nutritionniste, cela coûte cher, et il n'y a aucune aide pour cela.
La prévention par les pairs est une idée en vogue. C'est bienvenu, mais cela témoigne d'une lacune. La multiplication des initiatives portées par des associations étudiantes ou des associations de jeunesse sur les questions de santé des jeunes témoigne du fait que les jeunes sont amenés à s'auto-organiser pour essayer de porter des actions sociales. On perçoit de plus en plus les jeunes comme étant les réceptacles de la santé - la fin du régime étudiant de sécurité sociale l'illustre bien - et non des acteurs de leur santé. On ne leur demande pas d'agir sur leur santé, on leur demande de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui va leur expliquer comment leur santé fonctionne. Pourtant, le meilleur moyen de changer ses pratiques de santé, c'est d'en devenir acteur. L'État devrait investir dans tout ce qui permet à des jeunes d'être acteurs de leur santé. D'un point de vue économique, c'est rentable, puisque cela réduit leurs problèmes ultérieurs de santé. Surtout, cela en fait des citoyens, ayant conscience de toutes les problématiques de santé et pouvant faire eux-mêmes leurs propres choix.
Le remboursement par la sécurité sociale des consultations psychologiques pose problème. De nouveaux dispositifs permettent aux jeunes d'aller voir des psychologues et des professionnels de la santé mentale. En fait, le problème concerne l'ensemble de la population. Dès lors, pourquoi cibler les jeunes ? Cela peut leur donner l'impression qu'ils ont des problèmes, alors que ceux-ci relèvent de la vie de la société. Mieux vaudrait étendre ce remboursement à toute la population, pour ne pas donner aux jeunes le sentiment qu'ils sont un poids pour la société.
Oui, il y a une spécificité des jeunes, comportant en son sein une spécificité étudiante : stress des examens, éloignement du milieu familial... La question de la santé des jeunes doit être pensée de façon globale : entre le lycée et l'université, on ne devient pas quelqu'un de totalement différent du jour au lendemain. Les problématiques de santé qu'on observe à l'université commencent par de mauvais comportements au lycée.
Les sujets liés à la taille des établissements dépendent aussi des formations et des pratiques, qui varient. Dans un petit établissement, on a davantage de relations sociales, grâce à la concentration. Et, selon les formations, l'on n'a pas les mêmes moments de pression. Loin de moi les stéréotypes : ce n'est pas parce qu'on est étudiant en sociologie qu'on n'a pas des moments de stress important, par exemple lorsqu'il faut porter un dossier de recherche pour financer ses recherches.

Je ne me risquerai pas à faire une synthèse de tout ce que vous avez dit, mais cette table ronde confirme deux intuitions que nous avions au démarrage de cette mission. D'une part, les problématiques que vous avez très bien identifiées étaient antérieures à la crise de la covid-19, et on observe simplement leur amplification. C'est dire que ces problématiques continueront après la crise... C'est pourquoi nous considérons que les difficultés de la vie étudiante sur le plan de la santé, mais aussi sur les autres aspects, doivent être traitées de manière pérenne et non envisagées comme un phénomène cyclique qui serait lié à la crise. D'autre part, nous sommes très sensibles aux politiques publiques - diagnostic des problématiques spécifiques, mise en place d'organisations et de moyens adaptés, définition d'objectifs clairement identifiés - et j'ai à titre personnel le sentiment qu'en la matière, sur la santé de la jeunesse, on part d'assez loin ! Vous intervenez depuis de nombreuses années sur ce sujet, mais il me semble qu'il y a une page à écrire, en termes de politique publique, sur la question de la santé des jeunes, en tenant compte de la spécificité étudiante.
Oui, il y a une page blanche, nos interventions l'ont constaté. Cela offre une extraordinaire opportunité de mobilisation générale ! La somme des problèmes que nous avons évoqués est considérable. Il faut que le Gouvernement s'en empare et décrète sur ce sujet une mobilisation générale, afin de promouvoir des objectifs globaux de santé durable, avec un continuum entre la prise en charge et tous les aspects de promotion et de prévention, et en intégrant les questions de développement durable, auxquelles les jeunes sont très sensibles. C'est une révolution, et il faut la construire avec les jeunes. Pour cela, il faut savoir leur parler, et aller vers eux. Cette crise nous en donne l'opportunité.