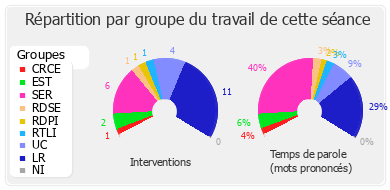Séance en hémicycle du 2 juin 2021 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, sur la reprise et la relance des activités culturelles.
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je vous rappelle que l’auteur de la demande du débat dispose d’un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, le groupe auteur de la demande dispose d’un droit de conclusion pour une durée de cinq minutes.
Dans le débat, la parole est à Mme Sylvie Robert, pour le groupe auteur de la demande.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quelques années après la fin du Second Conflit mondial, Albert Camus écrit : « Sans la culture, et la liberté relative qu’elle suppose, la société, même parfaite, n’est qu’une jungle. C’est pourquoi toute création authentique est un don à l’avenir. »
Ces quatre mots – culture, liberté, création et avenir – composent presque autant un programme pour la réouverture des lieux culturels qu’un récit existentiel et civilisationnel.
Depuis plus d’un an, en effet, à l’exception de rares moments, nous avons expérimenté une vie sans culture vivante.
Certes, le numérique a permis d’apporter une forme d’ersatz culturel, et des choses formidables ont été réalisées. Néanmoins, la preuve est faite aussi qu’il ne peut se substituer à ce qui fonde les arts vivants et, plus globalement, l’acte culturel : ce partage avec les autres est le ressenti, en réalité, d’émotions et de réflexions aussi diverses que diffuses. Ce pouls-là, palpitant, nous a terriblement manqué.
Ainsi, à la gravité de la période que nous venons de traverser, doit désormais répondre une forme non pas d’insoutenable légèreté de l’être, mais de douce légèreté commune.
Il ne s’agit pas tant d’affirmer que rien n’est grave, mais plutôt, puisque tout est grave et que maintenant nous le savons, que nous pouvons aussi penser et nous extraire de cette réalité pour travailler et tendre vers d’autres imaginaires. C’est ce besoin, encore plus vital aujourd’hui, que la culture nous aide, entre autres, à assouvir.
Pour ce faire, et en vue de faciliter et de dynamiser la reprise des activités culturelles, les conditions de réouverture doivent être propices. C’est la raison pour laquelle notre groupe a demandé la tenue de ce débat, pour vous entendre, madame la ministre, et afin que vous puissiez répondre aux questions de mes collègues qui s’en posent encore.
J’en profiterai également pour avancer quelques idées, afin de participer à la réflexion, mais aussi de consolider la relance culturelle, y compris à moyen terme.
L’urgence de garantir un déconfinernent culturel réussi a trait au déploiement de ses modalités. Cela va du pass sanitaire à la cohérence d’ensemble des protocoles mis en œuvre. S’il ne s’agit nullement de reléguer l’impératif sanitaire au second plan, il convient néanmoins de rappeler que l’étude de mars 2021, menée par l’Institut Pasteur, sur les lieux de contamination au SARS-CoV-2, aboutissait à la conclusion que la fréquentation des lieux culturels n’avait pas été associée à un sur-risque d’infection pendant la période où ceux-ci étaient ouverts.
En d’autres termes, s’il est logique qu’ils soient soumis à des protocoles sanitaires, les établissements et les événements culturels n’ont pas à endurer des modalités de réouverture plus drastiques que d’autres lieux aux caractéristiques similaires. Je pense aux critères cumulatifs très lourds pour les festivals – mais cela va peut-être évoluer –, au pass, à la jauge et à la densité. C’est une question de sécurité, d’égalité de traitement, mais aussi d’accessibilité réelle à la culture.
À cet égard, le pass sanitaire, bien qu’il soit temporaire, et mieux cadré par le Sénat, soulève encore de multiples interrogations, et sa mise en œuvre se révélera compliquée et coûteuse.
Je tiens à rendre hommage à l’extrême agilité et pugnacité dont devront faire preuve les organisateurs de festivals et d’autres rencontres, qui ont décidé, et je m’en réjouis, de maintenir leur événement cet été, dans la mesure où ils se jettent, pour partie, dans l’inconnu.
Il faut les accompagner efficacement, par exemple par rapport aux dépenses supplémentaires. À cet égard, une garantie de redémarrage de la part de l’État ne serait-elle pas de nature à les rassurer ? Que pensez-vous, madame la ministre, de cette préconisation de la mission d’information sur les effets des mesures de confinement, dont M. Roger Karoutchi était le rapporteur ?
En plus des difficultés d’organisation, cet accompagnement est naturellement d’ordre financier. Chacun le sait : toutes les structures, les équipes et les artistes auteurs ont été fragilisés. La commission de la culture du Sénat avait alerté sur les pertes considérables que subissaient les différents secteurs culturels.
D’un point de vue quantitatif, le Gouvernement a agi, et il faut le saluer. Des fonds ont été débloqués pour soutenir les acteurs culturels, via des aides transversales et sectorielles. Néanmoins, d’un point de vue qualitatif, quelques points peuvent être soulevés, qui auront peut-être demain des conséquences sur la reprise. En effet, je suis intimement convaincue que la période la plus délicate, qui est devant nous, va révéler la fois les vertus de notre robuste modèle culturel français, mais aussi ses fragilités.
La situation des équipes artistiques est ainsi préoccupante, et les lieux dans le domaine des arts visuels et du spectacle vivant auront une responsabilité majeure, en termes de solidarité, pour les soutenir et les accompagner à un moment où l’embouteillage des projets induira forcément une sélection plus dure. Il me semble, madame la ministre, que la vigilance sur ce sujet devra s’accompagner d’une évaluation de cette situation par les directions régionales des affaires culturelles, les DRAC.
La difficulté à adapter les aides transversales aux spécificités du secteur culturel a été réelle ; je pense aux « trous dans la raquette », aux artistes auteurs et aux établissements publics de coopération culturelle, les EPCC, qui ont pu en être exclus pour des raisons juridiques. Là encore, une analyse fine des situations devra être menée.
Enfin, s’agissant de la problématique récurrente de la déclinaison territoriale des crédits, les lieux intermédiaires et les associations culturelles n’ont pas été suffisamment appuyés, alors que leur ancrage territorial est important.
Si nous nous tournons vers l’avenir, il se révèle indispensable que le soutien à la culture ne s’arrête pas du jour au lendemain. Le prochain PLFR permettra d’aborder cette question. Pour les intermittents, je pense qu’une clause de rendez-vous à l’automne, liée à la prolongation de l’année blanche, peut être nécessaire. Quant au volet sur l’emploi artistique, il devra également faire l’objet d’une évaluation et être amplifié, singulièrement en direction des jeunes artistes.
Les acteurs culturels nous alertent : ils sont heureux de rouvrir, mais n’ont pas pour autant franchi le mur. Ils sont parfois plongés dans un paradoxe, où l’euphorie de la reprise n’apaise aucunement les craintes quant à la pérennité de leur activité. Pour eux, le juge de paix sera 2022, voire 2023.
C’est pourquoi, au regard de l’ampleur de la crise et par souci de visibilité, établir une programmation pluriannuelle pour la culture de 2022 à 2027, sur le modèle de celle qui est prévue pour la recherche, serait peut-être un bon moyen de rassurer les acteurs de la culture. Qu’en pensez-vous, madame la ministre ?
En effet, ce besoin impérieux de visibilité est l’une des grandes leçons de cette crise. La politique de stop and go a été difficile à vivre, d’autant plus que l’anticipation est un facteur décisif ; les équipes sont épuisées.
Afin d’anticiper la rentrée, et quoiqu’il arrive, un plan de maintien des activités culturelles devra être bâti, en lien avec les acteurs culturels, bien sûr, mais aussi en dialogue avec les collectivités. De la même façon, il faudra rapidement anticiper sur les protocoles et préciser ces derniers, pour que les festivals en jauge debout – je pense naturellement aux Rencontres trans musicales, cet hiver, dans mon département – puissent se préparer.
Puisque l’on parle d’anticipation, nous proposerons qu’un plan d’investissement en faveur de l’équipement en ventilation et aération des établissements culturels soit inscrit dans la prochaine loi de finances, en lien avec les fonds de soutien des collectivités déjà à l’œuvre.
En outre, les collectivités territoriales, partenaires naturels des acteurs culturels, sont très heureuses de voir la vie culturelle reprendre sur leur territoire. Elles ont un rôle central à jouer dans la relance culturelle. Les conseils des territoires pour la culture, les CTC, doivent, plus que jamais, jouer un rôle de veille, mais aussi de coordination et d’impulsion pour permettre une véritable territorialisation d’une action publique mieux concertée.
Enfin, la reprise des activités culturelles n’est pas qu’institutionnelle : en France, près d’une personne sur quatre pratique une activité culturelle en amateur. Autant dire que, pour beaucoup de nos concitoyens, le retour à la vie culturelle était attendu. Un certain nombre de points réglementaires, notamment sur les protocoles de divers établissements recevant du public, ou ERP, les empêchent encore de pratiquer. J’espère, madame la ministre, que vous les préciserez très prochainement.
Définitivement, la culture est tout sauf un privilège. Plus que nécessaire, elle nous est essentielle, et c’est peut-être la grande révélation de cette période difficile que nous venons de vivre.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et UC.
Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, depuis le 19 mai dernier, les spectacles, les monuments, les théâtres, les salles de cinéma, les centres et galeries d’art ont rouvert leurs portes au public.
L’amélioration de la situation sanitaire permet de renouer avec ce qui fait l’essence même de la culture : se réunir, se retrouver et échanger. La réouverture se traduit par des retrouvailles, et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cette réouverture tant attendue des lieux de culture se veut toutefois prudente et progressive. Elle est échelonnée en plusieurs phases, d’ici au début du mois de juillet, de manière coordonnée et cohérente avec les autres secteurs jusque-là fermés.
Après la première étape du 19 mai, les contraintes de jauges seront allégées à compter de la semaine prochaine et seront levées pour toutes les salles et, là où le public est assis, à compter du 30 juin. Cette démarche décline le modèle résilient sur lequel le ministère de la culture et les professionnels se sont mobilisés depuis plusieurs mois dans cette perspective. Les prochaines semaines permettront au pays tout entier de vivre la culture.
La réouverture s’amorce bien, avec une offre très diversifiée dans tous les secteurs. Au cinéma, plus de 2 millions d’entrées ont été enregistrées lors de la première semaine de réouverture, soit, malgré la jauge de 35 %, plus du double des entrées réalisées sur la même période en 2020.
Les musées, les expositions et les salles de spectacles ouvertes ont également fait le plein, et le public a été au rendez-vous ; je pense notamment au musée d’Orsay et au Centre Pompidou, qui affichaient complet pour leurs expositions temporaires durant le premier week-end.
Les festivals ont également pu reprendre depuis le 19 mai. C’était le cas des Nuits de Fourvière, à Lyon, hier soir, avec des jauges également réduites et qui évoluent selon les mêmes étapes. Grâce à la vaccination et à l’amélioration de la situation sanitaire, les festivals, si nombreux et si divers, pourront se tenir cet été ; nous devons nous en réjouir.
Je sais que les questions sont encore nombreuses, et, madame la sénatrice Sylvie Robert, vous en avez énuméré un certain nombre, auxquelles je répondrai au cours de notre débat interactif.
Les interrogations sont nombreuses notamment sur les modalités pratiques, et je sais qu’il s’agit d’un vrai sujet de préoccupation pour le Sénat. Je m’attends donc à de nombreuses questions et interpellations dans les prochaines minutes.
La réouverture se fait également dans des conditions maîtrisées de sécurité sanitaire, tant pour le public que pour les artistes, les agents, les techniciens et les salariés des lieux. Les professionnels ont, en effet, tout mis en œuvre, avec l’appui du ministère de la culture, pour que la réouverture, qui repose sur des protocoles rigoureux et toute l’expérience qui a été accumulée lors du premier déconfinement, soit une réussite.
Le public a ainsi pu être accueilli, dès le premier jour, dans les meilleures conditions, grâce à la mobilisation de l’ensemble des personnels des lieux culturels. Je veux vraiment ce soir, devant vous, les remercier. Cette réouverture est également possible dans de bonnes conditions parce que le Gouvernement a mobilisé toutes ses forces pour soutenir la culture et faire en sorte qu’elle reste vivante, forte et que, dans toute sa diversité, elle surmonte cette période si difficile.
Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont quelque 12, 4 milliards d’euros qui ont été mobilisés par l’État en faveur de la culture, pour les structures publiques, les entreprises culturelles, les créateurs, les artistes et les techniciens. Ce chiffre est inégalé dans le monde.
Plus de 8 milliards d’euros d’aides transversales et près de 1, 4 milliard d’euros d’aides sectorielles ont soutenu l’ensemble de la filière du cinéma, de la musique, du théâtre, aidé les festivals et encouragé les captations de spectacles. Enfin, le Gouvernement déploie depuis le mois de janvier les 2 milliards d’euros accordés au titre du plan de relance, qui permettent de soutenir nos opérateurs, de renforcer l’emploi culturel et de moderniser les filières culturelles.
Vous pouvez d’ores et déjà constater, dans vos territoires, la mise en œuvre de ces crédits.
Pour accompagner la réouverture, qui commence par des jauges limitées, un nouveau train de mesures a également été mis en place, avec une enveloppe supplémentaire de 148 millions d’euros pour soutenir les secteurs du cinéma et du spectacle vivant, particulièrement frappés par la crise sanitaire.
À compter du mois de juin, ces entreprises continueront de bénéficier du fonds de solidarité, sous certaines conditions et de manière dégressive, au prorata de leurs pertes de chiffre d’affaires.
Enfin, le dispositif d’activité partielle sera prolongé pour les secteurs prioritaires sans reste à charge pour l’employeur jusqu’à la fin du mois de juin, et même au-delà dans certaines conditions. À partir de juillet, un régime dégressif prendra le relais, pour tenir compte de la reprise progressive d’activité.
Par ailleurs, l’année blanche en faveur des intermittents est prolongée de quatre mois, jusqu’au 31 décembre 2021, avec trois filets de sécurité – j’y reviendrai lors du débat interactif – pour les douze mois suivants : extension de la période d’affiliation au-delà de douze mois, clause de rattrapage et modalités aménagées de l’allocation de professionnalisation et de solidarité. Ces mesures permettront de garantir une indemnisation durant toute l’année 2022, soit seize mois de protection supplémentaire pour les intermittents de la culture.
J’ai également eu l’occasion d’annoncer une enveloppe de 30 millions d’euros pour soutenir directement l’emploi artistique, grâce au renforcement de trois dispositifs qui visent à soutenir l’activité culturelle de proximité, en allégeant le coût de l’emploi artistique pour les employeurs occasionnels.
Les jeunes – vous en parliez, madame la sénatrice, et c’est tellement important ! – qui ont commencé leur carrière dans les professions de la culture et du spectacle pendant la crise sanitaire sont les premiers bénéficiaires des politiques de protection mises en place durant la crise. Ils profitent d’un accompagnement renforcé, avec non seulement le développement de l’apprentissage et un recours plus important au plan « 1 jeune, 1 solution », mais aussi l’abaissement du seuil d’accès au régime d’intermittent pour les primo-accédants de moins de 30 ans.
Cette réouverture est une réussite, mais elle n’est pas une fin en soi. Elle n’a de sens que si nous poursuivons nos politiques d’accès à la culture, principalement centrées sur les jeunes.
C’est ce que nous avons fait au ministère de la culture au cours des derniers mois. Je pense bien évidemment à la généralisation du pass culture, qui permet, depuis le 20 mai dernier, à chaque jeune de 18 ans de bénéficier d’un crédit de 300 euros utilisable vingt-quatre mois pour réserver des spectacles au théâtre ou à l’opéra, pour acheter des places de concert, des instruments de musique ou des livres, pour planifier des visites de musées et d’autres lieux de patrimoine.
Je sais que ce dispositif ne fait pas l’unanimité dans cet hémicycle, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : il y a un incroyable engouement depuis l’annonce de sa généralisation.
Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais vous dire en amont de nos échanges. Cette reprise était très attendue. Nous avons travaillé d’arrache-pied au ministère de la culture, avec l’ensemble des professionnels, pour qu’elle soit solide et pérenne.
Les Français ont été au rendez-vous de cette réouverture, et nous devons, toutes et tous, continuer à faire vivre la culture dans les semaines et les mois à venir.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
Dans le cas où l’auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n’ait pas été dépassé.
Je vous préviens, mes chers collègues, que je serai intraitable sur le respect de votre temps de parole !
Dans le débat interactif, la parole est à Mme Céline Brulin.

Madame la ministre, « non essentiels », voilà comment ont été considérés les acteurs culturels durant de trop longs mois.
La reprise culturelle doit être l’occasion de montrer exactement l’inverse et de redéfinir les objectifs d’une politique culturelle. Le premier d’entre eux, selon nous, doit être l’accès de tous à la culture dans la proximité ; j’insiste sur ce point. Cela veut dire mieux soutenir les lieux à rayonnement régional, mais aussi des lieux et des équipes artistiques divers et à dimension plus locale.
Tous doivent être accompagnés pour mieux aller à la rencontre des publics les plus éloignés de la culture, dont certains se sont encore plus éloignés du fait de la période que nous venons de vivre.
Selon nous, cela passe notamment par une redéfinition de la distribution des subventions : aujourd’hui, par exemple, 85 % des compagnies conventionnées en Normandie n’y vivent pas et ne font pas travailler les artistes normands. Nous attendons un nouvel acte de la décentralisation de la culture vivante.
Les intermittents sont soutenus au travers de l’année blanche et des filets de sécurité que vous venez de rappeler, madame la ministre. Toutefois, il semble que ce qui est donné d’une main est repris de l’autre, avec la réforme de l’assurance chômage et les modifications des annexes 8 et 10, qui les priveraient du bénéfice du régime de l’intermittence s’ils effectuent des heures au régime général.
Enfin, je souhaite insister sur le lien entre lieux culturels, équipes artistiques et établissements scolaires. Ces derniers sont l’une des clés de l’élargissement de l’accès à la culture, mais les financements manquent. Je pense, par exemple, au projet d’orchestre de l’école de la ville d’Eu, dans mon département, qui se trouve menacé faute de financement.
Or, comme chacun le sait ici, des enfants qui dansent, qui jouent, qui peignent, qui chantent, fréquenteront beaucoup plus facilement les lieux culturels en grandissant.
Je veux vraiment répondre à l’accusation récurrente, madame la sénatrice, selon laquelle nous ne considérerions pas la culture comme essentielle.
Ce mot a été prononcé pour définir des commerces journaliers dont nous avons besoin pour assurer notre subsistance ; il n’a jamais été question de dire que la culture n’était pas essentielle. Au demeurant, comme le disait Pierre Reverdy – à moins que ce ne soit saint Paul –, « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ».
Or, ces preuves, nous les avons données : 12, 4 milliards d’euros pour soutenir la culture. Observez ce qu’ont fait les nations comparables : l’Italie, pays ayant mobilisé le plus de crédits après la France, a débloqué un peu plus de 4 milliards d’euros ; l’Allemagne, 2 milliards d’euros ; la Grande-Bretagne, 1, 7 milliard de livres ; l’Espagne, pays tant vanté pour avoir laissé quelques salles ouvertes à Madrid, 800 millions d’euros pour aider ses artistes…
Oui, pour le Gouvernement français, la culture est essentielle. Il en a apporté la preuve en soutenant massivement le secteur culturel, avec ses opérateurs et avec ses directions régionales des affaires culturelles, les DRAC. La crise a montré combien l’organisation territoriale de l’État était importante, et les DRAC ont été au plus près des acteurs de terrain.
J’ai mobilisé les structures de concertation autour des DRAC avec la création des CTC, les conseils des territoires pour la culture, régionaux. Je mène également une politique active de développement des comités régionaux des professions du spectacle, les Coreps ; en effet, beaucoup de régions n’en possèdent pas, alors que ce sont précisément les lieux où les acteurs de la culture et les décideurs locaux peuvent se rencontrer.
En ce qui concerne les intermittents, je ne vous réponds pas tout de suite, car j’ai épuisé mon temps de parole, mais j’y reviendrai à l’occasion d’autres questions.
Sourires.

À compter du 9 juin, les grandes manifestations culturelles se verront appliquer une forme de double peine : pass sanitaire et jauge réduite.
La présentation du pass sanitaire sera exigée pour toute manifestation culturelle accueillant plus de 1 000 personnes. Et un maximum de 5 000 spectateurs devra être respecté, dès lors que ce seuil représente moins de 65 % de la jauge.
Or qui dit « pass sanitaire » dit « contrôles », donc « effectifs et coûts supplémentaires ». Qui dit « jauge » dit « moins de public », donc « moins de recettes ». Et qui dit « plus de coûts et moins de recettes » dit « absence de marge et déficit ».
Aussi, à l’instar de certains restaurants ou cafés qui font le choix de rester fermés, faute d’une surface de terrasse suffisante, cette spirale inflationniste a pu conduire certains organisateurs ou producteurs à annuler ou reporter une représentation, plutôt que de prendre le risque de perdre de l’argent. Nombreux sont les festivals qui, cet été encore, laisseront les artistes dans les loges, les techniciens au chômage et les prestataires à l’agonie.
Pourquoi donc imposer cette double peine ? Pourquoi imposer une jauge pour accueillir des spectateurs qui présentent la preuve qu’ils ne développent pas le virus de la covid-19 ? C’est bretelles et ceinture !
Madame la ministre, quel est l’intérêt de maintenir une jauge pour les événements exigeant un pass sanitaire ? Il semblerait que ce pass, tel qu’il est envisagé, ne soit pas satisfaisant. Prenons l’exemple du festival de Poupet, en Vendée : n’est-il pas dissonant d’imposer ce pass aux spectateurs quand on ne l’exige pas des organisateurs, des techniciens et des bénévoles ?
Madame la sénatrice, je ne puis laisser parler de double peine. La double peine, ce serait celle que nous infligerions aux spectateurs qui n’auraient pas été suffisamment protégés. Nous comprenons tous que plus ils sont nombreux, plus le risque de contamination est important. C’est en cela que je parlais de reprise progressive et cohérente.
Je rappelle qu’il serait illégal d’imposer le pass sanitaire aux agents, que ceux-ci soient salariés ou bénévoles ; c’est une question de droit du travail, et je ne puis donc retenir votre remarque.
Ce pass nous permettra de tenir un agenda de réouverture plus soutenu. Il s’agit d’une solution pragmatique. Comme je l’ai déjà souligné lors de mes auditions en commission, je n’étais pas une fanatique du passeport vaccinal, mais une partisane du pass sanitaire avec des conditions très encadrées. Je crois savoir qu’il a été voté, et c’est une bonne chose. La France est d’ailleurs loin d’être le seul pays à faire ce choix.
Le pass sanitaire sera applicable du 9 juin au 30 septembre, dès que la jauge de billetterie est supérieure à 1 000. Il s’agit d’événements de grande ampleur. Les établissements recevant du public, les ERP, concernés sont donc les chapiteaux, les salles de théâtre ou de spectacle de plus de 1 000 places, les salles de spectacle sportif, les salles de conférence, les salons et foires d’exposition, les festivals debout et assis, notamment en plein air.
Vous connaissez les trois types de preuve qui seront opposables : le test négatif, le certificat de rétablissement et le certificat de vaccination. Ces différentes modalités de présentation de la preuve permettront de garantir l’accessibilité de tous aux activités.
Je compléterai mes propos à l’occasion des questions suivantes.
Sourires.

Mme Annick Billon. À Poupet, comment pourra-t-on réaliser autant de contrôles et de tests, alors que 30 000 billets – donc potentiellement 30 000 tests – ont été vendus ? Que faire si le festivalier qui a acheté son billet depuis plus d’un an ne peut présenter un pass sanitaire ? Qui va payer ?
M. Roger Karoutchi s ’ exclame.

Peut-être faut-il envisager un fonds de compensation pour les remboursements ?

Madame la ministre, , en cette période de reprise – seulement partielle, il est vrai – des activités culturelles, je souhaite vous alerter sur les très grandes difficultés éprouvées par les directrices et directeurs de festivals et par les intermittents qui y travaillent.
Vous avez annoncé, voilà quelques semaines, les conditions de tenue des festivals à compter du 1er juillet prochain : des festivals en configuration debout, en plein air avec une jauge de quatre mètres carrés par festivalier. Ces mesures suscitent des inquiétudes chez les professionnels, qui se demandent comment adapter ces contraintes à la particularité de leurs manifestations.
Certains festivals sont toujours dans l’incertitude quant à la tenue de leur édition de 2021, quand d’autres ont d’ores et déjà dû renoncer, comme le Main Square Festival d’Arras, qui a donné rendez-vous à ses habitués pour une édition 2022.
Même si les acteurs culturels tentent, tant bien que mal, de conserver le lien privilégié tissé avec nos concitoyens, les difficultés sont encore très grandes. Le fonds de compensation billetterie ne peut malheureusement tout résoudre.
C’est en effet tout un écosystème qui est touché, de nombreux commerçants et sous-traitants souffrent. Les difficultés des acteurs culturels, tout comme celles des intermittents du spectacle, vont malheureusement perdurer de longs mois.
Nombre d’intermittents ne partagent pas l’optimisme du Gouvernement : la reprise des activités culturelles depuis le 19 mai, aussi bienvenue soit-elle, est pour bon nombre d’entre eux un leurre. Ils sont en effet un très petit nombre à avoir pu reprendre le travail.
L’annonce du prolongement de l’année blanche jusqu’au 31 décembre 2021 et la mise en place de filets de sécurité pour 2022 n’ont pas rassuré les intermittents, qui craignent une baisse sensible de leurs revenus à partir de janvier 2022.
Comptez-vous mettre en place une indispensable clause de rendez-vous en fonction des évolutions et prendre l’engagement de la plus grande vigilance dans les prochains mois face à la prévisible persistance des difficultés affectant le monde culturel ?
Vous avez raison, madame la sénatrice : ce n’est pas parce que les restrictions ont été levées que tous les événements culturels pourront reprendre.
Les uns et les autres sont soumis à des contraintes différentes. Je viens d’apprendre, par exemple, que mon cher festival de Baugé, en Maine-et-Loire, ne reprendra pas en 2021, parce qu’il collabore habituellement avec de nombreux artistes originaires de Grande-Bretagne, qui ne pourront venir exercer leur art cette année. Il s’agit d’un tout petit festival, en milieu rural, qui doit faire face à de nombreuses contraintes, à des problèmes de répétition… Certains spectacles vivants ne reprendront que le 1er septembre : la saison se terminant en juin, ils ne veulent pas relancer les équipes.
Nous allons accompagner ces transformations et les pertes de billetterie. J’ai annoncé, le 18 février dernier, un fond festival exceptionnel de 30 millions d’euros, dont 20 millions d’euros dédiés à la musique et gérés par le Centre national de la musique, le CNM, et 10 millions mis en œuvre par les DRAC pour les petits festivals et manifestations dans d’autres disciplines artistiques.
Nous aiderons aussi les festivals qui s’adaptent. Je pense, par exemple, aux Vieilles Charrues, en Bretagne, qui se tiendront cette année en mode assis. Cela entraîne bien évidemment une perte de billetterie et des frais supplémentaires.
Grâce à cette enveloppe de 38 millions d’euros mobilisée par la culture, de nouvelles commissions vont être mises en place pour soutenir la reprise des représentations du printemps et de l’été. Nous serons aux côtés de ces structures.
Avec les dispositifs que nous mettons en œuvre – à commencer par les quatre mois supplémentaires qui permettront d’accompagner cette phase de reprise –, les intermittents vont profiter d’une protection spécifique en 2022 que je vous détaillerai dans quelques instants.

Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des propositions que la mission d’information du Sénat sur les effets des mesures en matière de confinement a formulées pour ce qui concerne la réouverture des lieux culturels. Nous vous avions auditionnée et nous sommes à peu près sur la même ligne.
Je suis rarement généreux à l’égard du Gouvernement, mais il faut être un peu raisonné et raisonnable : il est certain que la France a bien plus aidé son secteur culturel que ses voisins
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

… et c’est tant mieux. À certains moments, il faut dire les choses ; je veux bien entendre que blanc c’est gris et gris c’est blanc, mais la vérité est là.
Nous vous le devons en grande partie, madame la ministre, car vous avez obtenu des arbitrages budgétaires plutôt positifs pour le milieu culturel. Je vous en remercie.
Pour ma part, je suis pour le maintien de la jauge et pour le pass sanitaire, tel qu’il a été voté par le Sénat. En effet, il serait insupportable à tous les Français d’affronter une quatrième vague au mois de septembre prochain. Qui l’accepterait ? Prendre des précautions me paraît donc tout à fait normal.
Toutefois, madame la ministre, même si les jauges vont être progressivement allégées, le monde du spectacle vivant craint que la dégressivité des aides ne soit de plus en plus forte et qu’ils ne puissent passer le cap de 2022. Avez-vous obtenu des arbitrages budgétaires favorables à cet égard ?
Mme Roselyne Bachelot, ministre de la culture.Timeo Danaos et dona ferentes – cela dit pour les amateurs des pages roses du Larousse ou d’Astérix…
Sourires.
À chacun ses références ! Je vous remercie, monsieur le sénateur, cher Roger Karoutchi, de vos propos.
Pourquoi les Français ont-ils accepté de voir le secteur culturel être autant aidé, parfois bien davantage que d’autres domaines d’activité ? C’est que les Français y sont attachés, même ceux qui ne le fréquentent pas. Un jeune homme me disait récemment ne jamais aller au théâtre, mais vouloir que les théâtres restent ouverts. Cette phrase peut paraître ridicule, mais elle ne l’est pas : nous vivons dans un pays qui permettra peut-être à ce monsieur, qui n’est jamais allé au théâtre, de s’y rendre un jour. Et c’est extrêmement important.
Bien évidemment, les dispositifs que nous mettons en place sont sous surveillance. Nous prévoyons clauses de rendez-vous et bilans. Je me suis engagée, voilà quelques semaines, devant le Conseil national des professions du spectacle, à nous retrouver à la fin de la période estivale pour faire le bilan : comment les choses se sont-elles passées, combien d’intermittents ont repris, pendant combien d’heures ont-ils travaillé…
Ce ne sera pas pour solde de tout compte. Tout au long de l’année, nous n’avons eu de cesse d’être réactifs, de tricoter les dispositifs pour éviter les trous dans la raquette et de prendre en compte la situation des uns et des autres. Ce monde est si divers, avec des rémunérations qui empêchent parfois les indemnisations ou les rendent difficiles. Nous suivrons bien entendu toutes ces questions, monsieur le sénateur.

Je ne doute pas de votre volonté, madame la ministre, mais j’entends d’autres membres du Gouvernement remettre en cause le « quoi qu’il en coûte »…
Le déficit 2021 sera nettement supérieur aux prévisions de début d’année. Le moment arrivera où la contrainte financière sera tellement rude que je ne sais pas si vous obtiendrez toujours des arbitrages favorables.
En tout cas, qu’il s’agisse de la bonification ou de la prolongation de l’exonération de taxes, le spectacle vivant a besoin de l’État pour revivre.

Après les longs mois de fermeture et la longue léthargie de la vie culturelle française, les salles de concert, les théâtres, les cinémas font leur timide retour, pour le plus grand bonheur des artistes et du public.
Les salles s’adaptent aux conditions imposées par la pandémie, avec une jauge réduite à 35 %. Ces limitations imposent l’adaptation du budget de chaque événement, ce qui implique de revoir entièrement la programmation.
Certaines salles en configuration debout ou trop petites ne sont pas adaptées aux nouvelles règles sanitaires et n’envisagent pas de rouvrir avant l’automne 2021. En effet, le concert test réalisé à Paris le 29 mai dernier, avec un protocole sanitaire extrêmement lourd, reste peu représentatif de la réalité des situations observées localement.
Les associations culturelles sont fortement pénalisées par la crise. Nombre d’entre elles font part de leurs inquiétudes à trouver les financements nécessaires auprès des collectivités locales pour relancer la vie culturelle. Or, nous le savons, l’organisation d’un événement nécessite des mois de préparation en amont.
La réouverture des salles de répétition et des conservatoires municipaux est également une question sensible pour de nombreux maires qui restent dans l’incertitude.
À l’école, le ministre de l’éducation nationale avait encouragé la pratique du chant choral. Or la crise sanitaire a entraîné une grande déperdition de bénévoles et la démobilisation des enfants ou des parents.
Dans un tel contexte, madame la ministre, quels sont les moyens envisagés par le Gouvernement pour favoriser une reprise progressive, mais pérenne, de la vie culturelle sur l’ensemble du territoire ? Je pense en particulier aux communes rurales.
Cher Jean-Pierre Decool, après les lois de 1983, la décentralisation a mis du temps à s’installer dans les collectivités territoriales. Il a peut-être fallu une génération pour qu’elles s’emparent de l’ensemble des pouvoirs qui leur avaient été donnés.
Toutefois, les crédits pour la culture pilotés par les collectivités territoriales sont aujourd’hui plus importants que ceux de l’État, il faut l’avoir en tête. Les opérations qu’elles mènent sont extrêmement importantes et permettent de mailler le territoire. Nous avons conclu ensemble des partenariats cruciaux et tout à fait signifiants.
La crise sanitaire nous a peut-être permis de mieux comprendre l’importance des collectivités territoriales : je les ai toujours trouvées à mes côtés ces derniers mois. Elles m’ont souvent sollicitée, et j’ai essayé de leur répondre de la meilleure façon, sans esprit de système et sans arrogance. Je les ai associées à tous les moments de la discussion pour bâtir ensemble. En arrivant rue de Valois, mes premiers mots ont été : « Je serai la ministre des artistes et des territoires », car rien ne peut se faire sans ces derniers.
Nous avons mis en place des mesures. Je pense notamment à l’enseignement artistique, auquel vous êtes très attaché, et aux conservatoires. Les enseignements ont repris dès le 19 mai pour les publics qui étaient déjà accueillis antérieurement ; ainsi de la danse sans contact pour les mineurs et du chant lyrique individuel. L’enseignement de la danse pourra reprendre à partir du 9 juin. La reprise sera totale à compter du 1er juillet, ainsi que pour le chant lyrique en pratique collective.
Il n’y aura alors plus de restrictions. Ce sera un moment très important pour nos territoires.

Madame la ministre, les Français danseront-ils cet été ?
La reprise des festivals est une véritable bouffée d’air frais pour beaucoup ; la joie de celles et ceux qui ont pu assister à l’ouverture des Nuits de Fourvière hier à Lyon en témoigne.
Toutefois, la musique ne s’écoute pas uniquement assis. Qu’il s’agisse des festivals debout de musiques actuelles ou des clubs, tout un pan de la culture est encore à l’arrêt. La question est celle non pas des aides, mais de la reprise.
Pour les clubs ou discothèques, qui sont souvent des établissements à vocation culturelle, depuis plus d’un an, à chaque déconfinement, à chaque allégement des contraintes sanitaires, c’est la même déception, les mêmes frustrations : « pas maintenant », « plus tard », « soyez patients »…
Le 1er juillet aurait dû marquer la reprise pour les festivals ou concerts debout, mais les règles sont encore floues avec cette jauge d’un festivalier pour quatre mètres carrés et l’appréciation laissée au préfet. De nombreux festivals ont donc été contraints d’annuler pour la seconde année consécutive.
Madame la ministre, le monde de la culture électronique et des musiques actuelles a été patient et inventif. Comme celui des Vieilles Charrues, le festival Nuit Sonores, par exemple, a su se réinventer en configuration assis.
Aujourd’hui, les terrasses se remplissent et les Françaises et les Français sortent de chez eux. Partout en France, on ressent cette même aspiration à la fête, à se retrouver, à la danse, à la musique, à déconfiner le corps et l’esprit.
Rappelons que cette culture des musiques électroniques, née dans la clandestinité, n’a jamais attendu aucune reconnaissance de l’État et sait s’organiser. Nous avons déjà eu l’occasion de le constater ces derniers temps, avec les raves et les soirées spontanées qui ont parfois rassemblé des centaines de jeunes danseurs. Laisser le monde de la nuit et des musiques actuelles se diriger vers la clandestinité risque de donner lieu à un été de répression.
Le 5 mai dernier, le Parlement allemand a reconnu les clubs comme lieux de culture. Pour eux, cela change tout : reconnaissance d’un rôle évident dans la création artistique, relation privilégiée avec l’État, changement de regard du public… Les conséquences positives de cette décision enrichissent tout le secteur.
Madame la ministre, vous nous aviez dit, lors de votre audition par la commission, que vous teniez encore des réunions sur la question des quatre mètres carrés par festivalier. Avez-vous avancé depuis lors ?
Par ailleurs, envisagez-vous d’accorder le statut de lieu culturel à certains établissements de nuit, pour éviter de les laisser tantôt entre les mains de Beauvau, tantôt entre celles de Bercy, et leur accorder enfin la reconnaissance de votre ministère ?
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
Loin de moi l’idée de dire que les discothèques et autres night-clubs ne sont pas des lieux de culture : ils peuvent l’être, comme ils peuvent ne pas l’être ; cela dépend.
En tout cas, sur le plan des attributions qui sont les miennes, les discothèques ne relèvent pas du ministère de la culture. On peut le regretter, mais c’est ainsi.
Effectivement, et il n’est pas très compliqué de le comprendre, les discothèques, dans leur mode de fonctionnement, posent des problèmes de sécurité sanitaire évidents. Il n’est pas besoin d’être épidémiologiste, infectiologue ou virologue pour s’en rendre compte.
Du concert test qui a été organisé à l’Accor Arena selon des modalités définies scientifiquement – chaque spectateur se tenait debout –, on peut tirer des enseignements intéressants pour une reprise de l’activité des discothèques.
En tout cas, n’allez pas imaginer que ce concert test puisse servir de modèle de fonctionnement pour les concerts ; c’est une expérimentation menée, d’un côté, par une organisation professionnelle spécialisée dans le spectacle de musiques actuelles, le Prodiss, et de l’autre, par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, selon des modalités définies scientifiquement.
Cette expérimentation a fait appel à des êtres humains, lesquels pourraient d’ailleurs se retourner contre les autorités sanitaires ou politiques s’il était avéré qu’ils n’avaient pas été protégés.
Cette expérimentation lourde nous permettra de tirer des enseignements extrêmement précis. En réponse à d’autres questions, je reviendrai sur les conditions d’organisation de ces concerts pour bien faire comprendre ce qu’est un concert test.

Il n’a pas été répondu à ma question portant sur les modalités concrètes de mise en œuvre de la jauge d’un festivalier pour quatre mètres carrés. Cela nous aurait permis de les comprendre un peu mieux.

Madame la ministre, lorsque l’on parle de reprise des activités culturelles, on pense souvent, ce qui est bien normal, aux lieux – aux salles de spectacle, aux cinémas, etc.
Par ailleurs, il a été souligné ici que la France avait aidé, comme nul autre pays, son secteur culturel.
La culture sous toutes ses formes doit redémarrer partout, dans tous les territoires. De fait, madame la ministre, vous avez annoncé, à la suite de l’été 2020, la reprise de l’été culturel en 2021.
Mes questions sont donc les suivantes : quel bilan tirez-vous de l’été culturel 2020 pour pouvoir affirmer qu’il faut le reprendre en 2021 ? Quels moyens financiers y seront consacrés ? Comment faire pour qu’il soit le plus ouvert possible, le plus large possible, le plus inclusif possible, comme l’on dit parfois aujourd’hui, afin notamment qu’il prenne en compte les questions d’égalité entre les femmes et les hommes ou bien la valorisation des jeunes talents et des jeunes artistes ?
Cette déclaration va dans le bon sens. Nous souhaiterions en savoir davantage sur ce que sera l’été culturel 2021.
Monsieur le sénateur Julien Bargeton, votre question sur l’été culturel répond finalement à deux préoccupations précédemment évoquées. D’une part, comment aider les jeunes, à la fois les artistes qui créent, qui jouent, et les jeunes désireux d’assister aux spectacles ? D’autre part, comment mailler le territoire par des manifestations artistiques facilement accessibles ?
Le bilan de l’été culturel 2020 est extrêmement positif. Quelque 10 000 manifestations ont rassemblé plus de 1 million de spectateurs et participants et permis à 8 000 artistes de travailler. Cela a donc été un vrai succès, d’autant que ces manifestations se sont déroulées principalement dans des secteurs prioritaires, des secteurs confrontés à des difficultés sociales considérables.
Cette initiative a permis de renforcer le partenariat avec les collectivités territoriales, de découvrir de nouveaux partenariats avec des équipes indépendantes et des collectifs qui n’étaient pas nécessairement connus des services. Les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, ont ainsi découvert de petites compagnies, de petites structures qui se sont mobilisées et qui ont pu trouver du travail.
Tous les lieux ont été investis, qu’il s’agisse des zones difficiles, des zones très rurales, des Ehpad, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des centres de vacances.
La sphère culturelle demeurant très touchée cette année, j’ai décidé de reconduire le budget de l’été culturel pour l’année 2021, à hauteur de 20 millions d’euros.
Les DRAC assureront la répartition de ces fonds au plus près des territoires, avec un focus particulier, cette année, sur les jeunes artistes récemment sortis des écoles, l’attractivité de ces territoires, un partenariat affirmé avec le pass culture, une volonté de développer des projets associant sport et culture en préparation de l’Olympiade culturelle, enfin, comme vous l’avez souhaité, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’ouverture à la diversité – c’est l’un de mes mantras.

Madame la ministre, je m’associe aussi aux témoignages de reconnaissance pour tout ce qui a été fait pour la culture durant cette crise sanitaire, mais le patrimoine ne doit pas servir de variable d’ajustement face aux besoins suscités par celle-ci, alors que nos monuments et nos musées sont essentiels à la relance, à la fois en tant que vecteurs d’émancipation pour les citoyens, en tant que leviers de cohésion sociale et en tant que facteurs de rayonnement national et d’attractivité des territoires.
Certains monuments historiques ont ainsi subi des pertes de chiffre d’affaires de plus de 50 % sur un an. Le Gouvernement s’est engagé dans le cadre du loto du patrimoine ou du plan de relance pour la rénovation du petit patrimoine et des cathédrales.
Avant la crise sanitaire, les besoins de restauration du patrimoine protégé étaient déjà importants au regard de leur mauvais état.
Le manque d’ingénierie des petites communes et des propriétaires privés constitue d’ailleurs un frein à la réalisation de nombreux projets. Cette difficulté pose particulièrement problème à l’heure actuelle, où le temps presse pour lancer des projets susceptibles d’aider les entreprises de restauration du patrimoine à surmonter la crise.
Toutefois, les financements des monuments ne peuvent être pérennes avec la seule aide de l’État : les recettes touristiques sont essentielles pour leur survie, en particulier pour les propriétaires et gestionnaires privés.
Madame la ministre, comment promouvoir le tourisme pour leur assurer une fréquentation maximale cet été et les aider à surmonter la crise ? Afin d’assurer le respect des gestes sanitaires tout en garantissant la réouverture des monuments, comment comptez-vous, de manière pratique, limiter les files d’attente et, ainsi, respecter la jauge ? L’État pourrait-il financer la modernisation numérique du secteur en systématisant la pratique des billets horodatés pour accéder aux monuments ?
Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d’abord de rappeler le montant inédit des moyens qui ont été mobilisés pour le patrimoine, les 614 millions d’euros du plan de relance s’étant ajoutés aux 7, 1 milliards d’euros de crédits courants du ministère de la culture. À ce titre, 1 milliard d’euros a été consacré à la préservation du patrimoine.
Cette mobilisation inédite rejoint d’ailleurs l’une des priorités de la présidence française de l’Union européenne, qui a inscrit parmi celles-ci, en accord avec les autres pays, la valorisation du patrimoine.
Je veux que les ponts qui existent entre le patrimoine et le spectacle vivant, entre le patrimoine et le tourisme, soient renforcés.
J’en donnerai un exemple. Dans le plan de relance, une ligne budgétaire de 30 millions d’euros est prévue pour la commande publique d’œuvres à de jeunes artistes. Bernard Blistène, qui pilote ce dossier, nous a proposé – nous l’avons accepté – que chacune des œuvres soit accueillie dans un site patrimonial, que ce soit un site patrimonial bâti ou un site naturel. À cette fin, il travaille, d’un côté, avec le Centre des monuments nationaux, et, de l’autre, avec le Conservatoire du littoral.
C’est ainsi que je conçois le patrimoine, un patrimoine vivant, qui diffuse de la culture et qui s’extraie ainsi d’une vision purement muséale.
Ces monuments ont été largement aidés selon les normes que nous avons fixées pour l’ensemble des autres structures et ils continueront bien sûr à l’être.

Ma question concerne les conséquences de la crise sanitaire sur l’éducation artistique et culturelle. Celle-ci est un pilier de la démocratisation de la culture. S’appuyant sur le réseau scolaire, elle a pour but de permettre à tous les jeunes un accès à la culture. Elle se traduit par le « 100 % EAC à l’école », dont on ne connaît pas vraiment les critères, mais qui a le mérite d’être un objectif pour tous.
Cet objectif a été fixé à 88 % en 2020, avant d’être abaissé à 75 % compte tenu du contexte sanitaire, les 100 % étant désormais attendus pour 2023.
La crise sanitaire a donc conduit à des retards dans le « 100 % EAC », liés aux mesures de confinement, aux protocoles sanitaires et aux fermetures de lieux culturels.
L’EAC, dans sa forme d’échange, de visites et de rencontres, n’a pas eu lieu pendant un temps si long, pour tant d’écoles et pour tant d’enfants. Ce retard et cette raréfaction des actions, associés aux effets du confinement et du distanciel, nous le savons, vont creuser les inégalités culturelles liées au contexte socioéconomique et territorial. Si elle n’est pas corrigée, cette carence sera néfaste en matière d’accès à la culture, à la diversité culturelle et à l’ouverture à des propositions différentes.
L’EAC bien mené et accompagné constitue un moyen essentiel pour amener les jeunes et les enfants à s’ouvrir hors les murs de cette période difficile et si enfermante.
Dès lors, madame la ministre, à l’heure où les activités culturelles reprennent, comment comptez-vous rattraper le retard pris par ces jeunes générations, pour lesquelles les différences de capital culturel se ressentiront encore plus que les autres ?
Madame la sénatrice, il est exact que le confinement et les difficultés rencontrées par le secteur culturel ont amené à freiner cet objectif de diffusion du « 100 % EAC » que nous nous étions fixé. À partir du moment où l’on ne peut pas emmener les élèves visiter un musée ou une exposition ou assister à un spectacle, cette ambition s’en trouve réduite. Toujours est-il que nous en sommes à 75 %, ce qui n’est pas si mal compte tenu des difficultés liées au confinement.
Pour autant, il ne faut pas baisser les bras ; au contraire, il faut accélérer pour atteindre cet objectif, et c’est ce que nous allons faire.
Ainsi, je signale tout d’abord la création de l’Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle, qui sera inauguré à Guingamp en septembre 2021 et placé sous la direction d’Emmanuel Ethis. L’Institut sera donc un opérateur de référence dans la conduite de la politique en matière de formation initiale et continue, de recherche et de diffusion des ressources.
L’éducation artistique et culturelle ne peut être assurée en amateur ; elle requiert des professionnels pour ce faire.
Je veux tout de même souligner un élément : certes, cette période a été difficile pour les enseignants, mais certains d’entre eux, ce dont je les remercie, se sont sorti les tripes, si j’ose dire, pour mener ces opérations d’EAC.
Je remercie également les artistes qui ont accepté, bénévolement, durant ces derniers mois, de venir dans les écoles pour danser, pour jouer, pour lire des textes.
Ces activités sont à nouveau accessibles dans les lieux de culture. Avec le Premier ministre, nous sommes allés la semaine dernière au musée d’Orsay à la rencontre de jeunes élèves issus de quartiers prioritaires. Ce fut absolument extraordinaire : la façon dont ces jeunes avaient préparé cette visite et dont ils ont raconté ce qu’ils y ont vu montre à quel point nous avons eu raison d’évaluer l’action du ministère de la culture à l’aune de cette éducation artistique et culturelle, que je mène en parfaite collaboration avec Jean-Michel Blanquer.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre.
L’EAC nécessitera des moyens – vous en avez évoqué quelques-uns – pour une mise en place systémique et rapide dans tous les territoires. Vous comprendrez que cette question est d’autant plus cruciale à l’heure où le Président de la République a annoncé l’extension du pass culture jusqu’aux élèves de quatrième. Là, il y a des moyens !
Le pass ne peut ni ne doit à lui seul résumer la politique d’éducation culturelle. Vous avez répondu sur ce dispositif, mais il reviendrait tout de même, si on lui accorde la priorité, à donner un portefeuille sans avoir appris à s’en servir.
Le risque est grand de voir ainsi les inégalités se renforcer : le pass est un outil, en aucun cas une éducation à la culture. Les clés de la culture sont ailleurs que dans une application, fût-elle aimée.

Madame la ministre, je profite de ce débat pour aborder la question de la couverture sociale des intermittents du spectacle et de la situation particulière de toutes les professions discontinues, oubliées des aides.
Tout d’abord, comme vous le savez, les intermittents du spectacle qui n’ont pas effectué assez d’heures ne disposent pas de couverture maladie ou maternité. La plupart des intermittents n’ont pu effectuer un nombre d’heures suffisant pour rouvrir ces droits à congé maladie, cependant qu’ils ont perdu des droits acquis précédemment.
Si vous avez annoncé, à la mi-mai, avoir pris des mesures, il semble qu’aucune traduction juridique de ces dernières n’ait vu le jour, ce qui est tout à fait problématique pour les acteurs de la culture. Ils ne disposent d’aucune base légale justifiant la prise en charge de leurs soins ou de leur grossesse et entrent parfois en conflit avec la sécurité sociale, qui n’est toujours pas au courant des annonces faites.
Ma première question est donc la suivante : un décret est-il prévu pour combler ce vide juridique ? Quelle sera sa date d’effet et quelle sera sa date de signature ?
Par ailleurs, toutes les professions à interventions discontinues, qui n’entrent pas du tout dans le champ de l’intermittence – je pense aux créateurs, aux artistes acteurs ou musiciens, aux techniciens son ou lumière, aux pigistes, aux prestataires en restauration ou autres, à tous les autoentrepreneurs ou travailleurs libéraux – éprouvent aujourd’hui de grandes difficultés, comme ils en éprouveront à l’avenir, sans qu’aucune aide leur soit attribuable.
Avez-vous prévu des mesures financières spécifiques pour protéger ces professionnels tout au long de la crise sanitaire créée par la covid-19 ?
Monsieur le sénateur, j’espère que nous aurons l’occasion de nous voir au festival d’Avignon, où je me rendrai bien évidemment, ce festival qui est tellement emblématique que ses aficionados, si j’ose dire, l’attendent tous les ans avec un grand plaisir, qu’il s’agisse du in ou du off.
Rassurez-vous, les textes promis sont en cours d’élaboration. Je ne puis vous indiquer la date précise à laquelle ils seront signés, mais ils le seront en temps et en heure de manière à protéger les artistes, puisque tel est l’objectif. Il n’y aura aucun retard à l’allumage ; je suis cela de très près.
Dernièrement, André Gauron nous a remis, à Élisabeth Borne et à moi-même, le rapport que nous lui avions conjointement commandé sur les suites de l’année blanche en faveur des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel – le statut de l’intermittence relève du ministère du travail en tant que mode de protection de l’emploi. §Pardonnez ces petits problèmes respiratoires, dont mon amie la covid est la cause…
Ce travail d’évaluation montre clairement que, dès avant la reprise du 19 mai, quelque 75 % des intermittents – 100 000 sur 120 000 – avaient recouvré leurs droits. Au fil des semaines, et à mesure que les activités reprendront, ce chiffre ira croissant et les choses s’amélioreront.
Pour ceux qui pourraient ne pas avoir travaillé suffisamment d’heures pour bénéficier de ces droits, nous avons déployé des dispositifs qui permettront de les recouvrer : je pense en particulier à la clause de rattrapage, qui s’appliquait jusqu’à présent à la condition de disposer de cinq années complètes de couverture à l’intermittence, condition que nous avons supprimée.
Nous avons ainsi permis à des jeunes qui n’avaient pas la possibilité de disposer de ces 338 heures nécessaires d’émarger néanmoins à ces six mois supplémentaires de protection, et même à une seconde période de six mois. Ce sont donc bien douze mois de couverture qui sont assurés.
Véritablement, nous avons veillé à ce que tous les intermittents puissent être protégés tout au long de l’année 2022.

Madame la ministre, vous ne m’avez pas tout à fait répondu s’agissant de ceux qui ne relèvent pas du statut de l’intermittence.
Or c’est un problème important. En effet, de nombreux artistes ou créateurs – je les ai cités tout à l’heure – relèvent non pas de ce statut, mais de celui de l’autoentrepreneuriat. Négociant directement avec les collectivités locales pour produire leurs spectacles, ils ne bénéficient pas des dispositifs que vous avez évoqués. J’espère donc que vous trouverez une solution pour leur venir en aide.

Madame la ministre, souhaitez-vous que nous marquions une pause de quelques minutes ?

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures quarante.

Avec le confinement, la fermeture des salles a profondément affaibli le cinéma français : chute de 70 % du nombre d’entrées, chute d’autant des recettes, baisse de 30 % des investissements dans la production cinématographique.
Si le Centre national du cinéma estime avoir évité une hécatombe, notamment grâce au soutien de plus de 400 millions d’euros déployé par l’État, les plaies demeurent vives pour le secteur.
Elles demeurent vives, car les relations entre les différents médias et le cinéma français ont également été bousculées.
Depuis 1946, le financement du cinéma français repose sur le principe de solidarité entre les supports de diffusion, qui n’ont cessé de se diversifier, et la protection de fenêtres d’exploitation en salle pour la projection première de la production cinématographique.
Néanmoins, au moment de la réouverture des salles, un défi majeur resurgit : celui de la chronologie des médias.
Les pressions se font en effet de plus en plus vives pour réduire les fenêtres d’exploitation en salle et accélérer la diffusion des films sur les médias à la demande. Ainsi, la fenêtre de ces derniers pourrait passer d’un délai de trente-six à douze mois, voire, pour certaines chaînes, de huit à six ou cinq mois.
Alors que les Français retrouvent avec plaisir et attachement leurs salles de cinéma, cette réduction des fenêtres d’exploitation de ces dernières constitue un péril nouveau pour un secteur en grande difficulté. Elle pourrait remettre en cause la découverte première de films en salle, qui, pourtant, participe de notre mode de vie et constitue tout autant un fait social qu’un mode d’accès à la production cinématographique.
Madame la ministre, dans un contexte où le cinéma est affaibli, l’État doit réaffirmer haut et fort sa détermination à le soutenir.
Quelle est donc votre position face aux pressions qui s’exercent sur la profession pour réduire les fenêtres d’exploitation en salle ? Êtes-vous prête à sanctuariser la fenêtre d’exploitation des films en salle, qui en ont plus que besoin ?
Vous avez raison, monsieur le sénateur Max Brisson, de dire que le cinéma français est une exception en Europe : notre industrie cinématographique se situe à la troisième place dans le monde, et elle est la seule en Europe. Si nous avons pu ainsi la conserver, c’est grâce à l’aide constante de l’État, qui a survécu à tous les aléas liés aux changements des majorités politiques.
Nous disposons également d’un réseau sans égal en Europe : 2 000 salles et 6 000 écrans. Je signale d’ailleurs que la crise a laminé nombre de réseaux de cinémas dans d’autres pays, cependant que nous avons su conserver le nôtre.
Ce ne sont pas 400 millions d’euros qui ont été mobilisés : en effet, à ces 400 millions d’euros d’aides spécifiques, il faut ajouter les aides transversales de près de 1 milliard d’euros, dont le cinéma a largement profité.
Pour accompagner la reprise de l’industrie cinématographique et la réouverture des salles de cinéma, j’ai proposé une enveloppe de 80 millions d’euros, dont 60 millions seront consacrés justement à la perte de recettes du fait de la limitation des jauges : 60 millions d’euros pour les exploitants de salles, 10 millions d’euros pour les distributeurs et 10 millions d’euros pour les producteurs. Nous sommes donc encore à la manœuvre pour aider le cinéma.
Dès le mois de décembre dernier, les professionnels ont été invités par le Centre national du cinéma, afin d’entamer une négociation en vue d’aboutir à un nouvel accord professionnel.
Ces discussions sont encadrées dans le temps par une disposition de l’ordonnance transposant la directive européenne relative à la fourniture de services de médias audiovisuels, disposition autorisant le Gouvernement, en cas d’échec, à adopter provisoirement une nouvelle chronologie. Certains représentants des producteurs et ayants droit se sont rapidement accordés sur une proposition de nouvelle chronologie, autour de laquelle se sont cristallisées les réactions des différents diffuseurs.
C’est à partir de ces échanges que le CNC proposera prochainement un projet d’accord, qui servira de base à la seconde phase de la concertation, avec pour objectif d’aboutir d’ici au 1er juillet prochain.
Je puis vous dire que, s’agissant de la protection de la distribution du cinéma et de la fenêtre de quatre mois pour la diffusion en salle, je serai intraitable.

Madame la ministre, vos propos sont forts, et je vous en remercie. Il s’agit bel et bien d’une exception française, reposant notamment sur le maillage territorial des cinémas. On trouve ainsi des salles dans les bourgs centres, les petites villes et les villes moyennes : c’est véritablement exceptionnel.
C’est la chronologie des médias qui a construit l’exception du cinéma français et qui doit permettre de la préserver : nous comptons sur vous pour la protéger. Sachez que le Sénat vous soutiendra dans cet effort !

Madame la ministre, je m’exprime au nom de David Assouline, que je vous prie d’excuser.
Après des mois d’attente, la culture se déconfine enfin, progressivement, pour le plus grand bonheur des Françaises et des Français.
On ne peut pas nier l’ampleur du travail accompli par le ministère pour soutenir la culture. Néanmoins, nous pouvons déplorer plusieurs trous dans la raquette.
Tout d’abord, je pense aux intermittents. Si l’année blanche a été bénéfique pour beaucoup, un très grand nombre de jeunes diplômés du milieu artistique ont été coupés dans leur élan par la fermeture des lieux culturels. Ils se retrouvent sans ressources et ne reçoivent que peu d’aides de l’État.
De surcroît, tous ces diplômés formés vont subir une double peine : non seulement ils auront davantage de difficultés à être engagés, mais la saison 2021-2022 sera une année blanche de création à cause d’un trop-plein de spectacles.
Trop d’interprètes, trop de créations, pas assez de diffusion : ce triangle infernal risque d’aggraver la précarité de ces jeunes artistes qui, s’ils ne sont plus étudiants, ne sont pas encore intermittents. En parallèle, il serait bon qu’une clause de rendez-vous soit discutée à la fin de l’année pour toutes les aides des intermittents.
Ensuite, le ministère a concentré ses plans de relance sur des structures et des compagnies traditionnellement subventionnées par l’État. Cet effort budgétaire est louable, mais incomplet, puisqu’il ne bénéficie pas aux établissements subventionnés par les communes, des musées aux théâtres en en passant par les salles de spectacles ou encore les établissements publics de coopération culturelle, les EPCC.
Les répercussions financières de cette crise sont très lourdes. Faute d’un meilleur accompagnement de l’État, il revient aux territoires de supporter l’intégralité du soutien de ces établissements, alors même que leurs finances sont dans le rouge.
La ville de Paris n’est pas plus épargnée que les autres collectivités : à ce jour, aucun mécanisme de soutien budgétaire direct et de compensation des pertes de recettes n’a été prévu pour la capitale. Ainsi, la réaction de l’État n’est toujours pas à la hauteur des enjeux soulevés par cette crise inédite.
Madame la ministre, les prochains plans de relance de l’État cibleront-ils bien tous les établissements culturels, sur l’ensemble du territoire national ? Que comptez-vous faire aider les jeunes artistes ? Il faut rectifier le tir et combler les trous dans la raquette.
Madame la sénatrice, je l’ai dit : nous sommes maintenant dans un État décentralisé. Les crédits mobilisés en masse par les collectivités territoriales et leurs groupements – communes et intercommunalités, départements, régions, structures informelles au sein desquelles elles sont rassemblées – sont maintenant plus importants que les crédits de l’État.
Dès lors, chacun doit se recentrer sur ses responsabilités. Vous parlez des difficultés financières des collectivités territoriales : que dire de celles de l’État ? Ce dernier a consenti un effort budgétaire massif, et même sans précédent.
Dans le cadre d’une politique culturelle territorialisée, on ne saurait partir du principe que l’État va aider toutes les structures existantes. Certaines d’entre elles ont été créées par des acteurs locaux, en particulier par des collectivités territoriales, qui se sont engagées à les soutenir et à les financer : face aux difficultés de l’heure, ils ne peuvent pas tendre la sébile vers l’État. Chacun doit trouver les ressources en soi.
Le rôle de l’État sera de piloter des têtes de réseau ; de faire en sorte que les têtes de réseau déjà financées acceptent des diffusions et des partenariats et agissent avec davantage de responsabilité dans les territoires. Je pense en particulier aux grands vaisseaux amiraux qui assurent la structuration culturelle du pays.
Si, demain, les dizaines de milliers de structures culturelles que la France dénombre étaient aidées par l’État, nous en serions réduits à une politique de Gribouille. Véritablement, nous devons réfléchir ensemble à ce qu’est une politique territorialisée, impliquant les responsabilités des collectivités territoriales et le rôle éminent de l’État !

La reprise des activités culturelles accompagne celle de la vie tout court, car la culture, c’est la vie : tout ce qui affecte l’une rejaillit sur l’autre.
Toutefois, à ce jour, malgré les éclaircies, il y a encore trop de brouillard, comme on le voit dans plusieurs secteurs sérieusement affectés.
Le spectacle vivant rassemble de nombreux acteurs. Il est indispensable à la vitalité de nos territoires. Il est pourtant à l’arrêt depuis un an, et la reprise engagée depuis deux semaines se fait à un rythme modéré.
Le secteur du spectacle musical et de variétés joue un rôle essentiel : son chiffre d’affaires et le nombre d’emplois qu’il regroupe en témoignent. Sa fragilité peut entraîner un effet domino sur d’autres activités. Il faut donc de la prévisibilité quant aux règles et aux protocoles applicables.
Comment appliquer la jauge de quatre mètres carrés par personne ? Quel sera le protocole pour les festivals de rue, où les gestes barrières ne sauraient faire oublier qu’il n’existe justement pas de barrière ? Les critères retenus ne sauraient être trop éloignés de leur identité, de leur public ou de leur modèle économique. Comment aider un festival pour lequel les buvettes et la restauration constituent un appui indispensable ?
Madame la ministre, vous avez annoncé la création d’un fonds de 30 millions d’euros pour accompagner les festivals qui s’adaptent, afin de compenser les pertes d’exploitation. C’est à la fois beaucoup et trop peu.
Les ressources des entreprises privées du spectacle vivant dépendent uniquement de la billetterie. Or, pour certains organisateurs, 2021 sera la seconde année consécutive sans festival. Les collectivités territoriales vont être sollicitées, mais elles n’ont guère de moyens.
Comment sera organisé le fonds de compensation de billetterie que vous avez annoncé ? Comment le pass culture sera-t-il mis en œuvre et associé à la reprise culturelle ?
Comment s’orienter vers un nouveau modèle économique pour l’activité culturelle ? Peut-on envisager comme piste la bonification du crédit d’impôt pour le spectacle vivant musical, le CISV ? Essayons d’être encore plus ambitieux et audacieux !
Madame la sénatrice, je n’aurai sans doute pas le temps de répondre à toutes vos questions en deux minutes ! Je ne pourrai en aborder que quelques-unes.
Vous avez raison de le souligner : les festivals de musique, en particulier de musique actuelle, sont un élément tout à fait majeur de structuration des territoires : toute mon action tend à les préserver, car je veux qu’ils puissent continuer.
Il suffit de regarder comment s’est déroulé le concert organisé à l’Accor Arena pour mesurer le défi sanitaire que nous devons relever : cette expérience a une véritable valeur pédagogique. En effet, les concerts de musique actuelle se caractérisent par une très grande proximité, des cris et beaucoup de transpiration : le public danse et se masse au pied de la scène.
Je tiens également à revenir sur la jauge des quatre mètres carrés, qui a provoqué un certain nombre d’interrogations. Certains semblent croire que chaque spectateur doit rester dans une sorte de petit espace de quatre mètres carrés où personne ne peut pénétrer.
Sourires.
Nous allons retravailler ce point, car il a fait l’objet d’un véritable problème de communication : je comprends qu’une telle interprétation ait pu prêter à confusion.
Quant aux festivals, ils constituent eux aussi une question majeure. J’ai lancé les premiers États généraux des festivals. Nous avons établi un diagnostic en octobre dernier à Avignon. Je serai également au printemps de Bourges, qui organise sa seconde édition depuis le début de la pandémie, et je vous invite à participer à la concertation qui se tiendra dans ce cadre à la fin du mois de juin : nous devons déterminer, ensemble, comment ces festivals doivent évoluer et quelles solutions nous pouvons trouver pour eux.

Madame la ministre, j’y insiste, la jauge des quatre mètres carrés est un réel problème pour les festivals de rue.
J’ajoute qu’il faut donner des signes aux organisateurs de festivals. Il est difficile de mettre sur pied de telles manifestations en quinze jours.

Depuis le 19 mai dernier, les lieux culturels accueillent de nouveau le public, et chacun s’en réjouit. Les portes se sont rouvertes, mais les professionnels s’interrogent : est-ce pour de bon ou seulement pour la saison ?
Bien des établissements, à commencer par les lieux du spectacle vivant, ont repris les représentations. Malgré les jauges et le port du masque, la présence du public confirme une grande appétence pour la culture.
Les aides allouées ont permis aux structures concernées d’affronter cette longue traversée du désert culturel. Mais, avec l’augmentation progressive des jauges, elles sont appelées à se tarir.
Je rappelle que bien des établissements, notamment les théâtres de ville, dépendent directement des communes : ces dernières contribuent pour près de la moitié au financement du théâtre vivant.
Or elles ont bien du mal à dessiner la trajectoire que vont prendre leurs finances, d’autant que les mécanismes de compensation des surcoûts liés à la crise ne sont pas encore suffisamment documentés. De plus, elles ignorent si elles pourront bénéficier du plan de relance et, le cas échéant, sous quelles modalités.
Le spectacle vivant risque donc de subir le contrecoup de la détérioration des finances du bloc communal, qui, face à la crise sanitaire, a dépensé davantage et a vu ses recettes diminuer.
Madame la ministre, dans ces conditions, vous imaginez l’incertitude et l’anxiété qui gagnent les directions des théâtres. Elles ont besoin de faire des choix artistiques, budgétaires et humains. Bref, elles doivent se projeter dans les prochaines années, sans savoir précisément sur quelles ressources elles pourront compter.
J’en viens à ma question, madame la ministre. Si des théâtres de ville ou d’autres établissements du spectacle vivant constatent, l’année prochaine, une baisse significative de leurs dotations, seront-ils éligibles à l’aide de 148 millions d’euros que vous avez annoncée ? L’État viendra-t-il secourir les théâtres de ville en danger ?
Madame la sénatrice, je commencerai par un point d’orthodoxie budgétaire : ces 148 millions d’euros sont des crédits d’urgence à dépenser pendant l’année 2021. Ils ne relèveront en aucun cas du projet de loi de finances pour 2022.
Votre intervention me permet également de rappeler que la question de la démocratisation culturelle est encore devant nous : au sujet de l’appétence des Français pour le spectacle vivant, sur laquelle vous insistez, je vous répondrai à la fois oui et non.
Qu’elles soient élaborées par le ministère ou par les organisations professionnelles, les statistiques relatives aux pratiques culturelles de nos concitoyens sont formelles : au total, quelque 55 % des Français n’ont jamais mis les pieds dans un lieu de spectacle vivant, qu’il s’agisse des musiques actuelles, des musiques classiques, de l’opéra, du théâtre, du cirque ou encore du cabaret.
De plus, sur les 45 % de Français restants, seuls 10 % sont des pratiquants habituels – figurent dans cette catégorie les personnes qui assistent à dix spectacles vivants au moins chaque année, ce qui n’est d’ailleurs pas si considérable.
Depuis soixante ans, notre politique d’offre culturelle est extrêmement forte. On a fait le pari de l’offre, en pensant que cette dernière allait ruisseler sur les pratiques culturelles des Français. À présent, il faut mener une politique de la demande, il faut aller vers les publics : c’est ce que nous faisons avec l’éducation artistique et culturelle ou encore avec le pass culture.
Nous ne devons pas nous aveugler : c’est tous ensemble que nous relèverons le défi de la démocratisation culturelle. Ce n’est pas parce que les salles de théâtre sont pleines que tout le monde va au théâtre. Ce débat m’offre l’occasion de le dire solennellement.
Enfin, nous sommes encore dans l’incertitude. Quelles seront les conséquences de la pandémie ? Quelles salles seront menacées ?
Pour moi, le plus urgent, c’est de garantir la sécurité sanitaire, car c’est une des conditions d’une reprise pérenne. Les structures du spectacle vivant font donc l’objet d’une très grande vigilance de ma part : nous devons les aider de la meilleure façon, car ce sont elles qui sont les plus menacées.

Depuis plus d’un an, les guides-conférenciers sont sans travail. Ils espéraient pouvoir reprendre leurs activités à partir du 19 mai 2021, mais compte tenu des conditions du déconfinement, des restrictions, de l’arrivée des variants, du pass sanitaire et des quarantaines appliquées lors du passage des frontières, nous pouvons déjà l’affirmer : les visiteurs, qu’ils soient Français ou étrangers, particulièrement les touristes américains et asiatiques, ne seront pas de retour avant bien longtemps.
La profession, qui s’exerce au contact des voyageurs et des groupes, est l’une des plus durement touchées du monde de la culture et du tourisme. Elle est pourtant restée dans l’ombre.
Les conséquences de la crise sanitaire ont frappé un métier qui souffrait déjà d’un statut saisonnier et précaire, tributaire des événements climatiques, géopolitiques et économiques.
Finalement, la pandémie nous ouvre les yeux sur la nécessité de protéger cette activité précieuse pour le rayonnement du patrimoine français.
Madame la ministre, ce sont environ 12 000 guides-conférenciers titulaires de la carte professionnelle qui travaillent en freelance, en tant qu’autoentrepreneurs ou avec des CDD de quelques mois, en jonglant avec plusieurs missions. Au total, 80 % des guides-conférenciers sont des femmes. À l’heure actuelle, ces professionnels sont toujours sans travail et beaucoup ne s’en remettront pas.
Diplômés, polyglottes, ils sont eux aussi essentiels à la vie culturelle de notre pays. Ils ont connu le même arrêt brutal que les intermittents du spectacle ; pourtant, ils n’ont pas eu droit à la même protection.
Les guides-conférenciers sont bien des intermittents de la culture, non des petites mains du patrimoine ou du tourisme. Il est urgent que le ministère de la culture, d’une part, devienne l’interlocuteur exclusif de la profession, et, d’autre part, envisage une reconnaissance légale protectrice de ce métier.
Madame la sénatrice, je tiens à vous rassurer : pour moi, pour mon cabinet ou pour les services de mon ministère, les guides-conférenciers n’ont jamais été dans l’ombre.
Vous l’avez rappelé : ils jouent un rôle de premier plan dans la valorisation touristique et culturelle de notre patrimoine et de nos territoires. L’effondrement de la fréquentation des lieux pour lesquels ils travaillent les place dans une situation très difficile.
Parmi ces professionnels, ceux qui exercent une activité internationale sont bien sûr particulièrement touchés. En outre – il faut bien le dire –, un certain nombre d’entre eux vivent en dehors des circuits classiques de rémunération : ils pratiquent des activités au pourboire, des activités grises qui ne leur permettent pas de cotiser et, partant, d’être protégés.
Le contexte est en train de changer : on peut espérer qu’un certain nombre de touristes étrangers seront remplacés par des touristes français – on l’observe d’ailleurs d’ores et déjà –, mais la situation reste très difficile.
Je rappelle que les guides-conférenciers sont éligibles aux dispositifs transversaux mis en place : leurs organisations professionnelles n’ont sans doute pas joué pleinement leur rôle d’information à cet égard.
En complément de ces soutiens financiers, nous pensons à la réorganisation de la profession, qui est absolument indispensable.
Un groupe de travail interministériel, qui réunit les quatre principaux syndicats et fédérations professionnels des guides-conférenciers, a été mis en place et se réunit. Nous avançons au sujet de la sécurisation des cartes professionnelles et pour la création d’un registre numérique permettant d’éviter les falsifications.
En effet, certains voyagistes facturent les visites de guides-conférenciers, puis, lorsque ces derniers montent à bord des cars, les touristes sont invités à donner un pourboire, ce qui est absolument anormal. Nous progressons également pour renforcer la reconnaissance de cette profession et évaluer ses besoins.
Depuis le 19 mai dernier, les visites guidées dans nos musées et monuments ont pu reprendre. Par dérogation aux règles liées aux rassemblements, les personnes titulaires d’une carte professionnelle peuvent guider une clientèle sans limitation du nombre de participants, ce qui est particulièrement important : leurs revendications ont été entendues.

Madame la ministre, depuis quinze jours la culture reprend ses droits, et tout le monde s’en réjouit. Pour autant, il reste une ombre au tableau : les activités culturelles n’ont pas encore repris partout du fait de l’occupation de certains lieux.
À Paris, le théâtre de l’Odéon n’est plus occupé depuis quelques jours. Mais, à Nantes, le théâtre Graslin est occupé depuis maintenant plus de trois mois, et de nombreuses autres villes françaises sont concernées.
Concrètement, les directeurs de ces établissements sont obligés de déprogrammer des spectacles qui pourraient avoir lieu : c’est un comble, alors que le pays a été privé d’activité culturelle pendant des mois !
Aujourd’hui, on ne peut plus accepter ces occupations de lieux culturels. J’ai envie – comme vous, j’en suis sûre – que les Français retrouvent leurs théâtres, et je pense notamment aux Nantais ; j’ai envie que les artistes retrouvent leur public.
Pour autant, il faut s’interroger : il faut comprendre ce que dit cette situation et mesurer la fracture qu’elle révèle. D’un côté, les grandes structures culturelles ont bénéficié d’un fort soutien, d’un grand accompagnement de la part de l’État comme des collectivités. De l’autre, de nombreux acteurs culturels – compagnies de danse et de théâtre, d’arts de la rue, artistes auteurs, etc. – ont été extrêmement fragilisés par cette crise et s’inquiètent légitimement pour leur avenir.
Aussi, ma question est double. Elle porte tout d’abord sur l’ordre public : comment et quand l’État compte-t-il redonner aux Français l’accès à ces lieux culturels ? Elle porte ensuite sur nos politiques culturelles : comment comptez-vous combler le fossé qui s’est creusé entre les grandes structures et cette myriade d’acteurs culturels qui sont essentiels à la dynamique de notre pays ?
Madame la sénatrice, au plus fort de la crise, une centaine de lieux culturels ont été occupés, par un ensemble d’environ 1 000 personnes : c’est beaucoup et c’est peu à la fois.
Cela étant, je n’ai jamais agi en comptable des mouvements sociaux. À mon sens, les personnes qui occupaient ces lieux de culture avaient des choses à nous dire : c’est la raison pour laquelle, dès le 7 mars dernier, je suis allée à la rencontre des intermittents de la CGT spectacle qui occupaient le théâtre de l’Odéon.
Je ne dis pas que je trouvais ces occupations normales. Elles étaient illégales, mais elles étaient légitimes, car, pour les intéressés il s’agissait de se faire entendre. C’est ainsi que je les ai vécues.
Nous avons multiplié les rencontres avec les organisations représentatives des intermittents, qui occupaient massivement ces lieux de spectacle.
Las – il faut bien le reconnaître –, il y a eu des dérives. Un certain nombre de maires et quatre directeurs d’établissement ont sollicité le recours à la force publique.
Je l’ai dit dès le départ : je ne serai pas la ministre de la culture qui demandera le recours à la force publique. J’ai fait confiance à l’esprit de responsabilité. Je savais que, dès la réouverture des lieux de culture, la plupart de ces mouvements cesseraient. D’ailleurs, le bilan est clair : hier, on ne comptait plus que vingt-huit lieux occupés – la décrue est donc des trois quarts – mobilisant 300 personnes, qui ne sont d’ailleurs pas toutes des intermittents.
Ce mouvement ne peut pas s’arrêter d’un coup d’un seul, et je le comprends. Certaines personnes ont pris l’habitude de vivre dans une certaine convivialité, en multipliant les assemblées générales et les colloques. Elles ont besoin de se retrouver ; d’autres ont émigré vers d’autres lieux.
En tout cas, maintenant, j’en appelle à la responsabilité de chacun. Les lieux de culture sont rouverts ; l’intermittence est garantie et, avec elle, la protection des intermittents. Il est temps de retrouver un fonctionnement normal des lieux de culture.
J’ai toujours respecté les intermittents : je continuerai à les respecter et à les écouter.

Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions. Je vous rejoins largement, mais ce qui était entendable – même si c’était illégal, comme vous l’avez rappelé – avant la réouverture des lieux culturels l’est beaucoup moins aujourd’hui : il s’agit précisément de relancer les activités culturelles, y compris dans ces lieux, même s’ils sont beaucoup moins nombreux qu’il y a quinze jours.
Au-delà, de la scène nationale et de la grande structure conventionnée à la petite compagnie de danse ou d’arts de la rue, c’est la solidarité de toute la chaîne culturelle qu’il va falloir retravailler au cours des mois à venir.

En conclusion de ce débat, la parole est à Mme Sylvie Robert, pour le groupe auteur de la demande.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je serai brève, car il est déjà tard.
Les débats consacrés la culture sont essentiels et ils ne sont que trop rares ! Je tiens donc à remercier l’ensemble des orateurs. Madame la ministre, je vous remercie également de vous être prêtée au jeu des questions-réponses après votre propos liminaire.
Vous avez constaté combien mes collègues sont attachés à la culture. La diversité de leurs questions témoigne de l’intérêt qu’ils portent à ce secteur et leur précision est le reflet de leur expertise. En faveur du secteur culturel, notre mobilisation collective est réelle et notre vigilance va continuer, sachez-le.
Tout d’abord, nous serons très attentifs à la mise en œuvre du plan de relance dans nos différents territoires : nous le savons d’ores et déjà, nous devrons assumer une importante mission de contrôle à cet égard.
Ensuite, à la rentrée prochaine, nous nous pencherons sur la situation de l’ensemble des acteurs. Vous l’avez dit fort justement : un certain nombre de dispositions doivent faire l’objet de clauses de rendez-vous. Nous y serons également attentifs.
Enfin, nous veillerons à la poursuite de l’accompagnement financier. Dès le début du mois prochain, un projet de loi de finances rectificative sera soumis à notre examen. Les aides transversales doivent être poursuivies : la culture en bénéficiera, mais nous devons voir précisément comment ces aides seront modulées. Il s’agit de garantir la poursuite des activités culturelles.
Bien sûr, le projet de loi de finances sera une étape importante. Nous avons évoqué le crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant : nous prolongerons ces débats en traitant de la protection sociale et des différents budgets concernés. Vous le savez, sur ces questions, nous serons pleinement mobilisés.
Mes chers collègues, on sait combien l’écosystème culturel est fragile : la crise actuelle l’a particulièrement montré. Il exigera des mesures de soutien et d’anticipation. En parallèle, l’évolution de la situation appellera de nombreuses clarifications.
Cette crise sera peut-être aussi l’occasion de modifier certaines pratiques. Peut-être tendrons-nous désormais vers plus de solidarité entre les lieux et les artistes, vers plus de bienveillance et d’attention. Peut-être cette crise nous permettra-t-elle de repenser notre modèle.
J’insiste toujours sur le caractère exceptionnel du modèle culturel français. Ses fragilités ont été mises au jour, mais cette crise nous permettra peut-être d’aller vers des pratiques plus vertueuses. C’est notre rôle que de les accompagner.
L’enjeu, en définitive, c’est la démocratie culturelle. Il s’agit d’une véritable nécessité : c’est pourquoi l’accès du plus grand nombre de nos concitoyens à l’art et à la culture doit être, véritablement, un objectif collectif et concerté.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.

Nous en avons terminé avec le débat sur la reprise et la relance des activités culturelles.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 3 juin 2021 :
À neuf heures trente :
Trente-cinq questions orales.
À quatorze heures trente :
Explications de vote puis vote sur la proposition de loi tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit, présentée par M. Vincent Delahaye, Mme Valérie Létard et plusieurs de leurs collègues (texte de la commission n° 627, 2020-2021) ;
Débat sur la régulation des Gafam ;
Débat sur le thème « Rétablissement du contrôle aux frontières nationales depuis 2015 : bilan et perspectives ».
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures dix.