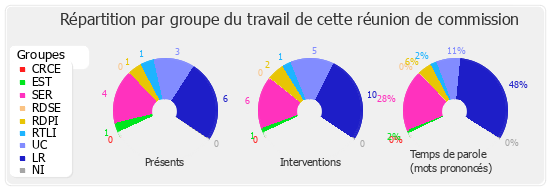Commission des affaires sociales
Réunion du 9 février 2022 à 9h05
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, dans le cadre de la mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19, nous entendons ce matin M. Fabrice Lenglart, directeur, et Mme Charlotte Geay, chef du lab innovation et évaluation en santé de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).
J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande.
Je salue ceux de nos collègues qui participent à cette réunion à distance.
Je rappelle que notre travail n'a pas pour objet de refaire le débat sur le passe vaccinal, dans la mesure où celui-ci a été tranché par le Sénat, qui a adopté ce passe à une large majorité. Nous cherchons plutôt à vérifier qu'un instrument conçu dans un contexte donné, avec un variant donné, est toujours adapté quelques semaines plus tard à une nouvelle configuration de l'épidémie.
Notre audition de ce matin porte sur les données et l'usage qui peut en être fait dans la gestion de l'épidémie.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Fabrice Lenglart et Mme Charlotte Geay prêtent successivement serment.
directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. - La Drees est le service statistique ministériel du ministère des solidarités et de la santé.
Je précise dès maintenant qu'en matière de suivi et de veille sanitaire l'organisme principalement responsable est non pas la Drees, mais Santé publique France (SPF). En effet, la Drees a avant tout pour mission de produire des études structurelles dans le domaine de la santé. Pour le résumer d'un trait, jusqu'à la pandémie, elle ne publiait que les résultats d'enquêtes annuelles ou pluriannuelles, par exemple sur l'état de santé de la population. Ma direction ne produisait pas de statistiques à un rythme infra-annuel.
Ce partage des rôles relativement clair, notamment entre SPF et la Drees, a évidemment été bouleversé par la crise sanitaire : au printemps 2020, la Drees, s'appuyant sur ce qui constituait son coeur de métier, c'est-à-dire aider à comprendre ce qu'il se passe sur un temps relativement long, a notamment lancé avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) une grande enquête en population générale, dite « EpiCov » (épidémiologie et conditions de vie), afin de pouvoir mesurer statistiquement, à un niveau fin sur le territoire, la prévalence de l'épidémie, même si ce type d'enquête ne livre des renseignements qu'après un certain intervalle de temps.
Par ailleurs, la Drees est à la tête d'un panel de suivi des médecins généralistes : elle a donc, dans l'urgence, au début de la crise sanitaire, conduit des enquêtes spécifiques auprès de ces médecins pour en savoir davantage sur leur activité médicale, que celle-ci soit en lien ou non avec la covid-19.
La Drees a évidemment été sollicitée pour ses compétences, notamment en matière statistique, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Au tout début de la première vague épidémique, j'ai ainsi demandé à un certain nombre de personnels de la direction, qu'ils travaillent ou non sur des thématiques liées à la santé, de rejoindre le centre de crise sanitaire pour aider à faire remonter le mieux possible les informations.
La Drees a aussi collaboré à une enquête pour déterminer où se trouvaient les respirateurs dans les hôpitaux. C'est un exemple parmi d'autres des actions que nous avons lancées à ce moment-là.
Petit à petit, le travail s'est formalisé et Charlotte Geay a été nommée, en tandem avec un fonctionnaire de la direction générale de la santé (DGS), pour diriger une équipe de statisticiens chargée de faire remonter des données au centre de crise sanitaire.
Par la suite, la Drees a eu accès aux trois grandes bases de données relatives à la crise de la covid-19 : la base SI-DEP, le système d'information national de dépistage ; la base SI-VIC, qui recense les données portant sur les hospitalisations des personnes atteintes du virus ; la base VAC-SI relative aux personnes vaccinées. Elle y avait déjà accès en théorie, mais les équipes n'ont pu exploiter ces données qu'après qu'elles ont été anonymisées. Protégées par un pseudonyme, ces données individuelles ont été exploitées et nous ont permis de faire des appariements.
J'insiste sur ce point : la Drees a mis en place un système d'appariement qui permet de relier les différentes bases entre elles. À compter du mois de juillet 2021, nous avons régulièrement produit des études statistiques sur le statut vaccinal des personnes hospitalisées, qui font l'objet d'une publication hebdomadaire. En matière de santé, nous avons changé de référentiel : désormais, nous publions des données sur la covid-19 chaque vendredi.
Nous publions également chaque jeudi des statistiques sur les tests, qui servent notamment à surveiller si les délais entre la réalisation des tests et la publication des résultats ne sont pas trop longs. Ces enquêtes sont une réponse immédiate aux difficultés que notre pays a rencontrées lors de la mise en place de la première campagne de tests.
Outre ces statistiques régulières, nous publions des études plus détaillées, en particulier sur le statut vaccinal. Je pense notamment à une étude visant à évaluer l'efficacité vaccinale, non seulement à partir des données agrégées chaque semaine, mais aussi à partir de modèles plus précis. Nous avons également publié les résultats de l'enquête EpiCov, qui a permis de mesurer la part de la population touchée par le virus à certains moments de l'épidémie. Nous devrions publier d'ici quelques semaines les premiers résultats de la troisième vague de cette étude, qui nous permettra de connaître avec précision la part de la population vaccinée à la mi-2021.

De quelle manière le Gouvernement sollicite-t-il la Drees pour obtenir des analyses de données en vue d'éclairer ses décisions dans le cadre de la gestion de crise ? Votre direction a-t-elle contribué, et de quelle manière, à la prise de décision de l'exécutif pour un certain nombre de mesures ?
La Drees, comme toutes les autres directions directement impliquées dans la gestion de la crise sanitaire, au premier rang desquelles on trouve évidemment la direction générale de la santé, la DGS, et la direction générale de l'offre de soins, la DGOS, participe aux réunions de crise organisées extrêmement régulièrement - le rythme est quotidien - sous l'égide du ministre de la santé et des solidarités. Dans cette perspective, lorsque la Drees est susceptible d'aider ou de répondre aux questions du Gouvernement, notamment sur la manière de collecter les données, elle le fait.
Ainsi, lorsqu'il s'est agi de mettre en oeuvre la future politique vaccinale, on nous a demandé si nous étions capables de publier des informations sur l'efficacité des vaccins. On nous a interrogés sur la forme que prendraient ces données, et à quelle fréquence nous serions en mesure de les produire. C'est pour répondre à cette sollicitation que la Drees a mis en place les appariements que j'évoquais tout à l'heure.
J'ai informé le ministre des premiers résultats que nous avions obtenus à la mi-juillet 2021, et je peux vous dire que ces résultats étaient en ligne la semaine qui a suivi. Dès le début, nous avons donc fait preuve de la plus totale transparence.
Par ailleurs, la Drees peut également aider et apporter un soutien matériel aux directions opérationnelles, comme la DGS ou la DGOS. Par exemple, à l'automne dernier, la Drees a aidé la DGOS à lancer une enquête auprès des établissements de santé pour évaluer la proportion des personnels de santé vaccinés.
De manière générale, nous sommes associés dès l'amont à la préparation de dossiers qui peuvent être soumis au conseil de défense sanitaire lorsqu'il se réunit.

Le passe vaccinal vous semble-t-il l'outil le plus approprié pour maîtriser l'épidémie ? En d'autres termes, est-on capable de calculer l'incidence du passe vaccinal sur le taux de vaccination, d'une part, et sur la maîtrise de l'épidémie, d'autre part ?
Ce passe vaccinal est limité dans le temps : est-il pertinent de le maintenir aujourd'hui ? Selon vous, quels sont les critères qui justifieraient une sortie de ce dispositif ?
La Drees produit de l'information statistique pour éclairer les choix du ministère, en particulier en termes d'efficacité vaccinale, depuis l'été 2021. Ces données aident l'exécutif à prendre des décisions, celle par exemple de mettre en place un passe sanitaire ou vaccinal, ou d'accélérer son application. En revanche, elle ne participe à la prise de décision à proprement parler. Je ne suis donc pas vraiment habilité à juger si le passe vaccinal est approprié ou non.
Cela étant, dans les semaines qui ont précédé la décision de mettre en place le passe vaccinal, la Drees a produit un certain nombre de statistiques sur le statut vaccinal des personnes hospitalisées, qui permettaient de conclure avec certitude que le vaccin était efficace, car il contribuait à éviter les formes graves de la maladie et qu'il permettait de prévenir la diffusion du virus - c'était avant l'apparition du variant Omicron. De ce point de vue, la Drees a d'une certaine façon justifié la décision de mettre en place le passe sanitaire.
La mise en oeuvre du passe vaccinal a coïncidé avec l'émergence du variant Omicron, dont la propagation est beaucoup plus rapide que le variant delta. Dans ses publications, la Drees a été assez rapidement capable de distinguer le statut des personnes testées positives et celui des personnes hospitalisées selon la nature du variant.
Nous avons donc pu faire tourner nos modèles, en évaluant cette fois-ci l'efficacité vaccinale selon que les malades sont affectés par le variant delta ou le variant Omicron. Cette étude confirme l'efficacité des vaccins, en particulier celle du rappel six mois après la première dose, pour lutter contre les formes graves de la maladie, qu'elle soit liée au variant delta ou au variant Omicron, en sachant que la probabilité de développer une forme sévère de la maladie est beaucoup plus faible avec Omicron. Elle montre en revanche une bien moindre efficacité des vaccins pour réduire la contagiosité du variant Omicron.
Pour répondre précisément à votre question, je n'ai donc jamais participé à une quelconque discussion sur l'opportunité ou non de mettre en oeuvre le passe vaccinal, mais j'ai fourni des informations de ce type.
Dès lors qu'une large part de la population est vaccinée et donc a priori protégée contre les formes graves de la maladie, la mise en place du passe vaccinal répond, à mon sens, à la nécessité de protéger les personnes non vaccinées en instaurant une forme de contrainte les concernant plus spécifiquement.
De par ma fonction, je ne suis pas non plus le plus qualifié pour vous répondre sur les critères à remplir pour sortir du dispositif. Cela étant, il me semble que le plus important est d'assurer un suivi de la prévalence de l'épidémie, et surtout de son incidence sur le système hospitalier, puisque le passe vise deux objectifs, à la fois protéger la population et faire baisser la pression sur l'hôpital pour qu'il soit en mesure de répondre aux besoins de la population.

Avez-vous établi des statistiques sur les patients atteints du virus en fonction de leur âge et des comorbidités qu'ils présentent ? Les enfants sont-ils nombreux à être infectés ? Ceux d'entre eux qui sont hospitalisés le sont-ils en raison d'une comorbidité ?
Les données que nous traitons sont déclinées par tranche d'âge de vingt ans, par région et par statut vaccinal. Nous ne publions aucune donnée sur les comorbidités, tout simplement parce qu'il n'existe quasiment aucune information à ce sujet dans la base SI-VIC. Il faudrait mobiliser d'autres types d'informations, en particulier celles qui figurent dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), qui recense l'ensemble des données sur les personnes hospitalisées.
Il y a quelques mois, une étude EPI-PHARE a certes fait le lien entre les données de vaccination et le PMSI, mais elle est rétrospective, les données du PMSI n'étant pas disponibles aussi rapidement que celles de la base SI-VIC.
Nous ne publions donc pas de données statistiques sur les seuls enfants.

Selon vous, la Drees bénéficie-t-elle de suffisamment de moyens, notamment humains, pour faire face aux sollicitations auxquelles elle a eu à répondre depuis le début de la crise ? La nécessaire protection des données individuelles vous pose-t-elle des problèmes dans l'exercice de votre mission et a-t-elle entraîné un surcroît de dépenses ?
Autre question, notre commission a auditionné hier le docteur Alice Desbiolles, dont les affirmations nous ont quelque peu troublés. Mme Desbiolles a ainsi déclaré qu'aucune donnée émanant du Gouvernement, qu'aucune preuve ne justifiait la mise en place du passe vaccinal. Elle estime que le recours systématique aux modélisations n'est pas pertinent. Qu'en pensez-vous ?
Comme je l'ai indiqué, au début de la crise, quand la Drees a cherché à se rendre utile, j'ai effectivement dépêché un nombre considérable d'agents au service de la gestion de la crise. Sur les 180 agents de la Drees, une trentaine d'entre eux y consacraient tout leur temps lors du premier confinement, alors même que cela ne relevait théoriquement pas de leur mission.
Nous avons fait avec les moyens du bord, mais la situation s'est très nettement améliorée à partir de la fin 2020, époque où la Drees a bénéficié d'effectifs supplémentaires pour répondre aux besoins liés à la crise sanitaire. Je parle là de cinq ou six personnes, qui ne sont pas des personnels de la Drees, mais qui travaillent sous mon autorité et celle de Charlotte Geay au quotidien.
La protection des données est un sujet qui me tient extrêmement à coeur : c'est dans l'ADN d'un système statistique ministériel et, plus généralement, de la statistique publique d'y être extrêmement vigilant. Nous veillons à la fois au cadre légal et technique des données.
Pour vous répondre sur la pertinence des modèles et des données que nous produisons, je vous invite à regarder nos publications hebdomadaires sur le statut vaccinal de la population : depuis le mois de juillet dernier, nous avons amélioré à plusieurs reprises notre méthodologie, et ce en toute transparence, puisque nous avons systématiquement signalé ces changements, en montrant les effets que cela induisait sur nos données. En statistique, il est parfaitement normal que les outils évoluent et s'améliorent. L'essentiel est de procéder à ces modifications en toute transparence.
Hélas, je n'ai pas regardé l'audition du Dr Desbiolles et ne sais pas précisément ce qu'elle a dit. Le terme de « modélisation » est assez vague. S'il s'agit de modélisations pour mesurer l'efficacité du statut vaccinal, elles peuvent être plus ou moins sophistiquées : elles peuvent porter sur des données agrégées, mais elles peuvent aussi être davantage détaillées et traiter des données individuelles.
À mon sens, les données dont la Drees dispose permettent avec certitude d'affirmer que les vaccins sont efficaces.
Si le terme de modélisation renvoie à d'autres types de mobilisations, comme celle de l'incidence de la dynamique épidémique sur le système hospitalier, qui résultent du travail de chercheurs qui dépendent pour la plupart de l'Institut Pasteur ou de l'Inserm, je pense qu'il conviendrait de les interroger directement. À mon avis, il s'agit moins de prévisions que de projections qui dépendent de critères nombreux et variables, comme la contagiosité des différents variants ou les comportements de la population au quotidien. De tels modèles sont utiles pour éclairer la décision, mais les résultats auxquelles ils permettent d'aboutir dépendent, par définition, des hypothèses sur lesquelles ils reposent, lesquelles ne peuvent être établies en amont avec une certitude absolue.
Non, la Drees ne conduit aucune étude sur ce thème, d'autant qu'elle n'en a pas les moyens en l'état actuel des choses, en tout cas pas avec les bases de données dont je vous ai parlé.
De tels travaux sont pourtant fondamentaux. La Drees pourrait éventuellement y contribuer à moyen terme, mais ils réclameraient à coup sûr de mobiliser un plus grand ensemble d'informations, d'appareiller des données de test et des données ayant trait à ce que l'on appelle le système national des données de santé (SNDS), de façon à suivre les personnes dans la durée. La France dispose d'un système d'information qui permettrait de produire des informations intéressantes à cet égard, y compris sur le long terme.

Ne serait-il pas opportun de moderniser la plateforme Health Data Hub, qui sert normalement à recueillir des données à but de recherche ? Dans un rapport récent, nous avons préconisé la mise en place d'un recueil adapté à la gestion de crise, un Crisis Data Hub en quelque sorte, qui permettrait d'être plus réactif. Une telle cellule nous permettrait aussi de mieux circonscrire le passe vaccinal, en l'adaptant aux caractéristiques du variant Omicron par exemple, et de modifier la stratégie de notre pays à la fois en termes de vaccination et de test.
Selon vous, est-il envisageable de réserver le passe vaccinal aux personnes âgées, par exemple, avant de le supprimer complètement ? Ne pourrait-on pas aussi le cibler sur les personnes fragiles, puisque vous nous avez expliqué que vous ne disposiez pas des données sur la comorbidité des malades, mais que de telles informations existaient bel et bien ?
Enfin, que proposeriez-vous pour que la stratégie de test soit plus adaptée à la situation actuelle et plus efficace ?
La plateforme des données de santé, dite Health Data Hub, est un outil extrêmement important et très prometteur. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que la Drees en est l'initiatrice.
L'idée qui sous-tend la mise en place de cette plateforme est que l'on peut, sous certaines conditions juridiques et techniques extrêmement strictes, réunir en un même endroit un ensemble de bases de données ayant trait à la santé, et les partager, de sorte à multiplier nos capacités de recherche et d'innovation.
Tel que je le conçois, ce rôle est absolument crucial, mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse pour autant de l'instrument à privilégier pour gérer et suivre une crise. Comme je vous l'ai dit, les réunions de crise sont quotidiennes : nous avons donc besoin d'un système d'information plus proche du pouvoir décisionnel, des équipes de Santé publique France et de la DGS, et qui permette à l'exécutif de disposer rapidement des données les plus récentes possible.
L'outil Health Data Hub serait à coup sûr très utile si l'on veut, par exemple, démultiplier les études sur le covid long, ne serait-ce que parce que cette plateforme, conjointement avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), a pour mission d'abriter ce que l'on appelle le système national des données de santé, dont le périmètre a vocation à s'élargir.
Pour éviter tout malentendu, je précise que la Drees interprète bel et bien les données qu'elle produit. Ainsi, lorsque j'affirme que les vaccins sont efficaces, je le fais sur le fondement des études que la Drees publie à ce sujet. De manière générale, cette direction fournit des informations qui constituent une aide à la décision, mais ne participe pas à la prise de décision en tant que telle, ce qui est normal : chacun doit rester dans son rôle.
J'en reviens au passe vaccinal. Ce qui a changé avec l'arrivée du variant Omicron, c'est que la contagiosité du virus est devenue telle que l'on peut être contaminé du jour au lendemain. Le passe vaccinal présente donc un réel intérêt de ce point de vue par rapport au passe sanitaire. Je précise par ailleurs que je n'ai jamais dit que le vaccin était totalement inefficace face à Omicron, mais qu'il était beaucoup moins efficace.
Dans ce contexte, passer du passe sanitaire au passe vaccinal revient à prendre acte de la grande difficulté qu'il y a à empêcher le virus de circuler, et à faire en sorte de protéger la population qui risque le plus de développer des formes graves de la maladie, à savoir les non-vaccinés. Il ne faut pas oublier qu'en dernier ressort la forte contagiosité du variant Omicron induit une pression importante sur notre système hospitalier.

Lors de son audition hier, le docteur Desbiolles a bouleversé les quelques certitudes ou convictions que nous avions depuis le début de cette crise. Ma question découle directement des propos qu'elle a tenus : dans la mesure où la Drees est placée sous l'autorité du ministre de la santé et des solidarités, pensez-vous qu'il soit sain qu'un ministère soit chargé de se juger lui-même ? Peut-on attendre autre chose de la Drees que la promotion des décisions du ministre ?
Un service statistique ministériel est d'abord une entité qui fait partie du système statistique public, dont le navire amiral est, en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce système est couvert par un règlement européen, qui garantit, y compris en droit français, l'indépendance professionnelle des statistiques publiques. Pour ce qui est des publications de la Drees, en tant que producteur de statistiques mises à la disposition du grand public, je peux vous assurer qu'elles résultent d'un travail frappé du sceau de l'indépendance professionnelle, et j'assume l'entière responsabilité de leur qualité et de la façon dont on peut les interpréter.
Un service statistique ministériel a une autre fonction, celle d'éclairer les politiques publiques du ministère dont il relève, en l'occurrence pour la Drees, les politiques publiques en matière sanitaire et sociale. Dans le cadre de mes fonctions, je peux être amené à conseiller le ministre et ses collaborateurs, au vu des données que nous collectons et publions, sur la mise en oeuvre de telle ou telle politique.
Enfin, un service statistique ministériel doit aider les directions qui sont plus opérationnelles. Lorsque j'ai envoyé des équipes pour aider la DGOS à trouver les respirateurs lors de la première vague épidémique, nous étions tout à fait dans notre rôle.
Le ministère de la santé est chargé de mettre en oeuvre les politiques sanitaires. Il me semble naturel qu'il puisse s'appuyer sur un service qui produit et publie des statistiques avec la plus entière indépendance professionnelle et l'aide à évaluer ses politiques, en l'occurrence la Drees. J'estime que le système actuel est assez bien conçu. D'ailleurs, rien ne s'oppose à ce que d'autres organismes d'évaluation ou le Parlement portent un regard extérieur sur les politiques du ministère.

Vous nous avez indiqué que vous produisiez des données par tranche d'âge de vingt ans : dans le contexte actuel, alors que l'on incite de plus en plus les enfants à se faire vacciner, ne jugez-vous pas utile de travailler sur des tranches d'âge plus réduites ?
Hier, le docteur Desbiolles a déclaré qu'un certain nombre de mesures avaient été prises sur le fondement d'analyses prospectives qui présentaient en définitive des résultats très différents de la réalité : à votre connaissance, existe-t-il des enquêtes évaluant l'écart entre ces projections et les chiffres constatés a posteriori ?
En effet, nos évaluations portent sur des tranches d'âge de vingt ans. Je rappelle que la Drees n'est pas l'organisme chargé de publier des données sur l'épidémie de covid-19 et que Santé publique France fournit des données beaucoup plus détaillées, y compris sur les enfants. Cela étant, si une politique vaccinale spécifique aux enfants est mise en oeuvre, il est tout à fait envisageable d'enrichir nos données.
Quant à votre question sur les analyses prospectives, je suis un peu gêné pour vous répondre, car je n'ai pas vu l'audition du Docteur Desbiolles. À vous entendre, je crois comprendre qu'elle évoquait des prévisions sur l'incidence de l'épidémie sur le système hospitalier : s'il s'agit bien de cela, sachez que la Drees ne travaille pas sur ce sujet.

D'après vous, le passe vaccinal servirait principalement à protéger les non-vaccinés, en les obligeant à limiter leurs interactions sociales, et à protéger le système de soins. Son efficacité doit par conséquent être évaluée à l'aune de ces deux objectifs.
Sur un plan statistique, connaissez-vous la proportion de personnes fragiles, en raison de leur âge ou de leurs comorbidités, parmi les 5 millions de personnes non vaccinées ? Parmi les personnes hospitalisées, quelle est la proportion de personnes fragiles ? Il me semble que c'est en fonction des réponses chiffrées que l'on sera capable d'apporter à ces deux questions que l'on pourra réellement juger de l'efficacité du dispositif mis en place.
Le passe vaccinal vise un troisième objectif : inciter à la vaccination.
Les données que nous publions permettent de démontrer avec certitude que la part des personnes non vaccinées qui sont hospitalisées, parce qu'elles ont développé une forme grave de la maladie est, en proportion de la population qu'elles représentent, beaucoup plus élevée que celle des personnes vaccinées qui sont hospitalisées.
On est également capable de détailler ces données par tranche d'âge, ce qui nous a permis de conclure que le risque de développer une forme grave de la maladie était directement lié à l'âge du patient. On sait également que ce risque est corrélé avec les comorbidités, mais comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas les moyens de publier des statistiques à ce sujet. Dans la base VAC-SI, ces données existent, mais elles sont insuffisamment détaillées et, donc, inexploitables. Des données de meilleure qualité figurent dans le PMSI, mais elles sont disponibles avec un temps de retard.

Après l'annonce de l'instauration du passe vaccinal, on a constaté une hausse du nombre de primo-vaccinés. Où en est-on aujourd'hui : la courbe des vaccinations est-elle toujours aussi haute ?
Les données de SPF sont révélatrices : on observe une augmentation notable des primo-vaccinations au mois de janvier, mais la tendance est moins marquée depuis quelques semaines.
La Drees a publié une étude qui prouve la corrélation entre l'annonce du Président de la République d'une accélération de la mise en place du passe sanitaire l'été dernier et la hausse du nombre de tests. Nous n'avons en revanche aucune information scientifique démontrant une causalité entre cette annonce et la hausse du nombre des vaccinations, même si l'observation des courbes laisse peu de doute.
Dernier point, la Drees n'a pas publié d'étude contrefactuelle pour tenter de décrire ce qu'il se serait passé si un nombre moins important de personnes s'était fait vacciner ; néanmoins, les statistiques que nous publions permettront à d'autres de faire ce type de calcul. Je renvoie en particulier à l'étude du Conseil d'analyse économique (CAE) dont vous avez sans doute entendu parler.

À ce propos, que pensez-vous de la méthodologie à laquelle le CAE a recouru et des résultats auxquels il a abouti ?
Cette étude, qui conclut que l'accélération de la campagne de vaccination a permis de diminuer sensiblement la pression sur l'hôpital et de réduire le nombre de décès occasionnés par le virus, est sérieuse, et sa méthodologie est claire. Un tel travail se fonde sur un certain nombre d'hypothèses, qui peuvent évidemment être débattues, mais il me semble solide.

Merci beaucoup pour l'ensemble de vos réponses.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux en entendant à présent MM. Nicolas Berrod, journaliste, Germain Forestier, chercheur, et Guillaume Rozier, fondateur du site CovidTracker.
Je rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande.
Notre audition porte sur les données et sur l'usage qui peut en être fait dans la gestion de l'épidémie. Vous êtes tous trois usagers des données publiques pour l'information du public. Vous nous livrerez vos analyses sur ce que ces données peuvent apporter au traitement de notre sujet.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, MM. Nicolas Berrod, Germain Forestier et Guillaume Rozier prêtent successivement serment.
Je suis consultant en data science, autrement dit data scientist. Mon métier consiste à traiter des masses de données informatiques, en utilisant un certain nombre d'outils statistiques qui permettent de mieux comprendre ces données et de les mettre en exergue, via des visualisations de données ou des traitements beaucoup plus lourds qui relèvent de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle ou le machine learning. Ce travail peut aider à la prise de décision et permet de réaliser des analyses prospectives.
En parallèle, je travaille depuis deux ans sur les données liées à la covid-19. Dès la fin du mois de février 2020, quelques semaines avant le premier confinement en France, j'ai commencé à m'intéresser à l'épidémie et tenté de comprendre comment elle évoluait en France par rapport à d'autres pays, notamment la Chine et l'Italie.
Dans la mesure où je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions parmi les informations gouvernementales ou dans les différents médias, j'ai décidé de me plonger moi-même dans les données existant sur internet et de les analyser. Cette démarche m'a amené progressivement à créer une plateforme, un site internet, nommé covidtracker.fr, qui, au début, était très simple et artisanal, puis qui s'est étoffé au fil des mois. L'objectif est de faire de la pédagogie, c'est-à-dire de faire comprendre la situation épidémique et sanitaire aux Français, et de montrer son évolution dans le temps en produisant des graphiques et des statistiques.
Par la suite, la plateforme a permis aux internautes de suivre la campagne de vaccination, via l'outil VaccinTracker. Elle les a aussi aidés à calculer le risque de contracter la maladie en participant à un événement. Cette démarche permet aux Français de mieux comprendre ce que peut signifier par exemple la notion de taux d'incidence.
J'ai créé une seconde plateforme très populaire, « Vite Ma Dose », qui agrège les données de l'ensemble des plateformes de vaccination, Doctolib comme les autres.
Ces deux outils, CovidTracker et Vite ma Dose, ont totalisé des dizaines de millions de visites : je m'en réjouis, d'autant que ce succès n'avait pas du tout été anticipé.
Je suis journaliste au Parisien depuis maintenant trois ans, et cela fait maintenant près de deux ans que je couvre l'épidémie de covid-19. En tant que journaliste, j'essaie de décrypter, d'analyser, de raconter et de répondre aux différentes questions que se posent les lecteurs sur tous les aspects de cette pandémie.
Le travail que l'on réalise quotidiennement repose évidemment en grande partie sur les données publiques, non seulement parce qu'elles peuvent inspirer des sujets et des angles de reportage, mais aussi parce qu'elles permettent parfois de confronter une stratégie à la réalité.
Dans le cadre des travaux que vous menez sur le passe vaccinal, différents types de données me semblent intéressantes : je pense au nombre de primo-injections quotidiennes, c'est-à-dire le nombre de personnes qui reçoivent une première dose de vaccin chaque jour. On a pu observer à cet égard que, lorsque le passe vaccinal est entré en vigueur à la mi-décembre, le nombre des primo-vaccinations avait augmenté. On a aussi constaté à cette occasion que les jeunes adultes étaient ceux qui se faisaient le plus vacciner.
Il y a aussi les données mises à disposition par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), lesquelles permettent de savoir, parmi les vaccinés et les non-vaccinés, le nombre d'hospitalisations, de cas positifs et de décès. Ces informations nous donnent une idée du risque supplémentaire, notamment de forme grave de la maladie, que court un individu s'il n'est pas vacciné. C'est un élément important, puisqu'il s'agit du principal argument avancé par le Gouvernement pour justifier la mise en place du passe vaccinal.
Je suis professeur des universités en informatique à l'Université de Haute-Alsace, qui se situe à Mulhouse. Je suis informaticien de formation et effectue de la recherche en informatique, plus spécifiquement en analyse de données.
J'ai été amené à travailler sur les données liées à la covid-19 au tout début de la première vague épidémique, dont Mulhouse était vraiment l'épicentre. À l'époque, je cherchais déjà à connaître le nombre des contaminations.
À travers les réseaux sociaux, j'ai constaté qu'il existait un réel engouement pour les visualisations de données sur l'évolution de l'épidémie ; j'ai également vu que Santé publique France mettait à la disposition du grand public énormément de données liées à l'épidémie.
Grâce à mes compétences en informatique, j'ai alors créé un programme permettant de générer automatiquement des graphiques, en les déclinant par territoire ou par tranche d'âge par exemple. Depuis deux ans, je poursuis ce travail indépendamment de mon métier d'enseignant, notamment sur les réseaux sociaux et, plus particulièrement, sur Twitter, où je poste régulièrement les graphiques que je produis et où j'essaie de trouver une manière de présenter les données qui parle au plus grand nombre.

Quelles sont les données que vous utilisez ? Effectuez-vous des retraitements ? Constatez-vous des difficultés dans l'accès aux données concernant le suivi de l'épidémie ? Si oui, de quel ordre ?
Vous avez notamment alerté, au début du mois de janvier, sur le changement de méthodologie dans la traçabilité du variant Omicron par Santé publique France. Ces changements sont-ils fréquents et, selon vous, justifiés ?
Quelles données regrettez-vous de n'avoir pas à votre disposition pour mieux suivre l'évolution de la crise sanitaire en France ?
Nous utilisons plusieurs types de données. Nous avons un certain nombre de données épidémiques - dépistage, tests positifs ou négatifs... - et sanitaires - admissions à l'hôpital, nombre de personnes hospitalisées en soins critiques et décédées à l'hôpital, etc. Ces données sont publiées par Santé publique France. Nous utilisons également des données concernant la vaccination : rythme de vaccination, nombre de personnes vaccinées avec une, deux ou trois doses, avec ou sans rappel...
Le troisième acteur de la publication des données est la Drees, qui publie notamment le statut vaccinal des personnes admises à l'hôpital. La Drees a effectué un appariement entre, d'un côté, les bases de données des personnes vaccinées et, de l'autre, celles des personnes admises à l'hôpital, pour connaître la proportion de personnes vaccinées admises à l'hôpital.
Tels sont les trois principaux jeux de données que j'utilise personnellement pour réaliser mes analyses.
Il faut savoir que ces données sont publiées en open data, c'est-à-dire de manière libre et gratuite sur internet. Que ces données soient publiées sur internet dans des formats informatiques permettant de les exploiter très facilement est la condition nécessaire pour que les citoyens puissent les réutiliser. C'est très important. Certains acteurs - je pense notamment au ministère de l'éducation nationale - publient les données dans des formats PDF, lesquels sont très difficilement réutilisables.
Les données publiées en open data doivent aussi, pour avoir de l'intérêt, être publiées avec une certaine fraîcheur, c'est-à-dire être mises à jour régulièrement, et être de bonne qualité - il ne doit pas y avoir d'erreurs ni de données manquantes.
Ces données ont été publiées petit à petit. Cela n'a pas été une évidence dès le début de l'épidémie. La France est aujourd'hui l'un des pays les mieux placés en termes de publication des données relatives au covid-19 : un certain nombre de données y sont publiées en open data, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Au début du mois de mars 2020, aucune de ces données n'était publiée en open data. Puis, les données sanitaires ont été publiées, en mai 2020, sur l'initiative de Santé publique France : suivi des données de dépistage. Ensuite, les mois passant, les données ont été affinées, notamment par régions, départements et tranches d'âge. D'autres jeux de données sont arrivés, comme la vaccination, en janvier 2021, puis les données d'appariement de la Drees, en juillet 2021.
Un certain nombre de ces données ont été publiées sous l'impulsion de citoyens voulant les réutiliser. Nous avons parfois dû formuler des demandes très insistantes auprès de certaines organisations pour les obtenir. Auraient-elles été publiées sinon ? Nous l'ignorons.
Je pense notamment au ministère des solidarités et de la santé. Au tout début de la campagne de vaccination, il était très difficile d'obtenir des données de façon ouverte. À cette époque, nous avions lancé, sur CovidTracker, VaccinTracker, qui permettait de suivre la campagne de vaccination, mais aucune donnée officielle n'était publique. Nous comptabilisions donc nous-mêmes les vaccinations, notamment via les articles de presse. Nous avons dû être très insistants et arrêter VaccinTracker pour que le ministère de la santé publie, deux semaines plus tard, les données.
Je pense aussi au ministère de l'éducation nationale, auquel nous avons adressé, ces derniers mois, un certain nombre de demande pour obtenir des données. Il a été très difficile de les obtenir. Certaines d'entre elles n'ont toujours pas été publiées en open data à ce jour.
Dans d'autres cas, cela a été fait avec succès. Je pense notamment à la Drees, à laquelle nous avions demandé la publication des données de statut vaccinal pour les hospitalisations. La Drees a répondu favorablement à cette demande l'été dernier.
Je trouve regrettable que toutes les administrations ne veuillent pas forcément publier leurs données par défaut. Que les données non personnelles soient publiées en open data de manière libre et gratuite, à des fins de transparence, pour que les citoyens puissent les réutiliser et les analyser devrait vraiment être un paradigme dans toutes les organisations d'État, des ministères, des administrations.
Vous avez évoqué le changement de méthodologie Omicron. Deux méthodes permettent de suivre l'évolution des variants de cette épidémie.
La première est le séquençage, qui permet de connaître précisément le génotype des virus, donc de savoir précisément à quel variant on a affaire pour chaque cas positif. Le problème du séquençage est qu'il est long - il prend plusieurs jours, voire une à deux semaines -, et coûteux. En proportion, on n'en fait pas beaucoup : en France, seuls 1 % des tests positifs sont séquencés.
Depuis un peu plus d'un an et demi, Santé publique France réalise un criblage ; la direction générale de la santé (DGS) a aussi demandé à le faire. Celui-ci permet de viser certaines cibles précises, donc certaines mutations. Il ne permet pas de connaître précisément le variant auquel on a affaire ; il ne permet qu'une suspicion très forte. Le criblage est fait de manière beaucoup plus systématique : sur 100 cas positifs, plusieurs dizaines sont criblées, ce qui permet de suivre relativement précisément le développement de certains variants.
Via le criblage, on suivait une mutation appelée L452R, ce qui permettait un suivi relativement précis d'Omicron. Or la DGS a décidé de changer de système de criblage, de manière à détecter plus précisément Omicron, avec plusieurs cibles. La conséquence a été un arrêt du suivi d'Omicron à un moment critique, à la fin du mois de décembre, alors que ce variant était en train de se développer. Cette situation a peut-être été liée à un manque de fluidité entre la DGS et Santé publique France. En tout état de cause, je sais que Santé publique France a travaillé très dur à la fin du mois de décembre, entre les fêtes de fin d'année, pour appliquer la nouvelle méthode le plus rapidement possible.
De quelles données manquons-nous ? Nous effectuons en permanence des nouvelles demandes de données, mais la situation évolue extrêmement vite, ce qui est source de complexité. À certaines périodes, nous avons besoin de données extrêmement rapidement, comme, par exemple, pour le suivi d'Omicron.
Les données qui m'ont le plus intéressé ces dernières semaines sont celles de l'éducation nationale : nombre de classes et d'écoles fermées, de cas positifs chez le personnel et les élèves... Or ces données sont parcellaires. Elles sont publiées de manière partielle et sont mises à jour de façon relativement peu fréquente.
On peut déjà commencer par rappeler que la France n'a vraiment pas à rougir - en tout cas par rapport à nos principaux voisins - du nombre de jeux de données qui sont mis à disposition.
Parmi les sources de données, il y a Santé publique France, la Drees, mais aussi l'assurance maladie, qui publie ses propres données de vaccination depuis le printemps dernier. L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie des données relatives à la mortalité. Ces différentes sources peuvent parfois donner l'impression d'une difficulté à travailler ensemble. Pour les données relatives à la vaccination, choisit-on Santé publique France ou la sécurité sociale ? Cela dépend de ce que l'on veut en faire. Il n'est pas facile de s'y retrouver.
Pour ce qui concerne le retraitement, je prends un exemple tout bête : si l'on fait un graphique sur le nombre de personnes qui se font vacciner chaque jour, en prenant pour point de départ le tout début de la pandémie, les premières doses seront à des niveaux beaucoup plus bas, mais, si l'on fait un zoom depuis l'automne dernier, on aura l'impression qu'elles sont toujours à un niveau élevé. L'information envoyée dépend donc de la façon dont on va mettre en forme les données, dont on va les représenter.
Quand nous travaillons sur un sujet, nous devons donc nous demander, par anticipation, ce que nous voulons montrer, avec quelles données et quelle est la mise en forme la plus adaptée pour atteindre le but recherché.
Pour ce qui est des difficultés d'accès, il est vrai qu'existe la tentation de vouloir toujours plus de données, mais nous avons parfois du mal à comprendre que des données publiées dans les rapports hebdomadaires de Santé publique France ne soient pas en open data, ce qui nous empêche de les exploiter. C'est toujours un peu rageant, même si l'on comprend qu'il y ait des contraintes techniques ou opérationnelles.
Je peux citer l'exemple des hospitalisations « pour et avec covid », c'est-à-dire des patients qui sont porteurs du SARS-CoV-2, que l'on appelle aussi les « patients covid ». On sait qu'une part d'entre eux est hospitalisée en priorité pour un motif autre que le covid. Cette information figurait dans les rapports hebdomadaires de Santé publique France il y a maintenant près d'un an, mais plus à l'automne. Nous voulions que cette donnée, qui nous semblait intéressante, soit ajoutée aux données qui sont mises à jour chaque soir. Nous sentions que le public était demandeur de cette information. Cette donnée a fini par arriver, il y a quelques jours, en open data. Nous en sommes très contents.
Guillaume Rozier a beaucoup parlé du changement de traçabilité : il pouvait effectivement être un peu frustrant et étonnant, alors qu'Omicron était en train de s'implanter en France, de ne plus pouvoir mesurer dans quelle région il progressait le plus. La situation est désormais rétablie, avec le nouveau système dont a parlé Guillaume, mais c'est vrai qu'il y a eu une période de flou au coeur des vacances de Noël.
Oui, il y a toujours des données que l'on regrette de ne pas avoir. Je peux en citer deux. Premièrement, la part, parmi les cas positifs, de symptomatiques et d'asymptomatiques, est une information qui me semblerait intéressante, surtout avec Omicron, alors que 300 000 cas positifs ont pu être recensés en 24 heures. Deuxièmement, il serait intéressant que nous puissions savoir combien de personnes, parmi les vaccinés qui n'ont pas encore reçu leur dose de rappel, ont été infectées il y a moins de trois mois et n'ont donc pas besoin de cette dose pour garder leur passe. Cette information serait précieuse, mais elle est impossible à avoir ; on ne peut que faire des estimations.
Concernant les retraitements, je suis très attaché à ce qu'il y ait une cohérence entre ce que l'on va calculer et publier de notre côté, en tant que citoyens, et les valeurs qui vont être affichées, par exemple sur le site officiel de Santé publique France. Si j'indique que le taux d'incidence actuel, en France, est de 2483, j'espère retrouver le même chiffre chez Guillaume Rozier ainsi que chez Santé publique France. Les données sont présentées de manière un peu différente, de façon à mettre en lumière certains aspects, mais les données nous affichons sont a priori les mêmes que celles des agences sanitaires.
Nous pouvons être amenés à effectuer quelques calculs, mais ces derniers sont tout à fait cohérents par rapport à ce qui est fait au niveau des agences sanitaires.
Il est effectivement important que nous puissions accéder aux données en open data. Les fichiers doivent pouvoir être facilement réutilisables par des programmes informatiques.
S'agissant des données que nous regrettons de ne pas avoir à notre disposition, je pense à la précision, notamment géographique, de certaines données. Nous avons souvent demandé à pouvoir descendre plus bas que le département, parce que les gens voulaient connaître le taux d'incidence dans leur commune, dans leur communauté de communes, etc. Des données infradépartementales sont fournies par Santé publique France, par tranche d'incidence - entre 0 et 100, entre 100 et 200... Au demeurant, cela pose des problèmes d'anonymisation des données : Santé publique France a cette contrainte de ne pas trop aller dans les détails, pour que l'on ne puisse pas identifier les personnes.
Nous demandons très régulièrement de nouvelles données. Nous sommes conscients que nous nous comportons là en enfants gâtés, puisque nous avons déjà énormément de données en France - notre pays est bien positionné au niveau international quant à la quantité d'indicateurs disponibles.
Concernant les données de l'éducation nationale, il faut savoir que nous n'avons eu les données, notamment les taux d'incidence par niveau scolaire, qu'à partir d'avril 2021. Précédemment, il y avait deux tranches d'âge - 0-9 ans et 10-19 ans -, ce qui était assez peu précis pour suivre l'épidémie au niveau des écoles. Depuis avril, les tranches d'âge sont beaucoup plus précises pour les taux d'incidence, mais un certain nombre d'informations ne sont malheureusement toujours pas disponibles. Cette situation est frustrante, parce qu'il s'agit de données que l'on peut retrouver dans des fichiers PDF diffusés çà et là, mais dont la reconstruction requiert un travail de fourmi.
L'information sur les réinfections nous intéresserait également. Elle existe d'ores et déjà. Actuellement, dans la base SI-DEP, qui contient les informations relatives aux contaminations, on considère qu'une personne est réinfectée si elle a deux tests positifs séparés de 60 jours. Quand plusieurs tests positifs sont réalisés au cours d'une même semaine, un seul est compté pour le taux d'incidence.
Il existe d'autres données : des données de séquençage, des données de séroprévalence, des données issues des études de cohortes. Ces données existent à différents endroits, mais ne sont pas facilement accessibles pour les personnes qui souhaitent les réutiliser.

Vous avez tous trois un positionnement un peu particulier, puisque vous traitez de l'information en vous situant entre les autorités sanitaires et le grand public.
Quelle est votre ligne éditoriale pour diffuser les différents messages ? Selon quel critère retenez-vous une information plutôt qu'une autre ?
Avez-vous mesuré l'impact de vos publications sur l'information relative au covid, mais aussi sur l'incitation à la vaccination ainsi que dans la lutte contre les fake news ?
N'avez-vous pas quelquefois le sentiment de faire doublon avec d'autres organismes - Santé publique France, la Drees, etc. - en retraitant les données ?
Quel regard portez-vous sur les conséquences du passe sanitaire, puis du passe vaccinal, en particulier au travers des différentes plateformes de rendez-vous ?
La question du critère est très importante ; on nous la pose assez régulièrement.
J'essaie, dans mes publications, de rester au plus près de ce que publie également Santé publique France. Nous recalculons quelques indicateurs, comme des taux d'augmentation qui ne sont pas affichés de manière explicite chez Santé publique France. Cependant, je ne fais pas d'analyse plus précise de ces données : je les montre simplement de manière différente.
L'impact de ce que nous faisons est assez difficile à évaluer, mais nos travaux ont l'air d'intéresser du monde si l'on se fie au nombre de personnes qui nous suivent. Nous avons été étonnés, Guillaume Rozier et moi, de l'intérêt des citoyens. Il faut dire que la pandémie de covid 19 rythme leur vie depuis deux ans...
Pour lutter contre les fake news, on essaie d'expliquer les données et de faire de la pédagogie, notamment sur leurs limites. Certaines données peuvent être mal interprétées. Par exemple, jusqu'à très récemment, les données d'hospitalisation, de réanimation, de décès pouvaient uniquement être obtenues en fonction de la date de déclaration : quand on dit qu'il y a eu 200 décès en 24 heures, ce sont 200 décès qui ont été déclarés en 24 heures, mais ils ont pu survenir la semaine précédente. Nous l'avons répété sans cesse depuis deux ans, mais ce n'est pas encore intégré.
De même, certaines comparaisons sont effectuées jour après jour, mais on ne peut comparer le chiffre du lundi avec celui du dimanche : il y a systématiquement une sous-déclaration le week-end et une surdéclaration en début de semaine. Il faut donc calculer des moyennes sur une semaine pour avoir des chiffres plus fiables.
Nous essayons de faire oeuvre de pédagogie et d'expliquer ces limites, ce qui est aussi une façon de lutter contre les fake news.
Nous sommes régulièrement interpellés sur le fait que nous travaillerions en doublon. Il ne serait pas normal que des citoyens fassent ce travail, qui relèverait des seules autorités sanitaires, comme Santé publique France. Ce n'est pas du tout ainsi que je vois les choses. L'open data est vraiment un vecteur d'innovation : les possibilités d'utilisation, de présentation, de restitution des données deviennent infinies.
La démarche consistant à proposer les données en open data est vraiment une invitation à les tester, à les vérifier ou à proposer des choses originales. Nous représentons ici plein de personnes qui, sur les réseaux sociaux, s'intéressent aux données et cherchent à les présenter de manière innovante.
Je considère plutôt que nos travaux se complètent. En revanche, je n'avais pas anticipé que certaines personnes auraient plus confiance dans nos chiffres et nos publications que dans ceux des autorités sanitaires. Le fait que ce soit un citoyen qui ait récupéré les données, qui les ait formatés, que ce ne soit pas le Gouvernement qui parle, nous donne un capital confiance supérieur.
S'agissant de la ligne éditoriale, je travaille, pour ce qui me concerne, sur deux produits : les graphiques quotidiens, que je mets à jour en expliquant leurs limites, et les articles que j'écris pour Le Parisien, qui me donnent la possibilité d'approfondir un sujet, de faire réagir des chercheurs, des épidémiologistes, des scientifiques, des médecins.
Si, par exemple, on atteint un pic de patients en soins critiques, on va essayer de raconter comment cela se passe, sur le terrain. De fait, il ne faut pas oublier que, derrière le nombre de morts, il y a des personnes et des familles. Derrière le nombre de patients hospitalisés, il y a des soignants. Il est donc important de faire des articles pour raconter ce qu'impliquent ces données, concrètement, sur le terrain.
La lutte contre les fausses informations qui peuvent circuler, et Dieu sait qu'il y en a eu lors de cette crise, constitue une grande partie de mon travail de journaliste. Des choses ont pu être dites, que les données ne permettaient pas de vérifier.
L'intérêt d'avoir autant de données à disposition - nous n'avons pas parlé des données à l'étranger, mais nous en disposons aussi via d'autres sources - est de pouvoir, procéder à des comparaisons et, ainsi, vérifier assez rapidement ce qui peut être dit par des personnalités politiques ou sur les réseaux sociaux et qui n'est pas forcément vrai.
Cela dit, je suis bien conscient qu'il y a des personnes que l'on n'arriverait pas à convaincre, même avec des articles, des graphiques ou des publications sur Twitter, ou qui continueront de ne pas croire ce qu'on peut leur raconter.
Il est arrivé à plusieurs reprises que les données qui étaient mises à disposition par les agences publiques aient été corrigées parce que ces dernières se sont rendu compte qu'il y avait des erreurs ou des doublons. J'en prendrai deux exemples.
Premièrement, au début de l'année dernière, le nombre de cas positifs était légèrement surestimé du fait de doublons : des personnes avaient été testées positives avec un test antigénique, puis un test PCR. Ces personnes pouvaient donc apparaître à deux reprises dans les cas positifs, ce qui était évidemment un problème. Je l'ai appris en février, et cela a été corrigé en avril. Sur ce point, notre travail a consisté à rédiger des articles pour expliquer, de façon pédagogique, ce qui s'était passé.
Il est donc toujours important de préciser les limites des données que l'on montre, avec modestie. Ce n'est pas grave en soi, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi les données ont changé.
Deuxième exemple, sur le sujet très sensible des hospitalisations selon le statut vaccinal, les données sont complexes, parce qu'elles impliquent de croiser différentes bases de données. Le nombre de non-vaccinés n'était donc pas forcément cohérent avec celui de Santé publique France. La Drees s'en est rendu compte ; elle a changé à la marge son mode de calcul, ce qui a modifié le nombre de non-vaccinés, donc les taux d'hospitalisation, de cas positifs...
Il est important d'expliquer que les données ont des limites et qu'elles peuvent être corrigées. Nous le faisons sur Twitter et via mes articles. Si nous faisons preuve de pédagogie, cela ne pose pas de problème.
Comme Germain Forestier, je ne pense vraiment pas que nous faisons doublon. Je pense plutôt que nous sommes complémentaires des agences officielles. Toutes les visualisations, tous les graphiques, tous les articles que nous pouvons faire, Santé publique France ou l'assurance maladie les font aussi, mais ce n'est pas leur coeur de métier : en termes de visualisation, nous avons le champ libre. D'ailleurs, certaines figures de Guillaume Rozier sont souvent évoquées par Alain Fischer et des graphiques de Germain Forestier ont pu apparaître dans les avis du conseil scientifique. En fait, il s'agit d'une sorte d'écosystème, qui profite un peu à tout le monde.
Quel a été l'impact du passe sanitaire, puis du passe vaccinal notamment sur la vaccination ? Quand Emmanuel Macron a annoncé l'instauration d'un passe sanitaire, le 12 juillet à 20 heures, le site Doctolib était saturé deux minutes plus tard... Énormément de gens ont dû se dire que, pour aller au restaurant ou au cinéma, ils devraient avoir un passe, donc se faire vacciner. L'impact a donc été majeur.
S'il y a eu un petit rebond des primo-injections lorsque le passe vaccinal a été annoncé mi-décembre, il est important de noter que ce rebond était en partie porté par les enfants, qui venaient d'être éligibles. Les données montrent que ce sont surtout les jeunes adultes - ceux qui sont le plus susceptibles de vouloir aller au restaurant ou au cinéma - qui se sont davantage fait vacciner le jour où le passe vaccinal a été annoncé. L'impact du passe vaccinal sur les primo-injections n'a pas été majeur. En tout état de cause, il a été moins élevé que celui du passe sanitaire.
En outre, il y a un biais : énormément de personnes ont été testées positives à Omicron depuis moins de trois mois. Toutes ces personnes doivent attendre au moins deux ou trois mois pour se faire vacciner. Cela explique pour l'essentiel pourquoi, depuis deux semaines, la courbe des vaccinations chute.
Je suis en accord avec la totalité des réponses de Germain Forestier et Nicolas Berrod.
Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la ligne éditoriale. Une analyse et une présentation de données nécessitent forcément certains choix subjectifs. Même si l'on essaie d'être le plus objectif possible, un simple choix d'échelle, de couleurs ou de forme peut avoir des impacts sur l'interprétation et la compréhension des données. La publication de façon libre et gratuite des données en open data par l'État est, à cet égard, très importante, puisqu'elle permet une pluralité d'interprétations.
Comme beaucoup de journalistes et de personnes qui interviennent sur internet, nous sommes très suivis par des personnalités politiques qui sont aux responsabilités, mais aussi par des citoyens, qui prennent des décisions individuelles à leur niveau pour lutter contre l'épidémie. Il est très important, pour ces personnes, de disposer d'une pluralité d'interprétations qui leur permette une compréhension plus fine et plus objective de la réalité de la situation.
Pour ce qui nous concerne, nous avons décidé de publier le code informatique des algorithmes en open source. Chacun peut donc consulter le code informatique de CovidTracker, vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur ou qu'il n'y a pas de biais dans le traitement des différentes données.
Je ne pense pas que nous fassions doublon avec les autres organismes ; c'est, du reste, lié à ce que je viens de dire. Le citoyen est beaucoup plus agile et flexible que l'État. Cela nous a permis de faire des analyses très rapidement - en quelques jours - en mars 2020, quand l'État a mis plusieurs mois, voire plusieurs années, à mettre en place des analyses, des sites internet, des tableaux de bord permettant de suivre les données.
S'agissant de l'impact sur l'information et l'incitation à la vaccination, comme l'a dit Nicolas Berrod, un certain nombre de nos visualisations de données sont reprises publiquement, y compris, par exemple, dans des conférences de presse du Premier ministre ou du Président de la République, mais aussi par les médias. Elles ont donc un impact considérable sur l'information et sur le débat, que nos analyses factuelles de données factuelles contribuent à alimenter.
Je pense que l'open data est très important dans la lutte contre les fake news, tout simplement parce que la publication des données à des échelles vraiment très fines - départementales, voire infradépartementales - permet une certaine vérifiabilité des données : la personne qui resterait sceptique peut vérifier elle l'information.
En février 2020, on n'avait pas d'argument solide à opposer à une personne complotiste qui contestait l'existence du covid-19. Maintenant que les données des tests positifs sont publiées de manière assez fine et précise, on pourrait l'inviter à procéder à ses propres vérifications, à interroger les laboratoires situés à proximité, à faire des comparaisons avec les données publiées par l'État... L'open data offre une transparence qui donne confiance aux citoyens sur les données.
Les décisions prises pour lutter contre le covid-19, comme le passe sanitaire et le passe vaccinal, sont des décisions politiques, reposant notamment sur des facteurs qui sortent de mon champ d'action, notamment des facteurs économiques, de santé mentale, etc.
Il est évident que le passe sanitaire a engendré une entrée dans le schéma vaccinal d'un certain nombre de personnes. Le Conseil d'analyse économique estime ainsi qu'il a permis, à l'été 2021, de faire avancer d'environ 13 points le taux de primovaccination. L'impact du passe vaccinal est beaucoup plus difficile à évaluer, notamment parce que les fêtes de fin d'année ont fait baisser temporairement le rythme de vaccination, mais aussi parce que la vaccination a été ouverte aux enfants, ce qui a entraîné un certain nombre de primovaccinations supplémentaires. En tout état de cause, il a probablement été beaucoup plus mesuré : quand le passe sanitaire aurait permis la vaccination de 5 à 10 millions de Français qui ne se seraient pas fait vacciner sinon, le passe vaccinal n'en a probablement suscité que plusieurs centaines de milliers. Je pense qu'un certain nombre d'études seront réalisées pour chiffrer cet effet.

Je retiens qu'il y a une certaine défiance à l'égard des sites officiels et, au contraire, une certaine confiance vis-à-vis de vos sites.
Monsieur Forestier, vous avez déclaré que vous vérifiez que vos chiffres étaient identiques à ceux de vos collègues. S'ils ne le sont pas, faites-vous en sorte qu'ils le soient ?
Cette défiance est assez étonnante. Il peut toujours y avoir des erreurs. Nous en détectons en consultant les sources officielles.
Quand nous constatons des incohérences, nous en discutons. J'échange ainsi régulièrement avec Nicolas Berrod, Guillaume Rozier et d'autres sur les bizarreries que je peux repérer dans les données publiées quotidiennement. Quand nous ne comprenons pas, nous contactons le producteur de données, Santé publique France, qui peut alors se rendre compte qu'il a fait une erreur ou qui nous donne une explication. Parfois, c'est nous qui commettons des erreurs d'interprétation. Je pense que ces échanges au sein de cet écosystème sont vraiment sains et permettent une amélioration des données. Je vois donc les incohérences plus comme une chance de découvrir une erreur éventuelle que comme un problème réel.
Il faut savoir que les données de contamination SI-DEP s'appuient sur les informations rentrées par les milliers de laborantins des laboratoires de biologie médicale, qui sont ensuite remontées et agrégées au niveau national. Les indicateurs ne sont que le bout d'une chaîne de traitement énorme, dans laquelle peuvent se poser de petits problèmes.

Vos travaux sont très rassurants sur le niveau de notre recherche.
Avez-vous travaillé avec le réseau Obépine ? Si oui, que pensez-vous de sa façon de travailler ?
Disposez-vous des données de la sécurité sociale par le biais du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) ?
A-t-on des données sur la vaccination de l'enfant et les comorbidités ? En ma qualité de pédiatre, je sais qu'il n'y a pas d'unanimité sur la nécessité de la vaccination de l'enfant...
Vous avez fait état d'énormes difficultés pour récupérer les données de l'éducation nationale. On sait que les tests salivaires, dont l'utilisation systématique aurait pu être intéressante à un moment donné, n'ont pas été beaucoup utilisés. Quelles sont vos réflexions à ce sujet ?
Les travaux du réseau Obépine nous intéressent depuis un an et demi. Ils consistent à s'attacher aux eaux usées plutôt qu'au nombre de personnes testées positives L'idée est de pouvoir estimer combien de personnes sont effectivement infectées en surface. Cela permettrait peut-être un suivi plus fin de l'épidémie, notamment au début d'une vague, lorsque le nombre de cas positifs augmente tout en restant bas et que l'on a un peu du mal à voir dans quelle mesure il augmente.
J'échange avec les chercheurs d'Obépine depuis largement plus d'un an. Leurs données étaient intéressantes, mais, pendant longtemps, on ne disposait pas des données brutes : on devait se contenter des rapports ou des chiffres qu'ils nous communiquaient, mais qui n'étaient pas faciles à exploiter. Finalement, au printemps dernier, ces données sont parues en open data : on a pu connaître la concentration des eaux usées en SARS-CoV-2 aux niveaux national et régional et, à partir de là, commencer à faire des analyses. Suivant les régions, la cohérence avec le nombre de cas positifs était plus ou moins forte.
Ces données sont très intéressantes, mais nous avons appris à les manier avec précaution, parce que nous n'avions pas assez de recul ni d'expérience pour pouvoir interpréter ce que montrait l'évolution du suivi des eaux usées. Cet indicateur est, en effet, moins tangible que le nombre de personnes testées positives - dont, du reste, nous disposons quotidiennement.
En outre, on avait l'impression qu'il y avait, du côté de Santé publique France, une sorte de méfiance à l'égard du réseau Obépine. Les choses semblent changer depuis quelques semaines, avec la prolongation d'un financement. L'idée est de bâtir un cadre et de pouvoir dire, ensuite, comment interpréter ces données. C'est précisément ce qui nous manque. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, même si le travail a été lancé. Il serait utile, en cas de prochaine épidémie, de disposer de cet indicateur dès le départ et de savoir comment bien l'interpréter. Il serait complémentaire du nombre de cas positifs.
J'en viens à la vaccination des enfants. J'ai dit tout à l'heure que, pour la vaccination, il y a, grosso modo, deux sources d'information : Santé publique France et l'assurance maladie. Celle-ci informe sur les couvertures vaccinales par comorbidité, indicateur précieux que Santé publique France ne délivre pas. En revanche, pour ce qui concerne les enfants, nous n'avons pas, à ma connaissance, d'information précise sur la couverture vaccinale par comorbidité.
On sait simplement qu'il y a eu tant d'enfants vaccinés avant l'ouverture de la vaccination à tous les enfants. De fait, avant même le mois de décembre, quelques milliers d'enfants étaient déjà vaccinés, parce qu'ils avaient un risque très important de développer une forme grave. Il était donc possible de les vacciner avant que la vaccination soit élargie aux enfants avec comorbidités « classiques », puis à tous les enfants. Cela dit, ce n'est pas à moi de trancher le débat scientifique sur la vaccination des enfants.
J'ai travaillé avec le réseau Obépine, qui analyse les eaux usées, à la fin de l'année 2020. Nous avons pris connaissance, notamment via les médias, de leur travail, qui paraissait extrêmement intéressant, puisqu'il permettait de mesurer le niveau de circulation épidémique indépendamment du dépistage, qui constitue un biais - mécaniquement, plus le dépistage est élevé, plus on trouve de cas positifs.
Obépine a rencontré des problèmes, notamment légaux, dans la publication de ses données, des chartes de confidentialité ayant été signées avec les communes dans lesquelles des capteurs ont été installés. Le réseau n'avait donc pas le droit de publier les données. C'était aux communes de le faire, mais très peu l'ont fait.
Finalement, les choses ont bougé. On a travaillé avec eux, et ils ont été mis en relation avec le Gouvernement, qui a accéléré le mouvement et les a aidés à faire sauter certaines barrières. Les données ont donc pu être publiées, mais seulement au printemps 2021. C'est assez regrettable, puisqu'il aurait été extrêmement utile de disposer de ces données plutôt au début de l'épidémie, lorsque le dépistage était très peu déployé, ce qui biaisait la vision de la circulation du virus.
Par ailleurs, il est très difficile d'analyser les eaux usées pour suivre le covid puisque celui-ci y est présent en très petites quantités, même lorsque la circulation virale est élevée. Cette technique permet plutôt de détecter la différence entre une circulation très faible et une circulation modérée à importante du virus, mais, une fois que la circulation du virus est modérée ou importante, ce qui est le cas en ce moment, il est très difficile de voir des variations. Elle a donc moins d'intérêt aujourd'hui.
Concernant les données relatives aux enfants, Nicolas Berrod a tout dit : je ne vois pas d'éléments complémentaires à porter à votre connaissance.
L'une des difficultés des données Obépine est qu'il y avait également beaucoup de corrections à apporter aux données brutes relevées par les capteurs, notamment du fait de la variabilité assez importante de la sécrétion et de sa durée suivant les personnes - certaines personnes peuvent sécréter pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Les précipitations jouent également sur la dilution. Il faut prendre en compte tous ces éléments pour affiner les chiffres.
Sur la vaccination des enfants, il ne me semble pas qu'il y ait de lien direct entre le PMSI et SI-VIC, qui ne doit pas contenir de données médicales. Effectivement, nous n'avons pas de données précises sur les comorbidités des enfants.

Vos données incluent-elles les outre-mer ? Avez-vous réalisé des études un peu plus pointues sur ces régions ? La covid y a fait des ravages, car la couverture vaccinale y était faible.
Les données relatives aux outre-mer sont publiées par Santé publique France et par quasiment tous les acteurs, qui opèrent une distinction entre ces territoires et la métropole.
Cela est vrai pour la plupart des territoires d'outre-mer, mais pas pour tous : les données relatives aux plus petits territoires ne sont pas publiées, mais j'imagine qu'elles seraient moins signifiantes.
Quoi qu'il en soit, nous disposons des données relatives aux outre-mer. Ces données sont très intéressantes, parce que la situation est souvent très différente outre-mer : ces territoires sont très éloignés et ne se situent pas forcément dans le même hémisphère. La temporalité des vagues peut y être différente. Le taux de vaccination y est également très différent, ce qui entraîne un surcroît d'hospitalisations par rapport à la métropole.
Sur la base de ces données, nous produisons des graphiques relatifs aux territoires d'outre-mer.
Effectivement, nous disposons de données relatives aux outre-mer. Il me semble que les outre-mer sont couverts de la même manière que la métropole.
Comme les dynamiques épidémiques sont parfois vraiment différentes, il peut nous arriver de faire un focus sur la métropole, mais tous les graphiques sont générés par département, en incluant évidemment ceux de l'outre-mer.
Sur la vaccination, les données relatives aux outre-mer n'ont pas été disponibles durant quelques semaines. Une partie des données initialement produites par Santé publique France l'étaient par lieu de vaccination, et non par lieu de résidence, ce qui conduisait à des sous-estimations et à des surestimations dans certains départements en raison du « tourisme vaccinal » - le fait de changer de département pour se faire vacciner. Cela a été corrigé par la suite. À la suite de cette mise à jour, des données sur les couvertures vaccinales dans les outre-mer n'ont pas été disponibles durant un certain temps. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé récemment les données concernées.
On peut effectivement faire le choix de regarder les indicateurs au niveau de la seule métropole. Cependant, dans la majorité des cas, on considère la France entière, y compris l'outre-mer, mais il faut garder en tête que cela peut engendrer un biais.
Par exemple, la vague de l'été dernier, avec le variant Delta, a été particulièrement forte dans les territoires d'outre-mer, notamment dans les Antilles. En août, un décès sur quatre à l'hôpital en France était survenu en Guadeloupe ou en Martinique ! Quand on nous dit qu'il y a 200 décès pour la France entière, on ne se rend pas forcément compte que 50 d'entre eux ont été rapportés dans ces départements. Vu de métropole, où le taux de vaccination est très élevé, ces chiffres paraissent énormes.
La couverture vaccinale est toujours aujourd'hui à peu près deux fois moins élevée aux Antilles qu'en métropole. Il est important de garder en tête et d'expliquer dans nos articles que les vagues épidémiques ne sont pas de même intensité dans les outre-mer et en métropole, et que les situations sont très différentes.
On peut faire le choix - cela m'est arrivé à plusieurs reprises - de consacrer des articles ou des analyses aux seuls territoires d'outre-mer, en se fondant sur les indicateurs qui les concernent, en interrogeant les gens sur place, en confrontant les données aux réalités du terrain... Mais, dans l'immense majorité des cas, les indicateurs présentés soit par le Gouvernement, soit par nous, valent pour la France entière, y compris, donc, les territoires ultramarins.

Messieurs, vous entendre évoquer votre travail, qui vise à traiter scientifiquement des données afin d'éclairer objectivement nos concitoyens, mais aussi les rapports très sains et faciles que vous avez avec les organismes publics me réconforte.
Actuellement, certains anti-vax proclament que la vaccination ne marche pas, puisque le nombre de personnes en soins critiques ou en réanimation augmente. Cela s'explique par le fait que la contamination par le variant Omicron est beaucoup plus massive. Or 80 % des personnes qui se retrouvent en soins critiques ne sont pas vaccinées.
Le fait que ce sont des personnes non vaccinées qui se retrouvent en soins critiques est-il suffisamment mis en évidence ?
Cela me fait penser à la question qu'a posée Mme la rapporteure sur les données que nous n'avons pas à notre disposition.
Bien évidemment, nous disposons des données relatives au statut vaccinal des personnes admises à l'hôpital, c'est-à-dire le nombre d'entrées quotidiennes à l'hôpital et en soins critiques en fonction du statut vaccinal, publiées par la Drees.
En revanche, nous ne connaissons pas le nombre de personnes actuellement hospitalisées, c'est-à-dire le nombre de lits occupés à l'instant T, en fonction du statut vaccinal. C'est une donnée dont nous aimerions disposer. Elle serait très importante, puisque l'on suspecte que la durée du séjour à l'hôpital des personnes vaccinées est plus courte.
Nous pouvons donc aujourd'hui, monsieur le sénateur, évaluer la réduction du risque d'admission à l'hôpital à la suite de la vaccination.
L'analyse est complexe. Si l'on regarde les chiffres de façon absolue, un peu plus de 50 % des personnes qui entrent chaque jour à l'hôpital sont vaccinées. Cela ne veut pas dire que la vaccination n'est pas efficace ; au contraire ! Plus de 90 % des personnes éligibles à vaccination sont vaccinées. Elles sont sous-représentées parmi les admissions à l'hôpital. Si l'on s'intéresse aux admissions de manière relative - rapportées aux effectifs de personnes vaccinées et non vaccinées -, on remarque que le risque d'admission à l'hôpital est bien plus faible chez les personnes vaccinées.
Ces données sont mises à notre disposition par la Drees, qui publie des rapports hebdomadaires. Nous réalisons, à partir de ces données, des analyses, des graphiques, que nous publions. Je pense que nous faisons le maximum pour que ces données soient visibles par le grand public.
Il ne faut pas en rester au pourcentage de personnes vaccinées ou non vaccinées qui sont en réanimation. Il faut regarder également les effectifs. Actuellement, la très grande majorité de nos concitoyens sont vaccinés, mais le vaccin ne marche tout de même pas à 100 % - il y a notamment des personnes immunodéprimées avec de très fortes comorbidités. Nous essayons de communiquer à ce sujet.
La Drees a réalisé un important travail d'appariement, de mise en relation de la base de données du statut vaccinal et de celle des hospitalisations. Ces données, qui étaient demandées depuis longtemps, sont arrivées un peu tardivement.
Je ne vois pas ce que l'on pourrait faire de plus que de montrer ces données et d'essayer d'expliquer que la vaccination est efficace et qu'il faut se faire vacciner.
Je ne compte plus les articles que j'ai écrits, sur la base des études qui ont été publiées et des données de vie réelle sorties en France ou dans d'autres pays, qui montrent que la vaccination réduit très fortement le risque de forme grave.
On nous reproche parfois de ne pas dire qu'il y a des vaccinés à l'hôpital, mais dire que la vaccination réduit très fortement le risque d'être hospitalisé ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de personnes vaccinées qui iront à l'hôpital !
L'immense majorité des gens sont vaccinés, mais les données de la Drees ne permettent pas de savoir combien d'entre eux souffrent de comorbidités. Or le groupe des vaccinés est très divers : vaccinés immunodéprimés, vaccinés avec comorbidités, vaccinés qui n'ont pas eu leur rappel...
Cela limite l'analyse des données. Il nous serait évidemment extrêmement utile de disposer de données relatives aux comorbidités : cela montrerait sans doute que les personnes immunodéprimées, même vaccinées, présentent toujours un risque plus important d'aller à l'hôpital que les vaccinés qui ne sont pas immunodéprimés.
Bien évidemment, toutes les études et toutes les données montrent l'efficacité des vaccins contre les formes graves. En revanche, il est vrai, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, qu'il y a, avec Omicron, ce qu'on appelle un « échappement immunitaire » : ce variant infecte les personnes vaccinées plus facilement que le variant Delta. Cependant, avec une dose de rappel, la protection contre les formes graves reste à un niveau très élevé.
Il existe encore une part d'inconnu sur la façon dont cette protection très élevée se maintiendra dans le temps. Les premières données britanniques sont plutôt rassurantes, mais nous manquons évidemment encore un peu de recul. Quoi qu'il en soit, il est incontestable que le risque de développer une forme grave est largement réduit par la vaccination.

Nous avons bien compris que le travail que vous réalisez est complémentaire de ce qui est fait par les institutions et de nature à rassurer nos concitoyens.
Ne pensez-vous pas que toutes ces données finissent par donner le tournis et contribuent au caractère anxiogène de notre société, qui est à la recherche de données toujours plus pointues ?
Avez-vous compilé des données concernant les déprogrammations dont on nous parle tant ?
L'excès de données risque-t-il de tuer la donnée ? C'est une question que l'on entend souvent. En tant que journaliste, j'y suis confronté quotidiennement.
Par exemple, certains se demandent s'il est pertinent de communiquer chaque jour sur le nombre effrayant de cas de contamination à Omicron. Cette question peut sembler légitime, et je l'entends parfaitement, mais je considère que cela a toujours du sens, dans la période que nous connaissons, de savoir combien de personnes ont été testées positives chaque jour. Le fait que l'on teste beaucoup plus qu'à une certaine époque explique aussi pourquoi l'on trouve beaucoup plus de cas positifs.
Voilà quelques semaines, un journaliste britannique du Financial Times, lui aussi spécialisé dans l'analyse des données, a écrit un message humoristique sur Twitter pour dire qu'il se perdait dans l'avalanche de données... Ce risque est réel.
Un autre risque existe : celui d'oublier ce qu'il y a derrière ces données. Le nombre de cas positifs, le nombre de patients hospitalisés, le nombre de décès ont des traductions concrètes, dans la vie réelle. Les cas positifs signifient des cas contacts, des isolements, des perturbations dans certains secteurs. L'augmentation du nombre de patients hospitalisés impacte concrètement le fonctionnement de l'hôpital.
Je n'ai pas connaissance de données, en tout cas de données publiées régulièrement, sur le nombre de déprogrammations et sur leurs raisons précises. Elles peuvent être causées aussi bien par un excès de patients atteints du covid-19 à prendre en charge que par un manque de personnel ou de lits. Pour autant, nous enquêtons sur le terrain, nous interrogeons des médecins, nous posons la question aux agences régionales de santé (ARS) : ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de données que nous ne travaillons pas sur un sujet. Vous avez raison, il faut savoir parfois sortir le nez du guidon et prendre un peu de recul pour bien interpréter les données.
Les données, en effet, sont très nombreuses, et de sources diverses : Santé publique France, la Dress, l'assurance maladie, Insee... Nous cherchons à en simplifier la présentation pour nos concitoyens.
Oui, il faut compter ce qu'on arrête ! Ce n'est pas à nous de déclarer quand l'épidémie sera finie. Évidemment, nous n'aurions jamais imaginé qu'il y aurait un tel intérêt pour nos travaux. Nous espérons pouvoir les arrêter rapidement, car nous les menons sur notre temps libre ! Nous les arrêterons dès que le consensus sera que l'épidémie est terminée.
Vous parlez du potentiel anxiogène des données. À mon avis, l'analyse des données est moins angoissante qu'un chiffre brut donné quotidiennement. La mise en perspective est plus intéressante, qui montre les évolutions, à la hausse ou à la baisse. C'est la compréhension fine des données qui rend leur présentation moins anxiogène.
Nous essayons de produire des analyses objectives, sans commenter les résultats : nous livrons les données à nos concitoyens de manière neutre. Sur les déprogrammations, nous ne disposons pas des données, en effet. Peut-être sont-elles disponibles au niveau de chaque centre hospitalier ? D'ailleurs, nous n'avons pas beaucoup de données sur le système hospitalier. Par exemple, on ne peut pas savoir combien de personnes sont hospitalisées à un moment donné, toutes causes confondues. Nous ne connaissons pas non plus la répartition des hospitalisations en fonction des pathologies, ni entre niveaux de gravité. Certains autres pays, comme le Canada, publient de telles données, très utiles pour comprendre l'état du système hospitalier et l'état de santé des citoyens.

Il semble que deux millions d'actes médicaux et chirurgicaux ont été déprogrammés. Pourrions-nous vous revoir dans quelques années pour analyser les conséquences de ces déprogrammations sur les patients ?
Merci, en tout cas, pour tous ces renseignements.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Dans le cadre de la mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19, nous avons à présent l'honneur de recevoir le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande.
Je rappelle que l'objet de notre travail n'est pas de refaire le débat sur le passe vaccinal. Ce débat a été tranché par le Sénat, qui a voté ce dispositif à une large majorité.
Notre sujet est plutôt de vérifier qu'un instrument conçu dans un contexte donné, avec un variant donné, est toujours adapté, quelques semaines plus tard, à une nouvelle configuration de l'épidémie.
Vous nous direz, monsieur le professeur, quelle place le passe vaccinal a prise et prend encore dans la stratégie vaccinale et, plus largement, dans la gestion de cette épidémie.
Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Monsieur le professeur, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites : « Je le jure. »
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, le professeur Alain Fischer prête serment.
Professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. - Je crains de vous répéter des choses que vous avez déjà beaucoup entendues...
Cent fois sur le métier...
Professeur Alain Fischer. - Je commencerai donc par faire un rapide bilan de la situation de la pandémie. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, l'infection au SARS-CoV-2 est bénigne, voire asymptomatique. Le virus disparaît de l'organisme à mesure que s'organise la réponse immunitaire, normalement en quelques jours. En France, 21,1 millions de cas ont été diagnostiqués à ce jour. Ce chiffre sous-estime certainement la réalité, mais il donne un ordre de grandeur convenable.
Malheureusement, dans un certain nombre de cas, rares, mais pas négligeables, la maladie prend des formes sévères, en particulier, mais pas exclusivement, chez les personnes âgées et les personnes déjà malades. Dans ce cas, la réponse immunitaire s'emballe et le virus n'est plus contrôlé. En France, nous totalisons, depuis début 2020, 700 000 hospitalisations et 133 600 décès. Dans le monde, l'épidémie a causé au moins 5 700 000 décès, sachant que ce chiffre provient de données largement sous-estimées dans certains pays.
Aujourd'hui, le taux d'incidence est de 2,5 % environ. Il est en décroissance, après avoir atteint 3,7 % le 25 janvier. Le variant Omicron est devenu quasiment exclusif, puisqu'il constitue plus de 99 % des cas. Même si la vague actuelle est en décroissance, ses conséquences médicales sont loin d'être négligeables : en moyenne hebdomadaire, on compte plus de 2 700 hospitalisations par jour, dont les deux tiers ont pour cause principale le covid-19. C'est un chiffre considérable, tout comme celui des 300 hospitalisations quotidiennes en soins critiques, dont entre 80 % et 90 % ont pour cause principale le covid-19, et celui des 285 décès quotidiens. Nous ne sommes donc pas au bout de la vague ni de ses conséquences, y compris indirectes, sur le fonctionnement de nos structures hospitalières.
Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN, qui mute sans cesse. Chaque personne infectée est porteuse de différentes souches. L'arbre généalogique du virus montre bien les variants principaux. Alpha a été présent en France, après être arrivé en Grande-Bretagne au printemps dernier. Nous avons presque oublié Bêta et Gamma, qui ne se sont pas trop répandus en France, d'ailleurs : Bêta s'est diffusé surtout en Afrique du Sud et Gamma, au Brésil. Delta a été très présent chez nous l'automne dernier, en revanche. Quant à Omicron, il est très différent des autres. Il est apparu en Afrique du Sud après une succession de mutations, probablement chez une même personne immunodéficiente. Sur la branche qui y mène, un bras collatéral mène à BA.2, qui vient du Danemark et semble se développer. Il n'est pas plus pathogène, mais la réponse immune est très légèrement distincte de celle qui a été générée par Omicron. Il n'est pas exclu que BA.2 soit à son tour rebaptisé avec une lettre grecque. Sa diffusion ralentit probablement la phase de décroissance qu'on observe aujourd'hui.
Omicron résulte de nombreuses mutations, notamment sur la protéine Spike, qui permet au virus de s'attacher aux cellules, ce qui induit la réponse immunitaire, et contre laquelle immunise la vaccination. Les mutations qui le caractérisent sont beaucoup plus nombreuses que celles qui définissent Delta. C'est donc un variant très différent des autres. Il manifeste une moindre sensibilité à la réponse immunitaire, vaccinale ou naturelle - c'est ce qui a fait qu'il a été sélectionné. Et il jouit d'une transmissibilité accrue de plus de 80 %. Heureusement, sa sévérité est moindre, elle aussi 80 % environ.
De plus, le taux d'anticorps contre Omicron est extrêmement faible, même après deux doses de vaccin. En revanche, après trois doses, la réponse immunitaire devient très significative et protectrice. Le rappel est donc absolument primordial dans le contrôle de l'infection par Omicron, et donc des formes graves. En tout cas, j'y insiste, la protection contre le risque d'hospitalisation reste supérieure à 90 %.
La couverture vaccinale en France n'est pas mauvaise, même si elle n'est pas parfaite. Plus de 93 % des personnes âgées de plus de douze ans ont reçu au moins une dose. Cela représente 80 % de tous les Français, tous âges confondus, y compris les bébés, qu'on ne vaccine pas. La vaccination des enfants, malheureusement, ne progresse pas assez vite.
Une modélisation faite par des économistes montre bien l'effet du passe sanitaire sur la couverture vaccinale : s'il n'y avait pas eu de passe sanitaire, 13 % des Français aujourd'hui vaccinés n'auraient reçu aucune dose.
En quoi la vaccination est-elle utile ? Toutes les données montrent que le vaccin continue de protéger contre l'infection, contrairement à ce qu'on dit. L'effet n'est certes pas massif, mais, à l'échelle épidémiologique, il est tout à fait significatif, et donc très important. Il protège aussi, très clairement pour le coup - d'un facteur dix - contre l'entrée en hospitalisation conventionnelle et en soins critiques et de réanimation. Pour un sujet infecté, le risque d'être hospitalisé baisse fortement si l'on est vacciné, même si la protection diminue avec l'âge. Surtout, après le rappel, la protection contre les formes graves est excellente. Aujourd'hui, 36,6 millions de Français ont reçu une dose de rappel, parmi lesquels plus de 80 % des plus de 65 ans.
Qui meurt du covid-19 en France ? Il y a essentiellement trois catégories de personnes. D'abord, les personnes non vaccinées et, notamment, celles qui sont très âgées. Il y en a encore 450 000, malheureusement. Ensuite, 10 % des décès sont dus au couplage du covid-19 avec des pathologies chroniques diverses, qui vont de l'insuffisance rénale à l'obésité, en passant par les cancers ou les maladies psychiatriques. Les personnes en situation de précarité, également, sont moins vaccinées. Celles qui ont reçu une primo-vaccination, mais pas de dose de rappel, présentent aussi des facteurs de risque. Enfin, le groupe le plus critique compte environ 300 000 personnes en France, qui sont profondément immunodéprimées et répondent mal ou pas à la vaccination. Ces personnes dépendent de nous pour être protégées. Il s'agit, par exemple, de patients en insuffisance rénale terminale, de patients ayant subi des transplantations d'organes, de certains types de patients traités pour des cancers ou des maladies auto-immunes... Imaginez ce que vivent ces malades, obligés de se cacher en permanence, car le risque pour eux de mourir du covid est énorme, et on n'arrive pas à les protéger par la vaccination, ou très mal. Ils peuvent bénéficier de prévention par des anticorps monoclonaux, mais ce n'est pas complètement évident.
L'existence de ce dernier groupe pose un problème et justifie, à mon sens, une attitude proactive sur la vaccination, qui est à la fois une protection individuelle et un acte de solidarité à l'égard de ceux qui ne sont pas protégés directement.
J'ajoute que les femmes enceintes ne sont pas assez vaccinées. Certaines font des complications graves, pouvant avoir des conséquences sur leur bébé. Les femmes enceintes doivent être vaccinées, la vaccination ne présente pas de risque pour elles.
Nous avons contribué à la mise en place du passe vaccinal, au cours d'une série d'échanges informels. Dans un avis rendu au début de l'automne, nous avions proposé au Gouvernement d'inclure le rappel vaccinal dans le passe sanitaire. Le passe vaccinal n'est jamais que l'adaptation du passe sanitaire dans un contexte marqué par le variant Omicron, qui a un très haut taux de transmission. L'idée d'un passe sanitaire devenait scientifiquement moins valide parce qu'un test PCR négatif de moins de 24 heures ne peut pas garantir qu'on n'a pas été infecté depuis le prélèvement. L'évolution vers le passe vaccinal, de mon point de vue, était donc absolument logique pour permettre des activités sociales en sécurité, à condition de respecter les gestes barrières, parce que la vaccination ne protège pas à 100 %, et d'avoir effectué un rappel. C'est une incitation à la vaccination - c'est même une obligation partielle, disons les choses comme elles sont - que je trouve justifiée, car la vaccination n'est pas seulement une protection individuelle, c'est aussi une protection collective, significative pour les plus fragiles d'entre nous, comme les patients immunodéprimés ou les personnes très âgées.
Il reste à peu près 17 millions de personnes primovaccinées qui n'ont pas reçu le rappel, parmi lesquelles 9 millions qui doivent le recevoir avant le 15 février pour ne pas perdre leur passe sanitaire. Parmi eux, un certain nombre ont été infectées, et l'infection vaut rappel : nous y avons beaucoup insisté auprès du Gouvernement ces dernières semaines, et nous nous réjouissons d'avoir été suivis. Je rappelle que l'efficacité du rappel s'observe après sept jours, ce qui est très rapide.
Jusqu'à quand maintenir le passe ? D'un point de vue scientifique et médical, je vois deux critères.
D'abord, il faut que le taux d'incidence ait diminué. Il est actuellement à 2 500. Il faut qu'il soit divisé par dix ou vingt. Surtout, il faut que la surcharge hospitalière actuelle ait disparu et que les hôpitaux soient revenus à un état de fonctionnement habituel, c'est-à-dire que les patients n'ayant pas le covid-19 soient traités sans délai, sans retard et de façon efficace. Enfin, il faut que la couverture vaccinale de rappel ait atteint un niveau très élevé. Cela peut arriver assez vite : l'incidence est en train de diminuer rapidement, et la situation devrait redevenir satisfaisante sur ce plan fin mars et, sur le plan hospitaliser, une quinzaine de jours plus tard. Si nos concitoyens suivent les consignes induites par le passe vaccinal et se font administrer le rappel, la couverture vaccinale devrait être également satisfaisante fin mars.
Si nous faisons de la prospective, on voit que la protection contre les formes graves de la maladie, qui s'est effritée après la primo-vaccination, est dopée par le rappel, ou l'infection survenue plus de trois mois après la primo-vaccination. Quid pour la suite ?
Cette protection va-t-elle décroître rapidement, lentement ? Nous n'en savons rien. Plusieurs facteurs interviennent, parmi lesquels la nature et la virulence des variants qui circuleront dans les mois qui viennent, avec la possibilité de résurgence de variants comme Delta, par exemple. Il y a aussi l'espoir d'un vaccin combinant plusieurs Spike, pour couvrir plus largement le spectre des différents variants. Il est possible que nous en disposions à l'automne, pour un nouveau rappel.
On peut affirmer sans risque d'erreur, à mon avis, qu'on ne peut pas éradiquer ce virus. Le seul virus jamais éradiqué à ce jour est celui de la variole, grâce à la vaccination, mais pour les virus respiratoires, il est vraiment illusoire d'y songer. Un scénario plausible est que nous évoluions dans un contexte d'endémie, avec des vagues épidémiques du même type que celles de la grippe, avec des recrudescences saisonnières. La décroissance de la vague actuelle, qui a atteint son pic il y a une dizaine de jours, sera assez rapide. Nous aurons encore chaque année des vagues saisonnières, d'intensité variable, ce qui devrait nous amener à des vaccinations annuelles. D'où viendra le prochain variant ? Nul ne saurait le prédire. Nous devons pratiquer une veille intensive. Il sera sélectionné par un certain degré d'échappement à la réponse immunitaire, avec une virulence imprévisible.
La France n'est pas isolée dans le monde. Un peu plus de 10 milliards de doses de vaccins ont été administrées. Comme il faut deux doses de rappel, nous devons atteindre 24 milliards de doses administrées : nous sommes à 40 % de l'objectif à l'échelle mondiale. De plus, la répartition géographique des injections est extraordinairement hétérogène. L'Afrique n'est que très peu vaccinée ; l'Inde, le Pakistan ne le sont que partiellement, et avec des vaccins peu efficaces. Ainsi subsistent des foyers majeurs de l'épidémie, au sein desquels les nouveaux variants peuvent apparaître. Conclusion : nous ne serons pas en sécurité tant que l'ensemble de la population mondiale ne sera pas en sécurité.
Vos propos sont réconfortants, par rapport à ce que nous avons entendu hier soir !

Merci pour ce tour de piste, à la fois vertigineux et nuancé. En tant que président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, avez-vous pris part à la décision de transformer le passe sanitaire en passe vaccinal ? Votre Conseil a-t-il été formellement sollicité pour analyser la situation sanitaire et son évolution ? Votre conseil, ou certains de ses membres, ont-ils été sollicités à titre informel ? Si oui, comment et par qui ? Participez-vous aux conseils de défense sanitaire ? Le Premier ministre a annoncé publiquement ce changement de stratégie le 17 décembre. Par quoi ce dernier a-t-il été motivé ?
Professeur Alain Fischer. - La mise en place du passe vaccinal implique des considérations qui vont au-delà de la vaccination, sur les seuls plans scientifique et médical. C'est pourquoi nous avons été consultés et avons participé à la réflexion. Nous n'avons pas été les seuls, parmi les conseils informels, à réfléchir à cette question. En particulier, le conseil scientifique a également été mobilisé, ce qui me paraît tout à fait légitime compte tenu de la question posée de ses implications. En pratique, nous avions émis un avis le 29 octobre, dans lequel nous recommandions d'inclure le rappel dans le passe sanitaire. Tous nos avis sont consultables sur internet - il y en a environ 90 à ce jour.
Nous n'avons pas été saisis officiellement pour la mise en place du passe vaccinal. Cela dit, moi-même et plusieurs de mes collègues avons eu une série de contacts informels avec les équipes du ministère de la santé. D'ailleurs, nous sommes chaque semaine en contact étroit avec ces équipes ainsi qu'avec plusieurs membres du cabinet, avec le ministre à chaque fois que c'est nécessaire, et même le Premier ministre, puisque celui-ci m'avait demandé de participer aux réunions de présentation du projet en décembre.
En revanche, nous ne participons pas aux conseils de défense, mais, d'une certaine façon, nous les préparons : en fonction des questions qui vont émerger, nous sommes saisis en amont. Parfois se tiennent des réunions préparatoires. Nous en avons eu de nombreuses avec le Président de la République au premier semestre de 2021, et plusieurs, ces derniers mois, avec le Premier ministre et son cabinet.

Vous dites que le passe sanitaire a eu un effet sur le nombre de vaccinés, puisqu'il a poussé 13 % des Français à se faire vacciner. Vous soulignez l'importance du rappel, et répétez que l'efficacité contre les formes graves, sur une période de trois mois, est de 90 %. Mais quid après ces trois mois ? L'efficacité chute-t-elle ? Une quatrième injection sera-t-elle nécessaire, au moins pour les publics les plus fragiles ou les plus âgés ? Dans le courant du mois de janvier de cette année, 16 % des Français auraient été contaminés par le variant Omicron.
Professeur Alain Fischer. - Cela paraît plausible.
Ce chiffre ne remet-il pas en cause la pertinence du passe vaccinal ? Quels seraient les critères pour lever ce passe ? La communication du Gouvernement m'a semblé un peu brouillonne lorsqu'Olivier Véran a commencé à expliquer qu'une dose équivalait à une infection, puis à une injection... Qu'en pensez-vous ?
Professeur Alain Fischer. - La question de la quatrième dose nous occupe beaucoup ces temps-ci. Nous avons émis un premier avis il y a une quinzaine de jours, disant qu'il n'existait pas, à ce jour, d'arguments pour entreprendre une campagne d'injection d'une quatrième dose, sauf pour les patients immunodéprimés. Il est vrai qu'Israël, de façon isolée, a pris cette décision, mais sans se fonder sur des critères scientifiques solides, faute de données. Pour l'instant, on n'observe pas de diminution de l'efficacité de la protection contre les formes graves, y compris chez les personnes les plus âgées. Guillaume Rozier, que vous venez d'entendre, a construit des figures, à partir des données de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), montrant l'évolution dans le temps du risque d'être hospitalisé en fonction de l'âge et du statut vaccinal. On voit, à ce stade, que le taux d'hospitalisation des personnes les plus fragiles ne monte pas après quatre ou cinq mois. Nous verrons comment ces données évoluent : les connaissances scientifiques évoluent en permanence, et il faut s'adapter quasiment chaque semaine.
Les Allemands viennent de prendre cette décision. J'aimerais d'ailleurs savoir sur la base de quels critères exactement. Pour l'instant, ils sont quasiment seuls. Une information nous vient d'Israël, où l'on a commencé à administrer la quatrième dose il y a plusieurs mois : dans les quinze jours qui suivent la quatrième dose, le niveau de protection contre les formes graves est multiplié par trois ou quatre. Ce n'est pas spectaculaire, mais cela fonctionne. En tout cas, on n'attend pas de la quatrième dose un bénéfice aussi fort que celui du rappel. Pour l'instant, nous ne la préconisons pas, même pour des personnes très âgées. Mais il est très probable que, dans les semaines ou les mois qui viennent, selon l'évolution des données, elle soit préconisée, au moins pour les publics vulnérables.
Le fait que 16 % des Français aient contracté le variant Omicron remet-il en cause le passe vaccinal ? Je pense que non. Sans la vaccination, ce taux aurait peut-être été deux fois plus important, avec un nombre de formes graves beaucoup plus important. Il faut poursuivre la stratégie telle qu'elle est actuellement développée.
Concernant les critères, certains peuvent être d'ordre politique, mais je n'entrerai pas dans ce débat. Selon moi, il importe que l'hôpital retrouve un fonctionnement quasi normal. En parallèle, le niveau de rappels doit être tel qu'il doit nous apporter un peu de sécurité dans les semaines et les mois qui viennent.
Il est difficile de répondre à la question de la communication. Si la communication n'est pas fluide, sans doute avons-nous aussi notre part de responsabilité, car c'est l'une de nos missions que de conseiller en la matière. Franchement, la situation est horriblement difficile : l'évolution extrêmement rapide des connaissances fait que l'on peut dire l'inverse en un court laps de temps.
Nous nous sommes beaucoup battus pour faire admettre qu'une infection vaut dose de rappel, mais nous avons été écoutés. Les données nous permettent maintenant de prendre ce virage, assez fort, je le concède. Est-ce la communication qui engendre des difficultés de compréhension ou est-ce dû à des explications lacunaires ? Je ne sais pas. Mais, je vous l'assure, la communication dans ce contexte est un exercice très difficile.

Je poserai trois questions.
Pour justifier la troisième dose, vous mesurez les taux d'anticorps face à Omicron. Or plusieurs intervenants ont souligné que ce dosage n'avait pas de sens ni de valeur scientifique prouvée. N'est-ce pas paradoxal ?
Ma deuxième question porte sur la couverture vaccinale. Le groupe socialiste défend depuis le mois de juillet dernier l'obligation vaccinale sur le fondement de la solidarité pour éviter la contamination, notamment des personnes fragiles. L'un des intervenants que nous avons auditionnés hier nous a quelque peu déstabilisés dans la mesure où il nous a indiqué que la couverture vaccinale à 85 % n'avait pas ciblé de façon complète les personnes à risques. N'est-ce pas un échec du « aller vers » dans la mesure où 100 % des personnes de plus de 80 ans sont vaccinées dans certains pays voisins, alors qu'ils n'ont pas mis en place le passe sanitaire ? Comment aller plus loin encore ?
Ma troisième et dernière question concerne la prospective. Cette crise sera endémique. Tous les automnes, devra-t-on vacciner l'ensemble de la population ou uniquement les personnes à risques ?

Pour compléter cette dernière question, est-il possible de combiner ce vaccin avec celui de la grippe ?
Professeur Alain Fischer. - Vous avez rappelé à juste titre que le dosage des anticorps ne sert strictement à rien à titre personnel pour savoir si l'on doit faire un rappel ou pas. Lorsque l'on dose les anticorps, on dose tous les anticorps, et pas seulement les anticorps neutralisants, qui sont les plus importants. Or, en termes de protection contre les formes graves, l'immunité cellulaire joue un rôle très important. Je le confirme, il ne sert à rien à chaque individu de demander le dosage de ses anticorps, sauf les personnes immunodéprimées. Toutefois, sur un plan collectif, les données sur les anticorps neutralisants sont intéressantes. Ces anticorps jouent un rôle sur l'infection. Cette information est donc utile pour chercher à réduire le risque d'infection.
À titre personnel, je ne suis pas contre l'obligation vaccinale. En 2016-2017, à la demande de Mme Touraine, j'avais conduit une réflexion sur la vaccination obligatoire des nourrissons et nous nous étions prononcés, dans notre rapport, en faveur de cette obligation, qui a été mise en place par Mme Buzyn et qui est un succès. Il est vrai que 4,3 millions de Français adultes ne sont pas vaccinés, dont 450 000 personnes très âgées, environ 1 million de personnes souffrant de pathologiques, des personnes en situation de précarité et les opposants au vaccin. Je rappelle que 94 % d'adultes de plus de 18 ans sont primovaccinés, soit un niveau très élevé. L'obligation vaccinale ne permet jamais de toucher 100 % des personnes. Je doute qu'elle soit de nature à inciter les personnes isolées, les personnes en situation de précarité à se faire vacciner. Imaginez ce qui se passera si nous décidions l'obligation vaccinale dans les départements et régions d'outre-mer (DROM) ?
Bien que je sois très favorable à la vaccination, je ne pense pas que l'obligation vaccinale soit la solution. Nous nous étions prononcés en faveur de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, qui a été mise en place - ce fut une bonne chose, l'immense majorité étant vaccinée.
Il est indiscutable que les personnes très âgées sont plus vaccinées dans les pays latins, avec un taux de couverture de 100 % quasiment, mais la structure des familles y est certainement pour beaucoup. Leurs aînés sont moins isolés.
Cela dit, nous devons poursuivre nos efforts et les intensifier pour aller vers les 11 % de personnes âgées de plus de 80 ans, les personnes en situation de précarité, les gens du voyage qui sont peu en contact avec le monde de la santé. Il est vital de faire plus, même si cela prend beaucoup de temps.
Le quatrième rappel dépendra de la virulence du virus et, au-delà, de la perception sociétale, un sujet éminemment politique. Que tolère-t-on en termes de gravité, de décès, d'hospitalisation d'une infection respiratoire ? Cela nous donnera l'occasion d'élargir la réflexion à tous les virus respiratoires. De la réponse à ces questions devrait dépendre la réponse à votre question.
Il est possible de faire en même temps le vaccin contre la grippe et celui contre le covid. Des laboratoires préparent actuellement un vaccin mix grippe-covid. Pfizer notamment est en train de tester des combinaisons différentes. Ce serait très bien si nous pouvions n'avoir qu'un seul vaccin.

Je suis assez surprise quand je vous entends parler des anticorps. Vous mettez en doute les réactifs commercialisés spécifiques pour le covid. Le laboratoire habilité à faire des examens pour le Sénat délivre des résultats avec des taux d'anticorps IgG pour le covid. Mettez-vous en doute ces résultats ? Pourquoi ne dénoncez-vous pas les laboratoires qui commercialisent ces réactifs ?
M. le ministre Véran a évoqué sur BFM vos recommandations : pour bénéficier du passe vaccinal, on peut avoir ou une injection ou une infection plus une dose de vaccin. Si vous avez une injection plus deux infections ou une infection au milieu ou après, vous pouvez conserver le bénéfice de votre passe vaccinal.
C'est flou pour moi, et sans doute aussi pour toutes les personnes qui écoutent les médias. Pouvez-vous clarifier cette information ?
Professeur Alain Fischer. - Je ne remets pas en cause la qualité du dosage des anticorps. Les tests disponibles sont très fiables. Mais je discute l'interprétation des résultats, ce qui est tout à fait différent. Le dosage ne nous aide pas à déterminer si telle personne est protégée ou pas. Cela ne permet donc pas de savoir si la personne a besoin d'un rappel.
Concernant votre deuxième question, l'équation est assez simple : une infection vaut une dose de vaccin, si l'espacement entre l'infection et le vaccin est suffisant. Trois scénarios sont possibles.
Si vous avez eu une première dose de vaccin, puis un ou deux mois après, une infection, celle-ci vaut deuxième dose, vous devrez faire votre rappel trois mois après. Si vous avez d'abord eu une infection, puis une vaccination deux mois après, vous devrez faire uniquement un rappel trois mois après. Enfin, si vous avez eu deux vaccins, puis une infection plus de trois mois après la primovaccination, elle vaut dose de rappel. Si cette infection survient moins de trois mois après la primovaccination, il conviendra de faire le troisième rappel.
Pour schématiser, une infection vaut une dose de vaccin, avec quelques limites temporelles.

Je remarque à regret que l'instauration du passe vaccinal pour les adultes a occulté l'intérêt de la vaccination chez l'enfant.
Selon vous, de nouveaux vaccins, qu'ils soient d'ancienne ou de nouvelle génération, vont-ils sortir prochainement ? Comment seront-ils intégrés dans le passe vaccinal si celui-ci existe encore ?
Professeur Alain Fischer. - Alors que la vaccination est ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans depuis le 20 décembre dernier, seuls 5 % environ d'entre eux ont reçu une première dose de vaccin. En comparaison, dans les pays voisins, cette proportion atteint au pire 20 % et au mieux plus de 50 %.
En France, on note donc une certaine résistance face à la vaccination des enfants, ce qui est vraiment dommageable. Tout le monde sait en effet que certains enfants peuvent développer des formes graves de la maladie, être hospitalisés - ils sont 150 actuellement - ou souffrir de syndromes inflammatoires multisystémiques pédiatriques (PIMS), ce qui pourrait être évité, puisque les études montrent que, chez l'adulte, la vaccination permet de prévenir les PIMS.
La vaccination des enfants est utile et légitime, d'autant qu'elle permet de réduire la circulation du virus dans le reste de la population générale. En outre, les études américaines démontrent la quasi-absence d'effets indésirables des vaccins chez les enfants.
Les réticences proviennent, non seulement des parents, mais aussi du monde médical, médecins généralistes et pédiatres. Il faut poursuivre nos efforts et continuer d'expliquer le bien-fondé de la vaccination des enfants. En parallèle, il faut convaincre les familles et lever les inquiétudes.
S'agissant des vaccins, comme vous le savez, un nouveau vaccin vient d'obtenir l'approbation de l'Agence européenne des médicaments, le Nuvaxovid, qui est un vaccin protéique adjuvanté. Il devrait être disponible dans le courant du mois de février et sera valable dans le cadre du passe vaccinal. On sait que ce vaccin est raisonnablement sûr, efficace, même s'il l'est un peu moins que les vaccins à ARN messager. Il pourra être prescrit aux personnes qui sont rétives à ce type de vaccin.

Hier, lors de son audition, le docteur Desbiolles nous a fait comprendre que se faire vacciner pour protéger les autres était une idée presque intégralement fausse. Qu'en est-il exactement : les vaccins sont-ils efficaces pour protéger autrui ?
Dès lors qu'une infection équivaut à une dose de vaccin, faut-il continuer à vacciner tout le monde ou ne protéger que les personnes les plus fragiles ?
Professeur Alain Fischer. - Je suis surpris par ce type d'affirmation, qui est scientifiquement fausse : la protection d'autrui grâce au vaccin n'est absolument pas un leurre. Un certain nombre d'études le prouvent avec certitude. Du reste, il faut bien comprendre que, par définition, la protection contre l'infection équivaut à une protection contre la transmission. Cette protection est certes limitée, mais même avec le variant Omicron, le vaccin permet de diviser par deux ou trois le degré de contagiosité.
De cette certitude découle ma réponse à votre seconde question : il faut poursuivre la campagne de vaccination générale, au moins dans le contexte actuel où la circulation virale reste importante, de sorte à réduire le nombre d'infections et, donc, celui des hospitalisations.

16 % des personnes testées sont contaminées : ne pensez-vous pas que la stratégie en matière de tests doit être révisée ?
Professeur Alain Fischer. - J'en suis désolé, mais cette question est en dehors de mon champ de compétence. Ce qui importe, me semble-t-il, c'est la situation de l'école : je regrette que ce qu'avait préconisé le conseil scientifique, à savoir un dépistage systématique à l'école, n'ait pas été mis en oeuvre. Je conçois qu'il était difficile de le mettre en place, mais d'autres pays y sont parvenus.
Il y a sans doute quelques adaptations à opérer au niveau des tests, mais je ne connais pas suffisamment bien ce sujet.
Est-il envisageable de cibler le passe vaccinal sur les plus fragiles, notamment les plus âgés ?
Professeur Alain Fischer. - Non, il est très important que l'ensemble de la population se fasse vacciner : d'une part, c'est dans l'intérêt général, puisque se protéger, c'est protéger les autres, et, d'autre part, il ne faut pas oublier que certains jeunes adultes, sans facteur de risque, ont développé des formes sévères de la maladie.

Merci pour l'ensemble de ces informations, qui sont à la fois structurées, méthodiques et, d'une certaine façon, plus rassurantes que celles que nous a livrées le Dr Desbiolles hier : elle nous a par exemple expliqué que le port du masque et la vaccination des enfants étaient inutiles, à l'inverse de ce que vous affirmez aujourd'hui.
Je partage votre constat : il importe de persuader les médecins et les familles de l'intérêt de la vaccination. La communication est un art difficile, mais il va falloir trouver la bonne formule.
Professeur Alain Fischer. - Je vous remercie pour vos propos. Au passage, on entend parfois que les enfants ne supportent pas de porter un masque : c'est absolument faux. De manière générale, les enfants ont une capacité d'adaptation beaucoup plus forte que les adultes. Le port du masque est parfaitement justifié et réduit la transmission du virus.
Vous avez raison, il faut répéter inlassablement, par tous les moyens de communication à notre disposition, que la vaccination et le port du masque sont indispensables. Il ne faudra pas ménager notre force de conviction et de pédagogie.

J'ai récemment interrogé des pédiatres de l'hôpital de Marseille qui m'ont alerté sur le fait que les enfants hospitalisés en soins critiques étaient souvent des enfants souffrant de comorbidités dont le pédiatre ou le médecin avait conseillé aux parents de ne pas les faire vacciner.
Professeur Alain Fischer. - La Société française de pédiatrie, se fondant sur les données initiales dont nous disposions, a mis du temps avant de prendre position en faveur de la vaccination des enfants. Les pédiatres s'engagent encore trop souvent aujourd'hui sur la pointe des pieds.
Il est dommage de ne pas vous voir plus souvent dans les médias, professeur Fischer. Merci beaucoup pour vos réponses.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Une pétition en ligne déposée par M. Julien Devilleger le 12 janvier dernier sur la plateforme du site du Sénat enregistre actuellement une forte dynamique de signatures et devrait vraisemblablement atteindre le seuil de 100 000 signatures, au-delà duquel la conférence des présidents examine les suites qu'il convient de lui donner.
Le nombre de signatures s'élève aujourd'hui à plus de 33 500.
Cette pétition demande que soit réalisé « un état des lieux des effets secondaires consécutifs à l'injection vaccinale contre le covid-19, ainsi que du système de pharmacovigilance français ».
La commission des affaires sociales s'est saisie de la question des effets secondaires avec l'audition, en décembre dernier, de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Mme Christelle Ratignier-Carbonneil, laquelle a suscité un vif intérêt. La preuve en est que la vidéo de cette réunion est aujourd'hui l'une des plus visionnées sur le site du Sénat.
Ainsi que le Règlement du Sénat le permet, la Conférence des présidents a souhaité que cette pétition soit examinée sans attendre et a confié à la commission des affaires sociales le soin de déterminer la forme que pourraient prendre les travaux. Comme le prévoient également les règles en pareil cas, la pétition devrait désormais être fermée à la signature.
Il semble à notre présidente que, compte tenu de la défiance à l'égard des vaccins qu'exprime l'intitulé même de la pétition, la mobilisation de la communauté scientifique sous l'égide de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), à l'appui d'une étude sur ce sujet, serait tout à fait précieuse. Elle s'en est entretenue avec M. Gérard Longuet, premier vice-président de l'Office, qui partage ce point de vue.
C'est pourquoi la présidente de la commission vous propose de procéder, en application de l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, à la saisine de l'OPECST sur le champ couvert par la pétition déposée sur le site du Sénat.

Je n'ai pas d'observation particulière à formuler si ce n'est qu'il serait peut-être utile de mettre en regard de cette étude une évaluation des effets néfastes du virus lui-même !

Cette saisine de l'Office me semble justifiée. Cependant, je m'interroge sur les modalités d'examen des pétitions en ligne : si un seuil de 100 000 signatures a été fixé, pourquoi s'emparer de cette question, alors qu'à peine un tiers environ des signatures a été recueilli ? Ne donne-t-on pas ainsi trop de valeur à cette pétition ? En réagissant si vite, ne risque-t-on pas l'engorgement ?

C'est une bonne question, qui mériterait d'être posée lors de la prochaine réunion de la Conférence des présidents.

L'interrogation de Martin Lévrier est en effet pertinente.
En réalité, la Conférence des présidents qui s'est réunie hier soir a jugé que la dynamique des signatures était telle que le seuil des 100 000 signatures serait rapidement atteint et que, de ce fait, il était opportun d'aborder le sujet avant la suspension des travaux parlementaires.
Il en est ainsi décidé.
La réunion est close à 12 h 55.