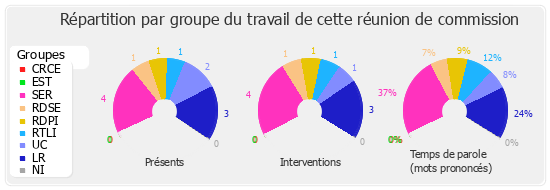Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Réunion du 9 février 2022 à 16h30
Sommaire
La réunion

Je vous remercie pour ces échanges qui nous ont fourni un éclairage précieux sur l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 12 h 35.
La réunion est ouverte à 16 h 30.

C'est avec un grand plaisir que nous recevons le ministre de l'agriculture et de l'alimentation pour échanger sur plusieurs dossiers qui intéressent au plus haut point notre commission. La dernière fois que vous êtes intervenu devant notre commission, c'était le 18 mai dernier, à l'occasion de l'examen du projet de loi « Climat et résilience ».
La semaine dernière, une table ronde a permis à notre commission de faire le point sur le bilan et les perspectives du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Nous avons ainsi exploré les enjeux liés à la raréfaction de la ressource en eau au cours des prochaines décennies et les solutions à envisager pour adapter notre modèle de gestion de l'eau, qui repose sur la concertation de tous les usagers.
En conclusion de cette séquence qui a duré neuf mois, le Premier ministre a notamment annoncé, au sein même de votre ministère, deux enveloppes de 100 millions d'euros chacune : la première pour accompagner les agriculteurs et leur permettre d'acquérir des agroéquipements innovants permettant de réduire la consommation d'eau et la seconde pour adapter les pratiques agricoles afin de consommer moins d'eau, avec des variétés plus résistantes à la sécheresse, favoriser l'émergence d'ouvrages innovants pour stocker l'eau et de nouvelles techniques d'irrigation.
D'autres mesures ont également été annoncées, comme le renforcement du rôle des préfets dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) et la révision du décret du 23 juin 2021 pour la détermination du volume prélevable hors période d'étiage. Pouvez-vous dans un premier temps dresser un bilan de cet exercice qui a réuni plus de 1 400 acteurs et qui tire les conclusions opérationnelles pour l'agriculture du travail de réflexion amorcé par les deux séquences des Assises de l'eau ? Quel sera le calendrier de mise en oeuvre des évolutions réglementaires - et éventuellement législatives - pour tenir compte des travaux du Varenne de l'eau ? En outre, quelle est la doctrine de votre ministère concernant les retenues d'eau et les nécessaires adaptations de notre système de production agricole au changement climatique, tout en assurant notre indispensable sécurité et souveraineté alimentaire ?
Cette audition nous offre également l'opportunité de vous interroger sur l'avancement des négociations sur le Pacte vert européen, dans le contexte de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Si ces négociations sont principalement menées par Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, que nous avons entendue il y a un mois sur le sujet, je relève que plusieurs dossiers stratégiques concernent les systèmes agricoles.
Je pense notamment au règlement européen relatif à la lutte contre la déforestation importée, qui vise à instaurer un devoir de diligence raisonnable pour les entreprises qui souhaitent mettre certains produits sur le marché de l'Union européenne, l'objectif étant de garantir que seuls des produits sans lien avec la déforestation sont autorisés sur ce marché. Plusieurs propositions sont débattues, notamment concernant l'extension du champ du règlement à d'autres produits de base, tels que l'hévéa, et la prise en compte de l'impact des productions concernées sur d'autres écosystèmes que les forêts, fragiles et riches en biodiversité, telles que les prairies et les zones humides. Peut-être pourrez-vous nous en dire plus sur l'avancée des négociations sur ce règlement, qui nous tient particulièrement à coeur : le Sénat avait largement complété la loi « Climat et résilience » sur son volet relatif à la lutte contre la déforestation importée.
Autre sujet pour l'agriculture dans ce Pacte vert : le règlement relatif aux puits de carbone naturels, qui prévoit l'atteinte en 2036 de la neutralité carbone pour les secteurs concernés par ce texte, ainsi que pour les émissions de l'agriculture hors CO2, liées à l'utilisation d'engrais et à l'élevage. La France est tenue par un devoir de réserve puisqu'elle préside le Conseil de l'Union européenne ; peut-être pouvez-vous toutefois nous donner des indications sur la teneur et l'avancée des débats à ce sujet ?
Je souhaiterais enfin profiter de votre présence pour aborder le sujet de la gestion des risques liés aux ammonitrates dans les ports, sur lequel notre commission s'investit depuis plusieurs semaines. Notre objectif est de publier un rapport en mars prochain, assorti de recommandations pour adapter ou renforcer notre législation, si cela s'avère nécessaire. Compte tenu des enjeux de prévention des risques liés au stockage de ces matières, nos réflexions portent également sur l'aval de la chaîne d'approvisionnement en ammonitrates, c'est-à-dire sur la gestion des risques au sein des coopératives et exploitations agricoles.
Vous venez de soumettre à la consultation publique un projet de décret visant à abaisser le seuil de déclaration des ammonitrates à haut dosage : ce seuil serait fixé à 150 tonnes, tous conditionnements confondus, contre 250 tonnes de vrac ou 500 tonnes de big bags actuellement. Cela a suscité de vives réactions de la part des acteurs de l'agriculture : quel regard portez-vous sur ce projet de décret et sur les inquiétudes qu'il suscite ?
Nous devons tous avoir en tête une difficulté majeure du monde agricole : nous vivons le présent avec des conceptions d'hier. Nous avons oublié le coeur du débat de nos anciens : l'agriculture est là pour nourrir les peuples. Or c'est ce qu'il y a de plus important. Avec le changement climatique, l'Europe aura demain, plus encore qu'aujourd'hui, un rôle de bassin nourricier. N'oublions pas que le« printemps arabe » est né de la crise du pain en Tunisie. Avec les sécheresses de l'été dernier ou la crise des engrais, nous voyons combien nous ne devrions pas l'oublier. Le Sri Lanka a confondu moyens et finalités, et cela a amené une des crises alimentaires les plus graves qu'ait connue ce pays depuis longtemps.
Nous sommes entrés dans la troisième révolution agricole. La première, ce fut la mécanisation permise notamment par le plan Marshall ; la deuxième ce fut l'agrochimie. Depuis lors, l'ensemble des politiques publiques, toutes majorités confondues, ont été guidées par la réduction des effets de cette deuxième révolution agricole. On a d'abord appelé cela l'agriculture raisonnée, dans laquelle j'ai baigné pendant ma formation d'ingénieur agronome dans les années 2000. Aujourd'hui, on appelle cela l'agroécologie.
Il faut continuer à limiter ces effets ; mais une nouvelle histoire de l'agriculture est en train de se créer : cette troisième révolution agricole est celle du vivant, de la connaissance, du numérique, de la sélection variétale, de la génétique, du biocontrôle, de l'agrorobotique. Lorsqu'on parle de trouver des substituts aux désherbants, il n'est pas vrai que l'on convaincra nos concitoyens de prendre une binette et de désherber à la main. La seule solution est l'agrorobotique.
Il y a 48 heures, j'ai présenté à Colmar à nos partenaires ce formidable site de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) : l'une des plus grandes bibliothèques de sélection variétale. C'est en France qu'on est en train de déterminer les sélections variétales résistantes au mildiou : c'est ainsi qu'on avancera.
Dernière transformation immense : le changement climatique, qui nécessite adaptation et protection. Ne perdons pas de vue la finalité nourricière de l'agriculture et donc la souveraineté alimentaire ; acceptons que les moyens ne puissent plus être ceux du passé pour éviter que ne tombe l'épée de Damoclès du changement climatique.
Le changement climatique pose d'abord une question sur la ressource en l'eau. Avec le Varenne de l'eau, nous avons pris trois engagements. Le premier, c'est l'assurance-récolte et la couverture des risques. Hier soir jusqu'à tard dans la nuit, nous avons eu un débat de très bonne qualité sur le projet de loi afférent. Je suis convaincu que les deux assemblées pourront se mettre d'accord sur ce sujet en commission mixte paritaire (CMP).
Deuxième volet : l'adaptation de nos pratiques culturales ; c'est une responsabilité du monde agricole, d'autant plus que s'il veut justifier d'augmenter ses prélèvements d'eau, il doit démontrer que les pratiques agricoles optimisent cette denrée rare qu'est l'eau. Nous avons investi dans ce domaine avec France relance et France 2030. Rien qu'en 2022, nous investirons 200 millions d'euros.
Juste un exemple : chacun se souvient du terrible épisode de gel. Certains agriculteurs avaient des matériels de protection : tours antigel, aspersion - tout cela doit être déployé partout. Mais ils auraient eu beau être à la disposition de tous, cela n'aurait pas suffi.
Troisième volet : le stockage et la gestion de l'eau. L'annonce du Premier ministre a été très claire. C'est précisément parce que ces sujets sont complexes, qu'il y a des conflits d'usage, qu'il faut les traiter. Nous sommes déterminés à avancer. Mais il faut, pour cela, que les cadres de discussions établis permettent in fine de prendre une décision. Des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) sont toujours en discussion depuis dix ou quinze ans. Une telle concertation ne peut pas durer aussi longtemps. Il faut donc revoir la circulaire de 2019 pour que le préfet puisse davantage encadrer le temps de discussion.
Les prélèvements d'eau doivent être sécurisés juridiquement. Le décret précité de 2021 était attendu depuis dix ans, car, en l'absence de règle du jeu claire, lorsqu'un préfet autorisait un prélèvement, celui-ci était attaqué neuf fois sur dix devant la justice administrative, avec des résultats parfois aberrants. Il s'avère qu'il faut aller encore plus loin, et c'est ce que nous avons annoncé ; il y aura le temps des consultations et de la validation, notamment si le décret doit être pris en Conseil d'État.
Deuxième élément : oui, il faut des retenues. Nous avons d'ores et déjà investi 13 millions d'euros dans l'optimisation des structures existantes - le curage des réserves est un sujet récurrent. Il faut continuer, créer de nouvelles structures là où c'est nécessaire et le faire avec une vision planificatrice. Nous avons travaillé avec les agences de bassin et les comités de bassin pour identifier, territoire par territoire, les dix projets les plus importants dans les dix à quinze prochaines années - car sur ce sujet, il nous faut travailler sur le temps long.
Il faut avancer sur la valorisation d'eaux qui ne sont pas réutilisées, comme les eaux usées. Cela n'est plus aujourd'hui un problème technique, mais d'acceptabilité et d'équation économique. Autre exemple qui me tient beaucoup à coeur et qui devrait occuper mes successeurs pendant une décennie : le changement climatique va engendrer de très fortes sécheresses l'été et de très fortes pluies en hiver et au début du printemps. Il y aura la même quantité d'eau, mais plus d'évapotranspiration, donc un bilan inférieur à celui d'aujourd'hui. Lorsque les nappes phréatiques sont pleines et que le sol est gorgé d'eau, tout mètre cube supplémentaire part à la mer. Il faut en prendre conscience, ce qui donnera plus de sérénité aux débats sur les conséquences d'un prélèvement sur l'étiage de la rivière. Il faudra trouver un consensus et identifier les solutions techniques ; dans le cas d'espèce, nous avons annoncé des expérimentations.
Vous m'interrogez sur les priorités françaises dans le Pacte vert européen - le Green Deal. Ce dernier est une vision politique, qui n'a pas encore été transcrite dans des textes législatifs. Cette vision doit se traduire avec pragmatisme : « il faut aller vers l'idéal en passant par le réel », comme aurait dit Jaurès.
Selon certains instituts indépendants, dont l'institut de la Commission européenne, son application telle quelle provoquerait une réduction de la production de 13 % et une augmentation des importations de 20 %, et deux tiers des émissions hors CO2 qu'on aurait réduites du fait de la politique agricole commune en Europe seraient importés du fait de l'augmentation des importations : on marche sur la tête !
Oui, le Green Deal est important, mais le rôle du Conseil des ministres de l'Union et du Parlement européen est de l'appliquer en prenant en compte la réalité.
L'une des priorités de la présidence française est d'arriver à la réciprocité des normes au niveau international. Je ne sais pas expliquer à un concitoyen qu'on peut importer des produits dont la production est interdite en Europe. Et je ne crois pas être le seul ! C'est un système qui dure depuis cinquante ans, notamment concernant les protéines, dont les États-Unis nous ont rendus totalement dépendants. Il faut y mettre fin via des clauses miroirs.
Il faut ainsi un règlement sur la déforestation. Vous vous souvenez de la théorie des avantages comparatifs, sur lequel on a tout fondé en matière agricole. Cet avantage peut prévaloir, mais pas s'il est fondé sur des externalités négatives environnementales, donc sur la destruction d'un bien commun, la forêt. Ce règlement interdira demain les produits issus de la déforestation importée.
Deuxième priorité : le carbone. J'ai réuni tous les ministres européens ces derniers jours. L'agriculture doit diminuer ses émissions de CO2, de méthane et de protoxyde d'azote, mais n'oublions pas que le sol agricole est le premier puits de carbone après le plancton marin - avant la forêt. On ne le sait pas suffisamment. Il faut prendre en considération le sol agricole et le sol forestier conjointement.
Nous serons demain à la croisée des chemins : soit l'Europe et les gouvernants disent aux agriculteurs et aux forestiers : nous allons vous imposer de réduire vos émissions grâce à une réglementation. Soit ils leur disent : dès lors que vous mettez en place une pratique culturale correcte, vous gagnerez des crédits carbone que vous pourrez vendre sur un marché.
C'est l'option à laquelle je crois profondément. Cela fait deux ans que nous y travaillons. L'entité France Carbon Agri a créé plus de 700 000 tonnes équivalent carbone de crédits carbone. Avec ma collègue Barbara Pompili, nous avons structuré l'offre en créant des labellisations sur des pratiques culturales sur l'agroforesterie, sur l'élevage, même sur les grandes cultures ; maintenant il nous faut structurer la demande. Pour vous donner un exemple, il y a dix jours, j'ai essayé de susciter l'intérêt vis-à-vis de certaines institutions comme la Caisse des dépôts, Action logement ou le Crédit Agricole ; j'ai annoncé qu'en 2022, le ministère que je pilote compenserait toutes ses émissions par l'achat de crédits carbone agricoles. Si le président Longeot pouvait faire en sorte qu'il en soit de même pour le Sénat, cela serait merveilleux - et cela aurait du sens pour la maison des territoires.

Monsieur le ministre, merci pour cette proposition que nous examinerons de près. Je vais donner la parole aux commissaires, pour qu'ils vous posent une première série de questions.

Dans son propos liminaire, le président Longeot a rappelé que notre commission a récemment tenu une table ronde au sujet de la gestion des risques liés à la présence de nitrates d'ammonium dans les ports fluviaux et maritimes. J'ai deux questions à vous poser concernant la gestion des risques liés à ces ammonitrates dans le monde agricole.
Le projet de décret dont le président Longeot a parlé vise à abaisser le seuil de déclaration des ammonitrates à haut dosage à 150 tonnes au lieu de 250 tonnes pour le vrac, et 500 tonnes pour les big bags. Certains acteurs craignent que cette évolution ne conduise des coopératives et des exploitations agricoles à déporter les stocks vers d'autres sites, afin de ne pas dépasser les nouveaux seuils, ce qui pourrait accentuer les risques. Ces inquiétudes sont-elles fondées ?
Monsieur le ministre, avez-vous prévu de prendre d'autres mesures dans les prochains mois, pour réduire les risques liés aux ammonitrates à haut dosage, par exemple en renforçant la formation des agriculteurs à la gestion de ces risques, ou en diffusant un guide national des bonnes pratiques, qui détaillerait et préciserait de manière simple les règles de stockage ?

Je souhaite vous poser deux questions concernant également la prévention des risques liés aux ammonitrates.
La première concerne la dépendance de notre agriculture aux engrais azotés. Les ammonitrates représentent une part significative des émissions de gaz à effet de serre en France. La loi « Climat et résilience » définit une trajectoire de réduction des émissions de protoxyde d'azote du secteur agricole d'ici à 2030, et envisage l'institution d'une redevance sur l'usage des engrais azotés minéraux. D'autres pays comme le Danemark ou les États-Unis sont allés bien plus loin, en instaurant un système de taxation des engrais azotés.
Monsieur le ministre, comment améliorer la sobriété de notre agriculture et tenir, d'ici 2030, les objectifs d'une réduction de 13 % de nos émissions d'ammoniac par rapport à 2005, et d'une baisse de 15 % de nos émissions de protoxyde d'azote par rapport à 2015 ?
Ma deuxième question rejoint par certains aspects celles de Pascal Martin. Selon notre réglementation, le seuil de déclaration des ammonitrates à haut dosage est fixé à 250 tonnes, alors que des seuils inférieurs sont appliqués en Belgique ou en Allemagne. Votre projet de décret nous rapprocherait des seuils de nos voisins européens, ce qui est tout à fait positif au regard des enjeux de sécurité.
Cependant, le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) révèle que la réglementation applicable à l'usage en vrac des ammonitrates à haut dosage serait bien moins « draconienne », pour reprendre les termes du rapport, en France que dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Australie ou l'Irlande. Pourriez-vous nous fournir des éléments de droit comparé sur ce point, afin de nous éclairer sur les progrès éventuels que nous pourrions réaliser ?

Le rapport dont a parlé Martine Filleul propose de renforcer la réglementation applicable aux stockages d'ammonitrates à haut dosage afin d'inciter les agriculteurs à privilégier les engrais à moyen dosage.
Or des acteurs du monde agricole nous ont alertés sur les risques qu'une restriction de l'usage des ammonitrates à haut dosage pourrait faire peser sur la souveraineté alimentaire de notre pays, puisque ces produits, à l'inverse des ammonitrates à moyen dosage, sont très majoritairement produits en France. Selon eux, cette restriction aurait pour effet d'augmenter les quantités de matières transportées sur nos routes, et donc les émissions polluantes. Ces inquiétudes vous semblent-elles fondées ?
Notre commission s'interroge notamment sur l'opportunité d'inciter à un usage plus conditionné des ammonitrates haut dosage, plutôt que de limiter purement et simplement leur usage. Votre projet de décret abaisse les seuils de déclaration pour les installations de stockage d'ammonitrates en mettant sur un pied d'égalité le vrac et les matières conditionnées. Ne pensez-vous pas que limiter l'abaissement du seuil de déclaration à 150 tonnes d'ammonitrates à haut dosage en vrac pourrait encourager les agriculteurs et les coopératives agricoles à privilégier les big bags ? Plus globalement, quel regard portez-vous sur l'idée d'interdire ou restreindre plus fortement l'usage des ammonitrates à haut dosage en vrac ?

Ma question porte sur la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE). Les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique ont fait réagir un certain nombre d'associations environnementales, qui craignent d'être mises à l'écart des discussions et des programmes d'action des PTGE.
Si la gouvernance doit être améliorée, il ne semble pas forcément souhaitable d'accélérer les concertations. Il est indispensable de prendre le temps de recueillir les données, et de rechercher un accord collectif. L'évolution de notre modèle agricole sous l'effet du changement climatique nécessite de renforcer les PTGE, en favorisant le dialogue et la concertation.
Comment les PTGE déclineront-ils concrètement les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique dans les territoires ? Quelles orientations particulières seront données aux préfets ?
Par ailleurs, alors que l'on dit souvent que l'eau paye l'eau, qui doit payer la création de stockages d'eau ? Est-ce la solidarité nationale, la solidarité locale ou la solidarité des agriculteurs ?
Pour répondre aux questions posées par Pascal Martin, Martine Filleul et Philippe Tabarot, la gestion des stocks d'ammonitrate ne relève pas des compétences de mon ministère, puisque l'approche n'est pas agricole, mais relève de problématiques de sécurité. Je ne suis pas signataire de ce décret, et je ne peux pas vous donner les éléments de législation comparée que vous demandez.
En revanche, j'ai regardé le sujet de près. J'entends ce que vous avez dit tant sur les conséquences d'une distinction entre les produits en vrac et ceux qui ne sont pas stockés en vrac, que sur le risque de déport signalé par Pascal Martin. La consultation doit avoir lieu, et ces éléments doivent remonter par ce moyen. Aujourd'hui, aucun décret n'est signé, il y a simplement une consultation qui est organisée.
Monsieur le sénateur Martin, même si cela ne relève pas des compétences de mon ministère, renforcer la formation des agriculteurs et établir un guide de bonne pratique semble être à l'évidence une bonne idée. Mais le sujet des ammonitrates n'est pas nouveau : cela fait une soixantaine d'années que les agriculteurs gèrent et utilisent ces produits. Les forces de sécurité, et notamment les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), gèrent les questions de sécurité dans les territoires, et la concertation lancée a précisément pour but de faire remonter ces éléments.
Concernant notre dépendance vis-à-vis des importations de certaines formes d'engrais azotés, il y a trois usages de ces engrais : sur l'une, notre production est indépendante ; l'autre peut être substituée ; et nous ne sommes dépendants que sur la troisième forme.
Ma position est pragmatique. Les engrais sont la nourriture de la plante, et les débats deviennent parfois irrationnels. Sans engrais, il n'y a plus de production. Il y a une corrélation directe entre la quantité d'engrais et la croissance de la plante, même si à un moment un excès d'engrais ne sert plus à rien pour la plante. Il faut bien nourrir la plante au bon moment, mais nous ne pourrons jamais nous passer d'engrais, naturels, organiques ou chimiques. Une plante de culture se nourrit, il faut le rappeler.
Concernant la dépendance vis-à-vis des d'engrais, ces derniers mois, nous nous sommes entièrement mobilisés face à ce qui a été appelé la « crise de l'engrais », très forte cet été et cet automne. Au-delà du prix, qui reste un sujet fondamental, nous avons réussi à éviter une pénurie d'engrais en France et à régler les questions logistiques liées aux fournitures d'engrais, qui plus est dans la période du covid.
Si la situation a été compliquée en France, elle a été très compliquée dans d'autres pays européens ne disposant pas de nos capacités de production, et qui ont dû parfois fermer des sites de production d'engrais en raison de la hausse du prix du gaz. Nous avons eu une bonne récolte de céréales cette année en France, mais dans certains pays européens les récoltes ont été mauvaises du fait de la sécheresse. Si cela a été très compliqué pour certains pays européens, cela a été incroyablement compliqué pour d'autres pays dans le monde.
J'ai tapé du poing sur la table au niveau du Conseil européen et auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) : on ne pourra pas dire, si nous connaissons une crise alimentaire l'année prochaine, que nous n'avons pas été prévenus. Les engrais sont nécessaires à la production. Il faut que tout le monde s'organise face au risque de la pénurie d'engrais.
En France, au-delà de la gestion de la crise conjoncturelle des engrais, de la question du prix et de l'accessibilité des engrais, nous devons utiliser les financements du plan France 2030 pour investir fortement dans nos capacités de production d'engrais permettant de moindres émissions de protoxyde d'azote.
S'il suffisait d'une taxe pour changer l'utilisation des engrais, cela se saurait. La flambée des prix des engrais est d'ailleurs probablement un très bon marqueur de leur importance. Dans les prochains mois, nous chercherons à évaluer les conséquences d'éventuelles taxes. Si une telle taxe avait été instaurée au moment où la loi « Climat et résilience » a été votée, elle aurait en réalité été cinq fois plus lourde pour les agriculteurs !
Je ne crois pas que les taxes fassent changer les pratiques. La loi a d'ailleurs non pas instauré une taxe, mais indiqué le chemin pour savoir s'il était pertinent d'établir une nouvelle taxe, et si le Parlement devait se positionner sur ce sujet.
Je pense que c'est par les pratiques culturales que l'on fait avancer les choses : pour gagner en autonomie, je crois beaucoup à la question des protéines, à celle des rotations de cultures, à l'utilisation d'engrais organiques. Je crois beaucoup plus à cet accompagnement qu'à l'idée qu'il suffirait de mettre en place une taxe sur les engrais azotés pour réduire leur utilisation.
Tout ce que l'on fait concernant les protéines, dans le cadre de la PAC et du plan Protéines, est fabuleux. Il faut qu'on produise davantage de protéines et qu'on plante davantage de haies dans notre pays, ce sont mes deux grandes marottes. Cela serait beaucoup plus efficace que de créer de nouvelles taxes.
Monsieur Gold, il faut avoir de la détermination concernant la création de stockages d'eau. Sur la gouvernance des PTGE, il faut faire en sorte que la concertation ne dure pas quinze ans. Par une circulaire de 2019, le Premier ministre a annoncé un renforcement du poids du préfet, qui peut limiter dans le temps la concertation.
Enfin, concernant le financement local des PTGE, je suis convaincu que l'État peut aider. Le plan de relance y a tout d'abord consacré 30 millions d'euros, et nous venons d'annoncer une deuxième aide de 13 millions d'euros - d'autres aides seront annoncées dans le cadre du plan France 2030. Mais en définitive, un projet territorial est toujours porté par les acteurs du territoire, et non par l'État, qui doit avoir une vision, planifier, faciliter, financer, permettre d'accélérer les réalisations. Mais ce sont les acteurs du territoire, à l'échelle tant des régions que des échelons plus locaux, qui doivent se réunir, discuter, et se mettre d'accord pour initier le projet.

Monsieur le Ministre, vous avez évoqué dans votre intervention liminaire le sujet de la déforestation importée, qui est étroitement lié à l'importation de protéines. Depuis le début des années 1960, l'accord préférentiel entre l'Europe et les États-Unis avait conduit la France à privilégier la production d'amidon, alors que l'Amérique, les États-Unis, mais également le Brésil, nous procurait des protéines végétales.
Non seulement cet accord a vieilli, mais il a surtout participé à la déforestation de la forêt amazonienne, qui s'accélère depuis l'arrivée au pouvoir du président Bolsonaro. L'année dernière, le « poumon vert » de la planète a perdu une surface équivalente à celle de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais.
Pour mettre fin aux importations de soja sud-américain, qui reviennent à importer de la déforestation, une stratégie est menée au niveau de l'Union européenne, dont vous êtes au nom de la France le fer de lance. Il y a un an, vous aviez annoncé la création d'un plan Protéines et d'une stratégie nationale à 10 ans pour les protéines végétales, doté de 100 millions d'euros. Un an plus tard, pouvez-vous établir un point d'étape, pour que nous sachions si la trajectoire fixée est bien respectée ?

J'ai l'intime conviction qu'avec tous les organismes de la filière agricole, nous devons être les acteurs de cette troisième révolution agricole, à condition d'abandonner quelques tabous.
La proposition de résolution déposée par le président Longeot et notre collègue Jean-Pierre Moga sur le développement de l'agrivoltaïsme ouvre des perspectives qui ne sont pas révolutionnaires - il y a longtemps que les Espagnols savent élever les moutons sous les panneaux solaires -, mais qui permettent de concilier les deux impératifs de l'économie des terres agricoles et de l'équilibre de notre mix énergétique. Nous devons également prendre en compte les revenus des agriculteurs, qui demeurent fragiles.
Le 21 février prochain, en compagnie des deux sénateurs auteurs de la proposition de résolution, je visiterai un projet de grande culture, qui a rencontré de nombreuses difficultés, en particulier pour être accepté par la direction départementale des territoires (DDT). Le préfet d'Occitanie, Étienne Guyot, m'a dit qu'il serait présent ou que ses services seraient représentés. Cela me semble important, car l'agrivoltaïsme ouvre de nouvelles voies. Le changement climatique rend délicate la maturation des céréales dans le sud de la France, car les épis brûlent avant maturation. Comment peut-on sensibiliser les préfets et les DDT afin qu'ils facilitent davantage la réalisation de projets pilotes, dont nous avons besoin ?
Je ne comprends toujours pas comment la Commission européenne a pu voter le Pacte vert sans attendre les résultats de son bureau d'étude. Faut-il profiter de la présidence française de l'Union européenne pour remédier à cela, et remettre les choses à leur place ?

Je voudrais revenir sur le pilotage par les préfets des PTGE. Vous parliez de limiter dans le temps les concertations qui seraient trop longues, mais sur le terrain, en liaison avec les collectivités territoriales, cette volonté n'est pas toujours très bien vécue.
Par ailleurs, la gouvernance de la construction des barrages de Sivens et de Caussade, dans le Lot-et-Garonne, était pilotée par les services de l'État, en contradiction avec les positions des collectivités territoriales et des élus locaux. Cela s'est mal passé ! Il va falloir trouver une position d'équilibre concernant les PTGE. Nous comprenons l'intérêt de mener une concertation de qualité, mais attention à ne pas provoquer le décrochage des parties prenantes locales.
Concernant l'affirmation du rôle des préfets, la loi dite « 3DS » prévoit également d'élargir le rôle des préfets dans la gouvernance des agences de l'eau. De manière globale, le rôle des préfets est affirmé par rapport à celui des collectivités territoriales. Les conseils d'administration des agences étaient parfois présidés par des préfets, mais parfois par d'autres acteurs.
Quelle est votre vision de la gouvernance de l'eau ? J'imagine que les comités de bassins resteront toujours présidés par des élus, mais il y a toujours un sujet au niveau de cette affirmation préfectorale.
Enfin, quand on voit les orientations du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique et de la loi « 3DS », on s'interroge sur les contractualisations avec les régions. Le Varenne de l'eau contient des orientations concernant les filières agricoles et professionnelles, mais qu'en est-il de la volonté d'une contractualisation de qualité avec les régions, sur un certain nombre d'objectifs développés par le Varenne de l'eau ?

Le dispositif des paiements pour services environnementaux (PSE) constitue un outil technique innovant au service de la transition écologique. Son référentiel couvre, non seulement la protection des sols, la biodiversité et la protection des paysages, mais aussi la préservation de la qualité de l'eau et, parfois, son stockage, ainsi que le stockage du CO2. En fin de compte, les PSE permettent de rétribuer les externalités positives d'une activité principale qui, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, consiste à nourrir les gens.
Mes questions sont simples : quel bilan dressez-vous des PSE et quelles sont leurs perspectives de développement ? À l'inverse, n'avez-vous pas peur avec le dispositif des crédits carbone de détourner les agriculteurs de leur activité principale, ce qui se produit parfois à la marge avec les méthaniseurs pour ce qui concerne la production énergétique, et, ainsi, de les transformer en quelque sorte en traders en crédits carbone ?

Ma question porte sur la plantation des haies. Aujourd'hui tout le monde se mêle de ce sujet, qu'il s'agisse de l'État, des régions, des départements, des communautés de communes, que ce soit ou non dans les contrats de relance et de transition écologique. Il conviendrait d'organiser un peu tout cela dans le cadre des nouveaux plans de soutien à la plantation de haies, car les dossiers sont de plus en plus complexes à gérer.
Concernant la captation du carbone, entendez-vous vraiment en faire une politique publique, une politique administrée par l'État, ou n'y a-t-il pas là une nouvelle économie, un marché qui se crée comme dans d'autres pays ? En Belgique, pays que je connais particulièrement bien, ce sont essentiellement les entreprises privées qui aident les agriculteurs à trouver des solutions pour capter davantage de carbone.

Ma première question concerne la balance commerciale de notre pays. Les chiffres sont évocateurs : nous avons perdu deux tiers de notre excédent commercial agricole en une douzaine d'années. Comment les choses vont-elles évoluer selon vous ? On sait que les aléas climatiques entraînent une baisse de la production ; notre production agricole souffre aussi d'un manque de recherche technologique sur les variétés. Comment comptez-vous agir pour relever ce défi ?
La meilleure assurance contre le risque climatique aujourd'hui, c'est évidemment la ressource en eau et l'irrigation. Vous avez parlé de réserves de substitution : il faut toujours beaucoup de temps pour les constituer et les procédures sont souvent très compliquées, sans compter qu'elles mobilisent de nombreux opposants. Au-delà des déclarations d'intention, comment envisagez-vous d'avancer sur ce dossier ?
Ma seconde question concerne la captation carbone. Je vous alerte sur l'existence de nombreuses entreprises étrangères qui sont à la recherche de terres agricoles pour y implanter des plantations et des forêts, notamment dans mon département, et ce pour profiter des crédits carbone. Qu'en pensez-vous ? Ne risquons-nous pas de livrer nos réserves de carbone à des pays tiers européens et de nous priver ainsi d'une activité que nous pourrions exercer nous-mêmes ?
Monsieur le sénateur Marchand, votre question est fondamentale. Lorsque la PAC a été créée, les Américains ne s'y sont pas opposés, mais, en contrepartie, ils ont demandé aux Européens de rester dépendants de leurs diverses productions de protéines, ce qui est le cas depuis lors. Les accords commerciaux, comme ceux qui ont été signés dans le cadre du cycle de Doha, ou l'Accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay (the Uruguay Round Agreement on Agriculture), ont consacré cette situation au point que, lorsque l'Europe a tenté de changer véritablement de politique et de reconquérir sa souveraineté protéique, comme a réussi à le faire le Président de la République pour la France à travers la mise en place d'un plan Protéines doté de 120 millions d'euros, cela s'est révélé très difficile.
Au niveau européen, la nouvelle politique agricole commune devrait soutenir la production de protéines, mais il faut bien comprendre qu'il a parfois été très compliqué de traduire cette ambition dans les faits, notamment parce que les aides auxquelles on voulait recourir ne convenaient pas. En réalité, c'est la France qui a réussi à faire bouger les lignes.
À l'échelon national, au travers du plan de relance, nous consacrons 120 millions d'euros à cette politique : nous avons d'ores et déjà soutenu 6 200 projets, et 56 projets au titre de la structuration des filières. L'effort est donc très significatif. Au total, plus de 75 millions d'euros seront dédiés aux équipements, plus de 50 millions d'euros à la structuration des filières. Cette action se poursuivra dans le cadre du plan France 2030 : de mémoire, une nouvelle ligne de crédits de 30 millions d'euros a déjà été ouverte pour promouvoir la recherche en protéines. Pour moi, il s'agit d'un marqueur absolument crucial de notre politique.
Monsieur le sénateur Médevielle, vous m'interrogez, d'une part, sur les New Breeding Techniques (NBT) et, d'autre part, sur l'agrivoltaïsme.
À titre personnel, je crois totalement aux NBT. Simplement, comme l'écrivait Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Autrement dit, il s'agit d'un progrès, mais il faut mettre en place cette technologie de manière convenable, notamment en recourant à la sélection variétale. Si cette sélection accélérée est destinée à créer des plantes résistantes à des maladies liées au changement climatique et permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne se dit pas que cette technologie est intéressante. À l'inverse, si c'est pour produire une plante qui résiste aux produits phytosanitaires, cela n'a aucun sens.
En tous les cas, je vous informe que l'Europe a pris une position très proche de celle de la France. Nous attendons encore la nouvelle réglementation sur les NBT, mais je peux vous dire que la vision politique de la Commission européenne est conforme à celle de notre pays.
Je vous rejoins également sur l'agrivoltaïsme. Il faut faire en sorte de clarifier cette notion, ainsi que celle de « terre agricole ». L'agrivoltaïsme est un système qui repose sur la synergie entre production d'électricité photovoltaïque et activité agricole, c'est-à-dire qu'il donne davantage de valeur à cette activité. Il ne s'agit pas, vous l'avez compris, de placer des panneaux à un, deux ou trois mètres au-dessus de deux poules et de trois lapins !
Pour que l'agrivoltaïsme devienne une très belle opportunité, il faut en retenir une définition très claire, faire en sorte qu'elle soit reprise dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) et de ceux de l'Agence de la transition écologique (Ademe), et l'introduire à terme dans le droit de l'urbanisme en vue de sa planification territoriale.
Enfin, sur la nécessaire évaluation de la Commission européenne, je partage les propos qui ont été tenus. Cela étant, il est déjà convenu, puisque l'on a fait adopter une position commune du Parlement et du Conseil, que la Commission devra publier des études et produire une évaluation de sa vision du Pacte vert avant que les textes soient votés.
Monsieur le sénateur Gillé, il faut veiller à ce que tout se passe bien dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), faute de quoi nous finirons par nous retrouver dans une impasse. Les PTGE représentent l'aboutissement de tout un processus qui a duré plusieurs décennies et qui a consisté à trouver le cadre de concertation le plus approprié sur ces sujets difficiles.
Il faut que la concertation soit menée à bien, et pour ce faire il faut que les règles soient bien définies. Pour que tout se déroule correctement, il faut offrir la possibilité à une autorité, en l'occurrence le préfet, de circonscrire la phase de concertation dans le temps ; de même, après la phase de concertation, une fois que les décisions ont été prises, il faut les faire appliquer de manière très stricte. On ne peut pas admettre que certains continuent de s'opposer aux choix décidés démocratiquement, et c'est évidemment le rôle du préfet, en tant que dépositaire de l'ordre public, de les faire respecter.
Cela étant, je préfère insister sur le rôle que joue le préfet dans le cadre de la concertation, celui de tout faire pour fixer un cap et faire aboutir la concertation dans des délais raisonnables.
Je partage pleinement vos propos, Monsieur Gillé, sur les projets de gouvernance et la contractualisation de l'État avec les régions. D'ailleurs, lors du Varenne de l'eau, l'État a signé deux premiers contrats avec les régions. Je le redis, un projet ne peut pas aboutir s'il n'est pas porté au niveau local, en l'occurrence, s'agissant de l'eau, par les régions, au vu de leurs compétences en matière économique.
Monsieur Pointereau, vous avez également abordé la question de l'eau. Permettez-moi de dresser un bilan de ce que nous avons fait dans ce domaine : cela faisait dix ans que l'on parlait d'un décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et personne n'avait osé le prendre. Personne ! Le Gouvernement, lui, l'a pris en juin 2021 et il va même certainement aller encore plus loin en le révisant à la suite des conclusions du Varenne.
Notre ministère investit déjà 30 millions d'euros dans les infrastructures d'eau à travers le plan France Relance. Pour un certain nombre de projets, l'État est venu se substituer aux collectivités. Je pense à un exemple précis, assez emblématique, d'une collectivité qui, à l'approche des élections, a préféré se retirer pour garder ses financements. Je suis donc très favorable à la contractualisation, mais elle n'est possible et efficace, je le répète, que s'il existe une volonté politique forte au niveau local.
Par ailleurs, l'État n'est pas loin d'avoir engagé plusieurs centaines de millions d'euros dans les matériaux de protection, d'irrigation et d'adaptation au changement climatique.
Enfin, le troisième volet de réflexion du Varenne de l'eau sur les PGTE et l'utilisation de l'eau correspond à une dynamique très forte. Ce ne sont pas des paroles en l'air : il s'agit d'argent qui a déjà été dépensé, de décisions réglementaires qui ont déjà été prises, ou qui ont été annoncées et devraient se concrétiser prochainement.
J'y insiste, le rôle de l'État est de créer un cadre favorable, d'accompagner et d'investir, mais aucun projet ne peut aboutir sans une volonté politique forte localement : il faut donc du courage à tous les étages !
Monsieur le sénateur Houllegatte, je ne pense pas du tout que les crédits carbone vont détourner les agriculteurs de leur vocation. Je vais tenir un raisonnement vraiment très sommaire : pour moi, un agriculteur est un entrepreneur du vivant qui nourrit le peuple. Il doit donc gagner sa vie, et son activité doit être bénéfique, d'abord pour lui et sa vie de famille et, ensuite, pour la Nation et les transitions.
Le système des crédits carbone est tout simple : un agriculteur est rémunéré dès lors que sa pratique culturale permet de stocker du CO2 et est bénéfique pour l'environnement. Cette rémunération lui est versée par le marché, par des investisseurs notamment privés, monsieur le sénateur de Nicolaÿ, et pas seulement via une subvention du ministère de l'agriculture ou de l'environnement, comme c'est le cas par exemple pour les PSE, dans lesquels je crois beaucoup par ailleurs.
Dans ce domaine, je ne défends pas une vision mercantile ; je plaide simplement pour une approche pragmatique.
Cela étant, nous allons devoir relever un véritable défi au niveau européen, car le coût des crédits carbone européens est beaucoup plus élevé que celui des crédits carbone sud-américains, en raison d'une différence de référentiel : 35 euros environ contre 5 à 8 euros. Dans ces conditions, comment convaincre le marché, public ou privé, d'investir en Europe alors que c'est moins cher ailleurs ?
Monsieur Pointereau, vous avez évoqué le déficit de notre balance commerciale ; en fait, l'enjeu est avant tout d'accroître notre compétitivité, car c'est de cela qu'il s'agit, d'abord la compétitivité-coût, mais aussi la compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualité.

Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que l'agriculture devait être nourricière et que nous avions perdu de vue cet élément fondateur.
L'agriculture évolue, c'est une évidence. Je suis moi-même élu dans un département agricole où l'on trouve beaucoup de polycultures, avec beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans l'horticulture. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il faudrait tendre vers une sélection variétale, notamment des plants. Les agriculteurs ne doivent-ils pas craindre une standardisation de l'offre, qui viendrait quelque peu réduire la diversité de ce l'on peut consommer dans ce pays ?
De votre point de vue, plusieurs sortes d'agriculture peuvent-elles cohabiter, par exemple une agriculture reposant sur un modèle extensif et d'autres types d'agriculture préservant davantage la qualité variétale des plants et, donc, la qualité de la nourriture ?
Il est vrai qu'il existe différents types d'agriculture ; seulement, à titre personnel, je défends tout autant - c'est d'ailleurs une critique que l'on m'adresse - l'agriculture biologique que l'agriculture de conservation, celle qui capte du carbone, l'agriculture à haute valeur environnementale et l'agriculture conventionnelle, qui privilégie la diversification des productions au travers des rotations.
J'ai le sentiment, pour avoir des échanges réguliers avec un certain nombre d'experts, notamment ceux de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), que la diversité génomique des principaux cépages est aujourd'hui assez faible, autrement dit qu'il existe déjà, de fait, une forme d'uniformisation. C'est d'ailleurs l'immense force de l'Inrae d'entretenir la diversité génomique par la sélection variétale en ne cessant jamais de faire des croisements, en vue notamment de lutter contre telle ou telle maladie.

Nous vous remercions pour cet éclairage, monsieur le ministre, et pour la qualité de ces échanges.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 17 h 20.