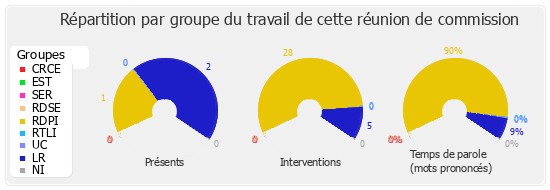Mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables
Réunion du 10 avril 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. alain griset président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de mme monique amoros coprésidente de la confédération nationale artisanale des instituts de beauté (voir le dossier)
- Audition de mm. christian couzinou président du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et jacques levoyer vice-président de l'union des jeunes chirurgiens dentistes-union dentaire (voir le dossier)
- Médecine esthétique
La réunion
Audition de M. Alain Griset président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de Mme Monique Amoros coprésidente de la confédération nationale artisanale des instituts de beauté
Audition de M. Alain Griset président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de Mme Monique Amoros coprésidente de la confédération nationale artisanale des instituts de beauté

En l'absence de Mme Jouanno, retenue par des impondérables, il me revient d'accueillir les représentants de l'assemblée permanente des chambres de métiers et d'artisanat (APCMA) : M. Alain Griset, président, et Mme Béatrice Saillard, directrice du département des relations institutionnelles. Je souhaite également la bienvenue à Mme Monique Amoros, coprésidente de la confédération nationale artisanale des instituts de beauté (Cnaib).
Comme vous le savez, le champ d'étude de notre mission n'est pas circonscrit aux dispositifs médicaux implantables mais s'étend à l'ensemble des interventions à visée esthétique, parmi lesquelles les très nombreux actes réalisés par la profession des esthéticiennes, ici représentées. Ce secteur de l'esthétique, en pleine expansion, évolue rapidement. Certaines de ses innovations scientifiques se situent parfois à la croisée de la médecine et appellent une attention particulière. Songeons par exemple aux techniques controversées de lyse adipocytaire... Comme pour les dispositifs médicaux implantables, il nous revient de nous pencher sur la réglementation applicable aux actes réalisés par cette profession, notre préoccupation centrale étant bien entendu d'assurer les meilleures conditions de sécurité aux consommateurs.

Combien existe-t-il d'instituts de soins esthétiques ? Quels sont le nombre d'esthéticiennes en activité en France et la proportion d'instituts qui relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat ? Je voudrais également connaître le poids économique du secteur et mesurer les évolutions récentes du marché.
Les chambres de métiers et de l'artisanat travaillent depuis de nombreuses années en partenariat avec la Cnaib, organisation représentative de l'esthétique. L'objectif de cette collaboration est de fournir aux consommateurs, dont les attentes évoluent autant que les techniques, l'information la plus précise possible car il s'agit d'un sujet sensible.
La loi de 1996 relative à la qualification de l'artisanat a instauré une qualification obligatoire des exploitants d'instituts de beauté afin que les consommateurs soient assurés d'avoir affaire à des personnes qualifiées. Face aux kinésithérapeutes auxquels le terme de « massage » avait été réservé, nous avions obtenu du ministre du commerce et de l'artisanat de l'époque, M. Renaud Dutreil, l'introduction dans la loi du terme de « modelage » comme étant une prestation pouvant être effectuée par les esthéticiennes. Malheureusement, le terme de massage est aujourd'hui utilisé par de très nombreuses structures qui ne sont pas des instituts de beauté et qui peuvent pratiquer ces massages sans avoir à justifier d'aucune qualification. Cela s'explique par la coexistence de deux codes professionnels distincts : seul le code 9602B, réservé aux instituts de beauté, impose une qualification pour effectuer du modelage, le code 9604Z permettant de faire du massage sans qualification tout en étant inscrit au répertoire des métiers.
Il s'agit effectivement des salons de massage que l'on voit fleurir partout et qui représentent donc une concurrence déloyale pour les instituts de beauté tout en étant source de confusion pour le consommateur.
Oui, c'est ce qui préoccupe la profession des esthéticiennes. Les esthéticiennes se trouvent associées à des pratiques qu'elles n'ont pas le droit d'exercer bien qu'étant qualifiées pour ce faire, alors que ces pratiques peuvent être exercées par des personnes non qualifiées et dans de mauvaises conditions, notamment du point de vue sanitaire. Cela est de nature à tromper le consommateur.
En France, on compte 36 000 entreprises, 65 000 esthéticiennes, pour un chiffre d'affaires de 1 428 millions d'euros ; 9 150 instituts de beauté emploient 94 % du nombre total de salariées, c'est-à-dire 30 000 salariées. 69 % des salariées sont à temps plein et 64 % en CDI.
La croissance de l'activité a été d'un peu moins de 1 % entre 2010 et 2011.
Ce sont, dans l'ordre d'importance, l'épilation, la vente de produits, les soins du visage et du corps, la manucure et la beauté des pieds, le maquillage. Aujourd'hui, la clientèle demande surtout des nouveautés : spas, soins amincissants, soins de bien-être et lumière pulsée pour la dépilation. Nous devons faire face à une forte demande malgré les difficultés que nous rencontrons.

L'usage de la lumière pulsée en institut est interdite. Les médecins affirment que son usage requiert des connaissances et des pratiques garanties par un diplôme.
Nous aurions voulu qu'elle soit autorisée aux esthéticiennes de niveau 4, celles qui détiennent un brevet professionnel ou un bac pro, et aux esthéticiennes de niveau 3, qui possèdent un BTS ou un brevet de maîtrise, sur la base d'un certificat médical produit par le client et attestant que celui-ci ne souffre pas de certaines pathologies. L'objectif est de vérifier que sa peau est saine. Nous n'avons absolument pas de vocation curative.

Vous avez abordé les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d'esthéticienne. Pourriez-vous décrire succinctement l'organisation et le contenu des formations dispensées à ce titre ? Ces formations vous paraissent-elles suffisamment complètes et adaptées ?
Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP), diplôme de niveau 5, est le seul requis pour ouvrir un institut. On y apprend les gestes de base : manucure, épilation à la cire et à la pince, soins du visage, beauté des mains et des pieds, maquillage. Au niveau 4, brevet professionnel (BP) ou bac professionnel, s'ajoutent des notions de gestion et de comptabilité ainsi que l'apprentissage des soins du corps et de soins plus sophistiqués pouvant nécessiter la manipulation d'appareils.
Dans le cadre CAP, on apprend à traiter des types de peau particuliers par l'application de produits spécifiques (anti-âge, déshydratation) et les soins du corps (amincissement et relaxation).
Avec des crèmes ou des appareils. Au niveau 3, correspondant au brevet de maîtrise et au brevet de technicien supérieur (BTS), on apprend le management et l'on se dote de compétences plus pointues dans le métier.
Nous avons demandé à plusieurs reprises au ministre de faire évoluer le niveau minimum d'installation, le BP nous paraissant plus approprié que le CAP pour ouvrir un institut de beauté. Les décrets de la loi de 1996 pourraient venir faire évoluer la réglementation en ce sens.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2009 et la création du statut d'auto-entrepreneur, des personnes, même non titulaires du CAP, peuvent proposer au public des actes d'esthétique à domicile. Cela pose problème en termes de concurrence et de protection du consommateur.
Les consommatrices aussi. Mais ce régime, que nous combattons depuis son origine, le permet puisqu'il n'existe pas de contrôle.

Internet ne permet-il pas l'achat d'instruments destinés aux soins du corps qui échappent, hélas, à toute surveillance quand ils sont utilisés individuellement et qui connaissent un fort développement ?
Vous avez raison. Il en va ainsi de la lumière pulsée pour laquelle des appareils sont facilement disponibles sur Internet. La réglementation fait défaut.
Les instituts de beauté sont soumis aux contrôles de l'inspection du travail, de la médecine du travail, des unions de consommateurs ainsi que de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette dernière vérifie les prix et la conformité des appareils, des diplômes ou encore de l'affichage, s'agissant par exemple des cabines de bronzage.
Le diplôme est contrôlé à l'installation.

On pourrait imaginer une situation où la patronne est diplômée mais pas ses employées...
Une praticienne non diplômée doit travailler sous le contrôle permanent de l'exploitante.

Ce qui signifie dans ce cas-là que c'est l'exploitante qui est responsable des actes effectués par son employée. Vous avez intérêt à disposer de personnels qualifiés !
Les contrôles de la DGCCRF sont fréquents pour les UV. Lorsqu'ils viennent pour contrôler les installations d'UV, les agents de la DGCCRF mènent un ensemble de contrôles, y compris sur les prix.
En dehors des apprenties, les esthéticiennes embauchent au minimum des titulaires de CAP et de BP. Elles ne peuvent pas se permettre d'avoir des salariées non qualifiées. Ce serait un non-sens au plan commercial.
Comme on le dit dans notre profession, le CAP constitue un tremplin d'entrée pour poursuivre vers un BP ou un bac pro.

En matière de responsabilité, existe-t-il des règles, un régime ? Les incidents touchant les clientes sont-ils portés à votre connaissance ?
Nous avons interrogé nos assureurs : aucun accident, ni aucun incident n'a été relevé. Dans le cadre de l'élaboration du décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique, la Haute Autorité de santé (HAS) a conduit une étude sur les soins amincissants : pas d'incidents, pas d'accidents. Les seuls incidents intervenus concernent la lumière pulsée dans son utilisation pour la réjuvénation : des érythèmes sont parfois apparus mais ils ont disparu en quelques heures. Nous n'avons donc pas connaissance de problèmes d'hygiène, ni d'accidents graves. C'est plutôt dans certains salons, qui ne sont pas des instituts de beauté et qui utilisent des méthodes comme le nettoyage des pieds en aquarium, qu'il peut y avoir des problèmes sanitaires, par exemple des mycoses.

Vous devez bien avoir des incidents liés à des allergies, sans compter des blessures qui s'infectent ? Un panaris à la suite d'une manucure, par exemple. Cela ne vous arrive donc jamais ? En coupant un ongle incarné ?
Nous n'intervenons qu'en superficie : on ne doit en aucun cas faire saigner. Nous ne touchons pas aux ongles incarnés : cela relève de la profession médicale.

Les produits sont-ils bien agréés ? Quant aux éventuelles complications, s'il y a une réaction cutanée, vous ne revoyez pas nécessairement le client : il va voir son médecin.
Une allergie est toujours possible. En pratique, les clients qui sont allergiques le savent et nous préviennent. Il existe des gammes de produits ne contenant pas de substances allergènes. Mais il est également possible de développer subitement une allergie sans qu'il y ait eu de préavis...
Jamais ! C'est strictement interdit et les fournisseurs ne nous livrent aucun produit qui pourrait être ainsi utilisé.

Puisque les produits changent sans arrêt, qu'en est-il de la formation continue et qui vous la dispense ?
Les fournisseurs assurent une formation théorique et pratique : une journée pour un produit ou davantage pour une gamme. Nous ne trafiquons pas nos propres produits.

Vous utilisez les rayonnements. Vous savez que leur usage est cancérigène, comme le souligne cet article paru dans Le Parisien le 3 avril ? Avez-vous des règles rigoureuses en la matière ?
Nous devons d'abord définir le type de peau pour déterminer le temps d'exposition et son fractionnement. Certains types de peau ne passent jamais en UV.

Les UV sont accusés d'augmenter les mélanomes, ces tumeurs cancéreuses de la peau.
Passer toute la journée au soleil est sûrement plus dangereux que de faire une séance d'UV dans un institut de beauté.
Je vois régulièrement ce type d'articles. Mais je n'ai jamais vu, dans ces articles, de mise en cause directe des instituts de beauté pour les UV. D'autres structures, qui ne sont pas des instituts de beauté, ne présentent pas les mêmes garanties. Je n'ai pas, pour l'instant, les éléments qui permettent de penser qu'un consommateur qui se rend dans un institut de beauté pour effectuer de temps en temps des rayons UV, ait subi des conséquences néfastes.

Les dermatologues s'inquiètent. Vous estimez donc que, les contrôles étant tellement stricts dans les instituts de beauté, il n'existe aucun problème ?
Les tarifs sont libres. Avec la concurrence, le forfait de dix séances d'UV s'établit entre 50 et 60 euros, 70 euros tout au plus. Des centres de bronzage cassent les prix et affichent un forfait à 30 euros ! La cliente y manipule elle-même le minuteur : elle n'est pas accompagnée comme chez nous. Dans les instituts de beauté, la formation des esthéticiennes doit être renouvelée tous les trois ans.

La liberté d'usage est dangereuse. Le client ne connaît pas forcément la différence entre un institut de beauté et un centre d'UV.

Quel est l'agrément requis ? Je suppose qu'un CAP ne doit pas suffire pour disposer d'une cabine et la faire fonctionner ?
Avant toute mise en place d'une cabine d'UV dans un institut de beauté, un organisme de contrôle rend visite à l'exploitant. La conformité de la pièce et de l'installation sont vérifiées. Les esthéticiennes sont formées et les appareils sont contrôlés tous les ans.
Dans les cabines sont affichés les diplômes et les passages de la DGCCRF.
Généralement, une femme qui se trouve dans ce cas-là ne vient pas en institut de beauté pour faire des UV. Il existe une responsabilité personnelle de la personne malade. Si le problème est apparent, nous n'acceptons pas que le client fasse une séance d'UV. Si elle insiste, nous demandons systématiquement un certificat médical.
La fiche que nous faisons remplir aux clientes préalablement à une éventuelle séance d'UV nous permet de contrôler la date des dernières séances, les maladies, les traitements médicaux. Nous en remettons un exemplaire à la cliente. La liste des médicaments susceptibles de provoquer une photosensibilisation se trouve affichée dans la cabine, de même que le diplôme de l'esthéticienne et le certificat de contrôle annuel de l'appareil.

C'est la situation idéale. En cas de forte affluence, à certaines époques...

Que pensez-vous du projet de décret réservant aux médecins les actes, procédés techniques et méthodes à visée esthétique présentant des risques sérieux autres que les interventions de chirurgie esthétique relevant de l'article L.6322-1 du code de la santé publique ? N'êtes-vous jamais sollicités, par exemple, pour de l'amincissement par ultra-son, ou de l'effacement de cicatrices... ?

Le projet de texte réserve aussi aux médecins l'épilation par lumière pulsée... Il vous restera la pince et la cire.
Le projet de décret tel qu'il est prévu aujourd'hui, et c'est aussi le sentiment de la présidente de la Cnaib, ne touche pas les bonnes cibles : auto-entrepreneurs, personnes non qualifiées ne travaillant pas en institut.

Vous savez qu'il existe même des gens qui pratiquent des actes médicaux sans être médecins.
En ce qui concerne l'épilation et l'amincissement, la Cnaib revendique pour les esthéticiennes de pouvoir les pratiquer avec tous les moyens modernes existants et toute la sécurité nécessaire. De notre point de vue, ce décret, qui interdirait aux esthéticiennes de recourir aux techniques modernes de l'épilation, n'est pas adapté.

Même si ces techniques apparaissent dangereuses ? L'épilation à la lampe flash ?
Ces matériels utilisés en instituts ne se sont pas révélés dangereux.

Si, ce sont des méthodes qui peuvent être dangereuses, provoquer des brûlures. Des problèmes sont apparus.
D'après les informations obtenues auprès des assureurs, on dénombre deux cas d'accidents à la suite d'un acte de réjuvénation par lumière pulsée liés à des érythèmes. Nous n'avons aucun retour d'incident, ni d'accident, en ce qui concerne l'usage de la lampe flash pour la dépilation.

Les professionnels médicaux usant des lampes flash ont connu des incidents. Pourquoi n'en auriez-vous pas ? Vous êtes devant une mission d'information. Il ne faut pas vouloir laver trop blanc.
Nos appareils sont bridés, avec en moyenne 20 joules, ils n'ont donc pas la même puissance que les appareils médicaux. Et nous travaillons sur des peaux saines. C'est pourquoi nous plaidons pour l'autorisation de l'utilisation de la lumière pulsée par des praticiennes de niveau 4, sur des clientes munies d'un certificat médical. En esthétique, nous n'avons pas d'accident.

Mais qu'est-ce qui vous gêne puisque vous dites ne pratiquer aucun des actes visés ?
Nous n'avons pas été consultés et avons pu nous exprimer que devant votre commission. La présidente de la Cnaib a fait savoir son désaccord au ministère.

Les appareils « Cellu M6 » sont-ils utilisés par les seules praticiennes diplômées ?

Je connais personnellement une femme ayant souffert d'un cancer et à laquelle l'institut de beauté où elle s'était présenté a affirmé que son sein pouvait être protégé, sous les UV, par une simple serviette éponge.

Il est évident que vous ne pouvez pas contrôler tout le monde. La profession doit avoir ses propres règles et la possibilité d'intervenir en cas de mauvaises pratiques.
Au nom de l'artisanat français, nous demandons pour nos métiers des qualifications à un niveau qui permette au consommateur d'avoir une garantie. Nous regrettons qu'aujourd'hui la qualifications ne soit pas suffisamment élevée et contrôlée.

Nous savons que les chambres de métiers et de l'artisanat sont très rigoureuses pour tout un ensemble de métiers. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Audition de Mm. Christian Couzinou président du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et jacques levoyer vice-président de l'union des jeunes chirurgiens dentistes-union dentaire
Audition de Mm. Christian Couzinou président du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et jacques levoyer vice-président de l'union des jeunes chirurgiens dentistes-union dentaire

Nous poursuivons notre après-midi d'auditions en recevant M. Christian Couzinou, président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et M. Jacques Levoyer, vice-président de l'Union des jeunes chirurgiens dentistes-union dentaire (UJCD-UD).
Nous évoquerons en premier lieu les injections d'acide hyaluronique par les chirurgiens-dentistes, puis nous nous pencherons sur l'apparition et le développement d'établissements du type « bar à sourire », spécialisés dans le blanchiment des dents.
Dans les deux cas, les chirurgiens-dentistes ont été en première ligne de polémiques touchant à la sécurité des personnes : tout d'abord avec l'ordre des médecins, qui s'est opposé à leur capacité à procéder à des injections d'acide hyaluronique autour de la bouche de leurs patients, puis avec les « bars à sourire » auxquels les chirurgiens-dentistes eux-mêmes ont reproché un manque de compétence en matière de blanchiment des dents.
Bien évidemment, nous ne voulons ici faire le procès de personne. Nous voulons seulement voir plus clair dans le domaine de la médecine esthétique qui intéresse la santé des personnes et qui manque cruellement de réglementation.

Pouvez-vous présenter vos organismes respectifs et le nombre d'adhérents qu'ils représentent ? Quelle est la différence entre les deux ? Est-ce lié à l'âge ?
L'un est un ordre, l'autre un syndicat. Organisme privé chargé d'un service public, l'ordre est l'organisme régulateur de la profession. Il a été créé par le général de Gaulle par une ordonnance de septembre 1945, François Billoux étant alors ministre de la santé. 44 000 chirurgiens-dentistes y sont inscrits. On ne peut exercer la profession sans l'être. Nous veillons à la moralité et aux compétences des chirurgiens-dentistes et luttons, afin de préserver la santé publique, contre l'exercice illégal de la profession.
Notre syndicat est l'un des trois syndicats représentatifs de la profession. Créé il y a cinquante deux ans comme association professionnelle, il est devenu syndicat le 15 mars 1995. Représentatif depuis 1997, il est signataire des conventions dentaires depuis 1998. L'UJCD-UD a été le seul syndicat à porter la convention avec l'assurance maladie entre 2000 et 2002. Sur 37 000 chirurgiens-dentistes en exercice, 6 000 sont membres de notre syndicat. Nous défendons les intérêts matériels et moraux de la profession, au sens de la loi de 1948.
Le deuxième après la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD).

Le 24 janvier dernier, un courrier conjoint de la direction générale de la santé (DGS) et de la direction générale de l'offre de soins (DGOS), adressé à l'ordre des chirurgiens-dentistes, disposait que l'injection de produits de comblement de rides sur le visage n'était plus autorisé aux chirurgiens-dentistes parce qu'un tel acte conduisait les chirurgiens-dentistes à intervenir dans une zone anatomique extra-buccale. Par la suite, un courrier signé de la secrétaire d'Etat à la santé les a maintenus dans cette capacité. Pouvez-vous nous préciser les enjeux de ce débat et nous indiquer le nombre de vos confrères pratiquant de tels actes ?
En 2004, quand M. Douste-Blazy était ministre de la santé, le code de la santé publique a été modifié en ce qui concerne notre capacité. Celle-ci portait auparavant sur les dents, les maxillaires et la bouche. On y a alors ajouté les tissus attenants à la bouche, pour être en adéquation avec une directive européenne de 1978. La France a mis vingt-six ans à transposer ce texte ! Depuis 2004, quatre cents à cinq cents chirurgiens-dentistes pratiquent des injections d'acide hyaluronique. Ce n'est pas le coeur de notre métier mais cela fait partie de notre capacité professionnelle. Cette lettre, signée par Mme Podeur et M. Graff, nous a beaucoup surpris. Nous étions déjà compétents pour l'intra-oral avant 2004, et pour l'extra-oral depuis. Personne ne sait vraiment d'où est sortie cette lettre de cachet. DGS, DGOS et cabinet se renvoient la balle. Evidemment, nous avons souhaité rencontrer Xavier Bertrand. Sa conseillère, Mme Clara De Bort, nous a reçus. Le vendredi suivant, nous recevions une lettre de Mme Nora Berra nous précisant que nous pouvions continuer à faire des injections d'acide hyaluronique.
Le sillon naso-génien et le péribuccal.
Le maxillaire fait partie de notre domaine. Le sillon naso-génien lui est attenant.
C'est un vrai-faux débat. Le vrai débat de fond, c'est la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste. Nos confrères médecins se trompent en nous critiquant sur ce point. Une autre question se pose : avons-nous la compétence pour pratiquer de tels actes ? Nous sommes toujours ouverts au dialogue sur ce point, mais la profession sera toujours unanime à défendre sa pleine capacité d'exercice.
Aucun. La Médicale de France, qui assure un grand nombre de chirurgiens-dentistes, nous l'a confirmé par courrier.
Jamais.

Que pensez-vous du décret en préparation qui vous retirerait cette compétence ?
Nous ferons tout pour nous y opposer. Le cas échéant, nous irons devant le Conseil d'Etat et jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne s'il le faut.
C'est une atteinte à notre capacité.
C'est une question de principe.
Nous pratiquons des actes bien plus compliqués que des injections, comme des relevés de sinus en implantologie. Le problème de l'acide hyaluronique tient au produit utilisé. Aux Etats-Unis, seuls six sont sur le marché tandis qu'on en compte cent dix en France, tous marqués CE. Les dentistes n'utilisent que de l'acide hyaluronique réticulé.
On fera tout en amont pour que ce décret ne voie pas le jour. Si, malgré tout, le Gouvernement le prend, nous continuerons à défendre notre capacité professionnelle devant la justice. Ce n'est pas sur l'acide hyaluronique que nous nous crispons, mais sur le respect de notre capacité professionnelle.

C'est pourtant d'une extension récente de votre capacité dont il est ici question.
Certains confrères médecins y voient une atteinte à leur clientèle. Les stomatologistes, qui pratiquent bien l'ensemble du champ de la chirurgie dentaire, n'ont jamais demandé que notre capacité soit réduite. C'est l'esprit de cette mesure qui nous fait nous dresser pour que soit respectée notre capacité, même dans ce domaine marginal.

La chirurgie dentaire n'a pas vocation à s'occuper des rides et de l'esthétique du visage.
La réglementation européenne et mondiale peut nous éclairer sur les évolutions récentes de la chirurgie dentaire : jusqu'il y a peu, on parlait d'art dentaire, dorénavant, le terme de médecine s'est imposé. Le code de la santé publique nous définit comme une profession médicale, non comme des auxiliaires médicaux. Nous ne chercherons jamais à être médecins, nous voulons simplement être de bons chirurgiens-dentistes dans la pratique totale de leur capacité.
La capacité, c'est ce que l'on peut faire, la compétence, ce que l'on sait faire.
C'est l'article L 4141-1 du code de la santé publique. Notre capacité comporte depuis 2004, selon cet article, « la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ». Certains médecins interprètent différemment ces derniers termes, mais ont-ils étudié la règlementation européenne de 1978 et perçu l'ajout des tissus attenants ?
Le dialogue est difficile. Ils défendent leur pré-carré. Pour certains d'entre eux, nous sommes encore des arracheurs de dents sur la foire.

N'exagérez pas ! Vous jouez sur les mots et eux aussi ! Il y a un conflit sur la signification des mots « et attenants ».
J'ai une liste de synonymes !

Vous parlez de tissus attenants. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous occuper des oreilles décollées, situées à proximité des maxillaires ? La distinction entre capacité et compétence est au coeur de notre débat. Tous les chirurgiens-dentistes ayant commencé à exercer avant 2004 n'ont pas été formés au traitement des tissus attenants. Il leur faudrait au moins une formation spécifique.
Tout à fait. Intransigeants sur notre capacité, nous sommes soucieux de notre compétence. Tout praticien se doit d'acquérir les compétences nécessaires à sa pratique. Le législateur, dans son bon sens, a élargi, dans la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009 les missions de l'ordre national. Il doit vérifier que le chirurgien-dentiste s'acquitte de son obligation de formation continue et ne se trouve pas en état d'incompétence. Il est garant de la compétence du chirurgien-dentiste. C'est une question de santé publique.
Une formation est délivrée par l'université Paris VII et certains confrères se forment à l'étranger. Des pays, comme le Luxembourg, ont fait le choix de limiter la capacité de faire à l'acquisition une compétence validée.
En France, les stomatologistes.

Ils sont d'abord médecins. N'y a-t-il pas des pays où les dentistes sont médecins ?
Pas dans l'Europe des vingt-sept.

Nous débattons actuellement d'une question à l'importance marginale : les chirurgiens-dentistes posent beaucoup plus d'implants qu'ils ne pratiquent le comblement naso-génien. Je partage le point de vue de ceux qui veulent préserver l'intégrité de leur compétence alors que d'autres défendent leur part de marché. Ce débat me gêne. Quel chirurgien-dentiste n'a jamais fait de chirurgie buccodentaire sur la lèvre supérieure d'un enfant victime d'un traumatisme sans se soucier d'une quelconque frontière anatomique ? L'échange épistolaire contradictoire avec le ministère que vous mentionnez ne plaide pas en faveur du sérieux du débat. La compétence doit s'accompagner d'une formation garantie par l'ordre. Je ne veux pas qu'on s'imagine que 95 % des chirurgiens-dentistes font une fixation là-dessus. Dans les quartiers populaires où j'exerçais, on est à mille lieues de ces préoccupations ou de celles liées au blanchiment des dents. L'important est de garantir une formation adéquate, voilà le point sur lequel j'aimerais avoir des assurances.
La directive européenne 2005-36 le prévoit : le chirurgien-dentiste doit avoir une formation qui corresponde à toute sa capacité. Si le projet de décret est publié sous sa forme actuelle, beaucoup de médecins qui ne sont ni dermatologues, ni chirurgiens plasticiens devront aussi suivre une formation complémentaire pour continuer à injecter. Nous sommes favorables à la création d'un tel mécanisme pour les dentistes. Il n'y a aucun problème là-dessus.

Il est beaucoup plus rentable de faire de la prothèse dentaire que de picoter, n'est-ce pas ?
Vous mettez le doigt sur une plaie béante de la chirurgie dentaire française. Les soins opposables, comme les soins de caries, les dévitalisations de dents, qui représentent 70 % de notre temps et 25 % du chiffre d'affaires, sont pris en charge à un niveau très inférieur à leur prix de revient, souvent avec un déficit de l'ordre de 40 %. Les tarifs français de soins conservateurs et chirurgicaux sont les plus faibles d'Europe alors que les prothèses ont le plus faible taux de prise en charge par l'assurance maladie. Un taux qui a été divisé, en euros constants, par deux en trente ans. En conséquence, nos patients ont des difficultés croissantes d'accès aux soins.
Je rejoins notre confrère sénateur : il est vrai que dans les zones défavorisées, les patients et leurs chirurgiens-dentistes ne se préoccupent pas des injections d'acide hyaluronique ou du blanchiment des dents. C'est une réponse à une demande marginale, mais cela concerne l'intégrité de notre compétence. Les problèmes sont tout autres et l'avenant à la convention dentaire, que nous sommes en train de négocier, loin de les régler, les prorogera sans doute pour cinq ans.

Quel est le cadre thérapeutique de l'utilisation l'acide hyaluronique ? C'est un produit essentiellement esthétique. Est-ce remboursé par la sécurité sociale ?
Quand un médecin prend en charge un malade dans le cadre des maladies de l'âge, est-ce thérapeutique ou esthétique ? Toutes les thérapies liées au vieillissement sont, à mon sens, thérapeutiques.

Cela dépend de l'organe : Entre le coeur sénile et le sillon naso-génien, il y a quand même une différence.
Je vous le concède, mais il faut aussi s'interroger sur la nature des produits injectés. Sont-ils des produits médicaux, pharmaceutiques ou strictement cosmétiques ? On se situe bien, dans le cas présent, dans le cadre d'une indication thérapeutique. On ne peut laisser dire que ce n'est que de la cosmétique. Une esthéticienne, absente du code de la santé publique, ou un auxiliaire médical, qui ne peut rien prescrire de tel, ne doit pas pouvoir réaliser de tels actes. Nous sommes l'une des trois professions médicales, nous prescrivons donc sous notre responsabilité. A nous d'y adapter notre compétence.

Réaliser une injection sous-cutanée n'est pas banal et des risques y sont attachés. Néanmoins, j'interpelle le président de l'ordre sur l'éthique, parce que je crains l'effet de mode et la pression des patients sur les praticiens. Je compte sur le discernement de la profession car il faut savoir leur dire non. Le non-remboursement de ces pratiques est bien sûr une barrière, mais je crains que ne se développent des demandes disproportionnées, comme on en a connu pour le blanchiment. Il n'existe pas de critère absolu pour différencier esthétique et thérapeutique : rien ne remplace le contact entre le praticien et le patient.
C'est le problème du consentement éclairé. Il est de notre devoir, lorsque les demandes du patient ne sont pas raisonnables, de le lui expliquer.

Je vois cependant un risque de dérive. Il suffit de feuilleter les magazines féminins pour comprendre que les demandes vont se multiplier. Il y a un risque de banalisation. La profession ne sortirait pas grandie de sa transformation en prestataire de services à vocation esthétique.

Dans un récent communiqué de presse, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) relevaient qu'un nombre croissant de personnes ont recours à la pratique du blanchiment des dents, soit à domicile au moyen de produits destinés à être appliqués sur les dents, soit dans des établissements. Une polémique semble s'être engagée entre les dentistes et ce qu'il est convenu d'appeler les « bars à sourire ». Certains de ces établissements ont porté plainte contre les instances représentatives des dentistes, car ils s'estimaient victimes de pratiques anticoncurrentielles de leur part. Pouvez-vous nous dire en quoi ces officines pratiquant le blanchiment des dents ont des méthodes plus dangereuses que les vôtres ?
J'ai été auditionné cinq heures durant par l'Autorité de la concurrence sur ce sujet.
Nous avons été alertés depuis environ dix-huit mois par des patients qui ont eu des problèmes après être passés par ces « bars à sourire ». Nous avons obtenu de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance (TGI) la possibilité d'envoyer des huissiers, qui ont examiné les pratiques et saisi des produits. Ces endroits emploient des produits qui contiennent du peroxyde d'hydrogène à plus de 0,1 % et du perborate de sodium, substance mutagène et cancérigène. Nous avons alerté les agences régionales de santé (ARS), qui en ont fermé certains, notamment en Alsace et en Bourgogne, ainsi que l'Afssaps, à qui nous avons fourni les échantillons saisis, et la DGCCRF.
Nous avons publié dans La Lettre un article qui n'a pas plu aux propriétaires de « bars à sourire », qui nous ont dénoncés à l'Autorité de la concurrence. La directive européenne de septembre dernier définit clairement deux marchés : celui du peroxyde d'hydrogène d'une concentration inférieure à 0,1 %, dont l'usage est libre mais l'effet limité, et celui des concentrations supérieures, jusqu'à 6 %, réservé aux dentistes.
La réglementation européenne limite les fortes concentrations aux chirurgiens dentistes, car ceux-ci pratiquent un examen clinique avant tout acte. Si ces produits venaient à être apposés sur des dents présentant des lésions carieuses ou sur des reconstitutions non étanches, il y aurait un risque de pulpite, c'est-à-dire d'inflammation du nerf de la dent, voire de nécrose pulpaire, ce qui aurait pour conséquence une dévitalisation de la dent.
Effectivement, le problème du marquage CE se pose. Les « bars à sourire » se fournissent sur internet, aux Etats-Unis, auprès des deux grands fabricants mondiaux. La DGCCRF a constaté de nombreuses anomalies. Qui plus est, ils utilisent des porte-empreintes non ajustés à la bouche du patient : le produit touche donc aussi les gencives. A Nevers, un cas de concentration à 35 % a été relevé. L'établissement a été fermé par l'ARS.
La concentration est inférieure à 0,1 %.
Dans ce cas, le blanchiment constaté est surtout dû à l'action mécanique de la brosse.
Il y en aurait quatre cents, ainsi que mille trois cents espaces dédiés chez des esthéticiennes. Il y a eu un effet de mode et plusieurs émissions de télévision leur ont été consacrées. A Rouen par exemple, Il s'en est récemment créé un tenu par une coiffeuse et un jeune diplômé d'école de commerce, sans autre formation.

J'aurais souhaité que vous abordiez les normes qui encadrent la pose d'implants.
L'implantologie a connu trois phases. Après une phase expérimentale, il y a vingt à vingt-cinq ans, avec le protocole mis au point en Suède par Per-Ingvar Brånemark, on a connu une phase de développement. Mais de nombreux problèmes sont apparus, notamment avec les implants juxta-osseux. On a relevé des accidents médicaux, les dégâts osseux pouvant être importants. L'implantologie entre aujourd'hui dans sa troisième phase, celle de la normalisation. Du fait des erreurs du passé, les dentistes sont de plus en plus attentifs. Les assureurs ont également modifié leurs contrats selon que le praticien pose des implants ou pas.
L'UJCD-UD cogère une société d'assurance civile professionnelle, et nous constations beaucoup moins de problèmes qu'il y a dix ou quinze ans. Le praticien doit disposer d'un plateau technique spécifique et réaliser un examen sérieux. La très large majorité de nos confrères qui posent des fixtures, des pièces implantées à l'intérieur de l'os, sont très conscients des risques.
La MACSF, qui assure 25 000 chirurgiens-dentistes, ne reçoit que dix à quinze réclamations par an. Le scanner et la radiographie 3D ont révolutionné les choses. Les nouvelles techniques ont changé la vie des gens qui ne pouvaient plus mastiquer ni sourire avec les dentiers complets. C'est une évolution formidable.
Sur quarante mille praticiens, quatre mille assurent la phase chirurgicale, les autres posent la prothèse ensuite.
Aujourd'hui, on relève moins d'accidents.

Il faut que vous soyez plus nombreux à poser des implants et moins à combler le sillon naso-génien.

Nous avons le plaisir d'accueillir, dans le cadre d'une table ronde consacrée à la médecine esthétique, un grand nombre d'experts du sujet, et je laisserai le soin à chacun d'entre eux de se présenter au début de son intervention. Nous souhaitons que vous nous éclairiez sur les contours du secteur encore peu encadré de la médecine esthétique, les dysfonctionnements constatés et les réponses à y apporter.
Les personnes que nous avons auditionnées jusqu'ici nous ont exposé des positions différentes quant à la spécificité de la médecine esthétique : certains évoquent sa consécration en tant que spécialité médicale à part entière, d'autres souhaitent qu'elle demeure une composante d'autres spécialités comme la chirurgie esthétique ou la dermatologie, d'autres encore envisagent ce que j'appellerais une solution intermédiaire : considérer la médecine esthétique comme un exercice particulier, comme l'allergologie par exemple. Il sera intéressant de recueillir votre sentiment sur ce sujet.
Par ailleurs, tant qu'il n'aura pas été établi de définition claire de la médecine esthétique et de son champ, il restera difficile de l'encadrer afin de mieux prévenir les événements indésirables qui y sont associés. Le décret en préparation soulève encore des difficultés. En outre, contrairement à d'autres spécialités médicales, nous constatons un manque criant de données scientifiques sur la médecine esthétique et les effets secondaires ou complications qui en découlent.
Je vous invite donc, en réponse aux questions de notre rapporteur, à la franchise et à nous faire des propositions concrètes pour corriger les dysfonctionnements et les manques que vous auriez pu déceler.
Enfin, je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et au public. Elle fait également l'objet d'un enregistrement audiovisuel et est retransmise en direct sur le site du Sénat.
Etes-vous d'accord avec cette retransmission ?
Je laisse maintenant la parole à notre rapporteur.

Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question, quelle définition donnez-vous de l'acte de médecine esthétique ? A-t-on assisté à une augmentation du nombre d'actes de médecine esthétique en France au cours des dernières années ? N'observe-t-on pas une dérive consistant à requalifier en médecine esthétique un certain nombre d'actes, pourtant assimilables à de la chirurgie esthétique, afin de pouvoir les pratiquer en cabinet et les soustraire à la réglementation applicable à la chirurgie esthétique - je pense par exemple à la lipotomie par injection de produits lipolysants ?
Je répondrai en reprenant la définition donnée ici même en 2004 au Sénat lors d'un colloque sur l'avenir de la médecine esthétique, c'est-à-dire « l'ensemble des prescriptions ou des actes visant à prévenir, améliorer ou corriger les aspects inesthétiques ou jugés comme tels par un sujet sain, quel que soit son âge, y compris les conséquences du vieillissement physiologique, et ce grâce à une approche pluridisciplinaire ».
Après avoir été particulièrement soutenue entre 2005 et 2010, la croissance du nombre des actes a connu une légère décélération au cours des dernières années, mais elle reste à deux chiffres, phénomène à mettre en parallèle avec la croissance de l'offre de soins, par différents praticiens.
On ne requalifie pas les actes médicaux. Le problème reste de qualifier les actes frontière - la lipotomie par injection de produits lipolysants est interdite, du reste, pour tous, par décret. D'où l'intérêt d'une formation pour tous les médecins concernés, adaptée à leur profil et à leur spécialité, qui pourrait soit être intégrée dans le diplôme initial, soit faire l'objet d'un diplôme interuniversitaire.
Je partage la définition donnée par M. Turmel ; la médecine esthétique, ce sont des actes médicaux permettant de modifier l'apparence corporelle sans visée nécessairement thérapeutique.
La croissance des actes de médecine esthétique serait de 11 % dans le monde, de 5 % à 8 % en France, chaque année. On le voit dans les congrès internationaux, la médecine esthétique a plus d'ampleur que la chirurgie. La médecine esthétique répond précisément à une demande forte des patients qui préfèrent avoir recours à des actes plus légers et ne souhaitent pas passer par la chirurgie. Au demeurant, nos techniques sont validées, et tous les effets secondaires rendus publics ; nous ne sommes pas vraiment dans le flou.
On parlerait d'actes sans but thérapeutique ? Il ne faut pas oublier le bien-être des personnes. Ce peut être un acte thérapeutique, au même titre qu'une psychothérapie. La médecine esthétique est moins chère et comporte moins de risques que la chirurgie esthétique. Les produits sont moins dangereux et les actes sont réversibles à plus ou moins long terme. Les médias diffusent largement les complications qui interviennent dans le domaine de la chirurgie esthétique ; celles-ci demeurent, en revanche, très rares en ce qui concerne la médecine esthétique. Il n'y a pas de requalification. Aucun acte dont l'innocuité n'a pas été démontrée n'est enseigné dans le cadre du diplôme interuniversitaire que je dirige à Lyon.
Il s'agit avant tout d'un acte médical. Il répond à une demande du patient dont l'apparence ne le satisfait pas, soit en raison de l'hérédité ou de la maladie, soit en raison des dégâts du temps, et qui souhaite faire appel à des techniques moins invasives, plus sécuritaires et enseignées de façon rigoureuse. Autrefois, l'apparition de tâches, qu'on appelle fleurs du cimetière, était un signe avant coureur d'une fin de vie dans les dix ans suivants. Aujourd'hui, lorsqu'elles apparaissent sur un patient de trente ans qui vivra encore quarante ans, on n'a pas le droit de lui refuser de s'en débarrasser. Nous vivons dans une société de consommation, où les gens travaillent et vivent plus longtemps. Le médecin esthéticien est alors appelé à dépister des carences internes liées à l'âge et à réaliser en conséquence un geste technique, scientifique et sécuritaire. Nous nous sommes engagés dans une charte à ne pratiquer aucun acte chirurgical. Tout est clairement encadré.

Le sociologue et l'anthropologue que nous avons entendus ont développé ce type d'approche.
Pour nous, la médecine dite esthétique n'est pas une spécialité. Mais il s'agit d'un acte médical à part entière, qui suppose examen et diagnostic préalables avant traitement. On est bien sûr totalement dans l'exercice de la médecine.
Les techniques ont évolué : un grand nombre d'entre elles sont désormais micro-invasives et sont prônées par des magazines féminins ou des émissions télévisées. Tous ces actes peuvent être pratiqués par des médecins, sans empiéter sur le domaine chirurgical. Enfin, l'encadrement légal et règlementaire est désormais bien connu.
Je préfère que nous parlions d'actes esthétiques médicaux, par opposition aux actes esthétiques chirurgicaux. Il existe bien sûr des formes frontière, mais la médecine esthétique ne constitue pas une discipline à part entière, car on retrouve de tels actes dans beaucoup de spécialités. Il n'est donc pas question de regrouper tout cela dans une seule spécialité. Ce sont d'abord des actes médicaux, même si leur visée est esthétique. La distinction entre médecine et chirurgie est claire dans la loi, qui devrait en revanche mieux anticiper l'évolution des techniques et l'évaluation des risques, car elle accuse aujourd'hui encore trop de retard en matière de matériovigilance - je pense aux cabines UV, car on connaît le risque de cancer de la peau qui y est associé.

C'est l'approche en termes de débat sociétal qui m'intéresse. Les standards esthétiques varient selon les époques et les sociétés. Quand l'acte est rattachable à une pathologie, il n'y a pas de problème, mais quand on est dans l'esthétique pur, j'y vois une forme de dérive sociétale : on sait que les standards sont suscités et que seule une upper-class a les moyens économiques pour améliorer une apparence qui influe souvent sur les critères de jugement. Compte tenu de l'évolution exponentielle que l'on observe, ne jouez-vous pas les apprentis-sorciers quand l'offre crée la demande ?
La question s'est posée au conseil national de l'ordre des médecins (Cnom), statuant à titre disciplinaire, dès 2003, face à la multiplication d'actes non déclarés. On ne pouvait plus laisser errer une population égarée auprès de médecins borderline, parfois un peu charlatans. Nous avons donc demandé aux médecins qui s'occupaient déjà d'esthétique d'élaborer des référentiels et de préparer un enseignement national afin de valider ces techniques, sachant que notre souci est avant tout la sécurité des patients et la qualité des soins.
Le colloque qui s'est tenu ici en 2004 l'a montré, c'est une question existentielle. La demande est croissante : on ne peut laisser les patients aller vers n'importe quel professionnel, une simple esthéticienne par exemple qui pratiquerait de la lumière pulsée alors même qu'il s'agit d'un acte médical. Il y a bien des médecins, et des non-médecins.
La simple lampe à la lumière pulsée est aussi dangereuse qu'un laser : cela peut trouer, décolorer, faire des tâches. Et les esthéticiennes, influencées par les fabricants, sont souvent mal informées de tout cela. D'où la jurisprudence récente. Pour pratiquer ces actes, il faut réaliser un diagnostic préalable, et disposer d'une assurance en cas d'aléa.
Distinguer entre ce qui est pathologique et non pathologique est toujours complexe : voyez le vieillissement de la peau, ou le traitement de la ménopause. Le rôle du médecin, c'est aussi d'aider les gens à mieux vivre.

Mais pas n'importe comment. Notre mission est fondée sur la sécurité du patient ; elle fait suite à l'affaire PIP, survenue alors que les mesures de contrôles existaient déjà.
C'est plutôt une affaire de moyens.

Nous voulons mettre en exergue les capacités requises, les formations. Avant d'exercer une profession, une personne est formée en général, ainsi qu'aux actes spécialisés pratiqués. Quelles conditions de formation souhaiteriez-vous voir appliquer aux professionnels pratiquant des actes de médecine esthétique ? Seriez-vous favorables à la généralisation d'un diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge, même si le mot ne me plaît guère ? La médecine esthétique a-t-elle vocation à s'imposer comme une spécialité médicale à part entière ou doit-elle constituer une composante d'une autre spécialité ?
Un diplôme interuniversitaire (DIU) de médecine universitaire esthétique anti-âge suffit. L'enseignement que nous dispensons à Lyon I comprend quatre universités. Le ministère nous a demandé de continuer afin de mieux impliquer certaines régions (Strasbourg, le Sud-Ouest). Le numerus clausus, qui est actuellement de quatre-vingt cinq médecins formés chaque année, doit demeurer en l'état.
Nous parlons d'une composante de la médecine ; le médecin doit poser un diagnostic préalable puis proposer un traitement : les médecins ne doivent pas se comporter comme de simples techniciens. La création d'un DESC ? Le DIU de Lyon I comporte déjà deux cents heures d'enseignement, dispensées par un grand nombre d'intervenants. Il est des gestes de prévention indispensables à connaître. Nous enseignons aussi l'endocrinologie, la dissection de la face (huit heures d'enseignement), de même que les conséquences médicolégales de ces actes. Qualité et sécurité sont nos maîtres-mots.
Un diplôme interuniversitaire n'offre pas de garantie de quota, ni d'uniformité dans la qualité. Le DESC, dont la qualité est supportée par un quota, certifie l'acquisition d'une compétence complémentaire et non exclusive, dans le cadre de chaque spécialité. Compte tenu de la formation en internat, mieux vaut un diplôme national équivalent à un DESC, qui concerne une compétence et non une spécialité.
Le diplôme interuniversitaire était la seule voie possible. Nous l'avons reconnu par le droit au titre, en autorisant les médecins qui ont validé cette formation à l'apposer sur leur plaque. Nous avons également conforté la maquette d'enseignement, pour renforcer l'apprentissage des actes techniques et avons demandé que soit élargi le recrutement universitaire. Il est vrai qu'il serait bon que ce DIU se transforme en DESC, cependant le médecin ne doit pas abandonner sa spécialité mais exercer avec une compétence particulière.
Si le dermatologue veut faire de la nutrition...
Oui, en cas d'acné, par exemple.
il faudra qu'il se forme.
Le ministère de l'enseignement supérieur, qui a souvent un temps de retard, veut que l'on conforte le DIU. Après cinq ou dix ans de recul, tout le monde veut parvenir à la mise en place un DESC. Cela assurerait une plateforme commune à toutes les spécialités sans marginaliser la médecine esthétique : on serait dans la prévention et le bien vieillir.
Le diplôme interuniversitaire est venu combler un vide : jusqu'en 2004, la médecine esthétique était essentiellement l'affaire de compagnonnages privés. Le DIU est enseigné à Lyon, mais dépend aussi d'autres universités - Montpellier, Paris et Pointe-à-Pitre. A l'époque, la création de ce DIU découlait du constat que la médecine esthétique était une médecine nouvelle mais qui s'apprend.
Le geste ne compte pas seul : le diagnostic est essentiel. Un DESC nécessite des stages, ce qui suppose de trouver des services hospitaliers et ce n'est pas facile. Les ministères concernés - enseignement supérieur et santé - constatent que le DIU a permis de sensibiliser à la prévention des infections, de connaître le champ des actes à ne pas dépasser, d'anticiper l'évolution des techniques, de différencier entre le besoin et le fantasme du patient, en définissant une déontologie. Pour aboutir à la mise en place d'un diplôme national, ils nous demandent l'extension à quatre villes. Un DESC, qui serait l'idéal, se heurte à bien des difficultés pratiques, car il n'existe pas de services hospitaliers dédiés à la médecine esthétique - c'est pourquoi nous proposons des stages pratiques en centres libéraux. Pour l'heure, nous disposons d'un DIU élargi, bien assis sur son socle universitaire. Près de 600 médecins ont été formés sans aucun sinistre notable.
Je suis tout à fait pour le DESC dans la mesure où il permet à toutes les spécialités d'intégrer une composante esthétique. Depuis 2002, nous en sommes à la troisième version du DIU, qui a aujourd'hui acquis ses lettres de noblesse avec le droit au titre du conseil de l'ordre. Ce diplôme a le mérite d'exister, d'offrir un apprentissage des actes, qu'on n'apprend pas dans les livres. Le projet de décret prévoit une validation des acquis - il faudra peut-être proroger la date de forclusion. Reste que je suis plutôt favorable au DESC.

S'il s'agit d'une problématique de santé publique, médecines de ville et hospitalière devraient marcher ensemble. Il ne devrait pas y avoir ce vide sidéral à l'hôpital, ce qui renforce d'ailleurs ma remarque initiale.
Il existe, dans le milieu hospitalier, l'angoisse d'un appel d'air des médecins généralistes, en nombre déjà insuffisant, vers la médecine esthétique. Mais l'essentiel doit être la sécurité : mieux vaut organiser des stages à l'université que de laisser se développer des formations sauvages.

L'important, pour nous, c'est que le cadre soit légitime et sécurisé ; la formation est préférable au recours à des officines à l'étranger.
Nous sommes d'abord allés assurer diverses composantes de la formation dans chaque ville, mais c'est épuisant. D'où le choix de Lyon, qui sera peut-être partagé avec Paris et éventuellement Strasbourg.
On en revient à une absence de quota, le DIU ne permet pas le contrôle des entrées et des sorties. En France, toutes les spécialités sont contrôlées : aucune raison ne justifie que la médecine esthétique ne se soumette pas aux mêmes exigences.
Nous donnons tous les ans la liste de ceux qui ont réussi et de ceux qui ont été inscrits au probatoire. En sept ans, nous n'avons jamais dépassé le quota fixé par le conseil de l'ordre.
N'oublions pas que la médecine est du compagnonnage. A Lyon, les médecins ont été formés en cliniques par manque de places d'internes, mais sous contrôle universitaire. On ne peut donc pas parler de médecine esthétique à deux vitesses.
Comme on manque de places d'internat, beaucoup font leur stage en cabinet privé, et personne n'y trouve à redire. Nous n'allons pas vers une médecine esthétique à deux vitesses : 93 % de notre patientèle est dans la moyenne, seulement 7 % est issue de la classe haute. Cela dit, nous pratiquons de l'esthétique et la question peut se poser du déconventionnement des médecins qui ne pratiquent que l'esthétique.
Pourquoi un déconventionnement, alors que la médecine esthétique ne constitue qu'une compétence particulière d'un médecin généraliste ou spécialiste ? Grâce au DIU, à l'hôpital, en gérontologie, on nous a ouvert une aire de soins pour les malades d'Alzheimer, avec l'espoir que retrouver un visage rajeuni aide au retour de la mémoire.

Seriez-vous favorables à une délégation par les médecins de certains actes tels que les injections ou l'épilation, à des personnels non médecins ?
La plupart des assurances exige que nos assistants soient des professionnels de santé. Mon assistante est infirmière. Elle n'aurait pas pu suivre le DIU de laser, réservé aux infirmières employées par des dermatologues, si je ne m'étais pas installée avec une dermatologue.
Il est impératif de bien distinguer la délégation d'actes et le transfert de compétences. La délégation d'actes, lorsque le délégué est seul et pleinement responsable de son acte, c'est de l'exercice illégal de la médecine, parce que la personne s'autonomise. La délégation de compétences est d'une autre nature : le manipulateur en radiologie demeure sous l'autorité et la responsabilité du radiologue.
Elle a ses actes propres. La question est celle de la délégation complète de l'acte qui ouvre la voie à des professions sous-médicales, comme en ophtamologie aux Etats-Unis ! C'est un problème pour la sécurité des patients. Aujourd'hui, l'entreprise médicale permet d'avoir un personnel sous la responsabilité du médecin.
Le médecin sait ce qu'il doit déléguer.
On est en train de créer une profession spécifique d'assistant de dermatologie, comme le radiologue a un manipulateur radio : libre aux autres spécialités de créer leurs propres assistants spécifiques.

Seriez-vous favorables à la mise en place d'un dossier médical du patient ayant recours à un acte de médecine esthétique, un carnet esthétique en somme, comprenant des informations relatives aux dispositifs et produits utilisés, aux zones concernées, etc. ?
Le dossier médical s'impose à tous. Tout patient doit avoir un dossier médical, sous forme papier ou électronique. Il doit être renseigné quand des actes esthétiques sont exécutés.
Les patients doivent en disposer.
Tous les médecins qui pratiquent la médecine esthétique assurent la traçabilité de leurs actes, reportés dans un carnet remis au patient depuis 2004, dont nous conservons un double inclus dans le dossier médical.
Le patient esthétique a tendance à cacher ou à égarer son carnet... Cela dit, je suis pour.
On doit parfois interroger un autre médecin. La traçabilité est importante, y compris pour des produits qui ont une autorisation de mise sur le marché (AMM). Il faut y obliger les fabricants de produits injectables, comme la toxine botulique pour laquelle nous ne disposons pas d'étiquette collante et nous devons recopier le numéro du lot.
Nos patients ont tendance à être plus nomades. Il existe une difficulté à reconstituer leur parcours médical.

C'est exact. Il faut l'interroger si nécessaire, en le mettant en confiance.
110 produits à base d'acide hyaluronique sont disponibles sur le marché. D'où viennent les produits ? Comment sont-ils fabriqués ? On risque d'avoir des accidents liés au produit plutôt qu'à l'acte médical lui-même.

Primum non nocere. Il est essentiel que les produits soient de qualité et authentifiés. Le marquage CE impose une coordination européenne. Il est fondamental que la sécurité du malade ainsi que des pratiquants soit assurée.
Se pose le problème des moyens de contrôle. Le cas des prothèses PIP illustre qu'il n'y a pas assez de contrôles inopinés. Non que je défende la multiplication des marques d'acide hyaluronique, mais s'il y en a moins aux Etats-Unis, c'est aussi qu'ils utilisaient auparavant d'autres produits et en raison de pratiques protectionnistes. En France, certaines chaînes de fabrication sont dédiées au marché américain, pour répondre aux exigences du contrôle : la Food and Drug Administration (FDA), qui se déplace, ne tolère aucun écart.

Certains disent qu'ils ont refusé les prothèses PIP par protectionnisme. Il faut une coordination européenne. Tant que l'on en reste à des certifications sans vérification, il y a des dérives et l'on peut tomber sur des escrocs. Notre objectif est de faire des propositions que nous allons élargir à la médecine esthétique. Nous irons aux Etats-Unis et dans les pays du Nord, qui ont l'expérience des registres. Le problème, c'est la sécurité, celle du malade et celle des pratiquants - comment ont-ils choisi leurs prothèses ? Certaines sont défaillantes.
Il y a une petite difficulté avec les esthéticiennes, qui sont blanches comme neige... Quant aux dentistes, ils tiennent au sillon naso-génien. Les « querelles de boutique » nous intéressent moins que de savoir à partir de quand un acte peut-il être médical. Quelles sont vos recommandations pour l'encadrement des actes à visée esthétique qualifiés de « non médicaux » ? Je pense, par exemple, à l'épilation par lumière pulsée pratiquée par les esthéticiennes...
Mauvais exemple !
Elles ont été condamnées pour exercice illégal de la médecine !
C'est un problème de législation. C'est toujours le problème de la classification des matériels. Les lampes flash sont apparues après les lasers, qui étaient réservés aux médecins ; elles ont progressivement gagné en puissance. Reste qu'un arrêté de 1962 encore en vigueur précise que les esthéticiennes ne peuvent épiler qu'à la pince et à la cire. Il y a un diagnostic médical à faire... L'hyper-androgénie n'est pas rare. Les lampes flash utilisent le même principe qu'un laser. Une destruction de lésion cutanée, c'est sérieux : un mélanome, potentiellement, ça tue !
Chacun son métier.
Il s'agit plus de définir des rayonnements électromagnétiques que des catégories de matériel.
Pour les UV, l'incidence du bronzage sur l'augmentation des mélanomes est avérée.

Mais on trouve des appareils à lumière pulsée dans les grands magasins.
C'est fort dommage.
Il existe des procédés physiques à risque, tels que l'usage des ultrasons ou des ondes radio, dont on ne connaît pas les effets secondaires.

Seriez-vous favorables à la mise en place d'un mécanisme d'indemnisation des accidents médicaux sans faute liés à un acte de médecine esthétique - un fond alimenté par une surprime assurantielle par exemple ?
C'est de la médecine, au même titre que la cardiologie ou la chirurgie.
Nous sommes dans le champ de la loi sur les droits des malades de 2002. Il est normal qu'en cas de préjudice sans faute, les gens soient indemnisés soit par les assureurs privés, soit par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) selon le degré de déficit fonctionnel permanent : en-dessous de 25 % d'incapacité, indemnisation par l'assureur, au-delà par l'Oniam.
La sinistralité en médecine esthétique est très faible, vingt fois inférieure aux actes chirurgicaux. Nous payons déjà une prime d'assurance dix fois supérieure à celle d'un médecin généraliste. Nous sommes opposés à la mise en oeuvre d'une surprime, d'autant qu'il y a l'Oniam et les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI).
Les appareils à radiofréquence librement commercialisés sont-ils soumis à un contrôle ?
Le conseil de l'ordre a la volonté de ne pas marginaliser, au risque de jeter sur elle le soupçon, cette médecine à part entière qui nécessite une formation universitaire et sur laquelle pèsent les mêmes obligations que pour tout médecin, notamment en termes de tenue du dossier médical ou d'assurance. La médecine esthétique doit être un complément d'exercice à une spécialité existante.
La formation continue devrait être obligatoire.
Elle l'est avec le développement personnel continu (DPC). Tout est organisé.
Vous ne nous avez pas interrogé sur l'accréditation ?
J'avais proposé au ministère une procédure d'accréditation pour les médecins esthétiques. Il ne l'a pas retenue car cela nécessitait de modifier la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

J'ai considéré en effet que la question était inutile. Il ne faut pas assommer les médecins. Dès lors qu'ils sont formés par l'université, qu'ils peuvent suivre une formation continue, est-il bien nécessaire de créer une accréditation ?
On peut accréditer plus facilement les structures. Le projet de norme Afnor est une usine à gaz.
Le projet de décret définit bien les actes des médecins, les équivalences, la formation. Tout serait beaucoup plus clair s'il était publié.

Il y a un impondérable, les élections. Il n'est pas utile d'opposer les uns aux autres.
Distinguons les actes esthétiques médicaux des autres !
Pourquoi les dentistes s'opposeraient-ils à ce sur quoi les médecins se sont mis d'accord ?
C'est un problème de sémantique.

Je vous remercie tous de votre contribution à cette audition qui a été très riche.