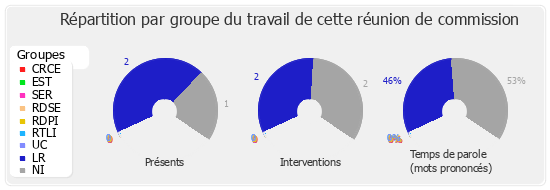Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 11 avril 2006 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La délégation a procédé à l'audition de M. Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du Sceau au ministère de la justice.

Après que Mme Gisèle Gautier, présidente, eut présenté l'intervenant, M. Marc Guillaume a d'abord indiqué que la conception propre au ministère de la justice du droit de la famille suivait un « fil conducteur » consistant à préserver la cohérence d'ensemble de ce droit.
Il a rappelé que le mariage restait le seul fondement juridique de l'institution familiale, même si la loi du 15 novembre 1999 avait reconnu le concubinage dans le code civil et institué une relation contractuelle ouverte aux couples hétérosexuels ou homosexuels, le pacte civil de solidarité (PACS). Après avoir noté qu'environ 170.000 PACS avaient été conclus en six ans, il a indiqué que le rapport établi par le groupe de travail installé par la Chancellerie pour dresser un bilan du PACS avait insisté sur le caractère purement contractuel du PACS qui n'a pas vocation à servir de fondement à une famille. Il a ajouté que la mission d'information sur la famille et les droits des enfants de l'Assemblée nationale avait repris à son compte cette position et a fait observer que le gouvernement avait présenté un certain nombre d'amendements tendant à améliorer le PACS à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif aux successions et libéralités par l'Assemblée nationale.
a insisté sur le fait que le mariage, qui donne lieu à environ 280.000 célébrations chaque année, demeurait l'institution fondamentale du droit de la famille en France. Il a rappelé que le garde des Sceaux n'était pas favorable à l'adoption par un couple de personnes non mariées, l'adoption ayant pour vocation de donner une famille à un enfant qui en est privé. Or, a-t-il fait remarquer, les concubins forment bien un couple mais non une famille, estimant que la rupture d'un concubinage pouvait survenir à tout moment et s'avérer préjudiciable à l'intérêt de l'enfant adopté. Relevant que le concubinage n'impliquait pas nécessairement l'altérité sexuelle du couple, il a estimé qu'il ne serait pas conforme à l'intérêt de l'enfant de lui donner une filiation ne comportant pas cette altérité. Il a considéré qu'il convenait donc de ne pas modifier les équilibres actuels du code civil, qu'il a jugé satisfaisants. Il a ajouté que, si l'adoption par une personne seule était possible, quoique limitée dans les faits, il s'agissait d'un cas de figure bien spécifique, cette procédure étant le plus souvent utilisée pour permettre à un époux d'adopter l'enfant de son conjoint.
a ensuite abordé la question de la résidence alternée, instituée par la loi du 4 mars 2002. Il a fait état de premiers éléments statistiques établis à partir d'une enquête auprès des juges aux affaires familiales, sur la base d'un échantillon représentatif de 7.700 décisions de justice concernant la garde des enfants, dont il ressort que 797 d'entre elles, soit un peu plus de 10 %, ont instauré une résidence alternée. Il a fait observer que la proportion de demandes de résidence alternée demeurait donc assez modeste, et a noté que, dans l'immense majorité des cas, une telle demande était formée par les deux parents, le plus souvent à la suite d'un divorce par consentement mutuel, le juge homologuant une convention des parties dans 95 % des cas. Il a ainsi estimé que ces premiers chiffres démentaient les polémiques parfois évoquées au sujet de la résidence alternée, et a souligné que l'intérêt de l'enfant devait être préservé, grâce à l'appréciation au cas par cas par le juge. Il a par ailleurs considéré qu'il serait très arbitraire de fixer un âge en-dessous duquel la résidence alternée serait interdite.
Puis le directeur des affaires civiles et du Sceau a indiqué que les ministres de la justice successifs s'étaient montrés favorables au développement de la médiation familiale, qui permet généralement de parvenir à des décisions négociées. Il a d'ailleurs fait observer que les crédits alloués aux associations de médiation familiale avaient plus que doublé en quelques années et que ces associations étaient incitées à travailler en relation avec la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) afin de favoriser l'accès à la médiation. En revanche, il a estimé qu'un recours obligatoire à la médiation allongerait inutilement les procédures.
a ensuite noté que les critères de fixation du montant des pensions alimentaires étaient simples et correspondaient aux ressources respectives des parents et aux besoins des enfants. Il a cependant fait observer que les décisions de justice en la matière pouvaient être divergentes selon les juridictions, car les juges n'appliquent pas un barème automatique, ce qui peut parfois faire naître un sentiment d'inégalité. Il a estimé qu'un divorce était généralement une cause d'appauvrissement à la fois des parents et des enfants. Il a expliqué l'existence de décisions de justice fixant le montant de la pension alimentaire à un niveau inférieur à celui de l'allocation de soutien familial (ASF) par la diversité des situations individuelles, certains pères pouvant être amenés à payer une pension alimentaire pour des enfants de plusieurs lits. Il a considéré que, pour parvenir à plus d'équité dans ces décisions de justice, il serait utile que le juge dispose d'outils à la décision fondés sur des indicateurs objectifs, par exemple le coût de l'éducation d'un enfant, et a évoqué l'existence d'expérimentations en ce sens. Il a par ailleurs indiqué que le garde des Sceaux n'était pas favorable à la création d'un fonds de recouvrement permettant de mutualiser le risque des pensions impayées, qui porterait atteinte au principe de la solidarité familiale sur lequel repose l'obligation alimentaire, la solidarité nationale ne pouvant jouer qu'afin d'éviter une extrême précarisation des familles.
Constatant que l'émergence des familles recomposées était une réalité sociale incontournable et posait le problème de la place du beau-parent, M. Marc Guillaume a observé qu'il n'existait aucun obstacle juridique à ce qu'un parent donne à un tiers l'autorisation d'effectuer des actes concernant la vie quotidienne de son enfant, l'intervention du juge n'étant nécessaire qu'en cas de désaccord entre les parents. Il a rappelé que la délégation et le partage de l'autorité parentale, institués par la loi du 4 mars 2002, permettaient de régler les cas où un tel mandat s'avérait insuffisant, sans porter atteinte au principe de coparentalité. De ce point de vue, il a attiré l'attention sur les risques d'éviction du parent biologique non gardien que pourrait entraîner l'institution d'un statut spécifique du beau-parent.
Un débat s'est instauré à l'issue de cet exposé.

a rappelé que certains pédopsychiatres évoquaient les « ravages » que la résidence alternée était susceptible de provoquer chez les enfants ce mode de garde pouvant constituer une cause de fragilité pour des enfants, qui ne se sentent plus chez eux ni chez leur mère, ni chez leur père. Elle a fait observer que la résidence alternée était généralement choisie par les personnes les plus aisées, qui peuvent de surcroît avoir recours en permanence à une nourrice accompagnant l'enfant. Par ailleurs, elle s'est dite favorable au développement de la médiation familiale, qui permet à des parents divorcés de renouer le dialogue sur l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Elle a enfin rappelé que le montant mensuel moyen de la pension alimentaire, de 150 euros par enfant, représentait une somme trop faible pour permettre de couvrir l'ensemble des besoins d'un enfant, et a estimé que la pension devrait être fixée en fonction des revenus du père.
a indiqué que les statistiques disponibles montraient que les deux parents demandant une résidence alternée avaient presque toujours fait l'effort de se mettre d'accord sur les modalités pratiques de l'éducation de l'enfant. Se référant à l'enquête précédente auprès des juges aux affaires familiales, il a précisé que l'âge moyen des enfants concernés était de sept ans au moment de la décision prononçant une résidence alternée. Il a estimé que celle-ci ne pouvait être la simple conséquence d'une revendication égalitaire des droits des parents, mais qu'il ne serait pas satisfaisant pour autant de revenir à une situation où la mère se verrait systématiquement confier le droit de garde. Il a insisté sur la nécessité pour le juge de faire prévaloir l'intérêt de l'enfant sur tout autre critère et a considéré que l'âge de celui-ci ne devait pas constituer le critère essentiel à prendre en compte. Enfin, il a estimé que la cause des difficultés rencontrées lors d'une résidence alternée pouvait aussi être recherchée dans la souffrance provoquée chez l'enfant par le divorce de ses parents. Au total, il a considéré qu'il pourrait être dangereux de modifier un dispositif récent dont l'application ne peut pas encore être complètement évaluée.
Par ailleurs, il a constaté les bons résultats de la médiation familiale, mais a reconnu qu'ils demeuraient difficiles à généraliser, une médiation pouvant être proposée à des parents certes en cours de divorce, mais dont le conflit n'est pas tel qu'il empêcherait tout dialogue. Il a en outre expliqué que le montant modique des pensions alimentaires pouvait être lié à la faiblesse des ressources du père, parfois également obligé de verser une prestation compensatoire.

s'est interrogée sur la pertinence d'une résidence alternée pour de très jeunes enfants.
a confirmé que si, au vu de l'enquête effectuée par le ministère de la justice, l'âge moyen des enfants concernés par une résidence alternée était de sept ans, certains d'entre eux étaient effectivement plus jeunes.

s'est tout d'abord déclarée favorable aux orientations tendant à ne pas permettre l'adoption par les couples homosexuels et à veiller à maintenir les relations entre le père biologique et ses enfants.
S'agissant de la résidence alternée, elle a rappelé que d'après les indications recueillies par la délégation, certains juges prononçaient aujourd'hui ce mode de garde de façon régulière et peut-être excessive. Elle a insisté, à ce sujet, sur la nécessité de respecter l'intérêt de l'enfant et suggéré d'entourer de suffisamment de précautions la décision de recourir à ce mode de garde. Elle s'est enfin interrogée sur la possibilité pour les familles de saisir à nouveau le juge afin de modifier les conditions de la résidence alternée en cas de difficultés.
a estimé qu'il serait utile de procéder à une nouvelle enquête de terrain pour évaluer les transformations de la pratique judiciaire au cours des dernières années et disposer de données statistiques globales. Il a rappelé que, du point de vue juridique, le juge pouvait prononcer une mesure d'alternance provisoire avant de statuer au fond. Il a également souligné que le juge avait la possibilité d'utiliser des outils d'évaluation et d'expertise, comme l'enquête sociale ou médico-psychologique, afin de prendre une décision fondée sur une analyse précise du contexte familial.

s'est associée aux remarques formulées par Mmes Janine Rozier et Sylvie Desmarescaux et a montré, sur la base d'exemples concrets, que la résidence alternée pouvait bouleverser les habitudes de l'enfant. Lorsque la mère s'occupait habituellement des enfants dans un couple, il lui a semblé plus aisé, en cas de séparation, de prévoir un droit de visite du père limité au week-end, et une résidence chez la mère pendant la semaine. Puis elle s'est félicitée des réponses apportées par l'intervenant, en soulignant qu'elles reposaient sur le principe de la primauté de l'intérêt de l'enfant.

a néanmoins insisté sur la nécessité de ne pas pénaliser le père en le privant des attributs de la parentalité.

a fait part de ses divergences par rapport à la conception de la famille exposée par les précédents intervenants. Tout d'abord, elle a indiqué qu'elle ne partageait pas l'idée selon laquelle seul le mariage est juridiquement adapté à la fondation d'une famille. Elle a évoqué, pour illustrer son propos, le cas des mariages forcés et des mariages fondés sur l'intérêt pécuniaire. Elle a ensuite estimé préférable pour un enfant, plutôt que de vivre en orphelinat, d'être adopté par un couple, même non marié.
Par ailleurs, elle a regretté que les couples homosexuels ne soient pas reconnus en tant que famille et a rappelé que le groupe communiste, républicain et citoyen avait pris l'initiative du dépôt d'une proposition de loi tendant à permettre l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel. Elle a déploré l'attitude qui consiste, sous couvert de l'intérêt de l'enfant, à véhiculer une image passéiste de la famille, s'interrogeant sur la possibilité offerte à une personne seule d'adopter un enfant alors que l'adoption n'est pas autorisée à un couple non marié.
Elle s'est, en revanche, ralliée à la conception selon laquelle l'enfant ne doit pas devenir l'instrument du conflit entre les parents et la résidence alternée ne peut être retenue qu'après un examen attentif de la situation familiale.
Puis elle a souligné qu'en cas de violences conjugales, la médiation familiale pouvait s'avérer inadaptée, les deux parties n'étant pas placées sur un pied d'égalité. Enfin, elle s'est interrogée sur la place respective à accorder au père biologique et au beau-parent dans le cadre d'une famille recomposée.
a rappelé la détermination du gouvernement à lutter contre les mariages non consentis, en précisant que les mesures contenues dans la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises sur des mineurs seraient prolongées par les dispositions d'un projet de loi tendant à un meilleur contrôle de la validité des mariages consentis à l'étranger, manifestant ainsi une convergence de vues sur ce point avec Mme Annie David.
Il a ensuite rappelé qu'en France le nombre d'enfants en attente d'adoption était très faible. Soulignant le nombre élevé de candidats à l'adoption, il a précisé qu'on recensait aujourd'hui 23 000 agréments en stock, alors que 8 500 étaient délivrés chaque année. Dans le même temps, il a rappelé que le nombre d'adoptions était de 4 000 par an à l'étranger et de 1 000 seulement en France. Il a précisé qu'il existait donc beaucoup plus de couples mariés candidats à l'adoption que d'enfants adoptables en France.

En réponse à une question de Mme Gisèle Gautier, présidente, M. Marc Guillaume a confirmé qu'une personne seule avait le droit d'adopter un enfant, en précisant que, dans la pratique, il ne s'agissait pas tant de célibataires que d'époux souhaitant adopter l'enfant de leur conjoint, les célibataires ne représentant que 10 % des demandes environ.

a mis l'accent sur les avantages de la médiation familiale en évoquant des cas concrets montrant que celle-ci permet de rétablir le dialogue dans certaines familles traversées par des conflits. Elle a ensuite estimé que la garde alternée était susceptible de se révéler dommageable pour les enfants qui peuvent perdre certains de leurs repères.
a rappelé que la médiation familiale avait été renforcée avec un doublement des moyens alloués aux associations exerçant dans ce domaine. Il a ensuite à nouveau souligné qu'il serait nécessaire d'actualiser et de compléter les statistiques de la pratique judiciaire en matière de résidence alternée afin d'améliorer la compréhension des évolutions en cours.

a évoqué les limites de la garde alternée pour les enfants arrivant à l'âge de l'adolescence, en insistant sur le besoin de stabilité qui se manifeste à partir de l'âge d'onze ou douze ans.
a précisé que les trois quarts des demandes de résidence alternée concernaient des enfants de moins de dix ans. Il a ensuite insisté sur les difficultés de l'évaluation de la résidence alternée, dont l'opportunité était parfois remise en cause pour les enfants en bas âge et pour les adolescents. Il a ajouté qu'il convenait également de prendre en compte le contexte général de la montée du taux d'activité des femmes. Puis il a rappelé que l'esprit de la loi du 4 mars 2002 était d'accorder aux deux parents des droits équilibrés et que l'édifice législatif existant reposait sur la priorité à accorder à l'intérêt de l'enfant.

revenant sur le problème de la médiation familiale dans des situations de déséquilibre imputable à des violences conjugales, a souligné que dans un certain nombre de cas, la médiation donnait la possibilité, à la femme victime, de s'adresser à son mari, dans des conditions de sécurité qui ne seraient pas réunies autrement, le cas échéant par l'intermédiaire du médiateur, sans que le mari soit physiquement présent au cours de l'entretien. Elle a ensuite souhaité que l'on ne dise plus d'une femme qui s'occupe de ses enfants qu'elle « ne travaille pas ».
a rappelé que l'intervention de Mme Janine Rozier lors de l'élaboration du projet de loi sur le divorce avait contribué à l'introduction d'une disposition permettant l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal.

s'est interrogée sur l'application concrète des sanctions pour non-représentation d'enfant, Mme Annie David évoquant, à titre complémentaire, le cas des parents qui à l'inverse abandonnent de fait leur enfant en n'exerçant pas leur droit de visite et d'hébergement et ne versent pas la pension alimentaire.
a reconnu les imperfections statistiques qui font obstacle à une connaissance précise de ces phénomènes. Il a toutefois précisé que 1 064 condamnations pour non-représentation d'enfant avaient été prononcées en 2000, 928 en 2001, 506 en 2002, 687 en 2003 et 926 en 2004. Il a souligné la nécessité d'un suivi des plaintes déposées pour non-représentation d'enfant et annoncé la prochaine mise en place d'un appareil statistique adapté à ce suivi.
S'agissant des sanctions applicables, il a rappelé l'existence dans le droit en vigueur d'un dispositif pénal assez complet qui prévoit des délits spécifiques en matière d'abandon d'enfant ou de famille, de non-représentation d'enfant, de soustraction d'enfant et d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité.

a insisté sur les obstacles pratiques qui se manifestent au stade du dépôt de la plainte.
a constaté, à ce sujet, qu'il n'était pas nécessaire de créer un délit nouveau d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale dans le code pénal et qu'il s'agissait a priori d'un problème d'application de la loi.
Au plan civil, il a rappelé que la loi du 4 mars 2002 imposait le respect des liens de l'enfant avec le parent non gardien. Il a cependant indiqué que le juge aux affaires familiales pouvait prendre toutes les mesures utiles, et en particulier statuer sur de nouvelles modalités de l'exercice de l'autorité parentale en fonction de l'intérêt de l'enfant, à condition d'être à nouveau saisi en cas de difficultés.
Concluant que le juge avait d'ores et déjà les moyens juridiques de tirer les conséquences, soit du non-exercice du droit de visite, soit de la non-représentation d'enfant, il a insisté sur la nécessité d'un examen au cas par cas des motifs pour lesquels un parent ne remplit pas ses obligations.