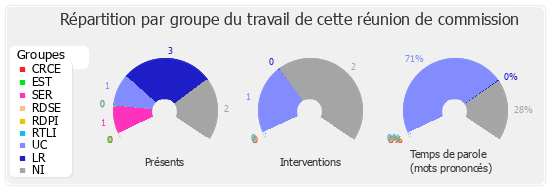Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 23 juin 2009 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission a procédé à l'examen du rapport de M. Philippe Richert et du texte proposé par la commission pour la proposition de loi n° 215 (2007-2008) visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories.

a indiqué que ce texte, déposé le 22 février 2008 par Mme Catherine-Morin-Desailly, a été cosigné par de nombreux sénateurs issus de différents groupes politiques. Cette initiative rappelle celle qu'avait prise en 2002 M. Nicolas About pour rendre à l'Afrique du Sud la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, dite la « Vénus Hottentote ».
Il a ajouté que les têtes humaines momifiées et tatouées, tradition du peuple Maori, avaient fait l'objet d'un trafic sordide avec l'arrivée des colons européens en Nouvelle-Zélande, et que certaines d'entre elles se sont ainsi retrouvées dispersées dans des musées. En octobre 2007, le conseil municipal de la ville de Rouen a adopté, à l'unanimité, une délibération visant à rendre aux autorités néo-zélandaises -qui en avaient fait la demande- une tête maorie conservée dans les réserves de son Muséum d'histoire naturelle. Or, saisi par le préfet à la demande de la ministre de la culture, le juge administratif a annulé cette décision : en effet, le muséum, ayant obtenu l'appellation « musée de France », est régi par les dispositions de la loi du 4 janvier 2002, aux termes desquelles les biens constituant les collections de ces musées sont inaliénables et toute décision de déclassement ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique. Le juge a considéré que les dispositions du code civil issues des lois « bioéthique » de 1994, qui prévoient que le corps humain ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial, n'étaient pas applicables en l'espèce. M. Philippe Richert, rapporteur, a relevé que, lors des débats sur la « Vénus Hottentote », le ministre de la recherche s'était pourtant appuyé sur ces dispositions pour justifier, alors, qu'une loi était selon lui inutile.
Il a précisé que la proposition de loi permettait de déroger à la procédure spécifique de déclassement prévue par la loi de 2002. Six musées -dont celui du Quai Branly et cinq musées territoriaux- ont, d'après les informations transmises par le ministère, une ou plusieurs de ces têtes dans leurs réserves, soit au total une douzaine. Il reviendra ensuite aux responsables des musées concernés et aux collectivités propriétaires des collections de définir, en étroite coopération avec le musée Te Papa de Nouvelle-Zélande, les modalités de la restitution. Il a indiqué ne pas avoir entendu, au cours de ses auditions, d'argument valable pour s'opposer à la restitution de ces têtes maories. Plusieurs critères en justifient le bien-fondé :
- d'abord, la Nouvelle-Zélande souhaite le retour des têtes maories, même si cette demande est exprimée avec beaucoup de précautions ; le musée national Te Papa est chargé de piloter le programme de rapatriement et de conduire les négociations avec les musées étrangers ; depuis 1987, dix pays ont déjà répondu favorablement à cette sollicitation ;
- ensuite, la restitution se justifie au regard du principe de dignité humaine, de l'éthique et du respect dû aux cultures et croyances d'un peuple vivant : d'une part, il s'agit de restes humains, et non de biens culturels ordinaires ; d'autre part, l'objectif du retour est d'offrir aux ancêtres une sépulture digne, conforme aux rites ancestraux ;
- enfin, les têtes maories n'ont jamais fait l'objet en France de recherches scientifiques ; il conviendrait, néanmoins, de conserver la trace de ce témoignage historique, comme le permettent les techniques de numérisation, pour ne pas aboutir à des « trous » dans la connaissance de l'humanité dont les musées sont aussi responsables.
a reconnu, cependant, que cette démarche pouvait susciter des craintes, en particulier celle d'une dérive vers de nouvelles revendications. Il a souligné que les mêmes réserves s'étaient exprimées en 2002 mais qu'elles n'ont pas été suivies de telles demandes.
Puis, tout en proposant à la commission de souscrire à la proposition de loi, il a souhaité que ce texte soit aussi l'occasion de faire avancer les choses sur des sujets majeurs pour la politique des musées. En effet, ce débat a révélé le retard de la France sur les questions de gestion éthique des restes humains. Par ailleurs, il a permis de constater que la procédure de déclassement des biens des collections des musées, introduite dans la loi de 2002 à l'initiative de la commission, était restée virtuelle.
Certes, une commission scientifique nationale des collections des musées de France a été instituée par le décret du 25 avril 2002. Toutefois, si cette commission a tenu plusieurs réunions, consacrées à des questions de restauration et d'acquisition, elle n'a jamais eu à statuer sur un problème de déclassement. Elle n'a pas davantage engagé de réflexion pour définir des critères en vue d'éventuels déclassements, comme le législateur l'avait pourtant invitée à le faire au moment des débats en séance publique.
Il a rappelé que M. Jacques Rigaud, chargé par Mme Christine Albanel d'une mission sur la question de l'aliénation des oeuvres collections publiques, avait indiqué, dans son rapport, tout en réaffirmant la portée du principe d'inaliénabilité, que cette procédure aurait au moins mérité d'être expérimentée.
Aussi, M. Philippe Richert, rapporteur, a-t-il proposé de compléter la proposition de loi en vue de « réactiver » cette procédure de déclassement, tout en l'encadrant de fortes précautions. Il a jugé utile, en ce sens, d'élargir la composition de la commission compétente, pour qu'elle ne réunisse pas uniquement des professionnels de la conservation, et de préciser sa « feuille de route ». Renommée « commission nationale scientifique des collections », son champ de compétence est étendu, au-delà des seules collections des musées de France, à d'autres collections publiques et notamment aux oeuvres du Fonds national d'art contemporain. Cette commission aura également vocation à définir une doctrine générale en matière de déclassement, permettant d'éclairer les propriétaires et gestionnaires de collections dans leurs décisions. Elle devra rendre compte de ses réflexions devant le Parlement, en remettant un rapport dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi. Compte tenu de l'importance des enjeux sur lesquels elle aura à se pencher (par exemple s'agissant des restes humains), la composition de cette commission est élargie aux représentants du monde politique, de l'Etat et des collectivités territoriales (en tant que propriétaires de collections publiques), et à des personnalités qualifiées notamment dans le domaine scientifique.
Enfin, il a proposé d'introduire dans la proposition de loi une disposition de nature à simplifier et clarifier la gestion de certaines oeuvres inscrites au Fonds national d'art contemporain (FNAC).
Un large débat a suivi l'intervention du rapporteur.

s'est déclaré favorable à la restitution des têtes maories. Celles-ci ont suscité un engouement des collectionneurs publics et privés au 19e siècle, dans un contexte colonialiste et raciste, si bien que certains esclaves ont eu la tête tatouée puis coupée en vue de satisfaire à la « demande ». L'anthropologie est d'ailleurs née dans ce contexte de racisme et a contribué à justifier scientifiquement certaines pratiques.
Il a avancé trois raisons rendant cette restitution légitime :
- il s'agit de restes humains et non de biens culturels ordinaires ;
- les Maoris sont un peuple contemporain ;
- la demande émane de l'ensemble de la nation néozélandaise, démocratique, et non d'une ethnie particulière.
Il a reconnu que les restes humains ne pouvaient être restitués à n'importe quelle condition et qu'il pouvait être important d'en conserver une trace, grâce aux techniques modernes, pour conserver ce témoignage de l'histoire et en vue d'éventuelles études ultérieures. Il s'est interrogé sur les raisons scientifiques qui pourraient justifier, selon certains, que l'on conserve ces têtes maories, et a estimé que la dimension éthique devait primer.
Il a regretté, cependant, que certaines dispositions que le rapporteur propose d'introduire dans ce texte conduisent à en changer la portée et à affaiblir la démarche initiale des signataires de la proposition de loi. Il a considéré, notamment, que la situation du FNAC constituait un sujet en soi.

a indiqué que l'objet premier de la proposition de loi était de permettre la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande, qui a adopté une démarche exemplaire. Il a estimé que la décision de « réactiver » la commission compétente en matière de déclassement contribuait à renforcer la portée de la proposition de loi, en insistant sur la nécessité d'engager une réflexion qui n'a pas été conduite depuis sept ans. Cette commission aura notamment à se pencher sur la dimension éthique de cette question. Il a reconnu, toutefois, que la disposition concernant le transfert de propriété d'oeuvres du FNAC était plus éloignée de l'objet initial de la proposition de loi, même si elle répond à des attentes.

a précisé que la proposition de loi avait été cosignée, à ce jour, par 57 sénateurs. Elle a rappelé que le muséum de Rouen avait souhaité s'engager, à l'occasion de sa réouverture, dans une gestion éthique des collections et avait suggéré, en ce sens, de rendre la tête maorie qu'il conservait. La ville de Rouen a renoncé à détenir celle-ci dans ses collections, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 16-1 du code civil, mais aussi sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones de 2007 et sur le code de déontologie du conseil international des musées (ICOM). La ville avait considéré qu'une saisine de la commission de déclassement serait vouée à l'échec, compte tenu de sa composition. La délibération ayant été adoptée à l'unanimité, la nouvelle municipalité rouennaise a réaffirmé sa volonté de poursuivre la procédure.
Elle a rappelé que les peuples demandant le retour de leurs « ancêtres » portent un regard différent du nôtre sur ces restes humains. L'exposé des motifs de la proposition de loi mentionne des critères précis pour justifier la restitution des têtes maories, afin de ne pas ouvrir la « boîte de Pandore ». Puis elle a fait observer que l'interdiction récente, par le juge, de l'exposition « Our Body » avait permis de prendre conscience des problèmes éthiques posés par l'exposition de corps humains. Elle a apporté son soutien à la décision de réactiver la procédure de déclassement et aux amendements présentés en ce sens par le rapporteur, avec lequel elle a travaillé en étroite collaboration. Elle a jugé nécessaire, en outre, de parvenir à un état des lieux plus précis des restes humains conservés dans les musées et de combler le relatif vide juridique concernant leur statut. Elle a souhaité, en ce sens, qu'une mission d'information puisse être conduite sur le sujet.

a considéré qu'il aurait été préférable de demander à la commission scientifique existant déjà de se prononcer sur le déclassement éventuel des têtes maories, avant d'en créer une nouvelle.

a indiqué que la commission scientifique aura sans doute à se pencher sur la question des têtes réduites des Indiens, qui sont revendiquées par des tribus, ainsi que sur la question des laboratoires d'anthropologie. Elle a regretté l'insertion de dispositions concernant le FNAC.

a fait observer que les Egyptiens modernes pouvaient parfois revendiquer une certaine filiation avec les pharaons. Sur l'objectif premier et ponctuel de la proposition de loi, il a estimé légitime que la France réponde favorablement à une demande qui est exprimée avec beaucoup de délicatesse par la Nouvelle-Zélande. Il a jugé nécessaire, au-delà, de prolonger la réflexion en prévoyant que la commission scientifique compétente en matière de déclassement se penche effectivement sur le sujet et élabore des principes généraux.

En réponse à Mme Monique Papon, M. Philippe Richert, rapporteur, a indiqué que, selon les indications qui lui ont été transmises, six musées de France ont une ou plusieurs têtes maories dans leurs réserves, sans que l'on dispose d'un inventaire précis, et que d'autres se trouvent dans des collections privées.
Il a précisé que la nouvelle commission devra conduire une réflexion scientifique et éthique importante pour déterminer des critères ou orientations en matière de déclassement. Il a indiqué que les Britanniques avaient effectué un tel travail et défini plusieurs critères, dont l'un est lié à l'âge des restes humains, ce qui permet d'écarter, notamment, toute restitution de momies égyptiennes.
Puis, la commission est passée à l'examen de la proposition de loi.

A l'article unique (Sortie des collections des têtes maories conservées par les musées de France), elle a adopté, après les interventions de Mme Béatrice Descamps, de M. Philippe Richert, rapporteur, de Mme Catherine Morin-Desailly et de M. Jacques Legendre, président, l'amendement n° C6 présenté par M. Philippe Richert, rapporteur, visant à expliciter la finalité du texte, en précisant qu'une fois sorties des collections des musées les têtes maories devront être remises à la Nouvelle-Zélande.
La commission a ensuite examiné l'amendement n° C1 présenté par M. Philippe Richert, rapporteur, portant article additionnel après l'article unique et visant à préciser la composition et les missions de la « commission scientifique nationale des collections », compétente en matière de déclassement, qui se substitue à celle prévue par la loi de 2002 relative aux musées de France.
Elle a adopté, en outre, deux amendements présentés par M. Philippe Richert, rapporteur, le n° C2, de coordination, et le n° C3 visant à prévoir que cette commission remettra, dans un délai d'un an suivant la publication de la loi, un rapport sur ses orientations en matière de déclassement.
La commission a ensuite examiné l'amendement n° C4 présenté par M. Philippe Richert, rapporteur, tendant à prévoir de nouvelles possibilités de transfert de propriété d'oeuvres inscrites sur l'inventaire du FNAC et mises en dépôt auprès de collectivités territoriales, élargissant ainsi les possibilités de transfert déjà ouvertes par la loi de 2002 relative aux musées de France. Après les interventions de M. Ivan Renar et de Mme Marie-Christine Blandin, M. Jacques Legendre, président, a proposé de reprendre cette disposition sous la forme d'une proposition de loi distincte. M. Philippe Richert, rapporteur, a partagé cette position et accepté, en conséquence, de retirer cet amendement.

Enfin la commission a adopté l'amendement n° C5, présenté par M. Philippe Richert, rapporteur, visant à modifier l'intitulé de la proposition de loi afin de tirer les conséquences de l'adoption des amendements n° C1 à C3.
La commission a alors adopté le texte de la proposition de loi ainsi modifié.