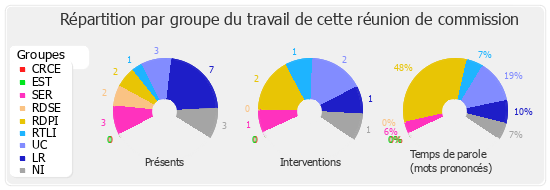Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 27 mars 2013 : 2ème réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission auditionne M. Xavier Nau, rapporteur pour avis du Conseil économique, social et environnemental sur l'avant-projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

Mes chers collègues, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Xavier Nau, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui a produit un avis sur l'avant-projet de loi relatif à la refondation de l'école.
Cette audition, qui vient à la suite de nombreuses auditions déjà conduites par notre rapporteure Mme Françoise Cartron et qui précède celle du ministre, revêt une réelle importance à nos yeux, dans la mesure où les avis du CESE, élaborés sans précipitation et sans pression politique, se caractérisent par leur grande qualité.
Monsieur Nau, vous avez la parole.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, les travaux du CESE, effectivement réalisés avec suffisamment de temps et sans la perspective d'un vote, se sont par ailleurs appuyés sur un précédent avis consacré aux inégalités, qui contenait déjà quelques réflexions relatives à l'école.
Nous avons, nous aussi, procédé à de nombreuses auditions, qui ont permis de voir se dessiner un diagnostic partagé par tous nos membres, duquel nous avons tiré des préconisations, elles aussi largement partagées, notre avis ayant été approuvé à la quasi-unanimité des membres du conseil.
Je peux ainsi vous indiquer, qu'à quelques réserves et nuances près, le CESE est favorable aux dispositions contenues dans le projet de loi, cette approbation globale pouvant s'articuler selon différents axes.
Tout d'abord, la priorité donnée au premier degré nous semble tout à fait essentielle, bien que nous regrettions que ne soit pas envisagée de refonte des programmes de 2008. Je dois aussi mentionner la réserve exprimée par l'un des groupes du Conseil, celui de l'Union nationale des associations familiales (UNAF), sur la scolarisation des moins de trois ans.
Le second axe d'accord est le retour à des modalités de formation des enseignants qui nous semblent mieux adaptées.
Nous avons cependant une interrogation sur le choix qui a été fait de placer le concours à la fin de la première année. Ce choix qui risque d'avoir pour effet de trop orienter cette première année sur les acquisitions théoriques, l'année suivante étant alors consacrée à la pratique, alors qu'il conviendrait de répartir ces deux aspects de façon équilibrée tout au long du cursus.
Nous tenons aussi à souligner la nécessité de s'attacher à la formation de la population d'enseignants qui, bien qu'exerçant dans l'enseignement privé, n'en restent pas moins des agents publics.
Enfin, alors que l'on devrait envisager une sorte de plan Marshall de la formation continue pour les 650 000 agents potentiellement concernés, celle-ci est évoquée sans que soient mentionnés les moyens qui lui seront consacrés.
Troisième axe d'accord : le postulat selon lequel l'éducation ne se limite pas à une transmission de connaissances uniquement orientée vers des hémisphères cérébraux gauche, mais qu'elle a pour objet la formation et le développement général d'être accomplis et équilibrés, et qu'il convient alors de dispenser des enseignements dans les domaines de la morale, du monde numérique et de l'artistique.
Cependant, alors que le projet de loi envisage ces enseignements sous la forme contrainte de matières ou de disciplines à intégrer dans un programme, il nous semble préférable de créer un contexte permettant de les dispenser en permanence et de façon transversale.
A une « éducation morale », dont les termes mêmes ont une connotation peu engageante, il faudrait substituer un travail sur la connaissance et la compréhension des valeurs et sur l'éveil de l'esprit critique. De ce point de vue, nous regrettons d'ailleurs la suppression du verbe « comprendre » dans la rédaction de l'article 28 du projet de loi, relatif à l'enseignement moral et civique, par rapport au texte dont nous avions été saisis. Ce climat général à instaurer dans les établissements aurait pour conséquence attendue une meilleure application des règles du « vivre ensemble » et un plus grand respect de l'autre, à conditions toutefois que l'institution elle-même se montre respectueuse des jeunes individus, notamment lors de leur orientation.
J'en viens maintenant au numérique. Nous devons garder à l'esprit le caractère primordial des rapports humains et ne pas le considérer comme une panacée. Celui-ci doit être envisagé comme un outil, comme une ressource et comme un moyen de communication, dont il convient de connaître les potentialités mais aussi les dangers.
S'agissant des enseignements artistiques, si nous regrettons que le contenu de l'article 6 ait été réduit et appauvri, nous trouvons très intéressant la notion de parcours et nous nous félicitons par ailleurs de l'accent mis sur la nécessité d'un partenariat avec les collectivités territoriales.
Au-delà du parcours accompli dans les domaines artistiques, c'est l'intérêt du parcours général effectué pendant la scolarité qui doit primer, notamment sur certaines considérations utilitaristes de l'institution visant à remplir les filières à pourvoir, quitte à effectuer des orientations-couperets au détriment de l'élève.
L'avis du CESE déplore certains reculs, notamment en ce qui concerne la place des parents qui constitue, si j'ose dire, le parent pauvre du projet, une simple affirmation. En particulier l'article 4 ter du projet de loi limite le rôle des parents des enfants handicapés à une simple consultation lorsque les équipes de suivi de scolarisation des enfants handicapés souhaitent proposer à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une révision de leur orientation ou de leur accompagnement.
Nous regrettons aussi que le projet de loi ne réponde pas aux attentes relatives à l'enseignement dans les zones prioritaires ainsi qu'à la mixité sociale, cette nécessité affirmée depuis 30 ans n'ayant bénéficié d'un véritable pilotage politique que sur une courte période de 5 ou 6 ans.
Enfin, pour la bonne mise en oeuvre du texte, nous nous félicitons de la mise en place d'un comité de suivi, qui devra s'attacher à une publication, non seulement rapide mais aussi cohérente, des décrets d'application.
Je souhaiterais conclure cette présentation de l'avis du CESE en insistant sur le fait qu'à l'issue de la réforme des rythmes scolaires, nous devrons envisager une réforme des programmes pour parvenir à une véritable refondation de l'école, de sorte de lui donner du sens... sans oublier la question des moyens.

Je vous remercie d'avoir actualisé votre analyse au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Je vais reprendre quelques points de votre exposé très exhaustif. Ma première remarque porte sur le regard qu'a posé votre assemblée sur la scolarité des enfants de moins de 3 ans. Ce n'est pas une obligation, c'est le choix des familles qui prévaut. Il s'agit d'une nouvelle dynamique offerte aux enfants des milieux les plus défavorisés.
Concernant les programmes, la recréation du Conseil des programmes devrait se mettre en place rapidement et sa première mission sera de revoir et d'alléger les programmes.
Sur la morale, je partage votre avis que ce ne peut pas être un enseignement soumis à un programme. Je le conçois comme une séquence transversale qui fasse se croiser des disciplines avec pour objectif la formation de citoyens libres, qui auront un regard critique, qui pourront exercer leur libre arbitre, apprendre la tolérance et le respect...
Pour moi, le numérique est un outil qui doit permettre une évolution, voire une rénovation des pratiques pédagogiques.
Sur les parcours artistiques, comme vous l'avez noté, les collectivités locales seront très partie prenante. On revient sur la question des rythmes scolaires. Il y aura un temps scolaire consacré à un enseignement artistique. Mais cela devra se poursuivre hors du temps éducatif obligatoire, pour une meilleure ouverture à la sensibilité artistique.
Je suis d'accord avec vous sur la vigilance à avoir sur la parution des décrets d'application. Ils ne doivent pas tarder, ni affaiblir la portée de la loi.
Quant à la place des parents, c'est un souci que je partage avec vous. Le dernier mot doit revenir aux parents parce qu'il y va du climat scolaire. On parle d'enfants en construction. L'orientation sera d'autant mieux acceptée qu'elle ne sera pas subie.
Enfin, sur la question de la mixité sociale, elle me semble insuffisamment présente et j'insiste sur les méfaits de cette non-mixité. Il ne faut pas baisser les bras devant ces inégalités sociales qui se transforment en inégalités scolaires, car ne l'oublions pas, ce projet de loi est porteur d'un projet de société.

Je ferai quelques remarques.
Sur les moyens accordés à la formation continue, faites-vous une différence entre la formation des enseignants du public et du privé ?
J'insiste sur l'orientation. J'approuve le fait de ne pas satisfaire d'abord les besoins de l'institution. On est là pour assurer au mieux l'enseignement aux élèves. Une orientation se fait progressivement en fonction des éléments que l'on obtient de la part des parents, du monde extérieur et de l'institution scolaire. Les centres d'orientation sont-ils remis en question ?
Enfin, le débat sur le pouvoir de décision final qui appartient au chef d'établissement, au conseil de classe ou aux parents, me semble particulièrement important. Cela mérite plus de précision.

Nous souffrons dans notre système scolaire, dès la maternelle, d'un état d'esprit très compétitif entre les élèves. Ne pourrions-nous pas aller vers plus de coopération et moins de compétition ? Quelle est l'incidence de la notation ?
Par ailleurs, notre système sacralise l'écrit au détriment de l'oral, de l'argumentation. Ce déficit de l'oral est à mon avis une des sources de difficulté de l'apprentissage des langues étrangères.
Avez-vous eu des réflexions sur ces deux sujets ?

Je vous remercie de vos propos. Vous connaissez mes inquiétudes et mes attentes par rapport à ce texte. Je réserve mes questions au ministre.

Je partage de nombreux points de vue avec votre analyse sur ce texte : le numérique, l'enseignement artistique, la formation continue ...
Sur la question de l'orientation, on a tendance à oublier l'enseignement technique. Quand vous parlez de la construction d'hommes et de citoyens, je voudrais vous répondre par l'enseignement agricole qui a fait beaucoup pour la construction de l'homme et du citoyen.
Je me pose aussi la question de savoir comment mieux impliquer tous les acteurs et quelle place offrir aux parents.
Enfin, pouvez-vous préciser votre pensée sur la scolarisation des enfants de moins de 3 ans ?

Avez-vous évoqué la place de la santé dans le cadre de la refondation de l'école ? Notre ancien collègue, M. Etienne, actuellement membre du CESE, qui était très attaché à cette question. Cela rejoint la question des élèves handicapés et celle de la violence à l'école.

Je reviens sur les modalités du projet de loi. Une partie des hostilités à ce texte porte sur la disparité que va entraîner la création de 4 heures d'éducation complémentaire soumis à la discrétion des collectivités locales. Le CESE s'est-il penché sur la question de ces deux formes de service public d'éducation, l'un national, obligatoire et gratuit, l'autre local, facultatif et pas forcément gratuit ?

Je m'interroge sur la question du redoublement. Dans le projet de loi, le redoublement devient exceptionnel. Or, il me semble que pour diminuer le nombre de redoublements, il faudrait proposer un accompagnement des élèves qui ne sont pas au niveau. Avez-vous réfléchi sur ce sujet ? Cela m'amène à aborder la question du collège unique et la question de la mixité sociale. Est-il possible d'envisager des niveaux différents au sein d'un même établissement afin de ne pénaliser ni les meilleurs, ni les moins bons ?

J'aurai deux remarques.
Les collectivités locales sont très partie prenante à l'éducation artistique et culturelle sur leur territoire. Cela est possible si les collectivités sont aidées de façon durable, comme le préconise le CESE, et accompagnées dans la mise en oeuvre des projets. Je pense aux petites communes rurales dépourvues de personnel et de locaux. Cette loi risque d'être source d'inégalités croissantes.
Sur la question du numérique, au-delà des recommandations du CESE, la réflexion doit être poursuivie sur les usages pédagogiques. En quoi le numérique révolutionne-t-il le mode d'accès à la connaissance ? Il ne faut pas s'arrêter à la sensibilisation aux risques d'Internet, ni aux aménagements techniques.

Je suis étonné que vous n'ayez pas plus abordé les rythmes scolaires qui figurent notamment dans l'annexe à l'article 1er du projet de loi. Je m'interroge aussi sur votre appréciation de la fin de l' apprentissage dès quatorze ans ainsi que du contenu du concours en fin de master en 1re année, la première année étant plus académique et la seconde plus professionnalisante.

S'agissant du chapitre consacré à l'éducation aux usages du numérique, j'ai cru percevoir certaines réserves dans votre propos à l'égard de ce que je considère personnellement comme une vision parfois utopique de l'apport de la technologie compte tenu de la réalité des moyens. De fait, les enseignants sont bien souvent moins expérimentateurs et praticiens des nouvelles technologies que leurs élèves. S'il est important que l'école valorise les usages numériques dans le cadre des apprentissages, elle ne doit pas surévaluer cette dimension. Surtout, le numérique ne peut ni ne doit remplacer l'éducation, plus large, aux médias et à la communication mise en oeuvre dans les établissements, sur la base du volontariat des enseignants, depuis une trentaine d'années. Or, j'observe que le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI), chargé depuis 1983 d'accompagner cette politique, a vu, ces dernières années, ses moyens humains et financiers amputés. La diminution des budgets ne permet plus de développer des expérimentations dans ce domaine. On considère désormais, à tort me semble-t-il, qu'une vidéo sur Internet remplace le visionnage d'un journal télévisé ou la lecture d'un article pour l'apprentissage du décryptage de l'information.

Après les prises de parole des groupes politiques et les questions plus ciblées des sénatrices et sénateurs de la commission, je vous laisse apporter, monsieur le rapporteur, des éléments de réponse à chacun.
L'exercice est délicat tant les sujets abordés ont été variés.
Le sujet de l'orientation a été mentionné par plusieurs intervenants. L'idée, réaffirmée par le projet de loi, que l'orientation ne doit pas être un couperet pour l'élève n'est certes pas nouvelle mais nulle politique, jusqu'alors, n'a réussi à dépasser ce paradigme. De fait, la décision d'orientation continue à être considérée, par les élèves qui la subissent sans la choisir, comme un couperet. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'on utilise, dans notre système éducatif, l'expression « être orienté », c'est-à-dire la voix passive du verbe. À ce titre, la notion de « parcours » développée par le projet de loi de refondation pour l'école ne constitue pas une véritable nouveauté. Il faut donc prendre garde à ce que ce principe ne demeure pas un voeu pieux, comme cela a été le cas par le passé.
La loi du 18 juillet 2011 pour le développement de l'alternance, la sécurisation des parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée, dite loi Cherpion, a ramené à quatorze ans l'âge minimum permettant d'entrer en apprentissage. Or, les études nationales et internationales montrent toutes qu'une orientation trop précoce est une erreur : le niveau global d'éducation d'une population est d'autant plus élevé que le socle commun d'éducation est long. Ainsi, après les résultats décevants de l'étude PISA de 2000, l'Allemagne est revenue sur sa politique d'orientation précoce. En ce sens, le projet de loi va dans le bon sens lorsqu'il propose de porter à quinze ans l'âge minimum de l'orientation en apprentissage. Pour autant, il faudra trouver des solutions pour les élèves qui peinent à suivre une scolarité classique jusqu'à cet âge. Il convient d'éduquer les élèves au choix, selon un double principe de réalité - le niveau de compétences et les besoins du marché du travail - et d'aspiration personnelle. Ce n'est que si l'orientation devient le choix de l'élève que la notion de parcours éducatif défendue par le projet de loi a un sens.
Je parlerai rapidement de la formation des enseignants du privé. Les accords Lang-Cloupet de juin 1992 signés entre le ministère de l'éducation nationale et l'enseignement catholique prévoyaient que les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) pilotaient la formation de l'ensemble des enseignants, en conservant des stages dans les établissements privés pour les enseignants concernés. La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005, qui introduit la « mastérisation », a modifié cette organisation, tandis que la loi du 5 janvier 2005, dite loi Censi, réaffirmait la qualité d'agents publics des enseignants du privé. Il a semblé important à notre section d'indiquer dans son rapport que, dans le respect des spécificités de l'enseignement privé, la maîtrise d'oeuvre en termes de formation des enseignants devait, pour tous, être confiée aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation, même si certaines formations pouvaient être déléguées à d'autres organismes publics ou privés.
En réponse à Mme Corinne Bouchoux sur le sujet de la coopération entre élèves préférable à la compétition, j'indiquerai que le Conseil économique, social et environnemental avait proposé d'amender l'article 3 du projet de loi initial pour y faire figurer la pédagogie coopérative. Las, cet article a purement et simplement été supprimé par l'Assemblée nationale au motif qu'il n'était pas possible de citer in extenso dans le code de l'éducation les valeurs de la République. Je le déplore. En effet, l'examen des résultats de l'étude PISA montre que les élèves français sont inhibés : plus que d'erreurs, leurs mauvais résultats résultent de l'absence de réponse à certaines questions. A mon sens, cette attitude défensive est le signe de leur crainte d'une notation par trop négative. Dans notre rapport de 2011 sur l'instauration du socle commun de compétences, nous avions indiqué que si l'évaluation de l'élève au travers ses strictes notions « acquis/non acquis » pouvait sembler primaire à certains, la variation de cette évaluation dans le temps (l'élève n'est pas noté à un moment M mais son acquisition des compétences requises est mesurée tout au long de l'année) permet de redonner confiance aux élèves en difficulté : l'élève est noté lorsqu'il a réussi, même si sa réussite est plus tardive que celle d'autres élèves de la classe.
S'agissant du redoublement, je redis combien son usage est démesuré en France. Il est utilisé par facilité, à défaut de rechercher une solution alternative. Or, son utilité est douteuse, mis à part, peut-être, au lycée. A tout le moins, il conviendrait d'en limiter le recours aux classes de fin de cycle.
Pour ce qui concerne l'enseignement agricole, il me semble utile de rappeler qu'il n'est pas organisé à la même échelle ni suivant les mêmes structures que l'enseignement dit classique. Ainsi, il lui a été confié une mission d'animation des territoires, qui implique, pour ces établissements, un ancrage territorial bien supérieur, notamment pour ce qui concerne les débouchés professionnels. Pour autant, il me semblerait intéressant de s'inspirer des réalisations de ces établissements, comme de celles des lycées professionnels d'ailleurs, en matière de pédagogie.
S'agissant de ce qu'il est convenu d'appeler l'enseignement de la morale, convenons ensemble que, pour de multiples raisons, les institutions qui transmettaient ces valeurs sont aujourd'hui décrédibilisées et que ces valeurs elles-mêmes sont désormais mouvantes, en écho au développement du multiculturalisme dans notre société. De nombreux jeunes confondent leur identité personnelle et leur appartenance à un groupe : il est essentiel de les aider à construire leur propre identité, dans le respect de leurs différentes appartenances, et à développer leur esprit critique. Cette construction doit avoir pour objectif de faire émerger chez chacun une exigence d'universel ; c'est le rôle de l'école.
Concernant le rôle des collectivités territoriales, notre rapport insiste sur les synergies nécessaires entre les établissements et les territoires. Au-delà des cinq à six heures passées quotidiennement dans l'établissement, le jeune a une vie de quartier, de commune. Il s'agit donc de réfléchir à un temps éducatif global pour l'aider à grandir et à évoluer en dehors du strict cadre scolaire. Certaines cultures disposent ainsi qu'« il faut tout un village pour élever un enfant », ce qui, je vous l'accorde, est très éloigné de notre modèle éducatif républicain centralisé. Oui, confier ce temps éducatif aux collectivités territoriales, c'est accepter les différences et les variations entre les territoires, mais je crois qu'il convient de faire confiance aux acteurs locaux pour lutter contre les inégalités qu'ils constatent mieux que quiconque sur leur territoire. En revanche, ils ne pourront assumer cette nouvelle mission sans aide, tant financière qu'en matière d'ingénierie éducative, comme l'a récemment rappelé l'Association des maires de France (AMF).
À Mme Maryvonne Blondin, j'indiquerai enfin, pour le déplorer, que le rapport de notre section, dont le Professeur Etienne n'est malheureusement pas membre, ne s'est pas penché sur le sujet de l'éducation à la santé dans les établissements scolaires.

Cet oubli est d'autant plus fâcheux que l'éducation à la santé contribue largement à la réduction des inégalités sociales.
Je ne peux qu'abonder dans votre sens et je me félicite que l'éducation à la santé ait été renforcée lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale.
Nous n'avons pas abordé la question des rythmes scolaires et ce pour deux raisons : d'une part, lors de notre dernier rapport il y a deux ans, nous n'avons pas voulu interférer avec les travaux de la commission sur les rythmes scolaires ; d'autre part, nous avons délibérément choisi, s'agissant du présent rapport, de privilégier d'autres sujets, celui-ci étant à notre sens largement traité dans le débat public. Nous avons néanmoins affirmé à plusieurs reprises notre souhait d'une réforme de l'organisation de l'année scolaire.
Pour préciser mes propos concernant le concours de recrutement des professeurs, j'indiquerai qu'il nous semble important d'articuler la première et la seconde année de formation en équilibrant, au cours de la scolarité, pédagogie, enseignement disciplinaire, sciences de l'éducation et stages pratiques. En conséquence, le concours ne peut être placé qu'à l'entrée ou à la sortie des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, afin de préserver la continuité de la formation.
Certes, mais le concours ne pourra pas, en tout état de cas, intégrer les expériences de terrain ; tout au plus pourra-t-il comprendre des épreuves pratiques de pédagogie. A cet égard, il me semble parfaitement cohérent d'avoir prévu que le futur conseil supérieur des programmes possède, dans ses missions, une compétence en matière de définition des programmes du concours.
Concernant le numérique et les médias, cela relève de l'esprit critique. Il y a bien une éducation aux médias, y compris numérique, et, par ailleurs, une éducation à la communication numérique. Ces deux points relèvent de logiques différentes.
Sur l'éducation au numérique, il y a l'approche pédagogique. Cela participe d'un problème beaucoup plus important où l'école n'est pas la seule dispensatrice du savoir, surtout à partir du collège. Le jeune dispose d'informations qui viennent d'un peu partout. Le travail de l'école est plus de structurer ces informations pour qu'elles deviennent des connaissances. L'usage du numérique dans la pédagogie peut les aider si les professeurs sont formés à cela. Mais les enseignants rencontrent une nouvelle difficulté liée aux corrigés des exercices qui figurent sur Internet. Comment utiliser intelligemment Internet ? C'est un défi pédagogique redoutable, ce qui renforce aussi l'idée de formation continue.
L'école pour les moins de 3 ans n'est pas obligatoire. La loi offre cette possibilité dans les zones les moins favorisées, notamment de forte immigration où la langue française est mal maîtrisée. Le taux de scolarisation de ces enfants est très variable d'un département à l'autre. Nous avons constaté ces dernières années qu'il bénéficiait à la fois aux enfants de milieu très défavorisé et à ceux de milieu très favorisé. La difficulté est d'ouvrir des classes là où il y en a besoin et que les familles le demandent. C'est de la responsabilité de tous les acteurs locaux pour faire en sorte que les enfants qui en ont besoin, puissent en bénéficier.
Cela m'amène à la question de l'homogénéité des classes. Il y a deux registres, celui du vivre ensemble et celui des résultats scolaires. Vivre ensemble avec ses différences est une excellente chose. En termes de résultats scolaires, les études montrent que l'hétérogénéité paie. Il me semble normal que les parents veuillent la meilleure école pour leurs enfants. Les parents ne sont pas comptables vis-à-vis de leurs enfants de la moyenne nationale, ils sont comptables du résultat de leur enfant. Sauf que globalement parlant, c'est l'hétérogénéité qui paie. L'entraide entre élèves de niveaux différents est payante à condition, bien sûr, qu'ils soient de niveaux à peu près équivalents, l'hétérogénéité ne devant pas être extrême, et que l'on puisse mettre en place des pédagogies différenciées. La mixité scolaire est indispensable pour améliorer le niveau scolaire général de la France. La question de la carte scolaire est complexe, il y a encore de gros efforts à faire.
Enfin, je ne pense pas que le texte intervienne sur la notion d'école gratuite et obligatoire. Le nombre d'heures d'enseignement ne change pas. Le temps pris en charge par l'éducation nationale est le même (24 heures), il y a seulement une nouvelle répartition des heures. Il y a 3 heures supplémentaires de présence à l'école, facultatives, qui n'ont pas le même statut et qui sont pris en charge par les collectivités locales. Pour nous, l'essentiel c'est la question de l'ingénierie éducative.

Je vous remercie. Cet exercice va nous être très utile en vue de notre rencontre avec le ministre de l'éducation nationale.