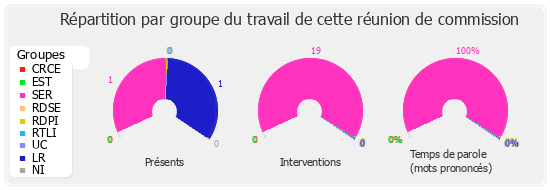Mission d'information sur les pesticides
Réunion du 22 mars 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. guy paillotin secrétaire perpétuel de l'académie d'agriculture (voir le dossier)
- Audition de m. franck wiacek directeur à l'institut du végétal arvalis (voir le dossier)
- Audition de mm. jacques my directeur général et philippe doyen administrateur de l'union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics upj (voir le dossier)
- Audition de m. marc mortureux directeur général de mme pascale robineau directrice des produits réglementés de m. dominique gombert directeur de l'évaluation des risques et de mme alima marie directrice de l'information de la communication et du dialogue avec la société de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail anses (voir le dossier)
- Audition du professeur pierre jouannet membre de l'académie de médecine (voir le dossier)
- Audition du dr. pierre lebailly chercheur à l'université de caen-basse-normandie responsable du programme agriculture et cancer agrican (voir le dossier)
La réunion

Nous allons débuter notre matinée d'audition en entendant M. Guy Paillotin, secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture, qui a présidé le Comité opérationnel sur la réduction de l'usage de pesticides, dans le cadre du Grenelle de l'environnement. La mission sénatoriale d'information étudie les impacts des pesticides sur la santé et l'environnement mais nous avons choisi de nous concentrer d'abord sur la santé des utilisateurs directs des pesticides : les agriculteurs, ou encore les salariés des entreprises qui fabriquent ces produits, qui sont à leur contact direct.
Je me réjouis d'être auditionné par des parlementaires, et souligne que je ne l'ai jamais été que par le Sénat. Je ne possède qu'une compétence plutôt à la périphérie de la question des pesticides. L'Académie d'agriculture a un peu travaillé sur ce sujet. J'ai présidé le comité d'orientation qui préparait le plan Ecophyto 2018, et j'imaginais bien que c'était à ce titre que vous souhaitiez m'entendre. Pourquoi ce plan comporte-t-il si peu de dispositions relatives à la santé des agriculteurs ? Parce que, en France, quand on parle d'environnement, on pense surtout santé. J'ai mis en place et présidé l'agence française chargée de la sécurité sanitaire environnementale. J'aurais voulu qu'elle soit une agence de « santé de l'environnement », mais n'ai pas eu gain de cause, car il était hors de question de faire comme les Américains... Si les aspects de santé sont si peu présents dans le plan, c'est aussi parce qu'ils sont déjà gérés par les directives européennes. Avant même la fin des discussions du Grenelle, une trentaine de substances dangereuses ont été retirées du marché, en urgence si je puis dire, car le ministère de l'agriculture était menacé d'absorption par le ministère de l'environnement : il voulait faire mieux et plus vite que le Grenelle.
Les risques, en outre, ne sont pas suffisamment pris au sérieux. La gestion des risques est répartie entre différents ministères qui ne travaillent pas en harmonie - j'emploie ici un euphémisme. Un seul exemple : en 2003, lorsque nous examinions les conséquences de l'encéphalite spongiforme bovine (ESB), un responsable syndical s'est inquiété des risques encourus par le personnel des abattoirs. Cependant, la direction générale de la santé a considéré que ce n'était pas son problème, tout comme la direction de l'alimentation de l'époque qui a recommandé de s'adresser au ministre du travail.
Le monde agricole n'est pas non plus assez attentif à cette question. Les agriculteurs sont autonomes, libres... et assurés. En Charente-Maritime, mon voisin agriculteur ayant raté son épandage et projeté quantité d'herbicide dans mon jardin, je m'indignai, craignant pour le sort de mes plantes : « ce n'est pas grave, je suis assuré », me répondit-il. L'agriculteur ne se soucie pas des conséquences de l'utilisation des pesticides pour la santé et celui qui en vient à porter plainte est une exception dans une profession où la réaction normale est plutôt d'aller manifester devant les préfectures.

N'y a-t-il pas un manque de formation des agriculteurs ? Qu'en pensez-vous, vous qui siégez au conseil d'administration de l'INAPG (AgroParisTech) ?
Je déplore surtout un manque de formation des futurs hauts fonctionnaires, au regard des responsabilités qu'ils devront assumer.
Vous m'avez interrogé sur la dépendance des rendements agricoles aux produits phytosanitaires. C'est en réalité une dépendance des agriculteurs, je dirais une addiction, dont il faut sortir ! On se prémunit des risques par les produits phytosanitaires, on gagne du temps, les produits sont faciles d'utilisation, si bien que, depuis des décennies, les agriculteurs y font un recours abusif.

Ce sont les industriels eux-mêmes qui assurent les formations et délivrent la certification...
Les industriels ne souhaitent pas seulement écouler leurs produits mais veulent les améliorer, les rendre toujours plus novateurs. Les coopératives leur emboîtent le pas mais elles ont poussé le bouchon un peu loin et le reconnaissent parfois. Leur souci était d'aider leurs membres à obtenir un meilleur revenu agricole.
A présent, il faut parvenir à sortir de la dépendance. L'Europe est la région du monde où l'on utilise le plus gros volume de produits phytosanitaires, beaucoup plus qu'aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, sauf pour le soja. L'Europe est dans le peloton de tête, avec le Japon. La France se situe au milieu du classement européen.
Ce n'est pas si facile. On dispose des chiffres de vente des industriels, fournis par l'Union des industries de protection des plantes (UIPP), mais les produits vendus peuvent circuler, être stockés. On ne peut connaître la consommation par catégorie de cultures car certains produits sont communs à plusieurs voire à toutes.
Le comité d'orientation du plan Ecophyto 2018 a souhaité que l'on tende vers une réduction de la consommation des produits phytosanitaires, à revenu agricole constant - et non à rendement constant - c'est-à-dire sans affecter la compétitivité de notre agriculture. Nos conclusions ont été adoptées à l'unanimité par l'ensemble de nos partenaires : je n'y suis pas pour rien, car j'ai mis l'accent sur le maintien du revenu et des performances. En effet, les agriculteurs qui consomment deux fois moins de produits que les autres peuvent également être les plus performants ! Mais travaillant dans un secteur concurrentiel, ils ne sont pas pressés de faire connaître leurs méthodes... Cela complique les choses.
J'ai plutôt confiance en l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), j'ai vu les équipes travailler, et le site de l'agence comporte beaucoup de données phytosanitaires, ce qui n'est pas le cas du site de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Alors que la culture française est une culture de la précaution, l'Europe privilégie la libre circulation des marchandises et des hommes. Il faut trouver un équilibre. L'ANSES dispose d'une expertise reposant beaucoup sur des vétérinaires, qui ont encore la culture du service public.
Les produits phytosanitaires les plus dangereux sont les insecticides car les insectes sont plus proches des humains que les plantes. Cependant les herbicides deviennent dangereux en raison des quantités utilisées.
Oui, la fraude existe, y compris transfrontalière. Quand des cas d'ESB sont réapparus dans l'Allier, on a invoqué les résidus dans la terre mais c'est la vente en fraude de farines animales, stockées depuis l'interdiction, qui est en cause. Lorsque l'on interdit la fabrication, celle-ci s'arrête instantanément, mais non la distribution qui met deux ans en moyenne pour cesser. Les coopératives ont des stocks, les agriculteurs aussi, et l'on a retrouvé des traces de produits bannis jusqu'à quatre ans après leur interdiction. Les ventes continuent, à bas prix : c'est un vrai problème. La seule solution réside dans la formation des agriculteurs, notamment juridique car lorsqu'ils découvrent les sanctions encourues, ils commencent à réfléchir... Dans certaines écoles, l'enseignement prend désormais en compte ces questions et certaines chambres d'agriculture et coopératives, les plus sérieuses, font leur travail de formation. France Nature Environnement aurait souhaité la création d'un corps de contrôleurs environnementaux. Mais c'est impensable, l'Etat n'a plus d'argent.
Je suis un peu le père de l'agriculture raisonnée et, récemment, j'ai été invité par une fédération de négociants à parler de ce sujet devant 600 négociants, petits ou gros. Le président de cette fédération souhaitait moraliser la profession par une démarche qualité, faisant appel aux bonnes volontés, éliminant les récalcitrants mais cette démarche est difficile.
L'Académie d'agriculture s'est penchée à deux reprises, en novembre 2004 et en juin 2009, sur l'exposition des agriculteurs aux risques liés aux pesticides, mais les conclusions qui en ont été tirées ne sont pas nettes. Quant au cas du chlordécone aux Antilles, le rapport du Pr. Belpomme, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ses conclusions, souligne bien, me semble-t-il, le laxisme administratif. Le mécanisme est le suivant : on prend une décision, puis on accorde des dérogations. L'état des sols, quel que soit le dossier - on peut aussi penser à Fukushima - est rarement pris en considération ; on estime le plus souvent que les résidus ont un impact bénin. Je n'en suis pas si sûr. Il faudrait au moins y regarder de plus près.
Dans les revues agricoles, les articles relatifs à la saine utilisation des produits phytosanitaires se multiplient. L'ANSES a réalisé des études qui font autorité, mais vous vous intéressez sans doute aussi aux effets à long terme et sur ce point, vous ne trouverez guère de données fiables.
Vaste question, bouteille à l'encre...
Les études disponibles font apparaître des départements très touchés par les conséquences des produits phytosanitaires. Mais l'incidence est-elle homogène sur le territoire des ces « départements rouges » ? Quant aux 11 000 morts, sur un total national de 160 000 décès annuels par cancers, il faudrait étudier la population par tranche d'âge, diviser par deux les 11 000 pour distinguer entre hommes et femmes, etc... Pour un statisticien, les chiffres avancés n'ont aucun sens. Ils ne disent rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. M. Belpomme invoque les pesticides comme source des cancers ; le rapport que vous mentionnez estime que 30 % des cancers sont dus à l'alimentation, mais d'où sort ce chiffre ?... Mystère. Sur les résidus, je signale qu'une loi existe ; elle n'est hélas pas respectée.

Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous d'abord nous indiquer en quoi les pesticides concernent l'Union pour la protection des jardins (UPJ) ?
Nous nous intéressons à la partie non agricole de l'emploi de pesticides. Il existe deux types d'utilisateurs, les professionnels qui ont accès à des produits réservés, et les amateurs qui ne disposent pas des mêmes produits.

Vous êtes peu nombreux à pouvoir parler de ce sujet. Nous nous réjouissons de vous entendre.
Nous sommes heureux de cette audition, car un amalgame est trop souvent fait entre utilisations professionnelles et usage amateur des pesticides. Les problématiques sont très différentes. Nous avons rédigé dans le cadre du plan Ecophyto 2018 un kit de base des soins au jardin. Nous avons signé deux accords-cadres, avec les professionnels et les amateurs, pour une utilisation responsable des produits phytosanitaires, destinés à intervenir en dernier recours. Nous avons également rédigé un livre sur les animaux utiles aux jardins, car il existe des lacunes : certains confondent le syrphe, fort utile, et la guêpe, nuisible. Ce kit est diffusé à la demande et à l'occasion des manifestations de la « clinique des plantes ». Notre slogan est simple : « traiter, ce n'est pas automatique, tout commence par un diagnostic ». Parfois, une plante périclite par manque ou excès d'eau : aucun traitement ne résoudra ce problème physiologique.
Nous balayons toutes les causes pour arriver au diagnostic.
Nous ne formulons pas de préconisations, mais présentons les méthodes : lutte biologique, prophylaxie, utilisation de produits de traitement - car face au mildiou, par exemple, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de traiter...
Attention à ne pas parer de toutes les vertus des produits prétendument naturels tels que la bouillie bordelaise, tolérée en agriculture biologique : c'est un produit chimique aussi, or on croit souvent qu'elle n'est pas dangereuse. Nous avons élaboré des fiches conseils sur la chimie des plantes, comportant des pictogrammes simples.
Non, ces pictogrammes ne figurent pas sur les étiquettes car il n'y a pas suffisamment de place : mais on y viendra.
Nous avons créé la plateforme technique pour les collectivités avec la société nationale d'horticulture de France, dans le cadre du plan Ecophyto 2018 concernant les zones non agricoles (ZNA).

Les amateurs ont tendance à utiliser les produits phytosanitaires en surdose. Ceux qui visitent ces sites sont déjà sensibilisés au problème, mais comment toucher les autres ?
Les produits pour les non professionnels - moins dangereux que les produits réservés aux professionnels - sont vendus dans les jardineries, or celles-ci ne font pas l'objet d'un agrément.
Les produits pour le jardin sont vendus à 70% par la distribution spécialisée.

On souligne dans vos brochures la notion « d'abus dangereux », ce qui laisse penser qu'en moindre quantités les produits sont inoffensifs...
Dans les jardineries et les surfaces de bricolage, des vendeurs conseils sont là pour informer les clients sur la dangerosité des produits et leurs conditions d'utilisation.

Peut-être faudrait-il soumettre les grandes surfaces à un agrément pour la vente des produits phytosanitaires, voire interdire la commercialisation de tels produits dans les grandes surfaces alimentaires ?
Nous avions demandé, avant même le Grenelle de l'environnement, que la loi s'applique à tous les types de commerce, prévoyant un conseiller sur le lieu de vente quel qu'il soit. Bien sûr, la fédération du commerce de grande distribution n'y était pas favorable alors que nous estimons fondamental qu'un conseiller puisse expliquer l'utilisation, le dosage, les solutions alternatives...
Pas exactement car le client achètera une binette ou un autre produit. Il serait bon d'avoir des espaces spécialisés, comme les parapharmacies par exemple : cela me choque de voir des produits phytosanitaires dans le même panier que la viande ou le poisson.

En Bretagne, nous avons fait une recherche de pesticides dans une rivière, à l'entrée et à la sortie d'une ville : à la sortie, l'eau était plus polluée que dans le bassin versant supérieur. Les surdoses dans les jardins sont importantes, le conditionnement y est sans doute pour quelque chose : on a acheté un gros sac, autant l'utiliser. Il y a un problème de comportement et de conditionnement.
Un texte limitait la taille des paquets, pour la vente aux amateurs : la Commission européenne ne l'a pas permis, mais nous avons dans notre code de déontologie recommandé aux fabricants de continuer à proposer ces petits conditionnements. Nous suggérons aussi de privilégier les produits prêts à l'emploi, car la phase de préparation provoque une consommation excessive - on emploie tout ce qui a été préparé, d'autant qu'on ne veut pas avoir à y revenir.
Du conseil, du conseil et encore du conseil, dans les grandes surfaces, dans les jardineries.... Nous travaillons à un outil d'aide au diagnostic sur Internet. Un problème peut avoir pour solution, un moindre arrosage, par exemple. Mais pour établir un bon diagnostic, il faut posséder une formation d'agronomie et une spécialisation, on ne s'improvise pas expert.
Non : la clinique des plantes sera à Savigny-le-Temple en fin de semaine prochaine, puis à Saint-Jean de Beauregard. Nous diffusons l'information et les connaissances. Autre projet, le collectif « Pacte jardins 2012 » demande que le jardinage devienne une activité scolaire et que l'on crée un jardin dans chaque école : c'est possible !
Un mot des deux accords-cadres : je faisais partie du « groupe Paillotin » de préparation du plan Ecophyto 2018, et comme j'ai fait remarquer que le groupe ne s'intéressait qu'aux agriculteurs et négligeait riverains et jardiniers amateurs, un sous-groupe de travail consacré aux ZNA a alors été créé. Il est à l'origine de l'axe 7 du plan Ecophyto, concrétisé dans l'arrêté de juin 2011 : l'utilisation de certains produits dans les lieux fréquentés par du public, notamment par des personnes vulnérables, est interdite. La France a ainsi été le premier Etat membre à suivre les préconisations de l'Union européenne en inscrivant des dispositions réglementaires dans le code rural et de la pêche maritime. Il y a aussi des obligations d'information du public.
Je l'espère ! Je n'ai pas signalé le répertoire des produits professionnels utilisables en ZNA, ni le guide méthodologique pour l'entretien des jardins. La mention EAJ, « Emploi autorisé dans les jardins », est une garantie de risques moindres. Nous sommes fiers du travail accompli sur le risque opérateur, l'évaluation des produits se limite généralement à l'exposition des manipulateurs et de ceux qui les regardent. Rien sur les jardins ! Nous avons fait des analyses sur les vêtements et sous-vêtements d'utilisateurs occasionnels de produits phytosanitaires, pour connaître le taux de pénétration. Précisons que l'amateur ne porte pas, lui, d'équipements de protection. De même, les utilisateurs professionnels en ville n'emploient pas le même matériel que les agriculteurs. L'exposition n'est donc pas identique. Les surfaces traitées sont petites ; le coefficient de transfert est proche de 100 % lorsque les produits sont appliqués à des plantes situées sur un trottoir. C'est ce qui explique les niveaux de pollution relevés dans votre ville bretonne. Jusqu'à présent, les collectivités locales ont eu accès aux produits professionnels alors que leurs agents n'étaient pas formés, puisqu'aucun agrément n'était nécessaire. Depuis cette année, ils doivent obtenir le certifphyto spécial ZNA professionnels.
Des centres de formation agréés.
Oui, et obligatoire : peut-être les politiques ont-ils là quelque chose à améliorer. Cette formation est une véritable poule aux oeufs d'or pour certains centres, car il y a 12 000 jardineries en France, les agriculteurs, les autres professionnels,...

Mais cela procure de l'emploi et sans doute certains centres font-ils bien leur travail ?
Informer les clients, dans les commerces, n'est pas inintéressant : les achats d'équipements, d'outils, augmentent. Les produits phytosanitaires peuvent aussi être vendus dans des paquets comprenant des gants ou un masque...

Les industriels communiquent sur les équipements, sur le dosage ; mais quid des solutions alternatives ?
Certaines jardineries ne vendent que des produits « alternatifs ». Nous avons suggéré un label « produit naturel », mais le ministère de la consommation nous a fait remarquer que les produits phytosanitaires étaient « 100% naturels » uniquement s'ils étaient exempts de conservateurs, si leur production ne faisait intervenir que des éléments naturels, bref, tout cela est un peu compliqué. Les amateurs et les professionnels se fient en réalité à la mention UAB, « Utilisable dans l'agriculture biologique ».
L'eau de cuisson des pommes de terre est un bon herbicide par brûlage, l'amidon de maïs chaud donne aussi de bons résultats, mais les risques pour l'opérateur qui utilisent des produits à plus de 90 degrés ne sont pas nuls. Je suis nuancé sur les brûleurs thermiques et je ne juge pas satisfaisante l'utilisation de bonbonnes de gaz... Je préfère la binette. L'acide pélargonique est un herbicide de contact, l'acide acétique également ; le bacillus subtilis est une bactérie utilisée en traitement préventif avec de bons résultats. Les alternatives se développent.
Il y a aussi tout le travail sur les plantes résistantes.
Quand ils ont les solutions, ils valorisent l'offre correspondante.
Le choix des plantes doit prendre en compte le climat et le sol.

Ne cherchons pas à faire pousser un bougainvillier en région parisienne.
On m'a déjà interrogé sur la façon de traiter des oliviers mal en point... dans un jardin de Lille, ce qui est curieux.
Je souligne que l'agriculture répond à un impératif économique. Les méthodes alternatives sont plus faciles à diffuser dans les jardins. Notre travail trouve ainsi tout son sens.

Il faut éduquer nos concitoyens au fait qu'un jardin n'est pas une moquette.
Oui, si l'on veut des papillons il faut laisser pousser les fleurs et ne pas tondre l'herbe à ras.
Audition de M. Marc Mortureux directeur général de Mme Pascale Robineau directrice des produits réglementés de M. Dominique Gombert directeur de l'évaluation des risques et de Mme Alima Marie directrice de l'information de la communication et du dialogue avec la société de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail anses
Audition de M. Marc Mortureux directeur général de Mme Pascale Robineau directrice des produits réglementés de M. Dominique Gombert directeur de l'évaluation des risques et de Mme Alima Marie directrice de l'information de la communication et du dialogue avec la société de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail anses

Nous accueillons maintenant les représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour évoquer les questions d'évaluation des risques liés aux pesticides.
Issue de la fusion de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), l'ANSES intervient dans des domaines très larges au sein desquels, non seulement elle préserve l'expertise scientifique des deux anciennes agences, mais elle développe aussi de nouvelles actions.
Nous sommes particulièrement attentifs à la prévention des conflits d'intérêts, question qui a donné lieu à la rédaction d'un code de déontologie et au renforcement de l'ensemble des règles. Nous sommes également attentifs à une plus grande ouverture à la société par un dialogue avec les parties prenantes en amont et en aval des expertises, ou au développement d'approches transversales consistant par exemple à considérer l'homme dans l'ensemble des modes d'exposition aux risques que sont le travail, l'alimentation ou l'environnement général, le lien ainsi établi entre alimentation et santé constituant un modèle innovant par rapport à ce qui existe à l'étranger.
Dans la mesure où l'on constate que tout est dans tout, cette organisation nous donne la possibilité de développer des approches nouvelles et de faire bouger les lignes, comme à propos du bisphénol A. En matière de pesticides, il y a une réelle valeur ajoutée au fait d'assurer à la fois l'évaluation des produits phytosanitaires avant leur mise sur le marché, mission autrefois dévolue à l'AFSSA et l'observation des risques de pesticides pour la santé au travail qui relevait de l'AFSSET.

Comment les informations de l'Observatoire des résidus de pesticides (ORP) sont-elles recueillies ?
La création de l'ORP répondait à l'objectif de parvenir à rassembler des données éparses recueillies notamment dans le cadre des plans de contrôle et de surveillance par les différents ministères, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, et de la consommation, l'une des difficultés tenant à la tendance de ces derniers à s'estimer propriétaires des ces informations. Aux données des plans de contrôle et de surveillance s'ajoutent celles issues de bases spécifiques sur l'eau, sur l'air ambiant ou sur des sujets encore peu documentés comme les environnements intérieurs ou les sols.
Ce travail de collation des données de différentes sources est appelé à se poursuivre, le projet initial de création d'un système d'information intégré n'étant plus véritablement d'actualité.
L'objectif n'est pas de permettre une évaluation des risques exhaustive, mais de fournir une information au public, notamment depuis le plan Ecophyto 2018, au travers de la production d'indicateurs relatifs aux usages des produits, à leur impact ou aux pressions sur les milieux. Notons d'ailleurs que les travaux du groupe de travail pluraliste en charge de ce plan auprès du ministère de l'agriculture ont permis de réaliser nombre d'études spécifiques venant compléter les informations existantes.
Quant aux expositions professionnelles, s'il est prévu qu'elles soient intégrées dans l'ORP, elles donnent aujourd'hui lieu à peu de données.
Nous disposons tout d'abord des données génériques sur les populations agricoles et sommes engagés dans un travail qui devrait durer au moins jusqu'en 2014, de segmentation de celles-ci en fonction des types d'usages.
C'est dans le cadre d'une auto-saisine que nous travaillons ce sujet essentiel grâce à une équipe composée de façon très ouverte, notamment de nombreux experts.
Différentes approches pourront être retenues, dont certaines expérimentations consistant par exemple à équiper les personnes concernées de capteurs, l'une des difficultés étant toutefois de documenter les événements passés, causes éventuelles des pathologies d'aujourd'hui.
Je rappelle qu'au départ, l'ORP s'intéressait à la population en général...
Un élément objectif est que, depuis une vingtaine d'années, le ménage a été fait pour les substances actives autorisées : les deux tiers d'entre elles ont été interdites.

Mais cela ne veut pas dire que vingt ans après elles n'aient pas de conséquences.
Bien sûr. Précisons toutefois que la sévérité des critères d'autorisation de certaines substances continue d'augmenter, un règlement communautaire en préparation visant, par exemple, les perturbateurs endocriniens, tandis qu'en parallèle le processus de révision des autorisations de mise sur le marché se poursuit.
Il convient de bien distinguer l'évaluation des substances effectuée au niveau communautaire et celle des produits réalisée par les autorités nationales pour certaines zones géographiques. Concernant la seconde, si les informations sont fournies par les industriels, ceux-ci ne disposent, notamment du fait des lignes directrices édictées par l'OCDE, d'aucune marge de manoeuvre quant à la façon de produire ces données. De plus, les laboratoires qui en ont en la charge, qu'ils soient ou non internes aux entreprises, sont régulièrement inspectés par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
Lorsque le rapport d'étude complet issu de ces laboratoires nous est adressé, notre premier travail consiste à y rechercher l'existence d'éventuelles anomalies.
Tout à fait. Ensuite, nous procédons à notre propre interprétation de ces données avant de transmettre les résultats de ces travaux à notre pôle « produits » en charge de l'évaluation finale.

Dans les scandales sur des médicaments, ce genre de procédures existait aussi et pourtant...
Certes, l'on peut toujours se retrouver accusé, mais les procédures applicables en matières phytosanitaires sont très structurées et apportent beaucoup de garanties. Dans le cadre du règlement REACH, la charge de la preuve de l'innocuité d'une substance a été inversée et pèse donc sur l'industriel. Quant à nous, nous procédons à nos propres expertises.
D'une façon générale, la création de l'agence s'est accompagnée d'un réel transfert de moyens.
Pour l'évaluation de certains effets sur l'eau, un an d'études a été nécessaire.

Comment expliquer que certains produits tels que le Lasso étaient encore autorisés en France alors qu'ils étaient interdits ailleurs ?
Depuis 1993, une vaste opération scientifique a été engagée en Europe, visant à réévaluer les produits mis sur le marché et, dans le cas du Lasso, nous avons eu à examiner 400 ou 500 préparations différentes, ce qui est extrêmement long.

Cela signifie qu'une substance commercialisée aujourd'hui sera ensuite soumise à un réexamen pouvant aboutir à sa sortie du marché ?

Existe-t-il des liens entre les travaux menés dans les différents pays ?
Alors qu'auparavant, le même travail d'étude était accompli dans chacun des Etats membres, il est aujourd'hui réparti entre eux selon un découpage en zones géographiques. Les prescriptions faites par un Etat membre à propos d'un produit sont transmises aux autres, qui formulent leurs observations dans le but d'aboutir à une évaluation commune acceptée par tous.
Nous sommes très attentifs à ce qui se passe ailleurs, étant pour notre part considérés par nos partenaires comme particulièrement rigoureux, nos exigences en matière d'application des modèles étant, par exemple, sensiblement plus élevées que celles de la Belgique ou de l'Allemagne. Au sein de la zone sud, cette réputation conduit d'ailleurs un certain nombre d'entreprises à demander à être évaluées par nous, ce qui, compte tenu de notre niveau d'exigence, constitue pour eux une garantie d'acceptation de leurs produits dans les autres pays.

Peut-on considérer qu'un produit mis sur le marché aujourd'hui ne sera dangereux ni pour l'agriculteur qui l'utilise, ni pour le riverain qui le respire, ni pour le consommateur qui l'ingère ?
La réponse à cette question est compliquée.
L'évaluation a priori est fondée sur la notion de risque, lui-même défini comme l'exposition à un danger. Cela signifie qu'un produit dangereux peut tout à fait présenter un niveau de risque acceptable dans la mesure où le niveau d'exposition de celui-ci est suffisamment faible.
Le danger ayant été analysé, au niveau communautaire, à l'occasion de l'autorisation d'une substance active, c'est ensuite au moment de l'évaluation du produit que l'on estime le niveau d'exposition sur la base de différents modèles, discutés dans un cadre européen et dont les paramètres évoluent en permanence.

Comment se passe le suivi des risques ? Au vu des incidents qui remontent à vous, que pouvez-vous dire de l'effet de tel ou tel type de produit sur tel type de production agricole en particulier ?
Les données de suivi des produits sur le marché ne nous parviennent pas spontanément, nous allons les chercher.
Afin de rendre, notamment dans le cadre de la réforme du système de pharmacovigilance, cette remontée de données plus fiable est plus rapide, nous menons beaucoup de discussions avec leurs émetteurs que sont principalement la Mutualité sociale agricole (MSA) et l'Institut de veille sanitaire (INVS), ce dernier disposant des informations des centres anti-poisons, qui subissent au demeurant les difficultés budgétaires rencontrées par les hôpitaux.
Nous avons plutôt accès à des données déjà agrégées.

Le fait que tout ne remonte pas jusqu'à vous signifie-t-il que vos évaluations reposent sur des données très partielles ?
Il est vrai que le système actuel ne nous garantit pas la transmission d'informations dans la bonne forme et dans les bons délais, notamment du fait des tensions sur le budget des différents organismes.

Travaillez-vous en lien avec le conseil général de l'agriculture et de la pêche qui vient de publier un rapport sur le suivi des produits après leur autorisation de mise sur le marché ?
Bien sûr. Si l'évaluation des produits avant leur mise sur le marché répond à une procédure bien établie, des progrès doivent encore être accomplis concernant les produits déjà commercialisés, notamment par la clarification du rôle de chacun, ma recommandation étant de confier l'ensemble de cette mission à notre agence.
En terme de fiabilité des données, il faut distinguer le cas des professionnels, exposés à un danger spécifique bien identifié, de celui de la population en général, pour lesquels les occasions de risques sont beaucoup plus nombreuses et donc plus difficiles à déterminer.

Ce qui est vrai pour les agriculteurs l'est aussi, par définition, pour la population générale.

Les risques peuvent se diffuser sur de grandes aires géographiques. Certains produits utilisés pour des cultures fruitières dans la vallée du Rhône se retrouvent ainsi à 30 ou 40 kilomètres.
Cela peut même aller plus loin.
En effet, le devenir de la substance dans l'environnement est une donnée très fortement prise en compte dans les dossiers qui nous sont soumis.

Qu'en est-il du cas de la viticulture pour laquelle on sait bien qu'un certain nombre de risques existent ?
Les données liées aux produits agricoles concernent des expositions aiguës et ne prennent pas en compte les utilisations tout au long de la vie. A partir des données épidémiologiques, il est aujourd'hui difficile d'établir un lien de causalité entre l'utilisation d'une substance et l'existence d'une pathologie, d'autant plus que les pesticides appartiennent à une gamme de produits très large.
Le risque aigu, suivi par le réseau « Phytoveille », est en effet plus facile à caractériser que le risque lié à une utilisation classique auquel s'intéresse le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P).

Dans la viticulture, nombre de personnes utilisent des produits pendant des années avant que l'on puisse établir quoi que ce soit.
La prise en considération d'un certain nombre de risques a tout de même permis l'élimination de certaines substances.

Le problème, c'est que les agriculteurs n'ont rien dit pendant des années. Il existait une espèce d'omerta qui s'est traduite par une absence de remontées d'information et qui rend très difficile d'apporter la preuve d'un lien de causalité.
C'est la raison pour laquelle nous nous saisissons de ce sujet. C'est précisément là où les données ne remontent pas spontanément que nous sommes le plus utile.

Quelle est votre perception de l'étude du RNV3P qui attribue aux pesticides une responsabilité éminente dans les cancers des agriculteurs ?
Globalement, le nombre de cas de pathologies touchant les agriculteurs est très réduit...
Sur 120 000 cas qui nous sont remontés, certes de façon un peu aléatoire, 50 000 présentaient des pathologies pour lesquelles les médecins avaient confirmé l'origine professionnelle, dont 578 agriculteurs, soit 1,2% de l'ensemble. 70 d'entre eux présentaient des tumeurs dont 45 pouvaient être attribuées à des pesticides. La difficulté dans l'établissement du lien de causalité des cancers tient à la reconstitution des pratiques professionnelles qui étaient celles de ces personnes il y a plus de 20 ans.

Si certaines substances ont été retirées du marché, c'est bien parce qu'elles étaient considérées comme dangereuses, ce qui accrédite tout de mémé l'idée que leur utilisation a pu favoriser les maladies, surtout à une époque où les équipements de protection étaient bien moins utilisés qu'aujourd'hui.
Si notre travail porte - chacun dans son rôle - sur la partie scientifique, il est bien évident que nous n'attendons pas de disposer de preuves absolues pour commencer à agir. Au vu des données dont nous disposons, nous nous efforçons de faire une application intelligente du principe de précaution. Beaucoup de choses ont déjà été réalisées, notre rôle est de documenter les faits afin de fournir des éléments d'appréciation aux décideurs.
Nous retrouvons cette problématique à propos de l'exposition au bitume dans la mesure où il est particulièrement difficile de reconstituer le bitume d'il y a 20 ans, très différent de celui d'aujourd'hui.
Les choses doivent aussi évoluer à propos des équipements individuels mais la classification européenne en la matière étant difficilement applicable aux équipements agricoles, il n'est pas encore possible de demander à l'industriel qui dépose un dossier de présenter les résultats de tests réalisés avec des équipements précisément identifiés.

Face aux industriels, estimez-vous que la puissance publique dispose, à travers votre agence, de suffisamment de moyens ?
Je puis vous assurer que nous n'avons jamais sacrifié la qualité de notre travail au respect des délais auxquels nous étions soumis, étant parfois allés jusqu'à les dépasser d'un an.
Le fait que nous ne soyons pas chargés de prendre les décisions exclut toute pression, bien que parfois nous souhaiterions refaire certaines études, ce à quoi nous renonçons au regard des moyens financiers considérables que cela exigerait et dont nous ne disposons pas. Pour le reste, il est malheureusement toujours possible de passer à côté d'un problème particulier.

Vos évaluations prennent-elles en compte des critères de rentabilité économique des produits ?
Pascale Robineau. - Non, pas du tout, bien que nous examinions quelle est l'efficacité des produits.
Notre modèle qui repose sur un financement public nous dote d'un outil appréciable par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, même si, bien entendu, nous sommes soumis aux contraintes budgétaires.

Je vous précise que nos travaux sont centrés sur la situation des utilisateurs de pesticides.
Mes compétences professionnelles ne portant que sur les questions de fertilité, j'ai rédigé au sein de l'académie de médecine, avec M. Henri Rochefort, un rapport sur les risques de cancers liés aux perturbateurs endocriniens qui ne concernait donc pas exclusivement les pesticides, mais qui les abordait au travers des cas de cancers hormono-dépendants.
Ces sujets sont particulièrement complexes et je me réjouis du grand nombre d'études et de travaux actuellement réalisés sur ces thèmes, car dans les années 1990, c'est sans grand succès que j'avais tenté de sensibiliser les pouvoirs publics au fait que la baisse de qualité des spermatozoïdes que nous observions à Paris pouvait être due à des facteurs environnementaux, et notamment à la présence de produits chimiques. A l'époque, avec des médecins et des chercheurs, nous avions essayé, sans succès, de sensibiliser le monde politique et les pouvoirs publics. Depuis vingt ans, les travaux scientifiques ont eu un plus grand retentissement médiatique et l'état d'esprit sur ces sujets a bien évolué, même si c'est un domaine où il demeure difficile d'avoir des certitudes.
Oui. On peut tout d'abord se fonder sur des enquêtes épidémiologiques, dés lors quelles sont bien menées, même si la difficulté principale dans l'établissement d'un lien de causalité entre cancers et pesticides réside dans l'existence de nombreux facteurs qui interagissent et peuvent avoir des effets synergiques ou antagonistes. Des associations entre situations n'impliquent pas des liens de causalité. Il est aussi possible de partir d'études faites sur d'autres espèces que l'espèce humaine, des informations assez précises existant en matière de reproduction. Enfin, la toxicologie expérimentale est susceptible de fournir des résultats.
Les perturbateurs endocriniens peuvent être responsables du développement de tumeurs, d'une part en tant que promoteurs directs, stimulant la croissance de cellules déjà transformées, d'autre part, en tant qu'initiateur de la cancérogénèse cellulaire sur le tissu-cible, introduisant des modifications génétiques ou produisant des effets épigénétiques. Les perturbateurs endocriniens peuvent enfin agir de façon indirecte, non pas sur les cellules cancéreuses elles-mêmes mais sur les enzymes régissant le métabolisme hormonal, ou, par exemple, via une substance modifiant l'âge de la puberté chez la femme, ce dernier étant lié à l'importance du risque de cancer du sein.
Chez l'homme, on peut penser que les substances qui inhibent la descente des testicules et provoquent donc la cryptorchidie ne sont pas sans lien avec les cancers de cette partie du corps. On constate au demeurant une augmentation de l'incidence en France des cancers testiculaires. Une étude danoise a récemment mis en évidence le rôle de facteurs environnementaux dans la perturbation de la différenciation des cellules germinales, durant la vie intra-utérine. Des cellules cancéreuses, qui peuvent rester dormantes, se constituent alors, et peuvent entraîner des cancers, des années plus tard. Ces mêmes facteurs peuvent provoquer une recrudescence de cryptorchidie ou d'hypospadias. Il faut donc s'intéresser aux perturbateurs endocriniens qui agissent sur le développement du foetus, car ceux-ci peuvent avoir des effets à long terme. Enfin, on peut observer des effets transgénérationels des perturbateurs endocriniens.

Les agriculteurs vous paraissent-ils soumis à des dangers particuliers ?
Une étude publiée en 2008 par Melissa Perry, chercheuse à Harvard, à partir d'une vingtaine de travaux, fait apparaitre que 13 d'entre eux tendent à établir un lien entre une activité professionnelle comportant des contacts avec des pesticides et une altération de la qualité des spermatozoïdes. D'autres études se sont intéressées aux modifications de la composition chromosomique des spermatozoïdes. Ces études ne concluent pas à un danger très clair dus aux pesticides, mais ce danger est suffisant pour justifier la poursuite de recherches.
Si les recherches en cours ne donnent rien de très significatif, notons toutefois une autre étude nord-américaine réalisée dans quatre villes, faisant ressortir que la qualité des spermatozoïdes la plus faible est observée dans la seule ville de Columbia (Missouri) située dans une région agricole, ces conclusions étant corroborées par une analyse des résidus de pesticides dans les urines. C'est un signe d'alerte, même si cela ne constitue pas une preuve définitive.
Ce serait de pouvoir déterminer le mécanisme par lequel cette causalité s'établit.
Bien sûr. Quant aux travaux sur l'homme, une équipe de Nice à mis en évidence le lien entre cryptorchidie et présence de certaines substances dans le lait maternel, une autre étude établissant un lien entre la composition de l'urine de la mère et la taille de la tête de l'enfant.
Concernant plus précisément la relation entre cancer et pesticides, les seuls éléments clairs portent sur l'effet de la chloredécone sur le cancer de la prostate en Guadeloupe, sachant que d'autres facteurs interviennent tels que les antécédents familiaux ou encore le fait d'avoir habité un certain temps en métropole.
Les perturbateurs endocriniens pourraient aussi favoriser les troubles du métabolisme comme l'obésité ou le diabète ainsi que des troubles neurologiques ; une étude américaine mettant en relation l'agressivité d'enfants de 8 ans et la présence de pesticides chez la mère. J'ai aussi été marqué par une étude chinoise sur les placentas des mères d'enfants nés avec des problèmes neurologiques. Mais à chaque fois, se pose la question de l'existence d'autres facteurs.
Des travaux menés sur les rats font apparaître que deux faibles doses de certaines substances peuvent avoir un effet comparable à celui d'une dose excessive de l'un des deux produits, mettant ainsi en évidence l'existence d'effets « cocktail ».
Je ne puis en revanche pas répondre sur l'existence de liens indiscutables entre maladies et pesticides.
Quant au classement en maladie professionnelle, sa modification me semble difficile dés lors que l'on n'a pas découvert d'argument décisif établissant un lien de causalité, sachant qu'il convient toutefois de distinguer les expositions toxiques à de fortes doses de produits des expositions classiques à des doses plus faibles.
Compte tenu de mon domaine de compétences, j'ai peu de choses à vous dire sur les règles de mise sur le marché si ce n'est que le principe de l'inversion de la charge de la preuve posé par le règlement européen REACH est une bonne chose, bien que les tests servant de base aux évaluations soient discutées et que ces règles ne s'appliquent qu'à des substances produites au-delà d'un certain tonnage.
La question des doses demeure fondamentale, car celles-ci font varier de façon très importante l'effet d'une substance.
J'ignorais que les substances étaient réévaluées tous les dix ans mais il me semble qu'en principe, elles devraient l'être chaque fois que nécessaire.

Que pensez-vous du fait que les études avant mise sur le marché soient réalisées par les industriels ?
Il faut faire confiance aux industriels, ne pas les diaboliser, tout en contrôlant leur travail et leurs données. Je propose même que chercheurs académiques et chercheurs industriels travaillent davantage en commun, comme, par exemple, pour la recherche d'une matière de substitution au bisphénol A.
L'Académie de médecine a fait des recommandations : informer le public sans l'angoisser, étiqueter clairement et lisiblement les produits, cibler les populations à risque : agriculteurs, personnel de santé, etc. Tout cela relève des agences comme l'ANSES et des ministères. Le travail d'information se développe dans d'autres pays. Prenons exemple sur nos voisins. Un site Internet du ministère de la Santé pourrait fournir des informations utiles et complètes, alors que les informations sur Internet sont généralement parcellaires ou non objectives.
Le principe de précaution - je préfère parler de prévention - passe, selon moi, par trois actions : surveillance, alerte et recherche. Il y a des choses à faire ; et tout n'est pas qu'une question de moyens. Une des raisons de nos lacunes réside dans un financement mal organisé, voire désordonné, avec une multiplicité d'appels d'offre et un montant moyen de contrat faible. Les chercheurs perdent trop de temps à rédiger des dossiers de financement. Les instances qui procèdent aux appels d'offre devraient mieux se coordonner.
Elle est intéressante.

Elle a été très critiquée : non prise en compte de certaines catégories, les salariés agricoles par exemple, périmètre d'investigation limité à certains départements... En dépit de cela, l'étude conclut que les agriculteurs sont en meilleure santé que le reste de la population.
Augmenter la taille ou le nombre de cohortes coûte très cher : lorsque l'on dispose d'une bonne cohorte, il n'est pas nécessaire de l'agrandir, il faut plutôt en profiter pour mener des études complémentaires. Les omissions que vous signalez m'étonnent. Je ne connais pas le détail de cette question. En revanche, réaliser l'étude sur quelques départements seulement n'est pas un handicap, dès lors que les zones sélectionnées sont représentatives.
Si la cohorte est de 180 000 personnes, des observations menées sur 90 000 d'entre elles, à condition bien sûr que les biomarqueurs soient bons, ont toute la pertinence requise.

Mais la communication porte sur les chiffres agrégés de toute la cohorte, non sur les seuls agriculteurs exposés aux pesticides.
Je ne connais pas le sujet précisément. Mais toute publication donne lieu à des réactions émotionnelles.

Dans ma région viticole, on parle beaucoup des cancers induits par l'utilisation des produits phytosanitaires.
Le cancer de la prostate est celui pour lequel les données sont les plus nombreuses et feraient apparaître un lien avec l'emploi des pesticides. Des études américaines semblent aller dans le même sens. Mais les agriculteurs ne meurent pas tous d'un cancer de la prostate ! Et l'incidence est considérée comme significative lorsqu'elle fait passer un facteur de 1 à 15. Messieurs, agriculteurs ou non, nous avons tous une probabilité sérieuse de mourir d'un cancer de la prostate.

Professeur, je vous remercie des explications que vous nous avez apportées.

Notre mission d'information a pour objet les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé des utilisateurs, depuis les fabricants jusqu'aux agriculteurs et jardiniers professionnels ou amateurs. Votre institut a sans doute un avis éclairé sur la question et sur la pertinence du plan Ecophyto.
Arvalis est un institut de recherche appliquée en agriculture, financé majoritairement par les agriculteurs français. Le champ de ses recherches s'est élargi depuis 1959 par des regroupements d'instituts : il travaille aujourd'hui sur diverses grandes cultures comme le maïs, les herbes, les fourrages, la pomme de terre, les protéines végétales et, depuis octobre dernier, le lin, mais pas le colza, le tournesol, le soja ou la betterave. L'objectif d'Arvalis est d'apporter des solutions aux producteurs afin qu'ils puissent vivre de leur activité en produisant plus et mieux.
Depuis l'origine, nous sommes chargés d'évaluer les innovations techniques mises à disposition des producteurs : l'efficacité des molécules mais aussi, depuis 1994, leur incidence sur l'environnement. Nous étudions également, depuis 1997, les pollutions ponctuelles, lors de la manipulation du produit, et les pollutions diffuses, en plein champ.
Un peu plus de la moitié provient des agriculteurs, environ 30 % de l'autofinancement, et 20 % de projets de recherche français ou européens.

Êtes-vous considérés comme ayant une légitimité dans le domaine des pesticides ?
Nous sommes agronomes, pas médecins. Arvalis emploie près de 400 personnes, dont 160 dans les services de recherche-développement et autant pour le transfert des connaissances sur le terrain que j'anime. Nos 26 sites expérimentaux et de recherche sont répartis dans la plupart des grandes régions agricoles.
Bien volontiers.
Au-delà de l'évaluation, nous développons aussi des outils d'aide à la décision, pour que les agriculteurs sachent quand et en quelle quantité employer des pesticides pour se prémunir contre des parasites, au champ ou lors du stockage. Je vous parlerai plus d'environnement que de santé même si l'on touche aussi à la protection de l'utilisateur.

Je vous demanderai cependant de concentrer vos propos sur la santé des agriculteurs, qui est l'objet de la première partie de nos travaux, et sur la manière de réduire la consommation de pesticides pour se conformer au plan Ecophyto.
Dans les bassins que nous avons étudiés, nous avons constaté que la contamination de l'environnement, et de l'eau en particulier, était due aux pollutions ponctuelles plutôt que diffuses, notamment hors utilisation aux champs, c'est-à-dire dès les cours de ferme. Nous avons transféré notre expertise à nos collègues allemands. Or, grâce à des méthodes simples, on peut réduire ces pollutions ponctuelles de 60 ou 80 %.
En France aussi : je vous laisserai un document qui rapporte les résultats spectaculaires auxquels nous sommes parvenus sur les eaux de surface d'un bassin versant dans l'Aisne.
Déjà du produit présent sur l'opercule qui ferme le bidon, par exemple : s'il est jeté sur le sol d'une cour damée et s'il pleut, le produit s'infiltre dans les nappes phréatiques. Et il y a souvent des puits dans les cours de ferme.
Lorsque les produits pénètrent dans le sol de 50 cm par an, la pollution peut mettre 16 ans pour atteindre une nappe située à 8 ou 9 mètres de profondeur... Il en sera de même pour l'effet de l'action ayant mis fin à la pollution en surface.

Pour informer les producteurs, passez-vous par les chambres d'agriculture ?
Oui, entre autres. Dans une aire de remplissage non étanche, un pulvérisateur qui déborde provoque de graves pollutions. Les agriculteurs ont du mal à s'en rendre compte, ils ont l'impression qu'une petite fuite ne porte pas à conséquence. Cependant, si la norme de potabilité est de 0,1 mg par litre, un gramme de produit peut polluer un ru de un mètre sur un mètre sur dix kilomètres.

Ces produits sont dangereux, surtout si ceux qui les utilisent ne sont pas informés et formés ! Pourquoi ne l'ont-ils pas été plus tôt ?
Nos diagnostics sont à la disposition de tous depuis douze ans. Mais nous ne sommes que 160 personnes sur le terrain. Nous tâchons de diffuser l'information grâce aux conseillers des chambres d'agriculture, des coopératives et du négoce.
Notre rôle est de mettre le fruit de nos recherches à disposition des professionnels, encore faut-il qu'ils en tirent parti. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre de tous les agriculteurs. Les divers organismes devraient éviter de recommencer les études que nous avons déjà menées, et qui ont été validées par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) et divers centres universitaires. Lorsque tout le monde s'engage et coopère, on arrive vite à des résultats !

Peut-être les chambres d'agriculture veulent-elles récupérer de l'argent en dupliquant vos études...
Je ne sais pas, mais je souhaite en tout cas que notre expertise soit valorisée. Peut-être y a-t-il moins de concurrence ailleurs en Europe...
Nous proposons un outil nommé Aquasite destiné à diagnostiquer et à réduire les risques liés aux produits phytosanitaires chez l'exploitant, depuis le transport des produits en passant par le local de stockage, la protection de l'utilisateur, le poste de remplissage, l'équipement du pulvérisateur, la vidange du fond de cuve jusqu'à la gestion des déchets. Rien de tout cela ne nécessite des investissements très lourds.
Je ne connais pas les chiffres, car nous ne travaillons pas directement avec les producteurs. J'ai pourtant l'impression qu'il reste beaucoup d'efforts à faire.
Oui. Nous avons conclu avec le ministère de l'éducation un contrat de partenariat pour former les enseignants gratuitement ; toutes les nouvelles fermes des lycées agricoles sont aux normes. Nous formons aussi de futurs agriculteurs et conseillers, y compris étrangers, Tchèques, Portugais, Belges, Espagnols. En France, lorsqu'une région décide de prendre les choses en main, les résultats sont là : le cas de la Bretagne est exemplaire en formation contre les pollutions dans les cours de ferme.
En Bretagne, les exploitants paient environ 300 euros. Mais certaines entreprises et coopératives intègrent le diagnostic dans leur parcours de conseil. Les choses progressent.
Toutes les générations ne sont pas aussi sensibles au problème, mais on convainc même les anciens. Dans l'Aisne, deux agriculteurs sur trente-deux avaient d'abord refusé d'appliquer nos méthodes, puis ils s'y sont ralliés.
Nous mesurons aussi les pollutions diffuses, aux champs, sur plusieurs sites, à La Jaillière en Loire-Atlantique, au Magneraud en Charente-Maritime, à Lyon, etc., en coopération avec l'INRA, le Cemagref, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) et diverses universités. Les résultats varient beaucoup selon le sol et le climat. Certaines molécules se dégradent en surface, nous insistons donc pour agir en priorité sur celles que l'on retrouve dans le sous-sol.

Revenons à la santé des utilisateurs. Que faites-vous dans le domaine de la prévention ?
Pour la protection des utilisateurs, lors des diagnostics, nous rappelons la réglementation et proposons des équipements de protection, d'abord pour protéger les mains et les avant-bras mais aussi des cottes, des masques... Rappelons que 50 à 60 % des cas de contamination sont dus à l'exposition des mains et des avant-bras.

Ne suggère-t-on pas aux producteurs de réduire leur consommation de pesticides et de produire autrement ?
Grâce aux outils d'aide à la décision mis en place depuis une quinzaine d'années, nous leur apprenons à optimiser leur consommation. Prenez l'exemple de la lutte contre le mildiou, cette maladie dévastatrice : certaines années, quand le climat est favorable, il est possible de réduire de moitié l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. La nouveauté est qu'aujourd'hui, on peut aussi les utiliser à plus faible dose (- 30 à 40% !) en les couplant à de nouvelles substances comme les stimulateurs de défenses naturelles. Lors du stockage, pour éviter par exemple que les pommes de terre ne germent, on teste des huiles de menthe antigerminatives, substances naturelles pour lesquelles des tests sont en cours. Sachons aussi tirer parti des progrès génétiques pour renforcer la résistance des plantes.
Par une sélection classique. Pour réduire la consommation de produits phytosanitaires, il faut aussi diffuser les outils d'aide à la décision, améliorer l'efficacité de la pulvérisation et jouer des divers leviers agronomiques, comme la rotation des cultures. En ce qui concerne le travail du sol, gardons-nous de tout dogmatisme : dans les régions sèches, le labour et le binage peuvent être très efficaces contre les mauvaises herbes - nos ancêtres le faisaient - mais il est difficile d'être efficace dans les zones humides. Les techniques alternatives ne sont pas possibles partout.
Voilà pourquoi nous sommes en train d'éditer plusieurs brochures - pour l'Ouest, le Nord, le Centre, le Sud et l'Est - où nous donnons 44 solutions simples par régions à l'aide de fiches pour limiter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Dans l'Ouest, les conseillers se mobilisent, ce qui permet d'atteindre plus de 50 000 paysans.

N'est-il pas paradoxal que vous ne parveniez pas à informer tous les agriculteurs alors que ce sont eux qui vous financent ?
Une trentaine de producteurs siègent à notre conseil d'administration mais nous ne pouvons pas aller dans chaque ferme. Nous transmettons nos solutions à des organismes qui font du conseil le quotidien. Les conseillers doivent comprendre que nous sommes là pour les aider, pas pour leur faire concurrence.
Audition du dr. pierre lebailly chercheur à l'université de caen-basse-normandie responsable du programme agriculture et cancer agrican
Audition du dr. pierre lebailly chercheur à l'université de caen-basse-normandie responsable du programme agriculture et cancer agrican

La mission d'information étudie l'impact des pesticides sur la santé des utilisateurs, nous avons été très attentifs aux premières conclusions de l'étude Agrican, qui porte sur une cohorte exceptionnellement nombreuse d'agriculteurs. Ces travaux ont tôt fait de susciter la polémique. Qu'en est-il des critiques qui vous sont adressées ?
Je suis directeur-adjoint d'une unité mixte de recherche de l'Inserm et de l'Université de Caen consacrée à la prévention des cancers, et je m'occupe plus particulièrement des facteurs des risques professionnels et environnementaux, dans le milieu agricole mais aussi chez les personnes exposées à l'amiante à partir notamment des registres des cancers.
En 1991, lorsque nous avons entamé nos travaux, des études épidémiologiques avaient déjà été publiées à l'étranger mais presque aucune en France. Les agronomes n'envisageaient guère que l'on se passe de pesticides, presque toutes les organisations professionnelles agricoles opposaient une fin de non-recevoir à nos propositions d'étudier ce milieu, et les pouvoirs publics s'étonnaient de notre intérêt pour cette question. Cette année-là a été publiée la directive 91/414/CE régissant l'homologation des pesticides au niveau européen, et l'on commençait à parler de réévaluer les anciennes molécules. Or nous n'étions pas même en mesure de savoir quels pesticides étaient utilisés en France, pas davantage en Basse-Normandie : l'Union des industries de protection des plantes (UIPP) ne nous a pas donné l'accès à leurs données hormis les tonnages.
L'UIPP, qui en disposait grâce aux premiers panels, refusait de nous financer ou de nous communiquer ses données. Nous n'avons pu commencer à travailler que grâce aux associations caritatives (Ligue contre le cancer, ARC), car il n'y avait ni appel d'offres en épidémiologie, ni registre, ni institut ou agence de veille sanitaire.
Sur les liens entre pesticides et cancers, les premières études écologiques, au sens de ce terme en épidémiologie - c'est-à-dire des cartographies de pathologies - étaient parues aux États-Unis d'Amérique à la fin des années 1960 ; elles mettaient en évidence une sous-mortalité globale des agriculteurs, à ne pas confondre avec les ouvriers agricoles - cette sous mortalité est donc connue depuis le début - mais une surmortalité liée à certains cancers dans le Midwest agricole, à l'époque où la consommation de pesticides explosait. Se mettaient alors en place quelques études sur des cas-témoins en France, fondées sur la comparaison de groupes de personnes atteintes d'une pathologie avec la population générale, mais on se heurtait à la faiblesse des effectifs des agriculteurs atteints de pathologies peu fréquentes. C'est pourquoi a été constituée aux Etats-Unis (Iowa et Caroline du Nord) entre 1993 et 1996 la première grande cohorte de 50 000 agriculteurs, 30 000 conjoints et 5 000 applicateurs professionnels de pesticides (titulaires d'un certificat renouvelable tous les trois ans), qui a fourni, à ce jour, les données à la base de 165 publications.
L'État fédéral et lui seul, les chercheurs pouvant compter sur un financement constant dix années durant, au lieu d'un ou deux ans en France. Avec nos faibles moyens, nous avons constitué en 1995 dans le Calvados une première cohorte de 6 000 agriculteurs, qui ne permettait pas d'étudier les cancers rares.
Parce que c'est là que nous travaillions, et parce que nous voulions nous fonder sur des biomarqueurs de génotoxicité et pas seulement sur des questionnaires comme aux Etats-Unis : il valait donc mieux être à proximité. Le panel était représentatif, car en Basse-Normandie comme dans l'ensemble de la France la moitié des exploitations pratiquent la polyculture et l'élevage.
En 1995, à Bordeaux, Isabelle Baldi commençait à constituer plusieurs cohortes pour étudier des pathologies neurodégénératives comme la maladie de Parkison et ses liens avec les pesticides (cohorte Paquid), la maladie d'Alzheimer et l'évolution des fonctions cognitives chez les ouvriers agricoles (cohorte Phytoner). Mais ni elle, ni moi n'étions capables de mesurer l'exposition aux pesticides. On admettait en général que l'exposition dépendait de la surface agricole traitée, mais la littérature agronomique soutenait le contraire. Nous avons donc constitué en 2000 un atelier sur la mesure de l'exposition. Parallèlement, un modèle de prédiction de l'exposition était créé dans le cadre de la procédure d'homologation au niveau européen. Les Français étaient alors les premiers utilisateurs de pesticides en Europe, les deuxièmes dans le monde, mais jamais il n'y avait eu d'études sur les conditions d'exposition, hormis celles de l'industrie, avant ou après homologation. Des études de terrain n'étaient exigées des industriels que dans le cas où les tests échouaient avec une tenue de protection complète, un habit de cosmonaute que jamais aucun agriculteur ne pourra porter. L'UIPP - qui finance mon laboratoire à hauteur de 45 000 euros par an - tentait par tous les moyens de nous dissuader d'entreprendre des études de terrain, arguant que les modèles de prévision de l'exposition étaient très conservateurs, basés sur des données des années 1980 qui surestimaient les expositions. Le recours à cet argument suffisait à obtenir l'homologation.
Au même moment, la cohorte américaine commençait à se fonder non plus seulement sur la surface traitée, mais sur d'autres critères comme le type d'équipements. Des études cas-témoin de plus grande taille étaient menées en France sur les tumeurs du système nerveux central, le cancer de la thyroïde ou du sein, le cancer broncho-pulmonaire, ou encore sur les lymphes, qui mettaient en évidence un lien avec le milieu agricole, sans préciser les pesticides ou les productions en cause. C'est en 2006 que nous avons pu proposer une étude plus ample, le programme Agrican.

S'agit-il d'une étude sur la santé des agriculteurs en général ou sur les effets de l'utilisation de pesticides ?
Sur les liens entre agriculture et cancer : il ne s'agit pas seulement des pesticides. La cohorte américaine, elle, est focalisée sur les pesticides : là-bas tout le monde en emploie...

Ne faudrait-il pas étudier spécifiquement le cas des utilisateurs de pesticides ?
Pour mesurer la relation dose-effet, il est bon de comparer les personnes exposées à celles qui ne le sont pas.

Votre cohorte comprend-elle des travailleurs saisonniers, des aides familiaux ?
Tous ceux qui ont cotisé au moins trois ans, saisonniers ou non, ont reçu le questionnaire.

Pourquoi cette durée ? En deçà de cette durée n'est-ce pas une exposition chronique ?
Si nous n'avions fixé aucun critère, nous aurions affaire à 850 000 personnes au lieu de 560 000... Le budget n'a été bouclé que l'an dernier ; heureusement, on fait crédit aux centres de recherche contre le cancer... A l'initiative du National Cancer Institute (NCI), un consortium international nommé Agricoh (Agricultural Consortium of Agricultural Cohort Studies) a été constitué, regroupant 24 cohortes dans 11 pays : les chercheurs américains, en butte aux attaques des industriels, cherchaient à conforter leurs propres résultats en les confrontant à ceux d'études étrangères. En 2011 ont été publiées les premières données et émises les premières critiques. Le consortium associe des pays en voie de développement, où les problèmes de santé ne sont pas les mêmes : Costa Rica, Afrique du Sud, Ethiopie bientôt... Quant aux Norvégiens, ils exploitent une pseudo cohorte en croisant les données du recensement agricole avec leur registre national d'incidences, celui sur l'état de santé général de la population, etc.
Oui, parce que cela permet d'obtenir l'information souhaitée très vite et pour un coût moindre.
Il faudrait constituer un registre national des cancers. Les détenteurs actuels de registres y sont curieusement hostiles... On dit que cela coûterait un euro par habitant et par an, un chiffre qu'on extrapole à partir du coût des registres départementaux.
L'essentiel est de connaître la catégorie professionnelle et la région où vivent les malades, afin d'identifier les problèmes. A l'heure actuelle, on ne connaît même pas le nombre annuel de nouveaux cancers en France : 360 000 n'est qu'une estimation fondée sur les données des départements dotés d'un registre alors que les létalités constatées ne sont sans doute pas représentatives de la France entière. Un registre national servirait non seulement à la recherche, mais à la prise en charge des patients ! Les pays scandinaves possèdent des registres nationaux des maladies cardio-vasculaires, des malformations congénitales, des cancers, et en créent un autre sur la maladie de Parkinson. En France, les données sur la maladie de Parkison se limitent à deux départements (cohorte Paquid).

On craint toujours que de tels fichiers ne soient utilisés à mauvais escient.
La Suède est à certains égards un pays plus démocratique, où l'on pratique la transparence, et ce genre de fichiers ne pose aucun problème. On utilise même couramment le numéro unique d'identification. Les Scandinaves et les Américains sont goguenards lorsque nous leur parlons de nos difficultés pour recueillir des données.
Le corps médical. Des sociologues ont montré que les médecins considéraient leurs patients comme leur propriété... En 1995, le médecin-chef du travail s'était opposé à ce que nous constituions une cohorte dans le Calvados ; heureusement, les chefs d'exploitation ne relevaient pas de lui.
Toutefois, la situation est en train d'évoluer : il y a désormais une veille sanitaire en France, et les appels à projets sont plus nombreux en épidémiologie. Reste que nous nous privons d'outils efficaces, et que nous ne formons pas assez d'épidémiologistes, déjà faute d'enseignants.
Je vais à présent tâcher de répondre aux questions que vous m'avez adressées par écrit. L'objectif d'Agrican est évidemment de déterminer les causes de cancer, pesticides ou autres. Au sein de la cohorte, seuls 48 % des hommes déclarent utiliser des pesticides, mais ce ne sont pas les seuls exposés, bien au contraire : celui qui taille la vigne est davantage exposé sur l'année que celui qui y applique un produit. Nous nous sommes donc gardés de ne retenir que des utilisateurs, contrairement à ce qui a été fait dans la cohorte américaine. En viticulture, en arboriculture, dans les cultures maraîchères - comprenant des expositions indirectes lors des phases de réentrées - il faut compter avec de fortes expositions indirectes, notamment chez les femmes. Ce problème était totalement méconnu jusque récemment, malgré une étude hollandaise sur la pomiculture de la fin des années 1990 montrant que les cueilleurs étaient davantage exposés que les applicateurs : on s'étonnait de nos relevés métrologiques sur des non-utilisateurs alors même que ceux-ci ne portaient aucune protection et ne se lavaient pas les mains... Dans une exploitation agricole, il y a beaucoup de main-d'oeuvre, mais seulement deux ou trois personnes sont utilisatrices de pesticides ; la quasi-totalité des exploitations ont recours à ces produits, mais notre cohorte est représentative de la population agricole, pas des exploitations.
Ils sont déjà nombreux dans notre cohorte de 100 000 hommes. Pour l'instant, nous avons comparé celle-ci avec la population générale, mais nous allons aussi réaliser des analyses internes, calculer des gradients pour apprécier les effets de l'utilisation des pesticides dans tel ou tel secteur.

Les industriels nous opposent que, d'après vos données, les agriculteurs souffrent moins du cancer que les autres... Peut-on vraiment tirer cette conclusion ?
Un fumeur sur deux meurt de son tabagisme, or les agriculteurs fument quatre à cinq fois moins que la population générale. Leur habitude de vie les met en meilleur état de santé, on le sait. Je suis pour ma part presque convaincu que les pesticides ont un effet cancérogène, mais si l'on peut supposer qu'ils doublent le risque de leucémie, fumer un paquet de cigarettes par jour décuple le risque de cancer broncho-pulmonaire, un cancer beaucoup plus fréquent.

Il faudrait donc, si j'ai bien compris, distinguer à l'intérieur de la cohorte entre les utilisateurs, les exposés et les modes d'exposition.
Certains ont conclu que les 52% de personnes ayant répondu au questionnaire en précisant qu'ils n'étaient pas utilisateurs de pesticides étaient des agriculteurs biologiques, comme si le questionnaire visait des exploitations agricoles et non des personnes. Vous m'avez demandé si les douze départements retenus pour établir la cohorte étaient représentatifs : par chance, oui, d'après les données du recensement agricole sur l'orientation technico-économique des fermes, et malgré une légère sous-représentation de l'arboriculture et une légère surreprésentation de la viticulture.
Non : rappelez-vous que nous n'avons constitué la cohorte qu'en 2006, en quémandant des fonds ! Les premiers résultats, parus fin 2011, concernent la mortalité, d'après le fichier national des causes de décès.

On dit que le lien entre mortalité et morbidité n'est pas toujours évident à établir.
Pour les cancers très létaux comme le broncho-pulmonaire, les données de mortalité sont correctes, c'est moins vrai du cancer de la prostate ou du sein. Nous pouvons ainsi disposer d'une image de l'état de santé de la population agricole, mais pour les analyses internes, nous nous servirons des données d'incidence : le croisement avec les registres de cancer, qui est un travail de longues haleine, est en cours, avec le même algorithme pour les douze registres, ce qui évitera toute distorsion.
La cohorte comprend bien les travailleurs saisonniers ayant cotisé au moins trois ans à la MSA. Pourtant, en viticulture, certains reviennent chaque année dans la même ferme et sont très exposés aux pesticides. Ils sont, en partie, dans AGRICAN mais la MSA ne les suit pas.

Le temps qu'ils prennent rendez-vous avec le médecin du travail, la saison est terminée...
C'est pourquoi l'approche gagnerait à être collective plutôt qu'individuelle. Les médecins du travail devraient se rendre sur le terrain pour inspecter les postes de travail plutôt que de multiplier les consultations individuelles : certains le disent. Il leur faudrait alors des moyens de fonctionnement, et notamment des outils de métrologie. Il serait bon que la MSA adhère à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), car elle ne dispose pas de ses propres laboratoires. De son côté, l'INRS n'a pas de mandat pour s'intéresser au monde agricole.
L'UIPP nous finance, minoritairement. Nous n'en aurions pas besoin si nous pouvions user aussi librement des fonds de l'État ou des agences ! Avec l'UIPP, nous sommes liés par une convention triennale qui n'oblige qu'à un rapport oral annuel. En revanche, l'ANSES qui nous avait accordé un budget en novembre, a exigé un rapport en décembre ! Deux ans après la constitution de la cohorte, elle s'étonnait que nous n'ayons encore effectué aucune publication. Or le suivi durera au moins quinze ans ! Aux Etats-Unis, il a fallu huit ans avant que puissent être publiées les premières études ; pour nous, les trois premières publications sont attendues cette année. En fait, on nous demande au moins trois rapports scientifiques et des rapports financiers pour une subvention sur deux ans !
Sans doute, mais les chercheurs américains ont une visibilité sur dix ans. A part les investissements d'avenir, aucun appel d'offre français ne va au-delà de trois ans.
Nous sommes capables de mesurer l'effet des pesticides sur l'entourage des agriculteurs, car beaucoup de conjoints cotisaient sans exercer de tâche agricole directe. Quant aux riverains, la cohorte comprend 5 à 10 % d'affiliés du régime agricole qui n'ont jamais travaillé dans une exploitation agricole mais vivent dans le milieu rural, comme les salariés de Groupama, du Crédit agricole, de la MSA, des chambres d'agriculture, du machinisme agricole. Mais l'objet principal est d'identifier les facteurs de risque professionnels et non les risques environnementaux.
Quant à votre question sur les études de référence, la référence, aujourd'hui, c'est la cohorte américaine avec une limite provenant des familles chimiques étudiées puisque, en grande culture, pratiquement aucun fongicide n'est utilisé aux États-Unis alors que la France en utilise beaucoup.
Pour en revenir à l'étude de mortalité par cancer au sein de la cohorte Agrican entre 2006 et 2009, celle-ci a surtout mis en évidence un déficit de cancers du larynx, de la trachée, des bronches, du poumon. Pour d'autres cancers, on ne dispose que de tendances. Nous allons bientôt consolider les chiffres en incluant l'année 2010.

Est-il probable que les différences ne soient pas très significatives ?
Absolument, sauf si des tendances s'affirment. On peut confronter ces données avec celles de l'Agricultural Health Study. L'étude américaine porte sur une cohorte moins nombreuse, composée uniquement d'actifs, entre 1993 et 2007. Pour notre part, nous pourrons comparer l'état de santé de générations différentes, différemment exposées aux pesticides. Dans l'ensemble, nos résultats se rejoignent.
J'ai dressé le bilan de la littérature américaine. Malgré une sous-mortalité liée au cancer de la prostate aux Etats-Unis, on constate une surincidence de ce cancer dans la population agricole étudiée.
Les utilisatrices de pesticides, peu nombreuses, y sont exposées. Donc il y a très peu de cas.

N'est-il pas curieux que les agriculteurs soient moins sujets aux mélanomes ?
C'est ainsi pour l'agriculteur américain. Une cohorte prospective a ses limites.
On est supposé se comporter avec un équipement de protection individuelle comme si on n'en portait pas. De fait, ce n'est pas le cas et on omet de prendre les mêmes précautions. Par ailleurs, la plupart des combinaisons mises sur le marché sont perméables. Il y a encore deux ans, elles n'avaient d'ailleurs jamais été testées pour leur perméabilité à un nuage de pulvérisation. Suite à une alerte d'un agronome de l'équipe d'Isabelle Baldi, il y a eu une étude de l'ANSES à ce sujet. On s'est aperçu, grâce une étude de terrain (Pestexpo) avec l'Institut technique de la vigne, qu'on était davantage contaminé avec une combinaison que sans lors de l'utilisation d'un pulvérisateur à dos.
Le port de combinaison est impossible à supporter en milieu agricole pour l'application des pesticides. Certains ont proposé des tabliers en ciré pour l'étape de la préparation.
Même sans aucune protection, il est possible de ne pas être contaminé. Mieux vaut utiliser correctement les produits. Voilà la prévention. L'équipement de protection ne doit intervenir qu'en dernier ressort.
Ce n'est pas possible. Certes, les équipements représentent un gros marché. Jusqu'à un passé récent, le Cemagref ne se préoccupait pas de l'adéquation entre les nouveaux pulvérisateurs et le risque chimique. Les vendeurs ne savaient pas comment fonctionnaient ces engins et les agriculteurs n'avaient jamais été formés à les utiliser.
Il n'y a pas de travaux pratiques prévus avec Certiphyto.
Quant aux études, où sont-elles ? Sortons du discours. Il n'a jamais été démontré qu'une action de prévention avait l'effet escompté. Nous devrions, comme les Anglo-saxons, faire des essais ramdomisés : l'exposition est très facile à constater, comme nous l'avons fait en utilisant un colorant bleu à l'occasion d'une mise en situation pour former des médecins du travail. J'aimerais d'ailleurs proposer cette expérimentation à un étudiant dans le cadre de Certiphyto.
Certiphyto ne va pas résoudre tous les problèmes. Il ne prévoit rien pour les exposés indirects et ne comporte pas de mise en situation. Par ailleurs, on ne vérifie pas l'effet des préconisations. Peut-être y gagnera-t-on du point de vue environnemental, mais sans réduire les expositions.
Pour revenir à la cohorte américaine, un mot de la liste des 50 pesticides pris en considération dans cette cohorte. La liste des fongicides est très courte. Mais tous les pesticides figurant sur la liste se retrouvent en France, et étudier ceux qui ont été interdits, comme le DDT, inciterait à éviter les erreurs. Nous disposons de 27 publications et l'on repère bien, par exemple, une liaison significative entre le diazinon et le cancer du poumon, même en tenant compte du tabagisme, et, avec la leucémie, on appréhende également la relation dose-effet. Mais il a aussi été constaté un effet protecteur des pesticides faces au cancer du pancréas ou du côlon.
Cependant, une étude, même très bien faite, ne vaut pas un faisceau d'arguments. Pour certains pesticides, on ne trouve aucune relation.

Vos travaux enrichissent-ils l'étude américaine en incorporant les fongicides ?
Oui, ainsi que sur des herbicides, car les Etats-Unis ne pratiquent pas le désherbage d'hiver. Je vous fais d'ailleurs observer que l'atrazine n'est pas interdit aux États-Unis ; du point de vue cancérologique, c'est une aberration de l'avoir interdit. C'est, le seul pesticide retiré du marché qui a été déclassé de 2 B à 3 par le Centre international d'études sur le cancer (CIRC).
Qu'il s'agisse de l'effet dose ou de l'ajustement à la consommation de tabac, il est difficile de faire beaucoup mieux que l'étude AHS. Il n'en reste pas moins à tirer parti de ses résultats que l'industrie s'ingénie à réfuter.
Au total, nous incluons désormais un million de personnes dans l'ensemble des cohortes du consortium Agricoh, dont 500 000 pour la cohorte norvégienne, 100 000 pour la cohorte américaine, et 180 000 pour nous - c'est toujours en construction.
Après la mortalité, nous allons étudier l'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas. J'espère inclure les nouveaux cas avant l'été afin de mettre au jour d'ici le début de l'année prochaine les facteurs de cancers broncho-pulmonaires. Pour certains cancers, les certificats de décès ne permettent pas de connaître avec précision la cause du décès. Pour les cancers broncho-pulmonaires, alors que l'arsenic était classé depuis toujours en niveau 1 et que les dérivés d'arsenic ont été, au bout de cinquante ans, interdits pour les agriculteurs, on trouve toujours ces produits dans les jardineries (produits anti-fourmis). On sait pourtant qu'ils sont cancérogènes et qu'il y a des alternatives. À noter qu'il existe des chaînes de production en Chine où les salariés manipulent de l'arsenic. De plus, le produit ne reste pas dans la boîte.
Dans votre questionnaire, vous m'avez interrogé sur l'utilité du programme Matphyto. Ce programme reproduit un travail que nous avons mis en place : une matrice sur les pesticides, spécifique au milieu agricole (Pestimat). Comment mesurer l'intensité de l'exposition ? Pour identifier les plus gros utilisateurs, il faut déjà savoir qui utilise, ou a utilisé, quoi. Contrairement aux Américains, nous considérons que si l'agriculteur connaît son histoire de culture, en revanche, il ne peut dire de façon fiable les produits qu'il a utilisés. Au demeurant, le ministère de l'agriculture n'est pas plus capable de donner les dates d'autorisation et de retrait de chaque molécule. Voilà pourquoi nous reconstruisons l'histoire des molécules depuis 1950 à partir de l'histoire des cultures et des renseignements communiqués, mais à titre confidentiel, par l'industrie. Ce serait intéressant d'étendre cela aux autres professions qui utilisent des pesticides : les menuisiers, les charpentiers et les paysagistes.

Vous n'auriez alors plus besoin de quémander une partie de votre budget auprès de l'UIPP ?
450 000 euros depuis dix ans...
Mais je ne veux pas conclure sans mentionner l'espérance de vie des agriculteurs. Pour les hommes, à 35 ans, elle s'établit à 43,5 ans contre 41 ans pour le reste de la population et cela, alors qu'ils sont plutôt en surpoids et consomment plus d'alcool que la population générale. Cela a été constaté depuis longtemps et étonne en général puisque les agriculteurs sont en contact avec les pesticides mais les facteurs environnementaux jouent un rôle majeur dans ce phénomène. En revanche les données manquent pour les ouvriers agricoles, qui se situeraient en deçà, sans doute dans le bas de la strate des ouvriers avec, à 35 ans, une espérance de vie de 39 ans, soit la plus faible.
De tout cela, je voudrais retirer quelques suggestions. D'abord, il est indispensable de connaître l'exposition professionnelle aux pesticides en agriculture. En 2010, on vient de rater - encore ! - le recensement agricole décennal, qui aurait offert une belle occasion d'en savoir plus, à la fois sur l'utilisation des pesticides en agriculture et sur le matériel de traitement. Mais à condition que le questionnaire comporte des questions sur ces thèmes.
Comment alors disposer de données indépendantes de l'industrie, comme en possèdent beaucoup de pays de l'OCDE ? Si l'on établissait des échantillons représentatifs de la population agricole et que l'on assurait des suivis ciblés, on n'aurait pas besoin d'attendre plusieurs décennies le renouvellement des matériels et l'on pourrait déterminer des marqueurs d'exposition dans l'industrie et décider certaines interdictions.
Une expertise collective est en cours à l'INSERM sur santé et pesticides, à laquelle je participe. L'étude de certains pesticides apparaît prioritaire.
C'est possible. Il serait intéressant d'imposer aux industriels de suivre les personnels de leurs chaînes de production avec des marqueurs à court terme pour suivre particulièrement les gens exposés, de même dans des fermes pilotes.
Absolument pas. Les agriculteurs tiennent théoriquement des registres, qui ne servent pas surveiller leur santé. Actuellement, ces registres peuvent éventuellement servir a posteriori pour demander une réparation. En attendant, rien n'est organisé pour recueillir ces informations alors qu'il serait facile de regarder ce qui se passe secteur par secteur.
De plus, il n'existe aucun contrôle de la tenue de ces registres.
À noter que la confrontation entre les différentes formes d'agriculture n'a pas de sens en termes de santé : l'agriculture bio utilise des pesticides d'origine naturelle et ses pratiques ne sont pas toujours respectueuses de l'environnement. On aurait pourtant intérêt à éviter les pesticides dans certains secteurs en revenant aux fondamentaux de l'agronomie, ce qui est possible pour les céréales et à production équivalente.
S'agissant des équipements de protection, soyons réalistes et ne renouvelons pas les erreurs commises pour l'arsenic et pour l'amiante : il n'y a pas d'équipement magique et il n'y aura jamais d'exposition zéro aux pesticides !
Tout à fait. L'argument de l'exposition zéro ne vaut que lorsque l'effet cancérogène n'est pas avéré. Sinon, il faut être complètement imperméable à cette argumentation - ce qui n'a été le cas ni pour l'arsenic ni pour l'amiante.
Matphyto pourrait servir à développer des matrices d'exposition professionnelle pour des métiers non agricoles. Il faudrait éliminer du marché des aberrations telles que les produits anti-fourmis pour la maison, mais aussi le lindane présent dans les anti-poux, qui sont associés à des cancers chez l'enfant.
Enfin, j'aimerais convaincre l'Observatoire des résidus de pesticides et L'ANSES d'effectuer des études d'exposition représentatives des foyers français. Le problème ne provient certainement pas de la consommation d'eau, mais, pour évaluer l'alimentation, on ne se donne pas les moyens de mener des études fondées sur la vraie dose de pesticides à estimer, grâce à des repas dupliqués, ou encore d'autres études sur les usages domestiques de pesticides.
Vous l'avez compris, je me suis investi dans cette cohorte parce que je pense que c'est efficace.
Pour terminer, je voudrais réagir au récent rapport de l'Opecst sur « Pesticides et santé ». Il faut nourrir le monde, assure-t-il. Sans doute. Pourtant, le tiers de la nourriture achetée par une famille moyenne allemande chaque semaine va à la poubelle : devons-nous tous imiter ce modèle ? L'obésité ne devait pas traverser l'Atlantique et nous serons bientôt à 15 % voire 20 % d'obèses en France. Est-ce le modèle que nous voulons exporter ? Nous mangeons trop de viande, facteur démontré de cancer colorectal, et produisons trop de denrées végétales pour nourrir le bétail. Mangeons moins, mais mieux.