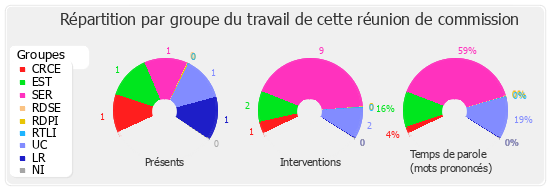Mission d'information sur les pesticides
Réunion du 18 juillet 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. pierre pernot airparif (voir le dossier)
- Audition de m. sébastien picardat fédération du négoce agricole (voir le dossier)
- Audition de mme nathalie gouérec coordonnatrice du centre d'étude pour une agriculture durable plus autonome cédapa et de m. frédéric darley (voir le dossier)
- Audition de mm. jean-luc bindel fnaf-cgt et roger perret iresa (voir le dossier)
La réunion

Merci de venir devant cette mission, créée à l'initiative de notre rapporteur, Mme Nicole Bonnefoy, sénateur, élue de la Charente, qui a été sensibilisée aux effets des pesticides sur la santé par l'affaire Paul François. Nous aimerions en savoir davantage sur la mesure des résidus de pesticides dans l'air en milieu urbain, qui est du ressort d'Airparif.
Je vous remercie de me recevoir. Airparif, créée en 1979, est une association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Elle accomplit cette mission à la demande du ministère de l'environnement dans toute l'Ile-de-France. Comme toutes les AASQA, elle met en oeuvre des outils de caractérisation de l'air : des observations, des campagnes de mesures, un réseau de stations permanentes et des outils de modélisation. Dotée d'un statut d'association de la loi de 1901, elle diffuse les bulletins quotidiens sur la qualité de l'air en région parisienne et, lorsque certains seuils sont dépassés...
En liaison avec la préfecture de police. Si besoin est, cette dernière peut décider des actions de réduction de vitesse des véhicules ou de diminution des activités industrielles.
Les polluants réglementés sont définis par des arrêtés ministériels et des directives européennes. Les pesticides dans l'air ambiant n'appartiennent pas à cette catégorie.
Bonne question ! Les polluants réglementés regroupent des polluants dont la valeur limite dans l'air est fixée par des directives européennes pour protéger la santé des personnes. En cas de dépassement, l'État membre risque un contentieux avec l'Union européenne. Il s'agit, entre autres, des particules en suspension et, bientôt, du dioxyde d'azote.
Certains polluants non réglementés sont également mentionnés dans les directives qui, sans fixer d'obligation de valeur cible, recommandent le suivi de leur concentration dans l'air. C'est le cas du mercure, de quelques hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les pesticides ne relèvent ni de la première catégorie ni de la seconde.
Je ne suis pas un spécialiste de la santé. En tout état de cause, il est difficile de quantifier l'impact des pesticides par la voie aérienne sur la population générale. Nous n'avons pas de valeur toxique de référence et, donc, de seuil réglementaire.
Cela dit, suivre les concentrations des pesticides dans l'air mettrait en lumière la variation des pratiques. Du fait du plan Ecophyto 2018 ou encore de la révision de la réglementation européenne, des produits phytosanitaires sont interdits, remplacés ; les tonnages évoluent. Comment ces changements se traduisent-ils dans l'air ? Voici la question.

Suivre les concentrations de pesticides dans l'air pourrait être une recommandation de notre mission. Nécessite-t-elle une modification de la réglementation française ou européenne ?
Actuellement, ni l'une ni l'autre ne prévoit ce suivi.

Pour avoir présidé l'Observatoire régional de l'air en Midi-Pyrénées (Oramip), l'AASQA de ma région, je connais le fonctionnement de ces associations. Elles vivent des subsides de l'État et, surtout, des industriels locaux, ceux qui polluent. Vous auriez besoin d'une commande pour effectuer ce suivi et disposer des moyens correspondants.
Au sein des conseils d'administration des AASQA siègent effectivement l'État, les collectivités territoriales et les industriels régionaux, qui sont nos financeurs, aux côtés d'un collège composé des associations de défense de l'environnement et de personnalités qualifiées.
Pour le moment, la volonté de travailler sur les pesticides est plutôt locale : ce sont les régions, les départements et les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) qui financent ponctuellement ces études. L'hétérogénéité est très forte : l'AASQA de la région Centre réalise, chaque année depuis 2001, des mesures sur les pesticides ; d'autres régions n'y parviennent pas, faute de financements.
Comment, au-delà de l'homogénéisation technique, qui concerne les experts, généraliser le suivi des pesticides dans l'air sur tout le territoire ? Les AASQA possèdent déjà le savoir-faire métrologique : depuis le début des années 2000, elles ont effectué plus de 2 300 prélèvements sur les pesticides et établi plus de 100 000 résultats. En revanche, l'évaluation de l'impact sur la santé est un autre métier, elle n'est pas de notre ressort.

Les pesticides dans l'air font-ils partie de l'étude longitudinale française depuis l'enfance (ELFE) ?
A ma connaissance, ce n'est pas son objectif. En plus, son volet air, qui concerne les AASQA, a posé certaines difficultés. Il est au point mort.

Les études quantitatives des AASQA sur la présence de pesticides dans l'air ont-elles servi de support à une analyse sanitaire par d'autres structures ?
Oui, il y a eu des études dans les régions Centre, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon. A chaque fois, on s'y heurte à l'absence de valeur toxique de référence pour interpréter les données d'un point de vue sanitaire.
Difficiles, non, car nous avons développé le savoir-faire technique. En revanche, l'exploitation d'un site de mesure des pesticides dans l'air coûte environ 25 000 euros par an, à quoi il faut ajouter les analyses chimiques, qui sont extrêmement coûteuses.
L'ozone, le dioxyde d'azote ou les particules en suspension font l'objet de mesures en temps réel. Pour les pesticides, nous recherchons des niveaux de concentration très faibles, des traces qui se mesurent au nanogramme par m3. Cela nécessite de faire passer dans un piège des volumes d'air très importants, de l'ordre de 168 m3, et de manière correcte. L'opération peut prendre une semaine en centre-ville. Les filtres sont envoyés en laboratoire où ils sont analysés selon des procédures assez complexes en chimie analytique comme la chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. On utilise des méthodes de prélèvement plus courtes, d'une demi-heure, pour les mesures à la limite des parcelles lors des traitements.
Outre le coût des installations et des analyses chimiques, il faudrait également inclure celui des techniciens... Bref, ces analyses sont onéreuses.
Quels sont leurs résultats ? Les concentrations hebdomadaires sont de l'ordre de plusieurs centaines de nanogrammes par m3 lors des traitements et en zone de culture. On trouve des traces de pesticides partout, en Beauce comme en plein Paris. Les pesticides qu'utilisent les particuliers et les services municipaux pour l'ornement se retrouvent plus facilement en ville, ceux pour les cultures en zone agricole. C'est logique... Les concentrations varient également selon les périodes : elles sont plus fortes au printemps.
Oui, les évolutions d'usage sont très fortes. Pour m'en tenir à quelques cas, aujourd'hui dans l'air il n'y a plus de trace d'atrazine, un produit interdit, alors qu'on en trouvait encore dans les eaux au milieu des années 2000. Tout au long des années 2000, l'air contenait de la trifluraline en quantité, plusieurs centaines de ng/m3, y compris en hiver. Elle a été interdite en 2008 et on n'en trouve plus les traces dans l'air en 2011. En revanche, les concentrations de chlorothalonil, un fongicide utilisé dans les grandes cultures et l'ornement, ne cessent de progresser.
Il faudrait approfondir les enquêtes d'usage pour se prononcer.
Autre exemple, le lindane, interdit en 1998 en tant que pesticide, se trouvait encore dans l'air dans les années 2000 à des concentrations assez faibles mais à des fréquences plutôt élevées. Parce qu'il appartient aux pesticides organochlorés, il a mis plus de temps à décroître.
On en relève encore des résidus dans d'autres régions que Paris, mais de moins en moins. Sa persistance s'explique sans doute par des effets de volatilisation à partir du sol, qui sert de réservoir, ainsi que par l'utilisation du produit comme biocide, autorisée jusqu'en 2006.

Les niveaux de concentration de pesticides dans l'air sont-ils plus élevés aux abords des usines de fabrication de produits phytosanitaires ?
A ma connaissance, aucune mesure n'a été réalisée. On ne s'attend pas à trouver des niveaux de concentration plus importants puisque ces produits sont, théoriquement, fabriqués dans des laboratoires confinés. Des prélèvements ont été faits à Béziers lors du démantèlement d'une usine qui avait brûlé. Les résultats étaient proches en termes de taux de concentration des résultats habituels au printemps. En tout état de cause, on se situait en-dessous des taux de concentration constatés en limite de parcelle après traitement.
L'application des pesticides passe souvent par le vecteur aérien, quel que soit l'épandage. D'après l'INRA, 25 % à 75 % des pesticides appliqués se retrouvent dans l'atmosphère.
Concernant l'épandage aérien, l'Oramip a réalisé des mesures dans le cadre de la lutte contre la pyrale du maïs et l'InVS a interprété les résultats obtenus. L'épandage aérien n'entraînerait pas de concentrations significativement plus fortes que l'épandage par tracteur. Ces conclusions sont à prendre avec précaution : on recherchait des substances actives, les solvants associés aux substances ont pu fausser les résultats.
Une étude est en cours en Aquitaine, pilotée par la cellule interrégionale d'épidémiologie en liaison avec l'université de Bordeaux, pour étudier les effets aigus de l'épandage sur la santé de la population générale. L'enquête sanitaire porte sur 600 personnes. Ses conclusions seront connues à la fin de l'année 2012.

Les agriculteurs sont les premiers exposés aux pesticides. Ils devraient se protéger lors des épandages. Nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Que savez-vous des dangers que courent les agriculteurs ?
Les AASQA s'intéressent plutôt à la population générale, d'où des mesures aux limites des parcelles pour les riverains. Les niveaux de toxicité sont différents pour les professionnels.

Pour autant, les études des AASQA sont publiques, les agriculteurs peuvent les consulter sur Internet.
Effectivement, la transparence est une condition de l'agrément des AASQA.
Pour avoir travaillé dans une région plus agricole, je sais les agriculteurs fortement sensibilisés aux pesticides : la nature est leur lieu de travail, leur intérêt est que les pesticides se fixent sur les cultures, pas sur les bronches. En même temps, ils vivent parfois ces études comme une contrainte supplémentaire qui vient s'ajouter aux normes sur l'eau.

Et l'exposition des riverains ? Quels types de produits retrouve-t-on dans l'air ? Dans quelles régions ?
Les concentrations sont plus fortes près des zones traitées. Cela dit, pour évaluer l'exposition des personnes, il reste à bâtir des valeurs toxiques de référence. Aujourd'hui, nous sommes seulement capables de construire, à partir des concentrations, des doses journalières admissibles, les DJA. L'étude Phytorive vous intéressera certainement, puisqu'on y compare deux communes, dont l'une est soumise à une forte pression phytosanitaire.

Il faudrait, nous dit-on, établir une distance entre cultures et riverains. Cette idée vous paraît-elle intéressante ?
Cette distance est difficile à déterminer, l'air étant un milieu ouvert. Toutefois, elle serait utile pour diminuer les pics de concentration lors de l'application des produits et, en raison du phénomène de volatilisation, lors de la post-application. Pour apprécier cette distance, il faudrait conduire des études fines au niveau des parcelles en fonction des types de produits utilisés et des conditions météorologiques.
On demande souvent aux AASQA ce type d'étude pour les polluants plus classiques, avant l'installation d'une crèche ou d'un stade à proximité d'une route.
Moins de vent signifie moins de dérive lors de l'application. Mais cela n'élimine pas la volatilisation post-application.

L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), l'ancien Cemagref, travaille sur la sécurité des matériels agricoles. Collaborez-vous avec cet organisme ?
Oui, dans le cadre du comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement (CORPEN), qui dépend des ministères de l'écologie et de l'agriculture. Il s'agissait de préparer des recommandations limitant la dérive des produits phytosanitaires lors de leur application. Encore une fois, nous avons plus vocation à regarder ce qui se passe pour la population.

Avez-vous un dispositif d'alerte aux abords des cultures et des entreprises de production ?
Non, et pour la raison technique que je vous indiquais tout à l'heure : il n'y a pas de seuil pour les pesticides. Ensuite, avec la méthodologie actuelle, nous ne pouvons pas prétendre à un suivi en temps réel.
Néanmoins, nos données sont publiques. Un numéro d'Aiparif Actualité a été consacré aux pesticides dans l'air francilien. Il avait eu un bon retentissement médiatique. D'autres AASQA ont également diffusé ce type de documents.

Quels sont les produits les plus dangereux ? Comment évaluez-vous la dangerosité des molécules ?
Un produit comme le lindane est classé dans le groupe 2B des produits possiblement cancérogènes pour l'homme. Pour les autres, nous croisons plusieurs données : le tonnage, la capacité à aller vers le compartiment atmosphérique ou encore les effets sur la santé via la DJA. Actuellement, nous réfléchissons à une liste socle nationale pour autoriser des comparaisons, sachant que l'agriculture n'est pas homogène sur le territoire français.
Si des valeurs limites sont fixées pour des produits, cela signifie qu'ils ont des effets sur la santé. Les PM10, ces particules aux effets cardio-vasculaires considérables, sont responsables de 400 000 morts en Europe, dont 40 000 en France.

Étudiez-vous l'impact des pesticides sur la biodiversité et les insectes pollinisateurs ?
Airparif focalise ses travaux sur la population générale. Un travail a été mené en Midi-Pyrénées sur les substances actives et les abeilles.
Nous possédons également des relevés lors du traitement des semences, qui sont délicats à interpréter pour les raisons que je vous ai indiquées. Ils constituent néanmoins un élément important dans nos discussions avec le monde de la santé. Nous devons fournir des éléments de mesure pour défendre l'idée de valeur toxiques de référence ; c'est un processus très itératif.
Pour vous donner une idée, les AASQA ont trouvé 100 molécules sur les 170 recherchées dans l'air depuis 2001. Toute la question est celle du financement du suivi et de l'homogénéisation de ce suivi. Aiparif a mené une première campagne sur les pesticides en 2007. Nous peinons à trouver des financements pour en financer une deuxième, sans doute à cause du contexte économique actuel.
Tout à fait. Nous avons ces éléments pour le lindane et le chlorothalonil en région Centre.
Dans le plan Ecophyto 2018, on cherche à mettre en place un indicateur pour le compartiment aérien à partir de mesures agrégées. Encore faut-il dégager des moyens pour suivre cet indicateur... En tout cas, il reflétera l'évolution des usages des produits phytosanitaires.
Cela dépend énormément des régions. Aiparif, bien que situé dans la première région industrielle de France, travaille beaucoup sur le trafic routier.
Effectivement, et elle rejoint celle des pesticides. Je pense à tous les biocides à usage vétérinaire, antiparasitaire, pour le traitement des charpentes et des piscines. L'Observatoire des résidus de pesticides (ORP) a travaillé sur l'exposition de la population générale à ces produits-là. En tout cas, il reste des marges de manoeuvre pour faire travailler davantage les AASQA et leurs partenaires sur les pesticides.

Mesurez-vous la présence simultanée de différentes molécules et des effets du trafic routier ? Dans notre mission, il est souvent question de l'effet cocktail.
Le niveau d'information diffère selon les polluants. Pour les pesticides, l'information est hebdomadaire. Pour d'autres polluants, nous sommes capables de mesurer la concentration, heure par heure, en tout point du territoire francilien grâce à la modélisation et à la cartographie.
Notre volonté est de disposer de multisites afin de mesurer simultanément les particules, l'ozone, le dioxyde d'azote et les pesticides et de parvenir à une vision globale de la pollution atmosphérique à un endroit. En revanche, je l'ai indiqué, le traitement des données est un autre travail, l'évaluation de l'effet cocktail encore plus.
Certaines AASQA s'en occupent ; en Ile-de-France, c'est le Réseau national de surveillance aérobiologique qui en est responsable, Aiparif diffusant directement les résultats sur son site Internet.

Un organisme national centralise-t-il toutes les données des AASQA ? Par exemple, le ministère de l'agriculture ou celui de la santé.
Oui, le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Pour les pesticides, la construction d'une base de données est théoriquement en cours ; là encore, un problème de moyens se pose.
Dans un souci de mutualisation, les AASQA ont déjà mis en place la base Alpha qui regroupe les données jusqu'à 2009.

Merci pour cet exposé limpide et clair, contrairement à l'air de Paris...

La Fédération du négoce agricole (FNA) est, aux côtés des coopératives, un grand acteur de la distribution de pesticides. Comment appréhendez-vous le plan Ecophyto 2018 ? Promouvez-vous des solutions alternatives à l'utilisation des pesticides ? Je vous poserai également quelques questions perfides sur le commerce transfrontalier de produits phytosanitaires entre l'Espagne et la France.
J'évoquerai ce dossier avec plaisir, il n'y pas de tabou. D'abord, merci d'auditionner la FNA. Je vous prie d'excuser l'absence de M. Christophe Viger, son président, qui profite du beau temps pour récolter ses graines dans le Maine-et-Loire.
Je m'efforcerai d'être concret et objectif. La FNA regroupe 400 négociants agricoles répartis dans toute la France. Leurs activités, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs salariés sont les mêmes que ceux des coopératives ; seul le régime du droit du travail diffère. Les coopératives dépendent de la Mutualité sociale agricole (MSA), non du régime général.
Nos adhérents sont des petites et moyennes entreprises familiales, transmises de génération en génération. Il n'est pas rare que le nom de leur fondateur soit encore inscrit au fronton de l'entreprise. Environ 70 % de nos entreprises comptent moins de vingt salariés. Nous travaillons au quotidien avec les agriculteurs, sur l'ensemble des filières, en amont comme en aval, de l'engrais aux semences en passant par les produits phytosanitaires jusqu'à la commercialisation. Les coopératives détiennent globalement 60 % du marché français ; nous, 40 %, avec des variations locales. Nous représentons 80 % du marché dans une région à culture spécialisée comme le Languedoc-Roussillon.

Combien de personnels employez-vous pour le conseil et la vente de produits phytosanitaires aux agriculteurs ?
Dans l'ensemble de nos entreprises, 2 600 techniciens-conseils et préconisateurs sont à l'oeuvre.

Vous adressez-vous aussi aux collectivités territoriales et aux particuliers ?
La FNA s'adresse aux utilisateurs professionnels. Donc, également aux collectivités territoriales et aux entreprises paysagères.
Dans nos dépôts, des libres-services sont ouverts aux particuliers. Cette activité sera soumise à agrément à partir du 1er octobre 2013.
Pas sur le plan du capital ni sur le plan fiscal : les coopératives bénéficient d'exonérations ; nous, non.
Oui, les chefs de silos en sont responsables.

Les coopératives ont des filiales de droit commun. Sont-elles adhérentes à la FNA ?
L'adhésion à la FNA est volontaire. Depuis quelques années, ces filiales la quittent, sans doute pour des raisons fiscales.
La FNA compte dix permanents, financés exclusivement par les cotisations.
Le code général des impôts introduit une distorsion de concurrence pour des activités de même nature qui s'approvisionnent auprès de fournisseurs identiques.

Ce statut ne vous empêche pas, d'après les coopératives, de leur prendre des clients !
Le nouveau dispositif d'agrément, nous le soutenions avant le Grenelle. Les exigences seront désormais les mêmes pour la distribution de produits phytosanitaires aux professionnels et la vente au grand public. Un agrément, et c'est une nouveauté, est aussi prévu pour le conseil indépendant.
Indépendant de la vente et de l'application, comme celui effectué par les chambres d'agriculture, par exemple.
Comme je le disais, l'entrée en vigueur de l'agrément est prévue pour le 1er octobre 2013. Aux côtés de l'agrément collectif, qui repose sur des référentiels, des Certiphyto sont délivrés à titre individuel. Or, le négoce agricole représente 10 000 collaborateurs, dont 2 600 techniciens-conseils et préconisateurs ainsi que 2 800 agents de dépôt, magasiniers et chefs de silos.
Les techniciens commencent par l'observation au champ et, s'ils constatent la présence d'une maladie, ils posent un diagnostic. Toutes les solutions disponibles sont ensuite présentées à l'agriculteur.
Bien sûr ! Des extraits d'algue pas exemple. Nous nous engageons à mettre à disposition de l'agriculteur toutes les solutions pour lutter contre la maladie. L'agriculteur peut ensuite décider en toute connaissance de cause. Nous suivons en cela les préconisations du Grenelle et des textes règlementaires qui ont suivi. Si l'agriculteur choisit une solution phytosanitaire, nous lui proposons divers produits et tout le processus est enregistré par des personnes certifiées.

Le conseiller indépendant est quand même votre salarié et l'agriculteur achète vos produits dans votre boutique !

Le vendeur a-t-il un intérêt financier à vendre des produits alternatifs ?
Vous touchez un point clé. Le technicien est détenteur de son certificat individuel conseil. Le conseil est identifié avec des fiches de mission et enregistré par écrit. Enfin, le technicien conseil n'est pas rémunéré au chiffre d'affaires ni au volume de vente. Et tout cela est certifié par un organisme indépendant.
Il peut l'être dans le cadre de la participation aux résultats comme dans toute entreprise qui met en place un tel dispositif pour son personnel.
Il perçoit des prestations de service.

L'agriculteur bénéficie-t-il de ristournes en fonction des volumes achetés ?
Cela arrive, comme dans toute relation commerciale.
Nous vendons aussi des méthodes alternatives qui ont été préalablement testées dans nos parcelles d'expérimentation.
Elles ne concernent que les produits phytosanitaires. Nous distribuons des solutions homologuées et autorisées. Ensuite, nous délivrons les produits aux agriculteurs dans nos silos ou dans la cour de la ferme. Nous avons 2 800 chefs de silos et agents de dépôt qui interviennent pour informer les agriculteurs afin qu'ils lisent les étiquettes et notamment la fiche de données de sécurité (FDS), qu'ils se protègent grâce à nos équipements de protection individuelle (EPI), qu'ils participent à Adivalor et qu'ils récupèrent les emballages vides.

Comment les équipements individuels de protection sont-ils référencés ?
C'est un vrai sujet : il faut avoir le bon EPI pour le bon produit.
Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être remis qu'après l'ouverture d'un compte client identifié vérifiant le certificat de l'agriculteur. Nous avons récemment conçu un guide qui rassemble toutes les exigences du chapitre 6 du référentiel en matière de protection, de stockage et de récupération des emballages vides.

Privilégiez-vous dans vos référencements des conditionnements plus protecteurs des agriculteurs ?
Nous n'avons pas ce type de demandes.

Les agriculteurs sont-ils plus sensibilisés à la dangerosité des produits ? Demandent-ils plus souvent des produits alternatifs aux pesticides ?
Les messages de protection sont diffusés depuis plusieurs années et ils montent en puissance depuis deux ans. Le retour est positif. Il reste cependant encore beaucoup à faire pour transformer le sentiment en actes concrets.
La directive sur les profils de toxicité des différentes matières actives a été révisée et les a fait passer de près de 1 000 à 268. Cela relève de la responsabilité des metteurs en marché.
Il est logique que la redevance pour pollution diffuse (RPD) varie en fonction du degré de toxicité des molécules, mais son application pose des problèmes. Les taux ont doublé en trois ans pour financer le plan Ecophyto. Quand elle a été instituée, en 2006, les distributeurs agréés, coopératives et négoce, y étaient assujettis. Nous faisions le chèque à l'agence de l'eau. Nous intégrions dans le prix de nos produits la redevance au même titre que les autres charges. Comme nous devions informer les agriculteurs par la facture, ils ne connaissaient le coût de la taxe qu'après l'achat. L'objectif de la loi sur l'eau n'était donc pas atteint, puisqu'il s'agissait d'orienter les agriculteurs vers des produits moins polluants.
La loi de finances pour 2009 nous a permis de sortir du prix le montant de la redevance : des produits sont donc distribués par des distributeurs français avec une matière active qui vaut, par exemple, 6 € le litre et qui supporte 2,55 € de redevance. Les importations de produits étrangers homologués se multiplient dans les zones frontalières, puisqu'ils n'acquittent pas de redevance. Dans le pire des cas, on importe des produits chimiques non identifiés - voyez sur ce sujet le reportage de France 24 ou l'article du Parisien. Ces produits viennent d'Ukraine ou de Chine et ils entrent en France en toute impunité, malgré les douanes. Dans les zones frontalières, notre chiffre d'affaires a diminué de 25 % à 30 %. En matière environnementale, le risque est majeur. Une étude d'une Agence régionale de santé (ARS) montre la présence de résidus sur les zones de captage : sur les dix premières matières actives, huit sont interdites.

Est-il exact que, en raison de la redevance, des sociétés de négoce auraient créé des filiales de droit espagnol afin d'importer des produits sans payer la redevance ?
Il s'agit de la liberté d'entreprendre. Si le droit est respecté, il n'y a pas de problème, d'autant que les agriculteurs doivent tenir un registre pour enregistrer les produits phyto achetés à l'étranger. Ils paieront la redevance sur leurs achats à partir de 2013. Mais, dans le cas des produits chimiques non identifiés, il s'agit de fraude.

Une étiquette rédigée en espagnol peut-elle renseigner l'agriculteur français sur les dangers ?
Les étiquettes doivent être écrites en français, même pour les produits importés. Cette distorsion de concurrence est très mal vécue par les entreprises françaises qui investissement deux millions par an pour former leur personnel sans être aidées par l'Etat. La loi doit être appliquée et des contrôles effectués.

Cela me gêne toujours terriblement de voir écrit : « substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction », comme s'il suffisait de payer une redevance élevée. Cela ne devrait pas exister et ce droit à polluer me pose question.
Nous avons recopié la formule de la loi de finances pour 2009.
Une négociation commerciale s'engage avec notre fournisseur pour qu'il reprenne le produit. Sinon, il est intégré dans la filière Adivalor.

Est-ce que les coopératives, elles, bénéficient d'aides à la formation ?
A cet égard, l'équité a bien été respectée entre les coopératives et le négoce, comme elle l'est sur les dossiers techniques.

Vous avez parlé de stockage des céréales et de traitement des grains par insecticides. Comment incitez-vous vos adhérents à avoir recours à des méthodes alternatives telles que l'aération ou la réfrigération ?
En tant qu'employeur, nous devons bien sûr respecter le code du travail et fournir l'ensemble des protections individuelles nécessaires. Dans le cadre de la désinsectisation, nous nettoyons et ventilons le grain tout au long du stockage. En outre, nous avons une obligation contractuelle de livrer du zéro insecte vivant. Il n'y a plus, depuis l'interdiction du dichlorvos, de traitement choc avant chargement, mais nous pouvons traiter avec la phosphine, un gaz qui ne laisse aucun résidu, mais présentant un risque important pour les utilisateurs.
Pour ce qui concerne les risques liés à l'utilisation de nos produits dans les silos, j'ai récupéré les statistiques de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) pour notre branche privée d'activité. Pour le commerce de gros des céréales et du tabac, nous déplorons, en 2010, quatre accidents du travail résultant d'une intoxication liée aux gaz, vapeurs et poussières, mais aucune invalidité permanente et aucun décès pour 20 000 employés.

On arrive bien à identifier les accidents directs, mais pas les maladies chroniques.
Ouvrir le dossier ne pose aucun problème : à l'exception des chefs de silos, nos entreprises transportent et stockent des produits conditionnés : nos salariés n'ont donc pas de contact direct avec les pesticides, contrairement aux agriculteurs.
Tout à fait et chez tout le monde : avant la récolte, tous les silos sont nettoyés et ventilés, mais il reste des endroits inaccessibles, d'où une désinsectisation préalable. Nos salariés assurent le traitement ou bien nous faisons appel à un prestataire agréé.
Bien évidemment.
Quand le grain arrive, il est passé dans un grand tamis pour le nettoyer, sans produit chimique, et il est stocké. Du fait de la réglementation, seuls les grains de céréales à paille peuvent être désinsectisés, ce qui n'est pas le cas pour les oléagineux, comme le tournesol ou le colza.
Tout au long de la campagne, le grain est donc ventilé pour réduire la température et éviter le développement d'insectes.

Quand un agriculteur vous livre du grain avec des insectes, le prix payé est-il inférieur ?
C'est du pur commercial. On ne dit pas non à un client, on lui trouve une solution. Nous facturons le nettoyage du grain, après accord de l'agriculteur. Une fois suffit. Puis, lors de l'expédition, s'il y a eu un incident, une nouvelle désinsectisation a lieu, pour que le lot ne soit pas refusé.
Nous sommes tenus par la règlementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) d'éloigner les bureaux administratifs des silos.

Lorsque vous expédiez les grains au loin, n'êtes-vous pas obligés de les traiter de façon préventive avant le voyage pour éviter toute contamination ?
Pour de longs transports en bateau vers des pays tiers, les exportateurs procèdent à des fumigations à l'intérieur des cales. Ce gazage ne laisse pas de résidu sur les grains.

Je suis exploitant agricole et j'ai récemment reçu une lettre circulaire de la coopérative me rappelant de bien nettoyer mes silos et d'envisager un traitement du grain lors de leur remplissage.
L'agriculteur gère son stockage comme il l'entend, mais le distributeur a une obligation de conseil avant toute vente et cela engage sa responsabilité. Votre coopérative aurait dû présenter la panoplie des solutions disponibles, dont les produits phytopharmaceutiques.

Les agriculteurs qui font du bio doivent avoir les mêmes problèmes d'insectes. Comment font-ils ?
Il y a des insecticides autorisés, que nous distribuons.

Ils sont donc arrosés d'insecticides agréés. Sont-ils plus chers que les autres ?
En fonction de la gamme.
Je n'ai pas l'expertise technique pour vous répondre.
Sur des matières actives destinées à des usages autorisés, à charge pour nous de nous assurer que le conseil que nous délivrons est donné pour des usages adaptés.
Pour minimiser les risques de contamination croisée, il y a des cellules séparées.

Les céréales dont vous nous avez parlé sont-elles destinées à l'alimentation humaine ou animale ?
Il s'agit de toutes les céréales, mêmes celles destinées à un usage non alimentaire.

Lorsque ces céréales arrivent à destination, peuvent-elles subir d'autres traitements, avant d'être transformées ?
Pour ce qui est des industriels, je ne saurais vous répondre. Si un lot comporte des insectes, il est refusé à l'entrée de l'usine.
Il y a une négociation commerciale : nous pouvons procéder à un nettoyage mécanique.
Audition de Mme Nathalie Gouérec coordonnatrice du centre d'étude pour une agriculture durable plus autonome cédapa et de M. Frédéric daRley
Audition de Mme Nathalie Gouérec coordonnatrice du centre d'étude pour une agriculture durable plus autonome cédapa et de M. Frédéric daRley

Nous vous remercions de participer à cette audition menée par la mission commune d'information sur les pesticides.
Je vous suggère de présenter l'activité du Cédapa. Le questionnaire que nous vous avons fait parvenir pourrait éventuellement servir de support à cette présentation.
Le Cédapa est une structure technique apportant une assistance aux agriculteurs, dans le cadre d'un régime associatif. Due à M. André Pochon, sa création s'est faite avec le concours de l'Institut national pour la recherche agronomique (INRA).
Non. Son organisation est départementale, avec toutefois un « réseau agriculture durable » couvrant la France entière.
En pratique, le Cédapa est présent surtout dans le Grand-Ouest et un peu dans le Sud-Ouest.
Nous percevons les contributions des agriculteurs, augmentées de subventions départementales ou régionales, sans oublier l'aide apportée par l'agence de l'eau. Un groupe d'agriculteurs participe à Écophyto 2018 ; certains financements sont procurés par d'autres actions environnementales, comme celle centrée sur la qualité de l'eau.
Nous intervenons principalement sur les élevages de bovins, d'ovins ou de caprins. Nos adhérents utilisent principalement des prairies temporaires, car leur bêtes se nourrissent avant tout d'herbe ; ils réduisent ainsi les intrants tout en assurant une alimentation équilibrée aux ruminants, qui mangent peu de soja. L'idée est de gagner plus en réduisant les charges.
Les agriculteurs membres du réseau ont élaboré un cahier des charges national validé par l'INRA.
Notre vérité provient de l'expérience agricole. Loin de relever d'un positionnement théorique, le cahier des charges agro-environnemental est le seul issu des pratiques du terrain. Il n'a pas été conçu dans des bureaux.
Environ 3 000.
M. Henri Tandonnet. - La filière lait est-elle adossée à votre démarche ?
Le lait d'herbage a des propriétés intéressantes pour la santé, notamment via les Oméga 3 et les Oméga 6. Certains éleveurs ont tenté de créer une filière de laiterie paysanne à destination de la restauration collective, mais l'initiative était sans doute prématurée. En novembre dernier, nous avons nommé un chargé de mission qui doit proposer des mesures à même d'améliorer la transformation et la valorisation du lait herbager. En ce domaine, l'obstacle à surmonter est simple : l'économie favorise les systèmes intensifs.

Au fond, quelle est la différence entre votre pratique et celle de l'agriculture bio ?
Nous n'excluons pas le levier chimique en dernier recours. L'agriculture durable intervient sur le même marché que l'agriculture conventionnelle, avec des marges et des productivités semblables.
Les fermes laitières herbagères produisent autant de lait à l'hectare, mais leurs vaches mangent moins de maïs et plus d'herbe, qui pousse bien dans nos régions.
Sur le plan économique, notre modèle est d'autant plus performant que l'énergie et les intrants coûtent cher.
Nous utilisons l'indice de fréquence des traitements (IFT). Sa valeur en Bretagne s'établit à 2 en moyenne, contre 0,2 à 0,3 chez nos adhérents. Comment avons-nous pu diviser par 7 le nombre de traitements ? Grâce à la rotation des cultures, qui réduit les besoins en intrants.

L'IFT n'est-il pas élevé dans la mesure où l'absence de traitement accroît les risques ?
C'est ce qu'avancent les vendeurs de produits phytopharmaceutiques. Or, je préconise une autre approche que le rendement maximal. Recherchons plutôt un optimum de rendement réduisant autant que faire se peut l'emploi de produits phytopharmaceutiques. Comparables en valeur à celles obtenues par l'agriculture conventionnelle, nos marges brutes sont aussi régulières, car nous utilisons des espèces naturellement résistantes. Et donc les années difficiles, lorsqu'on a utilisé tout de même des pesticides, on a enregistré malgré tout des pertes de récolte.

Êtes-vous hostiles à la nouvelle règlementation concernant les semences ?
Les semences ne sont pas un gros poste de dépense mais nous voulons reprendre la maîtrise du vivant, ce que ne permet pas cette règlementation.

Le maïs est très consommateur d'intrants. Pensez-vous qu'il faille sortir de la dépendance au maïs ?
Le maïs peut être cultivé avec peu d'intrants s'il s'intègre dans une rotation. Ce qui rend nécessaire l'emploi de produits chimiques, c'est la spécialisation des exploitations.

Les ventes de produits phytopharmaceutiques augmentent malgré l'existence de solutions alternatives.
Il est difficile de changer ses pratiques agricoles. En outre, la chimie simplifie la tâche. Son emploi croissant est très cohérent avec la réduction du nombre de personnes qui s'activent sur les exploitations : la productivité à l'hectare diminue, mais la productivité du travail augmente.
Nos agriculteurs gagnent au moins aussi bien leur vie que ceux pratiquant l'agriculture conventionnelle. La confusion entre chiffre d'affaires et revenu reste fréquente.
Oui !
On sélectionne actuellement des vaches sur leur capacité à produire du lait, alors que l'important est leur fertilité. Or, ces deux objectifs sont contradictoires. En Nouvelle-Zélande, on sélectionne des vaches pouvant se contenter d'une seule traite par jour. Les signaux réglementaires donnés en France sont incohérents.
Les normes applicables aux vaches laitières prennent en compte les rejets d'azote, mais le plan « algues vertes » incite à laisser les vaches dans les champs.
Oui, mais une norme unique limite fixant 170 kg d'azote par hectare est laxiste pour le maïs et excessivement restrictive pour l'herbe, car elle prend en compte les rejets en négligeant la valorisation. Si l'on disait que le coût de l'énergie et des intrants allait augmenter, les agriculteurs réduiraient l'emploi des pesticides... à condition que tous les signaux indiquent la même direction.
En effet. Les agriculteurs sont des acteurs économiques rationnels et intelligents, à même d'aller dans le sens voulu par la société, pourvu qu'elle s'exprime clairement.
Malheureusement, le milieu agricole est fermé sur lui-même.

Parmi les agriculteurs qui s'installent, certains proviennent de couches sociales autres qu'agricoles.
Souhaitons-le. Dans les écoles, on parle de plus en plus agriculture durable, mais l'intérêt pour le machinisme l'emporte. La culture dominante est celle du rendement. Toute interdiction de produit phytopharmaceutique est vécue comme une contrainte, alors que les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides !
Le syndicat majoritaire porte l'agriculture vers l'agrandissement des propriétés, vers l'utilisation accrue de la technologie pour surmonter les problèmes de pollution. Ce n'est pas nécessairement le retour à l'agronomie.

J'ai été frappée par la technicité des agriculteurs bio rencontrés par la mission, qui utilisent beaucoup de techniques, sont extrêmement modernes et pratiquent la sélection.
Prenons l'exemple du lisier de porc : le syndicat majoritaire oriente l'activité vers la mécanisation avec une filière « lisier », plutôt que vers la restructuration de la filière porcine.
La FNSEA privilégie l'adaptation des pratiques, non l'évolution du système.
La rotation entre maïs et blé est incompatible avec la réduction des produits phytopharmaceutiques. En revanche, on peut en diminuer l'usage en repensant le système d'exploitation, avec une rotation plus longue faisant alterner la luzerne - pendant trois ou quatre ans d'affilée - avec le maïs et le blé. Le mélange d'espèces ouvre également des perspectives intéressantes, bien que notre connaissance des interactions entre céréales et légumineuses soit purement empirique. Envisager le désherbage mécanique dans le cadre actuel reviendrait à s'engager dans une impasse. Ce que nous faisons n'a rien d'un retour en arrière. C'est moderne et stimulant.

Votre logique n'est pas celle de l'agriculture raisonnée, c'est celle de l'agriculture intensive. Votre réseau est-il principalement familial ?
Théoriquement, on peut envisager un assolement collectif : tel producteur de porcs laisserait un éleveur de vaches utiliser une surface pour faire pousser de l'herbe, mais cette pratique se heurte à l'attachement quasi viscéral éprouvé par un paysan pour sa terre.
Cette formation dure deux jours, ce qui est en soi une belle performance. Elle fait prendre conscience du risque sanitaire direct induit par l'emploi des pesticides, mais le volet agricole de la réduction se limite à une initiation. La formation n'est pas très poussée.

Grâce à cette formation, les agriculteurs accordent donc un peu plus d'attention aux risques que font peser les pesticides.

Toute la société en parle ! Certains agriculteurs sont gravement atteints. C'est notoire.
On sait qu'il y a de nombreux cas. La maladie de Parkinson semble ainsi corrélée aux produits phytopharmaceutiques. Mais on manque encore de données pour relier les pathologies aux pesticides.
Dans les champs, certains agriculteurs traitent sans protection. Nous avons un groupe d'agriculteurs engagés dans le plan Écophyto. Il est possible de diviser immédiatement par deux l'usage de produits phytopharmaceutiques.

Une expérience réalisée par l'INRA prouve que l'on peut réduire de 30 % des intrants utilisés.
Oui. Pour aller au-delà, il faut faire évoluer le système. Le Cémagref et l'INRA l'ont démontré.
Depuis cinq ans, le réseau d'agriculture durable s'est engagé dans l'élaboration d'un cahier des charges pour les grandes cultures. Nous réfléchissons globalement sur l'exploitation, avec un double objectif : maintenir les revenus des agriculteurs et diminuer l'usage de produits phytopharmaceutiques. Mais la réduction des pesticides ne peut se concevoir isolément. L'emploi d'azote est également réduit, des protéagineux sont réintroduits dans les assolements. Ce cahier des charges permet de réduire les utilisations de pesticides de manière spectaculaire.

Pensez-vous que des taxes peuvent dissuader de recourir aux produits phytopharmaceutiques ?
Ce qui fera évoluer les pratiques agricoles, c'est le prix excessif des produits chimiques. L'action sur les prix est efficace, mais il est regrettable de recourir à ce levier. En outre, toute hausse artificielle des prix encourage l'approvisionnement parallèle.
À mon sens, le prix exprime un signal politique plus qu'un enjeu économique. Changer de système est logique, car il faut penser autrement son exploitation.

Une telle évolution mettrait-elle en cause la rentabilité des investissements déjà réalisés ?
Ces dernières années, les revenus nets des céréaliers sont identiques aux primes PAC perçues. Il faudra donc verdir la politique agricole commune.
Le matériel utilisé pour le travail du sol n'a pas besoin d'être changé. En revanche, la reconversion d'une exploitation exige un grand investissement immatériel.
Lorsqu'un agriculteur s'engage dans un système fourrager économe en intrants (SFEI), le Cédapa l'accompagne.
Toutes les étapes sont suivies. Il faut plusieurs années pour qu'un rendement accru de l'herbe permette de réduire l'usage du maïs. Pendant ce temps, l'accompagnement individuel se conjugue avec une participation à des rencontres entre agriculteurs. Ainsi, l'expérience est partagée.
Il y a le dispositif agroenvironnemental. Nous avons un projet sur les grandes cultures économes en intrants, avec un cahier des charges.

Merci d'avoir accepté d'être entendus. Notre angle d'attaque sur le sujet des pesticides est celui de leur impact sur la santé de ceux qui sont directement exposés quelles que soient leurs fonctions, fabricant ou utilisateur.
Notre organisation est présente dans l'ensemble du monde agricole. Pour l'élection au collège des salariés dans les chambres d'agriculture, notre organisation est la première avec 38 % des voix, devant la CFDT (27 %) et FO (15 %). Le sujet des pesticides nous intéresse fortement : nous menons chaque année une campagne sur les conditions de travail et demandons à « arrêter le massacre ». En matière de pesticides, nous sommes en présence d'une bombe à retardement pour les salariés, qui explosera dans les années futures. Notre organisation participe à l'Institut de Recherche et d'Etudes des Salariés Agricoles (IRESA), qui associe scientifiques et chercheurs pour analyser les évolutions du travail agricole et des conditions de travail.
Le monde des salariés agricoles est souvent ignoré. Or la part du travail effectué dans les exploitations par les salariés est importante : elle s'élève à presque 30 % des unités de travail annuel (UTA) et, compte tenu des évolutions structurelles de l'agriculture, devrait croître dans les années à venir. Or, le travail agricole salarié est marqué par l'importance de la précarité : 50 % du travail salarié agricole est du travail saisonnier. Par ailleurs, on constate une progression de la part des femmes dans le travail salarié agricole, qui s'élève à 30 % environ aujourd'hui.
L'état des mentalités en agriculture conduit à sous-estimer les risques : cela est vrai pour les salariés mais aussi pour les exploitants eux-mêmes. Cette négation de la réalité des risques est liée à une conception productiviste de l'agriculture. Toutefois, les mentalités commencent à changer : ainsi, les tribunaux sont désormais saisis pour faire reconnaître des maladies professionnelles.
Un des aspects qui nous préoccupe aujourd'hui, à propos la sécurité au travail des salariés agricoles, concerne la mise sur le marché des machines agricoles, en particulier celles servant à l'épandage. Beaucoup de machines ne respectent pas les normes les plus évidentes et, d'ailleurs, l'inspection du travail a été amenée à constater un grand nombre d'infractions.
Un autre aspect concerne les conditions des autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques : on présuppose que ces produits seront utilisés avec des équipements de protection, mais nulle part les types de protection ne sont précisés. En outre, les équipements de protection sont inadaptés à la réalité du travail agricole. Nous pensons que si les pesticides sont dangereux, il ne faut pas autoriser l'exposition des salariés et donc interdire purement et simplement ces produits : c'est cela la prévention primaire !
Nous remarquons également que si, depuis le décret de 2001, un document unique d'évaluation des risques (DUER) doit organiser la prévention primaire en présentant au salarié l'ensemble des risques auxquels il peut être exposé, ce document est souvent inexistant dans les exploitations agricoles.
Il nous semble donc que nous devrions changer d'approche en réduisant l'exposition des salariés aux risques, y compris en retirant des produits du marché. Les fabricants devraient aussi mieux informer des risques auxquels leurs produits exposent et des moyens de s'en protéger. Trop souvent, les combinaisons proposées sont trop anciennes, plus aux normes, et ne sont pas adaptées. En outre, l'information agit sur les comportements : si vous voyez des opérateurs en combinaison pulvériser un champ, le lendemain, vous aurez du mal à acheter un produit venant de ce champ !

Des informations ne figurent-elles pas sur les bidons contenant les produits ?
Certains salariés, en particulier ceux recrutés par la voie de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne savent pas lire.

Il nous semble que s'il y a trop d'informations, cela ne sera pas lisible.

En pratique, les saisonniers sont-ils amenés à épandre les pesticides sur les cultures ?
Non, mais ce ne sont pas forcément ceux qui épandent qui sont les plus exposés. Les études de dangerosité effectuées - que l'UIPP ignore, en continuant à faire croire que les pesticides autorisés ne sont pas dangereux - montrent que ceux qui vont tailler la vigne ou travailler dans les champs de maïs après épandage sont les plus exposés. Les risques ne se réaliseront que longtemps après l'exposition, et pourront se transmettre sur plusieurs générations, les produits concernés ayant des effets de perturbateurs endocriniens.
Il est curieux que la législation reconnaisse que certains produits soient causes de maladies professionnelles, pour les salariés du régime général, alors qu'ils ne sont pas considérés comme causant de telles maladies, lorsqu'ils sont utilisés en agriculture. La reconnaissance des maladies professionnelles en agriculture a pris du retard.

Comment expliquez-vous que certains syndicats agricoles aient été hostiles à la reconnaissance de la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle ?
C'est une position étonnante, que l'on peut regretter. Au demeurant les exploitants sont exposés de la même manière que les salariés et doivent être traités de la même manière face au risque professionnel ?
Certains agriculteurs ont un intérêt direct à la production de pesticides, notamment ceux qui sont très impliqués dans les coopératives, qui sont aussi des distributeurs. Certaines pratiques posent problème : j'ai vu de l'enrobage de semence effectué dans une bétonnière ! En outre, il n'est pas étonnant que les exploitants soient réticents à la reconnaissance de davantage de maladies professionnelles car cette reconnaissance fait grimper leur taux de cotisation à la MSA.
Désormais, la maladie de Parkinson est reconnue dans le régime agricole comme maladie professionnelle, alors qu'elle ne l'est pas dans le régime général. Pour la plupart des autres maladies, nous connaissons la situation inverse. Mais un travail est effectué pour reconnaître les hémopathies. Nous préférons faire évoluer les tableaux pour avoir une certaine homogénéité dans les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles ; en effet, il y a trop de différences de traitement des demandes au cas par cas présentées devant les commissions régionales de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Nous souhaitons évoluer en deux temps : dans un premier temps, les maladies professionnelles liées aux pesticides reconnues dans le régime général devraient l'être dans le régime agricole et, dans un deuxième temps, un travail de fond devrait être engagé pour réduire l'exposition aux pesticides. Les produits utilisés ont un effet différé. Il faut donc un suivi à long terme des salariés exposés aux risques, pour mieux repérer les causes des maladies des salariés, quelques années plus tard.

Les carnets d'exposition existent pour les salariés des entreprises de la chimie ; cela n'existe pas en agriculture ?
Non, le seul outil utile est la visite effectuée à la médecine du travail à l'âge de cinquante ans, permettant de retracer la carrière de l'intéressé. Mais la médecine du travail a été réformée et la visite à cinquante ans est loin d'être systématique, du fait du manque de moyens de la médecine du travail. En outre, l'espacement entre les visites ne facilite pas le suivi des salariés.
J'ajoute deux points : le plan Ecophyto 2018 vise à réduire de 50 % l'utilisation des pesticides. Mais la consommation est très dépendante des conditions climatiques. Et calculer un tonnage ne suffit pas. Le plan doit évoluer.
Mon second point a trait à la recherche : nous souhaitons qu'il y ait un développement de la recherche publique sur les pesticides et que cette recherche se démarque du productivisme pour s'intéresser vraiment à la santé.
Les salariés agricoles ne profitent pas longtemps de leur retraite, c'est une réalité ! Les agriculteurs commencent d'ailleurs à s'en apercevoir et à protester contre les risques que leur font courir les produits qu'ils emploient.
Je souhaiterais une centralisation dans une banque de données des connaissances et recherches sur la santé dans le secteur agricole. La base Agrican ne suffit pas. Et la communication autour d'Agrican a été biaisée.
Je n'attaque aucunement le Dr Pierre Lebailly qui accomplit un travail important mais la communication de la MSA est à revoir.
Pour conclure, je dirais qu'en agriculture, les changements ne se produisent pas spontanément. C'est toujours au travers des interrogations sur la consommation qu'on a abordé les problèmes de santé causés par les pesticides, comme cela a été le cas pour la chlordécone. Comme il y a d'énormes retards dans les conditions de travail en agriculture pour la reconnaissance des maladies professionnelles ou encore au sujet des documents de prévention, il faut renverser les responsabilités : ce ne sont pas les agriculteurs qui doivent être en première ligne. Les textes doivent n'autoriser que des produits sans danger. De ce fait, si l'agriculteur ne respecte pas la réglementation, il n'y aura pas de conséquence dommageable. D'une manière générale, en agriculture, il faut des textes qui contraignent.

Quelle est votre vision sur le développement des méthodes alternatives ?
Il n'est pas possible de se satisfaire uniquement de communication. Le durable ne doit pas être astuce de communication. Les exploitations grandissent et il faudra toujours traiter les champs. Nous sommes sceptiques sur la capacité du milieu agricole à réduire spontanément leur consommation de pesticides, car les agriculteurs craignent que cela menace la production. Il faut promouvoir un autre modèle agricole. Nous ne sommes pas pessimistes car il y a une pression des associations de défense de l'environnement ou du consommateur. Certains agriculteurs se rendent aussi compte que le modèle productiviste touche à ses limites. Mais la lourdeur des habitudes exige une action énergique de l'État pour provoquer le changement.

Quel est le niveau de formation des salariés saisonniers ? Reviennent-ils sur les exploitations d'une année sur l'autre ?
Pendant longtemps, les salariés sont revenus année après année. Mais les pratiques sont parfois contestables : certains employeurs demandent de l'argent pour signer un contrat pour l'année suivante, certains aussi ne payent pas les heures supplémentaires effectuées, notamment par les travailleurs immigrés. Une nouvelle tendance se développe aujourd'hui : on fait venir des salariés sud-américains, relevant de sociétés de prestation de services de droit espagnol, dont les papiers sont donc en Espagne. L'inspection du travail ne peut donc pas faire de contrôles efficaces. Dans ces conditions, les salariés ne reviennent pas. Ce sont les moins protégés de tous.
Pour le reste, des efforts de formation sont à effectuer. Parfois, les salariés manipulent les produits sans savoir ce qu'ils font. Dans les vergers, il est inacceptable que les hélicoptères passent pour traiter alors que les salariés travaillent au sol.
Certains agriculteurs emploient aussi des clandestins comme salariés saisonniers.
Une technique de rémunération était particulièrement perverse : le paiement à la tâche. Certains employeurs trafiquaient la pesée pour qu'apparaisse un poids inférieur au poids de récolte effectif, permettant de payer moins les tâcherons.
D'une manière générale, les saisonniers sont des précaires, mis en situation d'infériorité, mais qui souhaitent revenir l'année suivante. Ils ne peuvent pas se plaindre. Là aussi, il faut inverser les responsabilités et demander à l'employeur de prouver que le salarié n'est pas en danger.
En ce qui concerne l'enseignement agricole, il faut que la question de la santé fasse partie du cursus de formation car cela participe de la prévention.

Comment un agriculteur peut-il devenir un mauvais employeur ? L'appât du gain explique-t-il tout ?
A partir du moment où le produit agricole est un produit comme les autres, on expose l'agriculteur à la concurrence internationale. C'est aberrant et cela pousse au productivisme. Les agro-carburants poussent aussi à la production. On se pose peu la question des effets des intrants. Or, les plantes s'adaptent et deviennent résistantes aux traitements. Ce modèle agricole va vers l'abîme. Le bio et le développement durable ne peuvent pas marcher si l'on ne change pas le cadre global.
Non, mais qui va sur les marchés bio ? Les bobos parisiens ! Les autres vont acheter dans le hard-discount.
Imaginez un agriculteur plein de bonne volonté qui reçoit un conseiller de la chambre d'agriculture : il suivra ce que l'on lui dit pour s'assurer de la meilleure production. Or, les pesticides doivent être achetés. Cela a une répercussion sur le coût de production. On parle toujours du coût des salaires mais jamais de celui des intrants, qui est pourtant déterminant.

Vous avez produit un rapport sur les pesticides et la santé, pouvez-vous nous en parler ?
Oui. La question de la santé en agriculture est difficile. L'objet de ce document était de sensibiliser les salariés et les responsables syndicaux à cette question compliquée par un document de vulgarisation. Les responsables sont souvent plus focalisés sur les questions de salaire et les autres aspects sont moins connus. Nous attendons aussi que des chercheurs et étudiants s'intéressent à la question. Nous travaillons déjà avec l'Université de Bordeaux. Notre action ne se limite pas à la santé mais porte aussi sur la sociologie : nous avons réalisé une étude sur la participation des salariés aux fêtes agricoles.

Avez-vous pu constater un nombre important d'accidents du travail liés aux pesticides ?
L'essentiel des maladies professionnelles reconnues relèvent des troubles musculo-squelettiques. En ce qui concerne les accidents du travail, il existe quelques exemples, notamment d'accidents dans les silos. Les silos posent aussi des problèmes d'expositions aux pesticides avec des particules en suspension dans l'espace lors des manipulations. D'une manière générale il y a des réticences à déclarer les accidents. Les salariés hésitent aussi à les déclarer car ils craignent de perdre leur emploi. Notre travail de responsables syndicaux consiste à faire émerger les problèmes. Nous regrettons que la MSA conteste systématiquement la reconnaissance de maladies professionnelles. L'année dernière, nous avons fait réaliser une étude sur les recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, constatant que, en conciliation, les salariés n'avaient satisfaction qu'à hauteur de 50 % des montants demandés et de 30 % au niveau des tribunaux administratifs.
Le problème vient du fait que le Conseil d'administration de la MSA est composé majoritairement de représentants des employeurs. La reconnaissance des maladies professionnelles est un calvaire pour les salariés. La question de l'établissement de la preuve est fondamentale.
Pour conclure, nous espérons que le législateur aidera à changer les mentalités en agriculture.