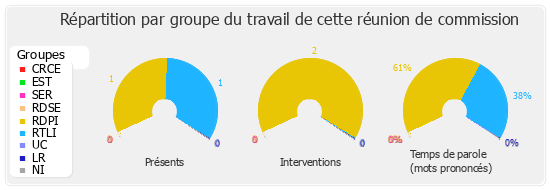Délégation sénatoriale à l'Outre-mer
Réunion du 13 novembre 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- audition de m. vincent bouvier délégué général à l'outre-mer accompagné de mme marie-pierre campo (voir le dossier)
- Audition de m. michel paillard département des énergies renouvelables marines institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ifremer (voir le dossier)
- Audition de m. vincent trelut directeur du développement eramet accompagné de m. alexandre vié (voir le dossier)
- Audition de m. bruno martel-jantin adjoint au chef du service ressources minérales bureau de recherches géologiques et minières brgm (voir le dossier)
- Audition de m. jacques peythieu vice-président stratégie et développement areva mines accompagné de mm. guillaume renaud et christian polak (voir le dossier)
La réunion
La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- Audition de M. Vincent Bouvier délégué général à l'outre-mer accompagné de Mme Marie-Pierre Campo
La zone économique exclusive des outre-mer : quels enjeux ?- Audition de M. Vincent Bouvier délégué général à l'outre-mer accompagné de Mme Marie-Pierre Campo

Nous voilà à nouveau réunis pour trois jours de travaux en séance plénière de notre délégation. La rencontre riche et passionnante organisée hier avec l'Institut national de l'audiovisuel sur le thème des mémoires audiovisuelles des outre-mer donnera lieu à des actes assortis d'un DVD, comme nous l'avions fait pour la rencontre du 9 mai dernier.
Nous renouons maintenant avec le thème des zones économiques exclusives et de leurs ressources. Les auditions prévues se concentrent sur les sujets miniers et les énergies marines, c'est-à-dire les perspectives d'avenir.
Jeudi matin, nous auditionnerons deux ministres du gouvernement polynésien par visioconférence, par souci d'économie, tant pour le budget du Sénat que pour celui de la Polynésie française.
Je souhaite la bienvenue au délégué général à l'outre-mer, Vincent Bouvier, que nous avons récemment entendu sur les perspectives européennes des régions ultrapériphériques et je le remercie de sa disponibilité.
Notre délégation a désigné trois co-rapporteurs sur les ZEE : Jean-Étienne Antoinette, Joël Guerriau, qui a succédé à Jean-Marie Bockel, et Richard Tuheiava.
Merci de m'auditionner sur ce sujet stratégique pour nos outre-mer. Ceux-ci représentent 97 % de notre zone économique exclusive, et c'est grâce à eux que la France dispose du deuxième domaine maritime mondial. Face à la concurrence mondiale, nous devons inventorier, protéger et exploiter nos ressources.
Quelles sont les orientations majeures de notre politique maritime ? Notre stratégie nationale pour la mer et le littoral se décline par bassin, dont quatre bassins ultramarins : les Antilles, la Guyane, l'Océan Indien et Saint-Pierre-et-Miquelon.
À la suite du Grenelle de la mer, le Comité interministériel de la mer du 8 décembre 2009 a mis en exergue la nécessité de développer la politique marine des outre-mer, et adopté un Livre bleu, qui doit aussi être décliné par région.
Cette orientation a été confirmée par la réunion du 11 juin 2011, lors de laquelle a été décidée la réforme portuaire. Bien entendu, la politique nationale doit être coordonnée au niveau européen : en octobre dernier, les ministres de la mer des États membres ont adopté à Limassol une déclaration commune qui insiste sur l'innovation et le développement économique.
Enfin, lors de la campagne présidentielle, M. Hollande a défini les trois axes de notre politique maritime : gérer et protéger notre important littoral, exploiter durablement nos ressources marines, renforcer la gouvernance de la mer et du littoral.
En tout état de cause, la mer est l'un des grands enjeux du XXIe siècle.
La délégation ayant déjà travaillé sur la pêche et l'aquaculture, je me limiterai aux ressources énergétiques.
D'abord, les hydrocarbures. Ils sont présents aux îles Éparses, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, surtout, en Guyane, à 150 km au large de Cayenne. Le pétrole sera peut-être à la Guyane ce que le nickel fut à la Nouvelle-Calédonie... Cette découverte nous impose à la fois un devoir de gestion et de protection. Pour la Guyane, un arrêté du 22 décembre 2011 a prolongé de cinq ans un permis de recherche accordé à Shell, ou plus exactement à un consortium qui réunit entre autres Shell et Total. Six autres demandes sont en cours d'instruction. Deux arrêtés de janvier 2011 et de mars 2012 ont accordé des autorisations de travaux. Celles-ci ont été attaquées par des associations. C'est pour examiner les conséquences de l'exploration qu'un comité de suivi et de concertation avec les partenaires a été créé. L'État a également confié à Mme Duthilleul, ingénieur général des mines et présidente de l'ERAP, une mission d'accompagnement pour faire bénéficier la Guyane des retombées du pétrole et concilier impératif économique et devoir de protection de l'environnement ; elle a rendu un rapport d'étape en janvier 2012. La commission de suivi et de concertation se réunit régulièrement ; quatre groupes de travail ont été créés : sécurité et environnement, recherche, formation et retombées.
Deuxième ressource : les énergies marines renouvelables. L'objectif fixé par le Grenelle est très ambitieux : l'autonomie énergétique en 2030, 50 % en 2020. Nous en sommes loin. Énergie houlomotrice, climatisation par les eaux en profondeur, biomasse marine, éoliennes off shore, le panel est large. Sont développés en outre-mer de nombreux projets innovants : énergie thermique marine en Guyane et à la Martinique, climatisation par les profondeurs marines à La Réunion : c'est le projet SAC, Seawater Air Conditioning. Cela dit, restent des obstacles à surmonter, comme les freins technologiques - pour adapter, par exemple, l'éolien marin aux cyclones -, les tarifs de rachat et la prise en charge du risque industriel. Pour l'heure, de très grands groupes privés et parapublics s'intéressent à ces projets ; c'est dire leur intérêt.
Troisième ressource, les biotechnologies marines. Ainsi, les algues ont des débouchés sanitaires - la station marine de Roscoff exploite les oeufs des étoiles de mer pour fabriquer des médicaments anti-tumoraux - énergétiques, cosmétiques, alimentaires... Nous en sommes encore au stade de l'expérimentation.
Quatrièmement, les ressources minérales profondes : nodules polymétalliques, terres rares et encroûtements sulfureux difficiles à exploiter mais intéressants. Au large de Clipperton et de Wallis-et-Futuna, les ressources en nodules polymétalliques sont importantes. La concurrence est rude : les Chinois qui détiennent 35 % de la ressource en terres rares, l'exploitent à 95 %. Raison de plus pour développer cette activité.
J'en viens au contexte juridique. Il convient de le stabiliser rapidement, notamment sur la répartition des compétences en matière minière, entre État et collectivités. Le 5 septembre, la ministre de l'écologie a présenté les grandes lignes de la réforme du code minier. Un projet de loi est attendu pour début 2013. Ce texte a plusieurs objectifs : mise en conformité du code minier avec la Charte de l'environnement, notamment son article 7, révision des procédures, prise en compte des enjeux environnementaux, refonte du droit des installations classées, réforme de la fiscalité minière, adaptation aux spécificités ultra-marines, responsabilité sociale des entreprises.
Un groupe de travail informel, présidé par un conseiller d'État, M. Tuot, et auquel participe la délégation, travaille à un avant-projet de texte avec Mme Duthilleul. Parallèlement, le gouvernement a lancé un travail de codification de la partie réglementaire du code minier. Enfin, la répartition des compétences entre l'État et les collectivités est à l'étude. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le transfert est déjà achevé. Cela pose question en Polynésie : comment définir les ressources stratégiques qui relèvent de l'État ? Les terres rares en font-elles partie ? A priori, oui, mais la question n'est pas encore tranchée.
Je termine sur les moyens.
Nous avons des ressources considérables outre-mer, pour l'innovation technologique et le développement économique de la France et de chacun des territoires d'outre-mer. L'outre-mer est une chance pour la France, mais la mer est aussi une chance pour l'outre-mer ! Nous avons aussi un devoir de protection, sans quoi tout cela restera un voeu pieux. Si nous voulons protéger le deuxième domaine maritime mondial de la pêche illégale et du pillage, nous devons avoir des forces de souveraineté suffisantes : par exemple, un nombre suffisant de bateaux de la Marine nationale. Le sujet est d'actualité à l'heure où l'on révise le Livre blanc de la défense. Dans les difficiles arbitrages à venir, il faudra insister sur la priorité de l'outre-mer.

Merci pour cet excellent exposé. Au fil des auditions se dégage une tendance : tout le monde se félicite de ce que la France, grâce à l'outre-mer, détient le deuxième domaine maritime mondial. Mais quid de l'enracinement de cette politique ? Les collectivités guyanaises n'ont pas été informées des permis de recherche délivrés sur les hydrocarbures, sinon par la presse. Une concertation préalable est nécessaire ; la LODEOM la prévoit d'ailleurs pour les permis d'exploitation mais l'on attend encore ses décrets d'application. Sans concertation, il est impossible de mettre en place les filières, d'accompagner cette industrie.
Aujourd'hui, le port d'attache de la plate-forme guyanaise est Paramaribo, au Surinam, et non Cayenne. À quand un tournant dans la gouvernance et dans l'enracinement des projets ?
Dernier point, où en est la coopération avec les pays limitrophes, celle de la Guyane avec le Brésil et le Surinam ou celle de La Réunion avec Madagascar ?

À l'évidence, l'outre-mer présente de grandes potentialités pour la France, mais concrètement, quels sont les projets en matière de terres rares, de biotechnologies marines ? Avons-nous une stratégie pour mettre en valeur ces ressources ?

L'outre-mer est-il intégré dans la réflexion sur la révision du Livre Blanc ?

Parlons clair : les ultramarins que nous sommes avons le sentiment, voire la certitude que nos intérêts sont insuffisamment pris en compte. À votre avis, comment faire pour ne pas être perpétuellement à la remorque ? Nous essayons de parler d'une seule voix sur la pêche...
Un contre-amiral est désormais, je crois, secrétaire général adjoint de la mer. Enfin, on agit ! On reconnaît l'importance de la mer.
Je conviens que la prise de conscience du fait maritime est récente. En 2008, on avait d'abord oublié l'outre-mer dans le Livre Blanc de la défense ! Concernant les hydrocarbures, il y a une volonté de concertation, de régler la question de la répartition des compétences. L'outre-mer a aussi besoin de ports adaptés aux besoins de développement. Mais les territoires devront se mettre d'accord : il n'y aura pas de grands ports partout.
La coopération ? Oui, il faut la renforcer avec les pays voisins, l'Europe et les grandes organisations non gouvernementales internationales de protection de l'environnement. Un exemple, nous coopérons avec la Dominique sur un projet d'exploitation géothermique.
La stratégie ? L'État, via ses grands instituts, soutient la démarche des grandes entreprises. Néanmoins, certains domaines comme les biotechnologies sont au stade de l'expérimentation ; d'où parfois une impression de tâtonnement.
Le Livre Blanc de la défense? Pour participer à un groupe de travail sur sa révision, je mesure qu'il y a une volonté, pour le dire brutalement, de ne pas oublier l'outre-mer contrairement à ce qu'il s'était passé la fois précédente.
Monsieur Vergoz, je l'ai dit, la prise de conscience de l'importance de la mer est récente. L'État a un rôle essentiel à jouer, mais les collectivités doivent aussi prendre leurs responsabilités.

La France paraît absente de la compétition internationale. Quand elle cherche à combler son retard, elle commet souvent des erreurs : voyez la Polynésie française. Avons-nous donc une stratégie ? Où en est le projet Extraplac ? Des Japonais ont trouvé les terres rares chez nous... D'où ma proposition de loi tendant à rendre la Polynésie française compétente en matière de ressources stratégiques, à l'exclusion des minerais nucléaires.
Dans le cadre du groupe informel sur le code minier, pourquoi mettre l'outre-mer à la fin ? L'administration doit changer d'approche.
La France est-elle en retard ? En tout cas, nous voulons une vraie stratégie de développement maritime. Quant au projet Extraplac, il est toujours d'actualité : nous discutons avec les Canadiens.
La répartition des compétences est une question centrale, qui concerne aussi la Polynésie française. Le sens du mot « stratégique » reste à définir.
La Jamaïque a accordé un permis d'exploitation à L'IFREMER sur la dorsale océanique. Cela aura des implications indirectes sur l'outre-mer.

Les Japonais ont opéré des prélèvements au large des Marquises sans autorisation. Nous retrouvons la problématique du Livre Blanc : comment protéger nos ressources ?
Vous connaissez certainement les difficultés budgétaires. Il faudra faire des choix. Les projets industriels et énergétiques constituent de vraies vitrines technologiques, des premières mondiales parfois. En matière de recherche, la France est très bien placée.

Un rapport de Jacques Blanc en 2011 mettait en exergue la vulnérabilité du marché européen en ce qui concerne l'approvisionnement en ressources minérales destinées aux technologies de pointe. Une volonté de diversification des provenances existe-t-elle ?
Nous sommes certes dépendants, mais nous n'avons pas de difficultés d'approvisionnement à ce jour.
Certes, mais dans un contexte de raréfaction des ressources.

Pour les enjeux marins, l'État a-t-il une stratégie de financement des projets ? La politique fiscale d'aide au photovoltaïque a été erratique ...
Il faut des solutions acceptables, notamment sur les tarifs de rachat. L'ADEME a des moyens, certes insuffisants. Nous voulons aussi recourir aux fonds européens. Rien n'est pire que l'hésitation : le ministre de l'outre-mer a rappelé son souci de stabiliser le droit, et notamment les règles fiscales.

Merci de vos éclaircissements. Nous n'en sommes qu'au début du chemin. Tirons mieux parti des richesses de l'outre-mer !
Audition de M. Michel Paillard département des énergies renouvelables marines institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ifremer
Audition de M. Michel Paillard département des énergies renouvelables marines institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ifremer

Que fait-on des ressources marines de l'outre-mer ? Pensez-vous dresser un état des lieux des énergies marines renouvelables, des atouts ultramarins, de la concurrence internationale ? Quels sont les projets de l'IFREMER les plus aboutis ? Quelles sont ses perspectives à long terme ? Quels sont les aménagements envisagés pour mieux exploiter ces ressources - infrastructures, formation, etc. ?
Je me limiterai aux énergies marines.
L'éolien se décline en éolien posé, jusqu'à 40 m de profondeur, et flottant. On produit aujourd'hui principalement en Europe, mais aussi ailleurs, plus de 4 000 MW en éolien offshore, plus de 6 000 MW sont en construction et des dizaines de milliers en projet. La filière a atteint sa maturité, ce qui ne signifie pas que la recherche cesse. Bientôt, on ira vers des installations de 10 MW qui feront jusqu'à 180 m de diamètre, contre 6 MW pour 120-150 m de diamètre aujourd'hui. Il y a deux projets français d'éolien flottant, technique qui permet d'aller plus loin des côtes. Cela évite des conflits avec la pêche ou la protection du paysage.
J'en viens à l'énergie marémotrice. L'usine de la Rance date de 1966, elle avait été inaugurée par le général de Gaulle. Il y a aussi des installations récentes, en Corée par exemple, des projets au Royaume-Uni, mais cette technique très intéressante pose des problèmes environnementaux.
Les hydroliennes tirent parti de l'énergie cinétique, des courants marins. Il existe une dizaine de projets pionniers, et un projet de parc au large de la Bretagne ; il faut encore faire baisser les coûts. Le potentiel est faible au niveau mondial, mais comme les marées, les courants sont prévisibles : on sait donc ce qu'ils vont produire.
En revanche, l'énergie de la houle représente un potentiel immense, très bien réparti sur toutes les mers du monde ; le jour où les techniques seront prêtes leur rentabilité sera grande, notamment dans des îles ou archipels isolés.
Quant à l'énergie thermique des mers, le projet d'une centrale de 5 mégawatts à Tahiti n'a pas été financé à cause du contre-choc pétrolier, mais de nouveaux projets sont en cours.
Enfin, l'énergie osmotique est très difficile à exploiter. D'où le désintérêt des énergéticiens, sauf en Norvège.
La France est longtemps restée très en retard au plan technologique ; les Britanniques étaient leaders. Le Grenelle a changé les choses. Les Allemands et les Danois sont les leaders mondiaux de l'éolien, mais les Français commencent à s'y intéresser. AREVA a racheté un fabricant allemand, des appels d'offres sont lancés. Alsthom a créé une machine et veut la construire en France. Idem pour l'hydrolien. Bref, une filière industrielle se met en place, grâce à la contribution de grands industriels. Jusqu'à il y a peu, EDF était seule. STX SA est aussi partie prenante du projet de parc flottant à la Martinique. Il y a désormais plus de visibilité sur le marché mondial, et les entreprises françaises veulent conquérir des parts de marché.
L'IFREMER a des délégations dans la plupart des territoires d'outremer. Il s'intéresse aux énergies maritimes depuis la fin des années 1970, est aujourd'hui impliqué dans toutes les filières, à des degrés divers. Il participe aussi à des projets étrangers. Son originalité est d'être très pluridisciplinaire. Sur les matériaux composites, par exemple, il a une expertise très ancienne, liée au pétrole, valorisée aujourd'hui dans la recherche sur les énergies renouvelables. Nous avons aussi des spécialistes de la pêche. Rien ne marchera sans concertation avec les acteurs locaux.
L'IFREMER n'est pas initiateur de projets : il est sollicité par des industriels, notamment pour les investissements d'avenir.
En outre-mer, les projets sont encore rares, car les techniques ne sont pas encore au point. Un projet de climatisation par pompage de l'eau froide existe en Polynésie à l'Hôtel Intercontinental de Bora-Bora. À La Réunion, nous travaillons sur l'énergie de la houle, sur l'énergie thermodynamique à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le pompage destiné à la climatisation. À la Martinique, il y a un projet d'exploitation de l'énergie de la houle. En Guyane, rien. En Nouvelle-Calédonie, un projet d'exploitation des marées est en sommeil. Sur la plupart de ces projets, l'IFREMER n'a pas été sollicité. En Polynésie française, nous étudions le potentiel des passes des lagons, qui peut être intéressant à exploiter localement. Des industriels métropolitains ont exprimé leur intérêt.
En Nouvelle-Calédonie, il existe un projet de climatisation et un centre d'énergie de la houle, mais l'IFREMER n'est pas concerné.
Le jour où la filière aura atteint sa maturité, les choses changeront, mais il peut être contreproductif d'aller trop vite.
Une installation au Portugal a dû être démantelée, la technique n'étant pas encore fiable. À La Réunion, on songe à créer une unité pilote en 2014.
L'énergie thermique des mers repose sur la différence de température entre la surface et les fonds marins. C'est une technologie très capitalistique ; de plus, elle exige de capter énormément d'eau.
L'énergie consommée est moindre que l'énergie produite, la preuve en est faite depuis 1930 par Georges Claude.

Comment l'IFREMER accompagne-t-il un projet ? Qui les lance, et quelles sont vos relations avec les industriels ?
En outre-mer, il importe de bien connaître la ressource, donc de développer des modèles. Sur cette recherche en amont, l'IFREMER est moteur. En revanche, nous ne développons pas de modes d'exploitation pour les vendre aux industriels, mais nous y songeons.
Les premiers systèmes d'exploitation de l'énergie de la houle ont été élaborés en laboratoire, par des gens qui ne connaissaient pas la mer. Faute d'ingénierie off shore, ce fut un échec. C'est la raison pour laquelle les industriels viennent nous voir : le bassin de Brest a servi pour tester de nombreux appareils.
Bref, nous sommes associés à la production du prototype. Nous n'avons pas vocation à développer un projet industriel. En revanche, nous pouvons apporter une assistance à un maître d'ouvrage, par exemple un territoire. C'est le cas en Polynésie.

À vous entendre, il n'y a aucune stratégie globale, c'est du coup par coup... C'est surprenant compte tenu de la dépendance insulaire à l'énergie fossile. Qu'attend-on ? Les régions établissent des schémas régionaux de développement des énergies renouvelables. À quoi cela sert-il, sans gouvernance globale ?
Les schémas régionaux concernent les énergies renouvelables existantes. Du fait que les énergies marines sont émergentes, elles sont seulement évoquées sans être programmées. Je sais que l'ADEME est intervenue à La Réunion, mais j'ignore dans quelles conditions. Dans la plupart des cas ce sont des industriels locaux qui initient la démarche.
Les conditions sont très différentes outre-mer : la houle, les cyclones... d'où l'importance de mener des tests dans les bassins avec les opérateurs locaux en coopération avec les pôles de compétitivité et les centres de recherche en métropole. Le pôle Mer Bretagne échange déjà avec la Polynésie française, mais tout cela est, encore une fois, émergent : les pôles de recherche ou de compétitivité outre-mer ont été créés récemment.

Il serait bon d'établir un état des lieux précis des énergies susceptibles d'être développées à moyen et long terme ainsi que des spécificités locales. Les élus que nous sommes en ont besoin pour soutenir la filière.
La commission européenne a réalisé en 2007 une étude sur le potentiel des régions ultrapériphériques. Cela dit, nous ne disposons d'aucune étude prospective car de nombreuses filières ne sont pas mûres. Mais les énergies marémotrice, éolienne ou hydrolienne sont pour demain : les premières fermes sont prévues en 2020 au large de Cherbourg, selon Alsthom.
L'énergie houlomotrice est plus complexe ; pour être fiable, il faut que le démonstrateur survive à la vague cinquantennale. Le projet Palemis sera prêt dans vingt ans. Vient ensuite la mise au point du récupérateur et la phase industrielle. Entre les deux, l'éolien flottant ? Sera-t-il accepté ? Peut-être dans trente ans quand l'énergie sera trop chère...
Les courants ne sont pas assez forts outre-mer, leur énergie n'est pas exploitable.
Reste l'énergie thermique de la mer, très intéressante aux Antilles et, surtout, en Polynésie française.
Monsieur Vergoz a raison : les territoires doivent afficher des objectifs précis programmés dans le temps.

Il faut travailler avec nos voisins, comme la Martinique et la Guadeloupe avec Dominique sur la géothermie. Nous sommes loin d'avoir atteint les objectifs du Grenelle : 50 % d'autonomie énergétique en outre-mer. Merci de nous avoir éclairés sur l'éventail des possibilités.
La compétition internationale pourrait accélérer la maturation des énergies marines. Il faut investir dans la recherche, comme l'a fait la Grande-Bretagne pour exploiter ce potentiel.

Nous étudions depuis cinq mois l'importante question des zones économiques exclusives. Monsieur Trelut nous parlera des ressources minières outre-mer. La parole aux industriels !
ERAMET est un groupe métallurgique, de la mine à la transformation métallurgique avancée - pour l'aéronautique, par exemple - jusqu'au recyclage.
Avec 47 sites industriels, nous sommes présents dans 20 pays, dont la Chine, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, une collectivité française qui a un statut très particulier.
Pour nous, c'est un gros marché : ce pays consomme la moitié des ressources de nickel et de manganèse. Nous y avons trois usines de manganèse. En Indonésie, les Chinois nous font de la concurrence. Ils sont très intéressés, en particulier, par les ressources marines.

Alors que personne en France n'investit dans les nodules polymétalliques...
Les ressources minérales profondes sont de trois sortes : les sulfures hydrothermaux sont liés à l'activité volcanique ; on peut exploiter les sites éteints entre 1 500 et 2 000 mètres de profondeur, ce qui est raisonnable. Ensuite, les nodules polymétalliques, dont on me parlait déjà à l'université dans les années 1970. Enfouis à 4 500 m, on ne sait comment récupérer ces cailloux dispersés sur le sol, qu'on trouve notamment au large de l'îlot de Clipperton. Des demandes de permis sont déposées, mais uniquement pour verrouiller l'accès à ces ressources. Enfin, les encroûtements cobaltifères dans les marges continentales, par exemple, au large de Tahiti, sont plus accessibles. Leur point commun est d'être situés à des profondeurs plus importantes que celles des mines marines existantes : 100 à 150 mètres pour les diamants dans l'Atlantique au large de l'Afrique australe, idem pour l'extraction de sables de construction en Bretagne.
La France n'est pas en retard : personne à ce jour n'exploite de mines marines profondes. Deux sociétés juniors, Nautilus Mineral et Neptune, y travaillent. Des études sont en cours, les engins sont là puisqu'on extrait du pétrole off-shore à des profondeurs bien plus grandes que 1 500 mètres, mais personne n'a encore lancé d'exploitation.
La Chine a déposé des permis d'exploration dans les eaux internationales auprès de l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM), qui dépend de l'ONU. Sa zone économique exclusive, pour les minerais profonds, n'est pas très intéressante. Elle n'est donc pas spécialement en avance...
En revanche, la France dispose de gisements de sulfures hydrothermaux grâce à ses îlots volcaniques... La France a donc peut-être plus de perspectives avec la Polynésie française et Wallis-et-Futuna que le Japon, qui n'a pas de zones aussi prometteuses. De plus, nous ne sommes pas en retard technologiquement, grâce à notre compétence en ingénierie marine.
Certes, mais ces minerais marins ne sont pas nécessaires pour couvrir les besoins de la planète : ce n'est pas comme le pétrole....
La Chine détient un tiers des terres rares, mais des milliers de géologues arpentent le monde pour trouver de nouveaux gisements. Et ils en trouvent... Si la France a des ressources, cela réduira notre dépendance et sans être une nécessité pour l'approvisionnement, les terres rares seraient également l'occasion de développer une filière industrielle.
Certes ! Personne n'a dressé un inventaire précis des ressources marines dans notre zone économique exclusive au demeurant très vaste. En toute hypothèse, l'effet environnemental de leur exploitation sera moindre que sur terre. D'autant qu'on espère trouver des métaux à forte teneur affleurant les fonds marins, de même que les Égyptiens ou les Crétois de l'Antiquité trouvaient de l'or, de l'argent ou du cuivre à portée de main. Actuellement, les mines de cuivre terrestres - c'était le cas de la mine de Falun, en Suède, pays qui n'est pas réputé pour son laxisme environnemental - exigent la manipulation de millions de tonnes de roches et une énorme consommation d'eau douce.
Depuis 2005, la Chine a changé le monde de la mine : la demande augmentant, les ressources terrestres s'épuisent et la teneur des minerais restant à exploiter diminue. À long terme, nous en viendrons donc aux minerais sous-marins.

Dispose-t-on des engins nécessaires, ou la recherche doit-elle progresser ?
Il faut encore faire de la recherche-développement en France. Après la phase d'exploration, on pourra se poser la question de l'exploitation, et faire des essais.
Elle n'est pas en retard, sauf peut-être dans telle ou telle technique particulière. Des partenariats avec d'autres pays sont d'ailleurs envisageables. Nos connaissances actuelles permettent d'élaborer un socle technologique français.
En effet : ne ratons pas le coche.
Nous n'avons pas encore d'activités dans la zone économique d'outre-mer. La concurrence s'exerce surtout entre les États, non entre les sociétés privés. Le projet le plus mûr est celui de sulfure de cuivre et de zinc en Papouasie ; il n'y a pas de verrou technologique, non plus qu'à Wallis. La question est celle des moyens financiers et la connaissance des ressources. Nous n'avons pas besoin d'évolutions fiscales, mais d'un partenariat renforcé : le consortium actuel est trop étriqué, nous ne sommes plus que trois. Je répète que le problème est financier : des puissances étrangères misent beaucoup plus de moyens sur ces projets d'avenir.
Le code minier a le mérite d'exister. Le domaine sous-marin reste à défricher. Il est difficile de prévoir à l'avance. Une question importante est celle des retombées pour les collectivités. En l'état actuel du droit, rien n'interdit un partenariat avec Wallis-et-Futuna. Peut-être l'encadrement pourrait-il être amélioré.
Quoi qu'il arrive, il faudra tenir compte des spécificités de l'exploitation sous-marine. Nous en sommes encore à un stade très préliminaire. Quand viendra le temps de l'exploitation, alors il faudra veiller à l'impact environnemental, qui reste mal connu.

Des activités sont-elles prévues dans notre zone économique exclusive ?
Si le partenariat à Wallis-et-Futuna se confirme, oui. Pour l'heure, nous ne voulons pas nous disperser.

Je participe au groupe de travail informel sur la réforme du code minier. Le principe de précaution doit prévaloir, lorsqu'on ne maîtrise pas le risque. Il y a eu des études sur le cobalt et le manganèse en Polynésie : les ressources y sont les plus élevées au monde.
Le recyclage est un enjeu immense. Quels acides employer pour extraire les métaux rares de la boue ? Les techniques sont-elles au point ?
En effet, on ne doit se lancer dans une exploitation que si l'absence de risque est avérée. La France doit-elle être pionnière ? Ce n'est pas sûr.
L'exploration a très peu d'impact sur l'environnement : on se borne à prélever des échantillons au fond des mers avec des sous-marins de poche. L'exploitation, c'est autre chose.
Tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas exploiter. Mais il faut chercher pour savoir, et faire des essais ! C'est là que se situe le débat. Refuser même les essais est contraire à l'esprit du principe de précaution. Si pareille règle devait être instaurée, autant le savoir au plus vite, nous éviterons de perdre de l'argent ! Nous avons suffisamment de travail ailleurs.
Des biologistes sont associés à chaque campagne, pour comprendre ce qui se passe dans ces zones.
Le recyclage des terres rares va progresser, celui des métaux comme le cobalt existe déjà. L'enjeu sous-marin est différent : c'est d'avoir du minerai très riche, facilement extractible.
Entre la production initiale et le recyclage, la demande a augmenté : le recyclage ne pourra jamais suffire aux besoins.
Ce ne sont pas des terres rares que l'on a trouvé à Wallis. Encore une fois, ce sont des minerais riches en surface que nous cherchons. Descendre à 3 000 m pour trouver un peu de terres rares ne présente aucun intérêt.

Il faut être demain en position de force, notamment sur les matériaux stratégiques. À vous entendre, il s'agirait d'exploiter à un coût moindre des minerais riches.
Mais aussi de construire des filières high tech et de mettre au point des techniques écologiquement responsables.
Je ne parlais que des activités sous-marines, où l'on est loin d'avoir établi quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques.
Nous disposons de rapports de sociétés privées, mais seuls les instituts d'État ont une vue d'ensemble ; l'IFREMER pourrait vous renseigner sur l'activité de L'IFREMER japonais...
Nous en sommes à vingt millions, rien que pour trouver des gisements. L'exploitation en coûtera des centaines, et au minimum un milliard.

Nous sommes curieux d'entendre l'avis du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur les réserves de notre zone économique exclusive outre-mer.
Vous m'avez invité en tant qu'adjoint au chef du service Ressources minérales du BRGM ; depuis, les ressources minérales ont été regroupées avec la géologie et la géothermie. Même si mes compétences sont plus commerciales que scientifiques, je suis prêt à alimenter le débat.
Le BRGM compte 1 100 salariés, dont 700 ingénieurs et techniciens. Nous sommes présents dans toutes les régions et la plupart des territoires d'outre-mer, sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon ; nous n'avons plus de représentation permanente en Polynésie. Notre chiffre d'affaires outre-mer représentait 6 millions d'euros en 2011, sur un total de 140 millions : 2 millions à La Réunion et à Mayotte, 1,5 à la Martinique, 1 en Guyane, 0,9 en Guadeloupe et 0,3 en Nouvelle-Calédonie.
Nos missions sont l'appui aux politiques publiques, la recherche et les activités à caractère commercial : cela vaut aussi pour l'outre-mer. Notre personnel en outre-mer est très limité et dispersé : 35 personnes, dont 10 volontaires du service civique.
Le BRGM, outre-mer, se préoccupe de géologie, de maîtrise des risques, de gestion de l'eau et des ressources minérales. Sur ce dernier point, nous sommes surtout actifs en Guyane. En Nouvelle-Calédonie, nous n'avons qu'un agent détaché.
Notre activité minière outre-mer est prioritairement orientée vers l'aide aux politiques publiques régaliennes, d'où nos fortes relations avec les services d'État et la faiblesse de nos relations contractuelles avec les régions.
Depuis la fin des grands inventaires miniers des années 1970, le BRGM ne s'intéresse plus guère aux ressources minérales en Guyane, même s'il apporte un appui technique à l'exploitation légale de l'or. Cela dit, M. Arnaud de Montebourg, ministre du redressement productif, nous a récemment sollicités pour relancer l'inventaire minier en France, y compris en outre-mer. On reverra donc le BRGM en Guyane.
Le BRGM s'implique aussi dans la gestion des ressources en granulats. Il est associé à ERAMET dans un projet sous-marin à Wallis-et-Futuna, en lien avec L'IFREMER.
Dans l'ensemble, par tiers. Les activités commerciales nous servent à équilibrer nos comptes et donc à amplifier nos actions publiques et scientifiques.
Nous avons une stratégie opportuniste : nous faisons feu de tout bois. Cela dit, nous nous efforçons d'être cohérents avec notre mission publique. Les mêmes questions nous sont posées par nos clients privés et nos tutelles publiques sur la sécurité d'approvisionnement ou la stratégie de développement minier : nous leur répondons en fonction du même socle de connaissances.
Certains, oui. Iamgold, qui a connu des déboires en Guyane, a songé à nous confier les études environnementales sur le site de Grand Caïman, mais nous avons refusé. Nous sommes beaucoup plus sollicités que par le passé, notamment en Guyane.

Comment arbitrez-vous donc entre les collectivités publiques et les sociétés privées? Qui décide ?
Tout dépend du directeur régional, qui est le mieux placé pour apprécier les enjeux au regard de nos activités. Il est le premier à recevoir les sollicitations des préfectures pour l'appui aux politiques publiques dans la prévention des risques naturels et le secteur minier. Si une activité du BRGM peut mettre en difficulté une de nos antennes par rapport à la tutelle, nous la limitons. Nous privilégions l'appui au développement des territoires. L'activité commerciale ne vient qu'après, s'il ne remet pas en cause notre stratégie.

Les inventaires sont-ils publics ? N'importe qui peut-il savoir où se trouve tel ou tel métal, ou y a-t-il une sécurisation ? Je pense aux orpailleurs clandestins...
Tous les inventaires sont publics. Détenteur de ce patrimoine, nous sommes extrêmement sollicités pour le mettre à disposition. Notre tutelle a rappelé qu'il n'y avait aucune limite à la mise à disposition à condition d'assurer la traçabilité des demandes.
Quotidiennement, cela pose problème. Répondre aux appels téléphoniques et organiser la consultation des documents a un coût...

Quid du domaine marin ? Y-a-t-il des échanges d'information avec le Brésil ou le Surinam ?
Le domaine marin n'est pas la spécialité du BRGM même si une cartographie des fonds de Mayotte établie à partir de techniques géophysiques figure dans notre rapport d'activités. De manière générale, l'IFREMER a compétence sur la mer. Nous collaborons sur la frange côtière et l'exploitation des granulats ; nous sommes associés au projet mené à Wallis-et-Futuna où nous nous occupons des aspects géologiques.
Les collaborations interrégionales ? Elles sont faibles. Pour avoir travaillé en Guyane, j'estime qu'elles devraient l'être davantage dans le secteur minier avec le Brésil. Il y a des synergies à développer, bien que les frontières limitent les collaborations pour des raisons économiques et financières.
Le BRGM a mis en place un atelier interne. Je n'y suis pas assez impliqué pour vous en dire plus. La question du guichet « H » et de la mise à disposition de l'information nous occupe et pose de nombreuses questions. Est-ce judicieux de prévoir une mise à disposition complète ? Il n'y a pas d'obligation, actuellement, pour les données de sondage et certaines données d'exploration. Si oui, selon quelles modalités pratiques ? Faut-il élargir les missions du guichet « H » au-delà des données juridiques ?

Comment concilier les activités commerciales avec la protection des intérêts nationaux ?
Certaines de nos missions d'appui aux politiques publiques sont confidentielles ; c'est le cas de la mission d'intelligence économique sur les ressources minérales. Généralement, la tutelle nous demande de décliner nos rapports sous une forme adaptée à la diffusion publique.

Le Centre d'analyse stratégique fait-il partie de vos clients politiques ?
Audition de M. Jacques Peythieu vice-président stratégie et développement areva mines accompagné de Mm. Guillaume Renaud et christian polak
Audition de M. Jacques Peythieu vice-président stratégie et développement areva mines accompagné de Mm. Guillaume Renaud et christian polak

Bienvenue à Monsieur Jacques Peythieu d'AREVA Mines. Votre entreprise est peu engagée dans la zone économique exclusive française, mais elle le sera peut-être demain. Le potentiel serait riche...
Merci de me recevoir. M. Guillaume Renaud, qui s'occupe des relations publiques, et M. Christian Polak, chargé de la veille stratégique sur les métaux, pourront aussi répondre à vos questions.
Jusqu'au début 2012, l'activité d'AREVA se concentrait sur deux métaux, l'or et l'uranium ; elle représentait 16 % de notre chiffre d'affaires. Nous avons vendu la partie « or » cet été dans le cadre d'un plan de développement stratégique pour financer nos autres activités. Notre présence est réduite à zéro outre-mer car on n'y a malheureusement pas trouvé d'uranium.
Pour des raisons historiques, AREVA s'est spécialisée dans le nucléaire. Nous avons choisi l'or pour nous diversifier.

La discussion sera limitée... Les ressources marines vous intéressent-elles ?
Nous avons des accords avec d'autres entreprises sur des sites où il y a aussi de l'uranium. Par exemple, avec ERAMET au Gabon où l'on a trouvé un gisement de terres rares et de manganèse. En revanche, on n'a pas trouvé d'uranium dans les gisements sulfurés des fonds marins.

Que pensez-vous de la réforme du code minier ? Y êtes-vous associés ? Est-ce un enjeu pour vous ?
Nous sommes évidemment concernés puisque nous sommes une société minière. Nous avons extrait 75 000 tonnes d'uranium en France, ce qui nous a permis d'être leader après la guerre. Nous n'excluons pas d'exploiter de nouveau ce minerai dans l'Hexagone. Nous sommes associés à la réforme, via la Fédération des minerais, des minéraux industriels et métaux non ferreux (FEDEM). Le droit actuel nous convient, même s'il faut y intégrer davantage les questions environnementales, conformément à une tendance mondiale.
Au Kazakhstan, nous sommes associés à l'État kazakh. Au Canada, il faut être Canadien pour exploiter l'uranium : un partenariat était donc indispensable. Au Niger, nous avons accordé une participation gratuite à l'État, sous la forme d'un free carry, à hauteur de 10 % ; c'est souvent le cas en Afrique. À chaque fois, nous nous adaptons. Faut-il prévoir une participation gratuite en France ? Je ne le crois pas.

Vous avez entendu parler du projet Iamgold en Guyane : les collectivités locales doivent-elles avoir un rôle dans la gouvernance ?
La question est politique ; il est difficile à un industriel d'y répondre...
Il est légitime que l'État ou les collectivités locales perçoivent une rente minière, qui peut prendre la forme de participations gratuites ou de royalties ; le Niger demande les deux. En Australie, il n'y a pas de participation au capital, mais les royalties sont plus élevées.
Tout dépend du niveau d'investissement. Une mine de cuivre ou de fer coûte des milliards de dollars. En revanche, en Guyane, l'or peut être exploité par des PME, et la communauté locale peut intervenir.

Qu'avez-vous à dire du recyclage et du procédé qui permet d'extraire les terres rares ? Les impacts environnementaux sont-ils maîtrisés ?
Chaque mine, chaque minerai a sa signature... Le recyclage correspond plutôt à de la sous-production : un métal aide les autres à se développer ; c'est le cas du gisement polymétallique de Mabounié au Gabon. Un savant japonais affirme avoir trouvé des terres rares dans le Pacifique : l'industrie minière a l'habitude d'un travail plus rigoureux. Quant à la crise médiatique des terres rares entre les Chinois et Rhodia, c'est un faut débat.
En revanche, notre expertise sur l'uranium est précieuse pour le gisement du Niger. Nous la développons là-bas pour des raisons plus commerciales que stratégiques.

Rien ne dit qu'on ne trouvera jamais d'uranium dans les fonds marins...
La géologie n'est pas une science exacte, mais a priori, les zones volcaniques des Caraïbes et de Polynésie ne recèlent pas d'uranium. D'ailleurs, celui-ci est soluble et se dépose très mal sur les sédiments ; un point sur lequel le rapport japonais est exact.
Le stockage de l'énergie sous forme d'hydrogène est un secteur prometteur pour l'outre-mer. Nous serions heureux d'être auditionnés sur ce point.