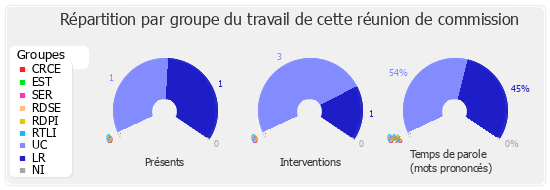Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
Réunion du 23 mai 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Nous recevons aujourd'hui les représentants des organisations syndicales et professionnelles des cadres hospitaliers. Depuis quatre mois, nous travaillons sur le financement des établissements de santé et en particulier sur la tarification à l'activité (T2A). Nous souhaitons connaître votre sentiment sur les vertus de ce système, si elles existent, mais aussi sur ses limites, ses inconvénients, ses conditions de mise en oeuvre, son impact sur les établissements, ses effets pervers et les correctifs qu'il faudrait y apporter.
La T2A a-t-elle eu des effets perceptibles sur la pertinence et la qualité des soins à l'hôpital, sur le parcours de soins coordonné ? Le mode de financement actuel doit-il prendre en compte ces objectifs, par des dotations ou des tarifs ?
Faut-il revoir le périmètre des différentes sources de financement ? La T2A est-elle adaptée à toutes les activités de soins ? Les missions d'intérêt général sont-elles financées de manière satisfaisante ?

Quelle est votre appréciation générale sur le financement des établissements de santé et en particulier des hôpitaux, sur leur budget d'exploitation ? Quelle est votre position sur la T2A ? Quelles sont ses incidences sur l'organisation et le fonctionnement des services de soins, des services de médecine technique, des services logistiques et administratifs ? Sa mise en oeuvre a-telle eu une incidence décisive sur l'activité et l'offre de soins des hôpitaux ? Quelles sont ses vertus, ses limites, ses effets pervers le cas échéant, sur le volume des actes, la qualité et la sécurité de la prise en charge ?
Votre organisation remet-elle en cause le principe même de la T2A et sinon faut-il lui apporter des correctifs et lesquels ?
Je suis directeur du centre hospitalier de Pau. M. Jérémie Sécher, qui m'accompagne, dirige celui de Fontainebleau ; il est également secrétaire régional de notre organisation, dont nous sommes bientôt appelés à devenir, respectivement, président et vice-président.
Les effets de la T2A sont contrastés. Parmi ses effets positifs, elle a permis de dépasser les rigueurs et les contraintes de la dotation globale, de mettre en place des outils très efficaces de connaissance des coûts au sein des établissements hospitaliers. Elle a eu des effets très favorables sur la dynamique d'activité de ces derniers. Sous son empire, les parts de marché de l'hôpital public, notamment en chirurgie, ont progressé.
Au nombre de ses effets pervers figure son caractère inflationniste. Par définition, ce système de régulation provoque une forte tentation de développer l'activité pour assurer la stabilité des ressources. Autres effets pervers, l'instabilité des tarifs et l'inadéquation de ceux-ci avec les coûts, qui conduisent responsables et médecins à développer des stratégies particulières de pilotage. De plus, chacun étant rivé sur la nécessité d'obtenir un minimum de ressources, il y a là un frein à la coopération hospitalière. Quant aux missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation (Migac), elles servent de variables d'ajustement...
Plus précisément, nous constatons un décrochage problématique entre l'échelle nationale des coûts et les tarifs, à quoi s'ajoute une grande imprévisibilité de ceux-ci.
Nous sommes opposés au principe de la convergence tarifaire, qui est délétère pour l'hôpital public. Pour nous, elle est caduque. Les rapports de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances sont constants : elle n'a jamais pu être objectivée, il est extrêmement difficile d'isoler des composantes comme la permanence des soins ou la prise en charge de la précarité.

Parlez-vous de la convergence intersectorielle ? La convergence intrasectorielle devrait être terminée fin 2012 mais elle est en trompe-l'oeil, selon la Cour des comptes, ce qui a rendu plus difficile la convergence intersectorielle.
Tout à fait exact. La convergence intersectorielle est fondée sur des principes uniquement comptables, qui ne tiennent pas compte des missions spécifiques des uns et des autres.
La T2A a vraisemblablement des effets sur la pertinence et la qualité des soins. L'éducation thérapeutique ou la prise en charge des pathologies longues sont affectées par la nécessité de coller aux tarifs qu'elle impose. La productivité assignée aux établissements dans le cadre de la fixation de tarifs qui décrochent de l'échelle nationale des coûts pose la question de la validation de la prise en charge des parcours.
Le financement des activités qui ne relèvent pas de la T2A, notamment les Migac, est un sujet très difficile pour les établissements publics de santé. Son insuffisance est chronique, alors qu'il doit permettre d'assurer les missions de service public ou d'intérêt général de façon convenable.
Faut-il modifier la T2A ? Oui. La mettre à bas ? Non. Nous pouvons la conserver, mais le financement doit être profondément rééquilibré entre la part couverte par les tarifs et la part couverte par les dotations, notamment les Migac. La T2A à 100 % est une spécificité française, ailleurs en Europe, c'est plutôt 50-50.
La régulation de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) se fait par le gel anticipé des missions d'intérêt général. Ce n'est pas satisfaisant. Dans un souci d'équité, elle devrait concerner aussi les autres secteurs de l'hospitalisation.
Enfin, les incidences de la T2A sur l'organisation, via la mise en place d'un système de comptabilité analytique et le pilotage médico-économique des établissements, sont très importantes.
secrétaire général du syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (Syncass-CFDT). - Nous suivons avec beaucoup d'intérêt vos travaux. On ne peut porter d'appréciation globale sur le système d'allocation des ressources si on ne regarde pas à qui il s'applique. Même en adaptant l'outil tarifaire, un établissement dont le bassin de population ne lui permet pas d'avoir une activité correspondant à ses coûts de production restera dans une situation difficile. La T2A est utilisée comme un outil de planification, d'orientation de l'activité alors qu'elle n'est pas faite pour cela. Si un établissement connaît des difficultés de recrutement, ce n'est pas l'outil tarifaire qui règlera son problème ! C'est dire que la situation est très diverse selon les établissements.
Le système d'allocation de ressources est assis pour l'essentiel sur les ressources tirées de l'activité. Au temps du budget global, les dotations étaient révisées en fonction de l'activité, mesurée par les points ISA. Sur le principe, allouer les ressources proportionnellement à l'activité est un progrès, sachant toutefois que toutes les activités ne s'y prêtent pas, missions d'intérêt général, psychiatrie, soins de suite par exemple.
L'utilisation de ce modèle tarifaire pour chaque séjour et chaque pathologie est complexe. Sa mise en oeuvre a été très progressive. Au départ, les directions, les équipes et le corps médical ont vu la chose d'un bon oeil et se sont mobilisés, mais ils ont vite déchanté : la logique intrinsèque du modèle oblige tous les ans à une progression de l'activité de 1 % à 2 % pour conserver les recettes de l'année précédente, donc incite à en faire le plus possible. L'effet est inflationniste : le nombre de séjours est à la hausse alors que la situation sanitaire du pays n'a pas changé. On voit bien le biais : comment fixer, sur un territoire donné, un objectif d'accroissement annuel des accouchements de 2 % ? Ou alors il faut faire revenir les patientes... Nous touchons là aux effets pervers en termes d'intensification du travail et de conditions de travail, qui provoquent une véritable fuite du personnel hospitalier et des difficultés de recrutement, avec cependant de fortes disparités régionales. Nous ne sommes plus dans la logique « gagnant-gagnant » initiale. Beaucoup ont le sentiment d'avoir été manipulés. Certains établissements s'en sont bien sortis, d'autres sont dans une situation plus calamiteuse. Le système n'a pas prouvé son efficacité au regard de la répartition des ressources. Des rentes de situation demeurent.
Quels correctifs apporter ? Il y a un effet tarif corrélé avec la diversité des disciplines. Outre le cas des CHU, les gros établissements ont plutôt été pénalisés simplement à cause de la typologie des actes qu'ils réalisent. Le case-mix peut avoir un effet de renchérissement des coûts. Les tarifs sont déconnectés des coûts. A l'origine, on s'est fondé sur une moyenne des coûts constatés et on a demandé aux établissements d'améliorer leurs coûts. Ce qui a conduit à des réorientations d'activité et des dérives graves : pour décourager les césariennes, leur tarif a été fixé en dessous de leur coût, tandis qu'on surpayait l'accouchement normal ! Le choix n'a pas à être fonction du tarif ! Et pourtant... Comme les coûts fixes sont importants, les opérateurs qui voudraient rattraper les écarts tarifaires feront davantage de césariennes... Utiliser l'outil tarifaire pour réorienter l'activité induit des biais, coûteux en termes économiques comme de santé publique.
Pour la CGT, la T2A n'est pas amendable et doit être supprimée. Il faut une révolution, revenir au budget global. Toutes les personnes que vous avez auditionnées pointent les effets calamiteux de la T2A, mais personne ne donne de solutions pour les réduire. Il n'y a donc pas d'alternative. Pourquoi tout le monde soutient-il ce système ? Les Etats-Unis, qui l'ont inspiré, ont des dépenses de santé de 50 % supérieures aux nôtres, pour 25 % de population soignée en moins. Donc, en proportion de la population, ceux qui ont inventé ce système dépensent 100 % de plus que nous !
Comme le chante Brassens, « ne tirez pas sur la femme adultère, je suis derrière ! » Qui sanctionne-t-on ? Pas le directeur ! L'idée même de sanction, dans le service public, est une aberration, alors qu'on ne touche pas aux bénéfices des patrons du privé ! Rappelons le rôle de l'Etat, de la tutelle ! Il faut un centre de crise pour les adolescents ? Soit, mais ce n'est pas rentable ! Les directeurs signent les contrats avec les ARS le revolver sur la tempe. La poursuite de la rentabilité à tout prix ne fait pas une politique de santé ! 70 % des dépenses hospitalières, ce sont des dépenses de personnel, 15 % sont des dépenses médicales et seulement 9 % vont à l'investissement et l'amortissement ; est-ce à la T2A de financer les dépenses d'investissement ? Finalement, c'est la sécurité sociale qui finance le patrimoine du secteur privé.
Nous sommes une industrie de main d'oeuvre, plutôt artisanale. Comment faire de la productivité dans ce secteur avec peu d'investissement - 9 % !- sans faire peser toute la pression sur le personnel ? Le statut est en déliquescence. Si la tarification est fausse, si l'allocation des ressources est fausse, le système explose !
Je veux insister sur la fausseté de l'échelle nationale des coûts. Un seul intervenant parmi ceux que vous avez auditionnés, représentant le secteur PSPH, a souligné ce point. Est-ce qu'on explique mieux l'évolution de la dépense en ajoutant un indicateur de plus ? Je m'en suis expliqué à plusieurs reprises devant le comité de suivi. Avec la batterie d'indicateurs actuels, on n'atteint pas une variance supérieure à 80 %, ce qui, pour moi, n'est pas beaucoup. On ne peut pas fixer un budget comme ça. Si on se trompe de deux points dans un budget, on va à la catastrophe ! L'expérience a été faite en psychiatrie. J'ai colligé depuis 1984 tous les événements T2A. Dès 1985, il apparaît que les résultats ne permettent pas d'établir un lien entre les groupes homogènes de journée (GHJ) et le coût de prise en charge. Peu de gens savent comment est fabriquée l'échelle nationale des coûts. Je vous renvoie à l'analyse de Jacques Marescaux ou à celle de la fédération hospitalière de France (FHF). Le taux d'erreurs est énorme. On essaye de rectifier le tir avec les Migac, mais cela ne marche pas, on l'a vu en Midi-Pyrénées : si les ressources T2A ont trop progressé, on baisse les Migac. Bref, la croissance de l'activité du secteur privé conduit à sanctionner le secteur public, à travers les Migac.
Autre exemple : on a porté l'aide médicale de l'Etat (AME) à 30 euros, mais qui la paie ? Avant, quand un patient arrivait aux urgences, il pouvait passer directement au bloc ; aujourd'hui, si le planning fait apparaître une opération plus rémunératrice en salle d'opération, on n'y touchera pas et le patient devra revenir par les urgences - facteur supplémentaire d'engorgement. Cela occasionne aussi des créances irrécouvrables, qui viennent en déduction des ressources de l'hôpital ; mais elles seront de toute façon prises en charge par la collectivité.
J'ai été chargé des modèles économétriques au bureau d'analyse économique de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. A l'époque, il n'y avait que mille pathologies et non deux mille cinq cents comme aujourd'hui. La comptabilité analytique permettait de calculer des coefficients en ramenant le nombre de journées à leur coût moyen. Mais 70 % des dépenses d'un hôpital sont liées au personnel. Comment les affecter à telle ou telle pathologie ? On les affecte à une unité administrative, puis on les divise pour les imputer à la journée, mais pas à une pathologie. On ne peut imputer le temps réel passé dans chaque service pour chaque pathologie. Pour vérifier la validité de ce système, il faudrait, à l'instar de ce que font les médecins, l'évaluer en comparaison d'un placébo... A l'époque où il n'y avait que mille variables, et non deux mille cinq cents comme aujourd'hui, sur les vingt-six hôpitaux de Paris, il avait été démontré que ce système, fondé pourtant sur une comptabilité analytique homogène, n'était pas bon...
On oublie !
Au budget global !

Il reposait sur des bases historiques qui pénalisaient certains établissements.
Il suffit de reprendre le travail statistique, en se fondant sur des indicateurs multiples, dont les points ISA, qui sont un indicateur parmi d'autres. Il convient aussi de décliner les missions de service public...
Oui, même s'ils ne recueillent pas l'unanimité. Je reste à votre disposition pour développer l'analyse des défauts de la T2A !
Notre position est plus modérée. CH-FO tire un bilan plus positif de la T2A, même si un même système de financement, au regard de la diversité des établissements, peut difficilement être adapté à toutes les situations. Il y a toujours des effets de seuil. Il faudra toujours réguler et adapter le système. Nous considérons cependant que nous sommes à la fin d'un cycle.
En interne, la T2A nous a permis d'entretenir un dialogue avec les équipes soignantes sur les problèmes de gestion et d'organisation des soins. Des adaptations de l'organisation ont été mises en oeuvre dans ce cadre : réduction de la durée moyenne de séjour (DMS) ou organisation de filières plus fluides, notamment en soins de suite et de réadaptation (SSR). Nous avons progressé au regard du mécanisme antérieur d'allocation des ressources, qui résultait pour beaucoup de rapports de forces dans la négociation de la dotation globale. La T2A a mis en partie fin à ces dysfonctionnements.
Avec l'état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) et le plan global de financement pluriannuel (PGFP), nous ne sommes plus obligés de présenter un budget artificiellement en équilibre et nous disposons d'une vision plus objective de la situation financière de nos établissements.
A côté de ces aspects positifs, la T2A a des limites, bien exposées par notre collègue de la CFDT. J'y insiste : nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup travaillé sur l'optimisation du codage. Nous ne sommes pas en situation, à l'hôpital public, de faire des actes pour des actes. Quand c'est le cas, cela est lié à la technicisation de la médecine et non pas à la T2A. Les hôpitaux publics en dotation globale n'avaient pas intérêt à développer la facturation. Grâce à la T2A, nous avons énormément progressé.
Le modèle de régulation au sein d'une enveloppe fermée, couplé à la tarification, implique d'atteindre un certain niveau d'activité - par tous les moyens possibles. C'est un effet pervers du système.

Le dernier rapport de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih) pour l'exercice 2011 montre que les efforts d'optimisation du codage entraînent une augmentation des coûts. Or la T2A a pour objet la maîtrise des dépenses, non d'accroître les coûts pour la sécurité sociale...
Y compris les coûts de contrôle ! Je dirige un petit établissement, qui n'a qu'une personne dédiée à l'information médicale ; lors d'un récent contrôle de la sécurité sociale, nous avons eu en face de nous pendant dix jours cinq médecins, qui se sont livrés à d'interminables débats d'experts sur le codage de tel ou tel dossier ! Les coûts ne sont pas que dans les établissements...
Et ils ne contrôlent pas la pertinence des actes...

Nous sommes allés notamment à Laval, où nous avons demandé aux médecins et aux équipes comment se déroulait en pratique le codage ; nous avons remarqué qu'il peut entraîner, pour une même pathologie, un basculement du simple au double, voire au triple ! D'où les débats d'experts dont vous parlez... Il faut sans doute renforcer l'expertise des établissements en matière de codage.
Les premiers travaux d'optimisation du codage avaient un sens. Mais je le redis, nous sommes à la fin d'un cycle. Il faut trouver d'autres moyens de régulation.
Autre inconvénient majeur : l'extrême variabilité des tarifs, qui est difficilement soutenable et entraîne de brutales variations de recettes. A quoi s'ajoute la construction de l'échelle nationale des coûts en déconnexion avec la réalité des coûts.
La T2A a favorisé les établissements de taille moyenne, implantés dans un territoire où l'offre de soins est cohérente. La situation est plus difficile à gérer pour les établissements implantés dans un bassin de santé à faible densité de population, comme en Champagne-Ardenne, ou dans des secteurs à faible démographie médicale. Sans médecins, c'est tout le financement de l'hôpital qui se trouve mis à mal, y compris là où les besoins de santé sont réels.
En outre, la T2A ne favorise ni la qualité ni la pertinence des soins. Nous reviendrons sur ces thèmes, qui ne sont pas forcément à intégrer dans le cadre du financement. La pertinence des actes est un sujet bien plus large. Il y a un travail à mener avec les équipes médicales sur les références médicales opposables (RMO), ce qui n'est pas simple...

Est-il vrai que de nombreux actes sont réalisés uniquement pour assurer la couverture médico-légale ?
C'est tout à fait exact. Les médecins ne sont pas tous prêts à accepter les RMO sans autre forme de procès... Il faut également avoir à l'esprit qu'aux urgences, par exemple, les prescriptions ne sont pas les mêmes en fonction des médecins de garde.
Merci pour votre invitation. L'ADH est une association partenaire des organisations syndicales ; elle regroupe environ un directeur d'hôpital sur deux. Je suis moi-même directeur général du CHU de Saint-Etienne.

Les directeurs peuvent-ils appartenir à la fois à un syndicat et à l'ADH ?
Bien sûr.
On peut critiquer la T2A mais il ne faut pas oublier que ce système est bien meilleur que le précédent. La dotation globale, que j'ai connue lors de mes débuts professionnels, poussait à l'immobilisme. Ceux qui avaient une rente de situation ou des appuis bénéficiaient d'une dotation globale importante, au détriment de ceux qui étaient plus innovants, voire plus utiles à leur bassin de population. En quelque sorte, tout le monde avait intérêt à ne pas avoir de malades supplémentaires et à ne pas faire de recherche. Et il était bien difficile de déplacer des ressources d'un établissement à un autre et même d'un service à un autre.
La T2A a obligé les médecins et les directeurs d'hôpitaux publics, qui n'ont certes pas plus de vertus que les autres, à s'interroger sur leurs pratiques et les coûts des actes réalisés. Elle a permis de rappeler à tout le monde que soigner avait un coût et que le financement était collectif. Elle a aussi permis d'avoir une meilleure visibilité de la répartition des ressources que la collectivité affecte à la prise en charge sanitaire et médico-sociale.
En revanche, la T2A n'est pas le seul élément qui contribue à l'équilibre et à la bonne santé financière des établissements. Elle n'est pas un outil parfait ; un établissement qui était en déficit, sans position privilégiée sur son bassin de population, a peu de chance de revenir à l'équilibre du fait du mécanisme d'ajustement prix-volume. On construit un budget sur une base annuelle, l'exercice commence au 1er janvier ; l'EPRD est établi en juin, si tout va bien ; les tarifs sont connus en mars, la notification du « hors tarif » en avril, mais pas toujours... Comment, dans ces conditions, élaborer un budget cohérent et crédible ? Si le gros défaut de la dotation globale était l'immobilisme, celui de la T2A est le court termisme ; nous sommes en permanence dans l'immédiat, pas dans la prévision, alors que c'était justement le but recherché. En outre, l'évolution des tarifs, qui changent d'une année sur l'autre, ne permet pas de construire avec la communauté médicale une politique durable. Comment bâtir un projet une année, alors que l'année suivante une révision à la baisse des tarifs peut mettre en péril son équilibre économique ? A quoi s'ajoutent les effets de masse dans les CHU... De ce fait, il est difficile de convaincre la communauté médicale, qui était majoritairement acquise à la T2A. Sans compter, tout le monde le sait, que les tarifs sont inférieurs aux coûts...
A l'hôpital, la T2A est vécue comme un outil de recettes plutôt que comme un instrument de régulation nationale des dépenses de santé. Si vous ne faites pas plus d'activité que l'année précédente, vous perdez des recettes. Les dépenses annuelles en investissement et en fonctionnement de mon CHU s'élèvent à 500 millions. L'activité doit augmenter de 1,7 % à 2 % en valeur par an si nous voulons éviter de perdre des recettes. Sur le plan pédagogique, c'est contre-productif ; cela peut même provoquer de sérieuses allergies chez certains praticiens... Le pilotage en interne est extrêmement difficile. Quand le tarif de l'ambulatoire, qu'on veut promouvoir par ailleurs, devient inférieur à son coût, l'effet est désastreux...
La construction des tarifs est obscure. Plutôt que d'entretenir l'illusion, autant dire clairement qu'elle a pour objectif la régulation des dépenses. Mais il est impossible de continuer à manager des équipes en tenant un double discours.
J'ai participé à la rédaction d'un rapport duquel il ressortait que la T2A, telle qu'elle est conçue et pratiquée à l'heure actuelle, est un obstacle majeur à la coopération entre les établissements...
Entre établissements, mais aussi entre services !
Lorsque deux établissements décident de coopérer de façon informelle, sans en référer à la sécurité sociale ni à l'autorité de tutelle, s'ils coordonnent les prises en charge en maximisant la tarification, chacun conserve ses recettes. S'ils décident d'aller plus loin, par exemple en fusionnant des services d'urgence, chacun y perd. Si l'on veut encourager des projets de coopération, il faut garantir les ressources des uns et des autres, au moins le temps des adaptations nécessaires. A l'heure actuelle, il y a un décalage entre les intentions restructurantes et leur traduction dans les faits. Nous prônons une contractualisation de ces coopérations entre les ARS et les établissements qui s'impliquent afin de donner le temps d'ajuster les ressources. Cela donnerait de la crédibilité à la démarche.
Dans la même logique, pourquoi ne pas forfaitiser au plan territorial certaines prises en charge coordonnées pour éviter la tentation de multiplier les actes pour maximiser les ressources ?
C'est un raisonnement macro-économique alors que dans un établissement hospitalier, la logique est beaucoup plus individuelle ; les recettes d'un établissement peuvent évoluer différemment de l'Ondam. Et il n'y a pas de raison que les ressources restent pour toujours au même endroit...
Elle est réelle, notamment dans les services médicaux ou les services associés à la prise en charge des personnes âgées. Désormais, tout le monde regarde le prix des malades.
La situation ne s'améliore pas. Autrefois, quand le CHU de Lille mettait du temps médical à disposition d'un autre établissement, il demandait un remboursement mais l'établissement conservait ses recettes ; aujourd'hui, celui-ci doit rembourser, mais il ne les conserve plus.
Ce qui est dommage.
Les CHU connaissent les mêmes contraintes. La mise à disposition de leurs compétences auprès des autres établissements de santé est freinée du fait de la T2A. Lorsqu'un praticien d'un CHU consulte dans un autre établissement, la perte de recettes pour le CHU est bien supérieure à la compensation de son salaire.
L'évolution des dotations Migac d'une année sur l'autre bouleverse nos équilibres. Elle est vécue par les hospitaliers comme un reproche permanent, alors que les Migac compensent des missions de service public. Dans mon établissement, l'écart entre les recettes et les dépenses pour les internes s'élève à deux millions, ce qui pèse sur nos marges. La situation est identique pour la permanence des soins. Autre exemple : certains établissements ont mis en place des astreintes en imagerie neuro-vasculaire interventionnelle ; ils savent bien qu'il y aura peu d'actes la nuit, mais il faut bien que quelqu'un assure ce service. Cela coûte cher en frais de garde et prive aussi le service le lendemain d'un médecin qui sera en repos de sécurité. On met ainsi un équipement à disposition la nuit qui ne sera pas disponible de jour quand on en aura besoin, faute de praticien disponible. C'est pour ces établissements un désavantage concurrentiel majeur.
Je souscris globalement à ce que vient de dire M. Boiron. La coopération devrait commencer en amont, par la planification et la répartition des activités. Les effets de la T2A ne sont pas les mêmes selon que sur un territoire donné il y a concurrence ou complémentarité. Les offreurs de soins peuvent se mettre d'accord pour éviter les doublons, par exemple le maintien d'activités à perte. C'est le rôle de l'ARS et des hospitaliers d'organiser en amont l'activité.
Les missions sont définies diversement dans des lieux divers... Le code de la santé publique définit des missions de service public, largement financées par la T2A ; mais la T2A met en concurrence les secteurs publics et privés tout en maintenant leurs différences. Le service public hospitalier a été supprimé, mais on a laissé les obligations de service public au secteur public pour toutes les activités. Puis il y a les Migac, qui relèvent du code de la sécurité sociale et sont financées par des dotations. Deux catégories à financement différent mais réputées toutes deux d'intérêt général.... Si le planificateur estime que pour assurer la continuité des soins, il faut un service de chirurgie à Saint-Jean-de-Maurienne, il devra prendre en compte le fait que l'activité y sera bien plus faible en été qu'en hiver, à cause des accidents de ski. Voilà une mission spécifique d'aménagement du territoire : qui la finance, et comment ? On ne peut faire comme si ce service était implanté au sein d'un établissement de la première couronne parisienne...
Ne reprochons cependant pas à la T2A d'aboutir à ce résultat : lorsqu'on se tape sur les doigts avec un marteau, il ne faut pas s'en prendre au marteau ! En revanche, on peut critiquer la T2A pour son opacité délibérée. Si elle doit servir comme outil de planification, elle change de nature.
Il n'est pas sûr que les concepteurs eux-mêmes s'y retrouvent !
Pour corriger le modèle, il faudrait ne pas inciter à l'activité tout en demandant une maîtrise globale du système. De toute façon, le jour où notre pays sera confronté à une crise sanitaire majeure, l'Ondam explosera et on ne pourra pas baisser les tarifs. Ceux-ci ne cessent de varier, nous en sommes à la version 11 et un peu au-delà... On affine, on affine, on baisse certains tarifs... et au vu de certains résultats on pourrait se dire que les cancers ont été moins graves en 2011 qu'en 2010... Le système doit être stabilisé. Les équilibres financiers fondés sur le plan Hôpital 2007 n'ont tenu qu'un an.

Les tarifs ont besoin d'être stabilisés, mais aussi simplifiés : il en existe 1 200 aux Etats-Unis, après plus de vingt ans de tarification à l'activité, et déjà plus de 2 300 en France en à peine six années !
L'optimisation du système d'information permet de faire rentrer des recettes, mais elle a des effets pervers. Les DIM se structurent désormais, non pour mieux connaître les pathologies, mais pour mieux en tarifer le traitement. L'information épidémiologique, le suivi sont négligés.
Il ne faut pas non plus noircir les intentions des hospitaliers ! Ce qu'ils font n'est pas contraire à la loi et pas seulement vu sous l'angle tarifaire.
Il y a au départ une impasse conceptuelle : il n'est pas possible de formaliser l'immense diversité des établissements et des activités dans les seuls tarifs. Mieux vaudrait s'interroger sur la part de financement complémentaire à la tarification que la collectivité est prête à consentir. Les ARS devraient objectiver les besoins des territoires et accompagner les coopérations. Grace au fonds d'intervention régional, les ARS peuvent inciter les établissements à coopérer. Le problème, c'est que coopérer aujourd'hui, c'est renoncer à des financements. Les ARS devraient disposer de marges de manoeuvre pour accompagner les transitions, sous réserve que la fongibilité des crédits ne vienne pas pénaliser les établissements hospitaliers. L'idée d'une enveloppe régionale est séduisante.

Pourquoi ne pas soustraire certains GHS à la T2A ? Je pense notamment aux soins intensifs et à la réanimation, qu'on ne parviendra jamais à faire entrer dans un tarif. On pourrait trouver un financement par dotation, comme on le fait pour les urgences...
La liste des GHS à extraire serait longue !
Le fonctionnement des Migac n'est pas plus satisfaisant que celui de la T2A. Si la part des dotations était plus élevée, cela impliquerait de revoir la façon dont elles sont attribuées. Les disparités d'attribution sont importantes et peu explicables à taille et missions similaires. Les règles d'attribution des ARS sont totalement opaques, d'autant que certains crédits sont reconductibles et d'autres non. En outre, les dotations Migac sont versées en juin et parfois même après Noël, cela m'est arrivé l'année dernière, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'équilibre financier. Si la part des dotations étaient plus élevée, il faudrait des règles d'attribution plus transparentes et un calendrier de paiement plus adapté, afin d'éviter les ajustements en fin d'année.
J'en viens aux parcours de soins coordonnés dont la terminologie est trop vague. Si l'on s'interroge sur les modalités de financement des hôpitaux, il faut élargir la réflexion aux autres partenaires de la santé, à commencer par les médecins traitants avec qui, aujourd'hui, il est très difficile de travailler - il est vrai qu'ils ne sont guère incités à cela. Un des principaux freins à l'hospitalisation à domicile tient par exemple au fait que les médecins traitants ne s'y retrouvent pas alors qu'ils sont censés suivre leurs patients en HAD. Peu de médecins - et d'infirmiers, d'ailleurs - acceptent de se lancer dans une démarche aussi lourde qui implique des visites à domicile, de la codification, des dossiers à remplir. Ils n'y ont aucun intérêt.
J'en arrive à la coopération entre les établissements publics et privés. Il est difficile de partager les contraintes, d'arbitrer entre les activités programmées et la permanence des soins. Dans mon établissement, nous partageons le bloc opératoire avec une clinique mais je n'ai jamais réussi à mettre en commun les équipes d'anesthésistes car l'obstétrique impose des gardes de nuit dont ne veulent pas entendre parler les anesthésistes du privé.
Sans compter les salaires qui n'ont rien à voir : un anesthésiste m'a récemment montré la proposition qui lui avait été faite par une clinique : 20 000 euros nets et des frais de garde, contre 4 000 à l'hôpital et des primes de nuit indignes.
J'entends qu'on nous reproche d'effectuer des actes inutiles, mais ils sont le plus souvent le fait des obligations médico-légales. Certains examens ne servent à rien, mais s'ils ne figurent pas dans le dossier, en cas d'incident, le médecin peut être attaqué.
Enfin, seuls les hôpitaux publics ont un service de réanimation - voilà une activité qu'on ne peut pas enfermer dans un GHS - car les tarifs ne couvrent pas les frais. Le secteur privé se contente d'unités de surveillance continue plus rémunératrices et passe des conventions avec le secteur public.

Il nous a été dit que les actes pour couverture médico-légale représentaient 14 % du total.
Il faut revoir la répartition entre activités couvertes par la T2A et celles qui sont financées autrement. Ce n'est pas un hasard si la réanimation est déficitaire au sein de l'hôpital public. C'est une activité structurante, au service d'un territoire.
En Ariège, la CGT a attaqué un directeur d'hôpital qui ne mettait pas les effectifs requis en réanimation, mais il faut bien avoir en tête que ces services, c'est du temps et de l'argent ! Cette activité ne peut pas entrer dans un tarif.
On oublie aussi trop souvent de prendre en compte l'âge moyen du personnel hospitalier qui, lorsqu'il est élevé, pèse évidemment sur la masse salariale. Je voudrais bien savoir comment les tarifs prennent cet élément en compte...
Les établissements publics accueillent les patients sans se demander s'ils vont rapporter ou s'ils vont coûter ; mais si on va au bout de la logique, ils auraient intérêt à y regarder à deux fois : à développer les activités rémunératrices et à laisser les autres à leurs voisins. Ce risque est majeur et les ARS ne semblent pas en avoir pris la mesure.
Un exemple : une patiente âgée prend vingt-sept médicaments différents prescrits par plusieurs médecins... Où est le parcours coordonné ? Autre exemple : une autre vieille dame arrive aux urgences, elle reste deux jours sur un brancard, on l'hospitalise dans un service spécialisé de pointe, puis en gériatrie après de nombreux examens, enfin en soins de suite pendant un mois, ce qui a coûté une fortune... parce que son aide ménagère avait pris ses congés. Tout cela nous incite à la modestie.
Comment voulez-vous motiver des chefs de service ou de pôle de réanimation en leur parlant d'objectifs quantitatifs ? Un mode de financement adapté à ces missions spécifiques de l'hôpital public devrait être défini, ce qui aurait une vertu financière mais surtout managériale. Les professionnels souhaitent pareille évolution, pour autant qu'elle respecte les missions de service public qui sont les leurs.

Vous pensez que les Migac ne permettent pas de financer les missions qui sont les vôtres tandis que le secteur privé estime que ces crédits sont trop élevés et qu'il faut poursuivre, voire accélérer la convergence tarifaire. Qui croire ? Comment sortir par le haut de cette contradiction qui s'étale dans la presse et qui pénalise le secteur hospitalier public ?
Rien d'étonnant puisque la tarification est fausse !
Vu la façon dont les tarifs sont calculés, les choses ne peuvent pas se passer autrement ! L'échelle nationale des coûts est fausse. Si les tarifs étaient exacts, le secteur privé serait en droit de se plaindre mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas fonder des contrats de service honorables sur la base de la tarification, en réanimation comme dans beaucoup d'autres activités.
Quand l'hospitalisation privée s'engage dans de mauvaises polémiques de façon aussi médiatique, c'est sans doute pour d'autres raisons que celles qu'elle invoque...
Les départements du Rhône et de la Loire reçoivent de nombreux demandeurs d'asile. Quand ces personnes ont besoin de soins, voyez où elles sont emmenées. Il en va de même pour les personnes en grande difficulté, nous les accueillons et nous les hébergeons dans les halls de nos hôpitaux. On nous donne l'impression que seuls les actes facturables ont de la valeur, alors que le secteur public accomplit beaucoup d'actes qui ont de la valeur mais pas de prix.
A l'heure actuelle, nous sommes dans une analyse financière systématique mais qui ne permet pas de quantifier les efforts de recherche ni les missions sociales des établissements publics. Ensuite, la pertinence des actes, sujet bien difficile... On sait que nombre d'établissements privés sont en équilibre grâce à des tarifs surévalués, notamment en ophtalmologie.
La polémique public - privé renvoie à la question de la convergence. Il s'agit d'une mystification puisque sont concernées des activités différentes, exercées dans des conditions elles-mêmes différentes. Si tout était égal par ailleurs, la convergence pourrait être la règle pour les tarifs des activités programmées, mais justement : rien n'est égal par ailleurs. La convergence inter-sectorielle n'a de sens que si ce qui est spécifique est financé à son coût réel ; sinon on demande à des établissements financés par des tarifs d'exercer des missions d'intérêt général... C'est comme cela qu'on en arrive à des choix d'activité, à la multiplication des actes et à la facturation de services complémentaires.
Je me suis récemment rendu dans une clinique privée : le parking était payant, les chambres particulières aussi, il y avait même un supplément pour « vue sur le jardin » !
Dans certaines cliniques, les frais d'administration sont facturés 11 euros.
S'agissant du risque de séquençage des séjours, on peut s'en prémunir en améliorant la traçabilité des parcours.
Nous sommes sereins pour répondre au mauvais procès qui nous est fait. Certaines Mig peuvent très facilement être évaluées grâce à la comptabilité analytique. C'est le cas des services mobiles d'urgence et de réanimation (Smur), dont le sous-financement est patent. L'exercice est plus complexe pour d'autres missions car entre le privé et le public, aucune comparaison n'est possible ; pensez au coût de l'obligation de neutraliser des salles d'opération pour faire face aux urgences, ou encore, dans les missions d'enseignement et de recherche, celui du temps passé par la secrétaire médicale à taper le papier du patron.... Il faut aussi prendre en compte le profil des patients. Pour une appendicectomie simple, le patient-type du privé est un gamin, on l'adresse directement en chirurgie, trois jours après il est dehors ; à l'hôpital public, c'est plutôt un patient âgé souffrant de plusieurs pathologies, amené par le Smur ou les pompiers, qu'on va d'abord hospitaliser en urgence pendant 24 heures... Pour la même pathologie, les coûts sont doubles ou triples.
Dans le public, on continue d'oublier des coûts. Quand un interne intervient, les frais de l'équipe qui travaille avec lui ne sont pas comptés. Et il faut aussi parler de la pertinence des soins. Privé et public ne réagissent pas de la même façon. Pour avoir rencontré des problèmes ORL et ophtalmologiques et m'être adressé à l'un et à l'autre, j'ai vu la différence !
Le système actuel ne fonctionnant plus, il faut en définir un autre. Les Migac comprennent trois enveloppes principales : précarité, Smur et consultations ambulatoires dans les prisons. Comment imaginer de les réduire ?
Avec la dotation globale, le système était figé et certains hôpitaux ne voyaient leur retour à l'équilibre qu'à l'horizon d'un demi-siècle. Avec la T2A, les choses se sont bien améliorées. C'est le cas au centre hospitalier de Douai, que je connais bien... Reste qu'il faut encore favoriser la coopération entre établissements, créer des parcours et des filières de soins, enfin optimiser les moyens dans le cadre d'une enveloppe fermée.

Lorsqu'on met en place une coopération hospitalière sur un territoire, il faut que chaque hôpital y gagne. Nous avons connu cela avec l'intercommunalité qui était fortement incitative. Le problème, c'est que l'enveloppe est fermée.
La liberté de choix du patient est essentielle, entre le secteur privé et le secteur public, et au sein de chaque secteur. Un Douaisien ne va pas se faire soigner à Béthune et réciproquement, un habitant de Béthune préfèrera se faire soigner à Lille, voire à Paris, plutôt qu'à Douai. Une organisation de proximité implique des filières amont et aval bien organisées. Mais la T2A favorise la concurrence.
Pour coopérer, il faudrait contractualiser, avec l'assurance qu'on reste financé si on coopère. Sinon tout le monde, directeurs, médecins, élus, freine des quatre fers. C'est humain ! Il faudrait une enveloppe spécifique dans le cadre des aides à la contractualisation.
D'où viennent les capacités d'investissement ? Pas d'un financeur qui possèderait une part du capital du CHU, ni d'un groupe européen ou international ! Elles proviennent d'une marge sur les recettes, estimée, selon les autorités sanitaires elles-mêmes, à 7 %, donc sur les tarifs, pour couvrir le renouvellement du patrimoine médical ou immobilier ; de crédits de soutien à l'investissement au titre de la mise en oeuvre de plateaux techniques ; de crédits d'aide à la prise en charge de l'impact financier d'un emprunt. Chacun connaît l'exemple des emprunts toxiques de Saint-Etienne, où un investissement de 300 millions d'euros a été financé exclusivement par l'établissement. Les crédits d'aide à la contractualisation sont une sorte de recapitalisation ; les crédits Mig doivent consolider la capacité d'investissement des hôpitaux publics.

Ce sont des suggestions intéressantes. Ne faudrait-il pas retirer de l'Ondam les investissements de construction, pour privilégier un financement du type contrat de plan Etat-région, comme cela a été fait pour d'autres infrastructures, routes, autoroutes, collèges ou lycées ? Cela éviterait de mettre en difficulté des établissements condamnés à payer pendant des années des charges liées à la construction.
Excellente ! Mais on risque de retomber dans les travers que nous avons connus dans le passé avec le budget global, où les rapports de forces ou d'influence emportaient les décisions sur les équipements. L'établissement perdrait la maîtrise de ses choix. Dans l'hypothèse où les tarifs seraient ajustés et permettraient de dégager des marges plus confortables, l'établissement garderait la main. Dans l'hypothèse que vous envisagez, les arbitrages sur les constructions lui échapperaient...
Nous sommes dans le cadre d'une enveloppe fermée. Nous n'avons pas trouvé de système permettant de ne financer que les activités utiles ! On a construit un modèle incitant, par construction, à la suractivité. Sur les investissements, les Migac, nous connaissons tous, dans chaque région, ce que nous appelons en jargon des « boulets », ces établissements dont les ARS ne peuvent éponger les dettes, parce qu'ils sont plombés par des emprunts toxiques, des investissements hasardeux ou pour d'autres raisons. Ces bombes à retardement sont loin d'être désamorcées.
Le plan Hôpital 2007 était miraculeux mais le miracle n'était qu'apparent. Il n'a pas subventionné les investissements, mais en compensant les surcoûts liés aux frais financiers, il a permis de financer beaucoup plus de projets pour une mise de un milliard d'euros. Bien sûr, cela s'est fait à crédit, en engageant les exercices suivants : il est difficile de payer les investissements de l'année avec les ressources de l'année...
On a vu parfois trop grand, c'est vrai. Des investissements ont été surdimensionnés, avec la bénédiction des pouvoirs publics et des autorités locales. Même avec des aides, le retour à l'équilibre sera une tâche très ardue.
Ce que vous proposez fait penser à ce qui s'est fait pour le rail, la déconnexion du réseau RFF et de l'opérateur SNCF. Il faut vérifier la pertinence de ce modèle. Sans en rejeter le principe, nous accueillons cette idée avec circonspection.
Pour appliquer la tarification à l'activité au Sénat, on pourrait se fonder sur le nombre d'amendements ou de propositions de loi...
Vous vous y opposeriez !
La CGT n'est pas contre le système que vous proposez, qui serait planificateur. Que les hôpitaux fassent ce qu'ils veulent de leurs marges, voilà qui serait anti-planificateur ! Les grosses marges sont dues à l'intensification du travail du personnel. Qui paie les hôpitaux en réalité ? Le personnel ! Il y a des établissements qui sont encore aujourd'hui soumis au budget global et ce ne sont pas les moins dynamiques ! Pensez aux UHSA (unités hospitalières spécialement aménagées) dans les hôpitaux psychiatriques, mais aussi à l'hôpital Marchant à Toulouse.
Les plans Hôpital 2007 et 2012 ont beaucoup fait pour les établissements du Nord-Pas-de-Calais - je pense à celui de Douai, qui a bénéficié d'un investissement de 160 millions d'euros. En empruntant sur vingt ans, les établissements bénéficient d'un effet de levier, tout en répondant aux besoins de santé des populations. Mais la situation a changé. Les établissements ont perdu leur capacité à investir et sont aujourd'hui confrontés à un credit crunch, on en voit qui émettent des emprunts obligataires pour financer de petits investissements ; d'autres comme celui de Lens, empruntent pour payer les salaires...
Si l'on change le système de financement, il ne faut pas toucher à un principe très fort : l'autonomie des établissements. La T2A a permis une nouvelle dynamique, celle qui se crée lorsqu'un directeur peut décider des investissements avec l'équipe médicale. Confier les décisions d'investissement à des « petits chefs » dans d'obscurs bureaux des ARS, c'est risquer de perdre cette dynamique. Ne revenons pas aux errements des années 1960, quand tout était décidé par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (Ddass) et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (Drass).
Il y a un fort besoin de transparence sur les décisions d'investissement. Il y a eu des investissements malheureux, c'est vrai, on a construit des cathédrales qu'on a laissées vides. Mais les responsabilités sont assez largement partagées ; les décisions étaient soumises à autorisation préalable, à délibération du conseil d'administration. Doit-on pour autant construire un système par référence à ces exemples malheureux ? La tentation du Léviathan administratif est une tradition française. Sortir les décisions du système hospitalier, soit, mais où les placer, comment les gérer ? Une gestion centralisée sera source de gâchis et de difficultés. Telle serait la position de notre association si elle était saisie de cette question. Les décisions d'investissement doivent être reliées aux besoins des territoires. Les constructions ou reconstructions majeures ne peuvent pas peser sur les seuls établissements concernés. Elles doivent impliquer les hôpitaux, les collectivités locales, l'Etat, la sécurité sociale. Ce ne serait pas une bonne chose que de placer le lieu de telles décisions dans une structure administrative centrale et lointaine. Nous avons vécu, dans les hôpitaux, le débasage partiel des crédits de recherche, inclus dans des Migac spécifiques. Au passage, on y a perdu. L'expérience nous a appris à craindre ces prélèvements effectués en passant.
Quel que soit le système retenu, il ne sera vertueux que si les acteurs eux-mêmes, directeurs, médecins, politiques, banquiers, financiers s'accordent sur une morale, une éthique, des valeurs à respecter. Il est de la responsabilité du prêteur de ne pas être indifférent au caractère d'intérêt public de l'investissement qu'il finance. Cette morale vaut pour la décision d'investissement, comme pour le recours à l'emprunt.

Des ordonnateurs ont pris la décision de recourir à des emprunts toxiques. Mais ceux qui devaient les conseiller, et touchent pour cela une indemnité, n'ont pas joué leur rôle qui est de les aider à prendre des décisions adaptées, en fonction de critères multiples, dont les caractéristique de l'emprunt. Il y a là une faiblesse.

Il appartenait à la tutelle d'empêcher ce type d'emprunt. Ce n'est pas à l'hôpital d'en payer aujourd'hui les conséquences.
Tout à fait d'accord.
Une question parlementaire a été posée en 1998 demandant un encadrement des emprunts structurés ; ce qui bloque, c'est l'interdiction de remboursement anticipé ou le fait de l'assortir d'un taux actuariel prohibitif. Si ce remboursement avait été rendu possible à l'époque, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Selon un arrêt de la Cour de cassation, certaines des clauses de ces emprunts sont indéterminées, donc nulles.
Parlons de l'avenir !
Vous avez bien compris que nul d'entre nous ne souhaite la création d'une agence nationale supplémentaire en charge des investissements. Cela n'aurait pas de sens. Plus on éloigne le niveau de prise de décision du terrain, plus on prend de risques.
Qui décide des orientations stratégiques des établissements ? Le principe d'autonomie nous est cher. Sa limite, c'est la planification ou la répartition de l'offre de soins. Certains investissements dépendent de l'organisation de celle-ci. Le principe de responsabilité doit jouer : celui qui est compétent pour prendre la décision doit en assumer la mise en oeuvre. Séparer le décideur du responsable de l'application de la décision ne serait pas gérable. Une économiste qu'on ne cite guère aujourd'hui, Béatrice Majnoni d'Intignano, distinguait les investissements à effet de gestion et les investissements à effet de santé. Le financement du renouvellement des installations, qui a pour objet de garder l'outil de production en état, doit être inclus dans les tarifs, puisqu'il s'agit d'assurer la continuité de l'activité. En revanche, les investissements de projet, d'innovation, de développement stratégique devraient faire l'objet d'un financement plus volontariste, dans une logique de planification. Mais ce n'est pas si simple de faire la distinction...

Dans un courrier du 27 avril, la Fédération hospitalière de France (FHF) demande une profonde révision du projet de guide de contractualisation des dotations finançant les Migac. Elle note le souhait du directeur général de l'offre de soins d'une euro-compatibilité des Mig, mais estime que « l'analyse d'une insécurité juridique n'est pas fondée ». Selon le guide, « l'absence d'objectivisation des notifications de dotation Mig peut entraîner une condamnation de l'Etat français sur la base d'une incompatibilité avec le droit européen » - ce qui ne pourrait que générer une contrainte préjudiciable pour les établissements, estime la FHF. En outre, elle entend dissocier les missions répondant à des besoins régionaux, qui relèvent d'une décision de l'ARS, de celles qui dépendent d'un dispositif national qui, par leur nature, ne peuvent en aucun cas relever d'un dispositif de contractualisation locale tel qu'il est décrit par le guide. La FHF estime aussi que la réévaluation annuelle des crédits et l'absence de prise en compte des investissements nécessaires ne pourront se traduire que par une précarisation de l'emploi hospitalier, pourtant contraire aux politiques nationales dans ce domaine. Que pensez-vous de ce courrier ?
Le Parlement a voté une loi sur la titularisation de certains contractuels qui s'applique bien sûr au secteur hospitalier, notamment aux contractuels employés dans le domaine de la recherche. En parallèle, la répartition des crédits affectés à la recherche hospitalière va être modifiée : la part stable va diminuer jusqu'à disparaître pour être remplacée par la part variable. Ce n'est guère logique : on nous demande de titulariser des contractuels, qui peuvent le rester - l'hôpital employeur ne maltraite pas son personnel, rien de comparable aux mineurs de Silésie - avec des crédits non pérennes !
Pourquoi exposer systématiquement les choix de financement que fait la France à la logique européenne, qui met en concurrence public et privé ? On finira par abandonner le financement des Mig ! Je relève que la FHF estime que la crainte d'un recours juridique contre la France n'est absolument pas fondée.
Un mot sur les guides méthodologiques que nous recevons : la production est telle que les praticiens n'en peuvent plus, ils veulent pouvoir se consacrer aux soins, à la recherche et à l'enseignement. Une pause et une simplification s'imposent.
Ce courrier démontre, s'il en était besoin, que les choses doivent changer. Le nombre d'indicateurs et de guides ne cesse d'augmenter et le système devient de plus en plus complexe et opaque. Comme il est à bout de souffle, on va chercher l'Europe pour justifier la baisse des aides au service public. Comment peut-on nous demander de mettre fin à la précarité de l'emploi en mettant tous les ans nos recettes en cause ? Il faut stabiliser l'emploi public, mais aussi financer les accords nationaux... Hausse des charges et baisse des recettes, c'est toujours l'Etat qui décide. Nous avons besoin de visibilité. Il faut faire confiance aux directeurs d'hôpitaux.
Les contraintes du droit européen ? Parle-t-on de services d'intérêt général ou de services d'intérêt économique général ? Le débat n'est pas tranché, mais nous exerçons les deux... Doit-on se situer dans une logique de marché ou de service public ? Ce que font les hôpitaux publics relève-t-il du noyau dur du service public ou se situe-t-il à sa marge ? Ce qui relève des Migac se trouve-t-il peu ou prou en totalité dans le service public ? Si c'est le cas, on ne peut pas les financer dans une logique de marché. On ne peut nous opposer la réglementation européenne.
En outre, le problème est quasi insoluble, les 250 pages du guide le démontrent s'il en était besoin. Pour répondre à la quadrature du cercle, chose bien connue dans le milieu hospitalier, on avait autrefois recours aux circulaires ; désormais, nous avons les guides. Nous avons un besoin urgent d'un guide d'aide à la gestion des contradictions...
Les hôpitaux psychiatriques financés par une dotation globale violeraient donc la réglementation européenne ? Pour nous, la réponse est non. Tout est dans le service public. ...
Faut-il mettre en concurrence les missions de service public de l'hôpital ? Si l'hôpital public fait convenablement son travail, ce type de question n'est pas recevable d'un point de vue politique.