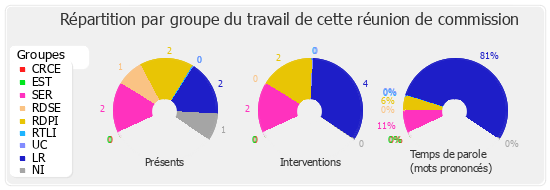Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 13 novembre 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Organisme extra parlementaire
- Projet de loi de finances pour 2014
- Mission « action extérieure de l'état » - examen du rapport pour avis et contrat d'objectifs et de moyens de campus france - avis (voir le dossier)
- Loi de finances pour 2014
- Création d'un groupe de travail sur l'université des antilles et de la guyane
La réunion
En application des articles L. 241-13 et R. 241-36 du code de l'éducation, la commission désigne Mme Françoise Cartron et M. Jean-Léonce Dupont pour siéger au Conseil national d'évaluation du système scolaire.
La commission examine tout d'abord le rapport pour avis de M. Louis Duvernois sur le projet de loi de finances pour 2014 sur les crédits de la mission « Action extérieure de l'État » ainsi que le contrat d'objectifs et de moyens de Campus France.

En l'absence de notre collègue Louis Duvernois, empêché pour raison de santé, Jacques Legendre a accepté -et je l'en remercie- de présenter devant la commission les crédits du projet de loi de finances pour 2014 relatifs à l'action culturelle extérieure de la France ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de moyens (COM) de Campus France pour les années 2013 à 2015.

Madame la présidente, chers collègues, les sujets abordés dans le présent rapport me tiennent particulièrement à coeur. C'est pourquoi j'ai accepté avec plaisir de représenter notre collègue Louis Duvernois.
L'action culturelle extérieure présente des visages aussi variés que les acteurs qui y concourent : elle concerne aussi bien l'éducation et la promotion de la langue française que les échanges artistiques et scientifiques.
Le ministère des affaires étrangères joue bien logiquement un rôle majeur en matière d'animation et de financement du vaste dispositif que constitue l'action culturelle extérieure, même si d'autres ministères, et en particulier celui de la recherche et de l'enseignement supérieur, y participent activement.
Pour la dixième année consécutive, le programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence » de la mission « Action extérieure de l'État » du ministère des affaires étrangères est affecté, dans le projet de loi de finances pour 2014, d'une réduction des moyens qui lui sont alloués. Après une diminution maîtrisée de 0,54 % en 2013, l'année 2014 s'annonce plus austère pour le réseau culturel français, qui enregistre une contraction de 3,3 % des crédits, à 724,7 millions d'euros.
Ces crédits sont répartis entre les six actions, de périmètre fort inégal, du programme : l'animation du réseau (44,1 millions d'euros), la coopération culturelle et la promotion du français (73,6 millions d'euros), les enjeux globaux (8,9 millions d'euros), l'attractivité et la recherche (101,8 millions d'euros), l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (416,5 millions d'euros), enfin, les dépenses de personnel (79,6 millions d'euros).
L'ensemble des dispositifs participe à l'effort d'économie. Ainsi, dans le cadre de la participation des opérateurs à la réduction de la dépense publique, leurs subventions ont été révisées : Campus France contribuera à hauteur de 0,16 million d'euros et l'Institut français pour 2,5 millions d'euros.
La subvention à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) diminue, pour sa part, de 8,5 millions d'euros, compte tenu de la stabilisation des taux des pensions civiles et des économies de fonctionnement jugées possibles. Pourtant, le nombre d'élèves scolarisés ne cesse de croître : après une augmentation de 30 % au cours des dix dernières années, la rentrée 2013 a induit près de 3 500 inscriptions supplémentaires. Cette croissance, dont il convient cependant de se réjouir dans la mesure où elle signe la reconnaissance de la qualité de l'enseignement français à l'étranger, engendre des coûts importants, notamment en termes immobiliers, que la dotation de l'AEFE peine désormais à couvrir.
S'agissant du réseau des instituts culturels, l'achèvement de la fusion des services de coopération et d'action culturelle (SCAC) et des établissements à autonomie financière (EAF) permet de réduire les crédits exceptionnels de restructuration du réseau à 1,4 million d'euros, soit une diminution de 53 % par rapport à 2013. La réduction des dotations de fonctionnement aux EAF s'établit à nouveau à 4 % en 2014 (40,7 millions d'euros), tandis qu'ils bénéficient de 12,6 millions d'euros pour leurs opérations. Par ailleurs, les subventions aux alliances françaises diminuent de 4,3 % pour s'établir à 7,02 millions d'euros. Enfin, les crédits dédiés à l'animation du réseau communication, missions d'évaluation, informatique, formation des agents, frais de missions et de représentation baissent de 4,3 %.
Plus encore que l'an passé, le réseau culturel français devra donc déployer des trésors d'imagination pour poursuivre la rationalisation de son fonctionnement sans renoncer à ses ambitions au bénéfice de l'influence de la France dans le monde. Sur ce point, j'estime fort dommageable l'abandon du projet, expérimenté depuis 2012, de rattachement des EAF à l'Institut français. Certes coûteuse dans un premier temps, la réforme aurait utilement permis de rationaliser les actions du réseau et de mutualiser certains coûts, notamment en matière de formation des agents.
Quoi qu'il en soit, la restriction continue des moyens dédiés à la diplomatie culturelle conduira prochainement le réseau à son niveau d'étiage, à partir duquel les efforts sur les coûts de fonctionnement ne suffiront plus au maintien d'un service de qualité.
Au-delà de la traditionnelle analyse des crédits alloués au programme 185 pour 2014, j'ai souhaité, cette année, orienter mes travaux dans une double direction : la francophonie et la promotion de la langue française d'une part, l'activité et les perspectives de l'opérateur Campus France, au sujet desquelles notre commission doit se prononcer à l'occasion de l'examen du prochain contrat d'objectifs et de moyens, d'autre part.
Selon l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), près de 220 millions de personnes utiliseraient quotidiennement la langue française, dont près de la moitié en Afrique. Ce chiffre pourrait atteindre 500 millions de personnes à l'horizon 2050, en fonction des prévisions de croissance démographique de ce continent. J'estime toutefois qu'au regard de l'offensive des langues vernaculaires et de l'anglais en Afrique francophone, ces prévisions semblent à tout le moins très optimistes, si ce n'est irréalistes.
Certes, à première vue, l'attractivité de la langue française semble ne rien avoir perdu de sa superbe : on compterait ainsi 450 000 professeurs de français à l'étranger et 100 millions d'élèves et d'étudiants francophones, ce qui ferait du français la deuxième langue la plus enseignée après l'anglais.
Toutefois, la géographie de l'apprentissage du français est mouvante et dépend de critères extrêmement variés, à l'instar de l'évolution du pouvoir d'achat local, des flux migratoires, du dynamisme du réseau mais également de l'importance donnée au français dans les programmes scolaires et universitaires.
En outre, ces chiffres encourageants masquent une tout autre réalité : le recul inexorable de la francophonie dans de nombreux pays, y compris des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), où les élites francophones, vieillissantes et parfois déconsidérées, ont laissé la place à des dirigeants économiques et politiques bien davantage anglophones.
La réalité de l'usage du français dans les organisations internationales et européennes, où il a pourtant statut de langue officielle, est également source d'inquiétudes.
Ainsi, l'office statistique européen Eurostat ne publie plus ses résultats qu'en anglais, l'Office européen des brevets, par le biais du protocole de Londres, tente d'imposer l'anglais comme langue scientifique et technique et de nombreux documents de travail européens à destination de l'État français sont rédigés en anglais.
L'association des fonctionnaires francophones des organisations internationales a d'ailleurs déposé plainte, le 18 octobre dernier, contre la Commission européenne, en raison de l'absence de traduction prévue dans le cadre de l'appel à candidatures pour la mise en place d'une plateforme de lutte contre la fraude fiscale.
En outre, aux Nations-Unies, la maîtrise de l'anglais est exigée dans 87 % des recrutements, tandis que celle du français l'est dans moins de 7 % des cas : cette dérive a d'ailleurs été dénoncée en 2011 par le corps commun d'inspection de l'Organisation des Nations unies (ONU).
Dans ce cadre, je souhaite saluer l'initiative du Premier ministre, qui a rappelé dans une circulaire en date du 25 avril dernier, l'obligation d'emploi de la langue française dans l'ensemble des outils de communication publique et par les fonctionnaires français dans le cadre des relations internationales. Il y est notamment précisé que l'usage d'une langue tierce ne doit se faire « qu'en ultime recours ».
Toutefois, dans ce contexte, la diminution de 5,6 millions d'euros des crédits destinés aux organisations multilatérales de la francophonie inscrit sur l'action 5 « Coopération multilatérale » du programme 209 « Aide au développement », qui étaient pourtant restés stables depuis plusieurs années, me semble particulièrement malvenue.
L'opérateur Campus France, qui fait l'objet de mon second « focus », est placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il a pour missions essentielles, outre la gestion des bourses, de promouvoir l'enseignement supérieur français à l'international, mais également d'accueillir et d'informer les étudiants et chercheurs étrangers. À cet effet, il s'appuie sur un réseau de 199 espaces dédiés placés sous l'autorité des ambassadeurs, employant 300 personnes dans 112 pays pour l'organisation d'actions de promotion variées (salons, forums, visites thématiques, tournées universitaires, qui totalisent chaque année en moyenne 200 000 visiteurs), soit un réseau comparable à celui du British Council. L'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dispose également d'un site Internet, décliné en une cinquantaine de versions locales, qui offre des informations sur le système universitaire français et les démarches à effectuer avant de venir en France.
Au cours de l'année scolaire 2012-2013, la France a accueilli 289 274 étudiants étrangers, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à l'année précédente et de 30,6 % en dix ans. Ils représentent 12,1 % des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur français (contre 4 % aux États-Unis, 10 % en Allemagne et 22 % au Royaume-Uni). 75 % d'entre eux sont inscrits dans les universités.
La répartition globale de l'ensemble des étudiants étrangers par région d'origine indique que l'Afrique du Nord et sub-saharienne demeure la première région d'origine avec près de la moitié des étudiants (44,9 %) mais en diminution de 3,5 % en un an. L'Europe se situe à la deuxième place avec 26 % des inscrits.
Si les comparaisons internationales doivent être approchées avec précaution, en raison de l'hétérogénéité des sources, on observe qu'un nombre croissant de nouvelles destinations, à l'instar de l'Espagne et de l'Italie en Europe, se positionnent en concurrents sérieux. La Chine affiche également des ambitions fortes et entend devenir d'ici 2015 un des premiers pays d'accueil des étudiants internationaux dans le monde.
Face à une concurrence internationale de plus en plus aiguë, il est heureux de constater que la place de la France est restée stable.
Pour autant, les restrictions budgétaires imposées à Campus France en 2014 devraient conduire l'opérateur à limiter ses activités de promotion de l'enseignement supérieur français à l'international, ce qui apparaît fort regrettable au regard de l'ampleur des défis à relever et de l'aggravation de la concurrence.
Il pourrait, en outre, être utile, comme le propose la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2013 sur le réseau culturel de la France à l'étranger, de :
- mettre en place un outil de suivi efficace des bénéficiaires de bourses sur le modèle du Club France Maroc ou de l'annuaire constitué par l'ambassade de France au Brésil, afin de faciliter les prises de contacts. Un tel outil existe déjà, avec des résultats encourageants, en Allemagne et au Royaume-Uni ;
- renforcer l'information aux étudiants étrangers, compte tenu des limites, malgré les progrès enregistrés, des espaces Campus France, dont l'efficacité varie en fonction de la fréquentation. L'opérateur pourrait s'appuyer à cet effet sur des enseignants des universités locales chargés, contre un complément de rémunération, de promouvoir le système français d'enseignement supérieur.
Au-delà de ce rapide bilan, nous sommes saisis, mes chers collègues, du premier projet de contrat d'objectifs et de moyens de Campus France, qui couvre la période 2013-2015. Il a fait l'objet, lors de son élaboration, d'un consensus des deux ministères de tutelle de l'établissement, comme des ministères cosignataires que sont le ministère de l'intérieur et celui de l'économie et des finances.
Ce document, dont on peut regretter que la première année d'application soit déjà pratiquement écoulée, propose quatre objectifs stratégiques :
- la valorisation et la promotion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français à l'international ;
- l'amélioration de l'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers ;
- le suivi régulier et l'animation d'un réseau d'étudiants et de chercheurs ayant accompli tout ou partie de leur cursus dans l'enseignement supérieur français ou le réseau d'enseignement français à l'étranger ;
- enfin, l'amélioration de l'efficience dans la gestion administrative et financière des programmes de mobilité et d'attractivité.
Comme le veut l'exercice et afin de permettre à la tutelle de juger des actions menées pendant la période de référence du contrat au regard des objectifs fixés, des indicateurs de performance et d'activité sont associés à chacun de ces quatre objectifs, eux-mêmes divisés en sous-objectifs plus opérationnels.
Au regard de la diminution annoncée des crédits publics, le contrat d'objectifs et de moyens présenté a le mérite d'un grand réalisme : les ambitions affichées apparaissent raisonnables, d'autant qu'il est prévu de les atteindre grâce à des gains de productivité et à une rationalisation de la gestion de l'opérateur, philosophie que je salue.
Deux points méritent également d'être soulignés : d'une part, la décision de mettre en place un outil de référencement commun avec le Centre national des oeuvres universitaires et scolaire (CNOUS), avec lequel les relations n'ont pas été des plus apaisées à la création de Campus France, dont on peut souhaiter qu'il contribue à améliorer la collaboration entre les deux opérateurs ; d'autre part, la mise en place d'un véritable suivi des étudiants et des chercheurs étrangers ayant effectué tout ou partie de leurs cursus en France, qui constitue une recommandation forte de la Cour des comptes. Il est toutefois regrettable que cet outil ne concerne que les boursiers.
Par ailleurs, je partage les observations de Campus France quant à la composition de ses organes de gouvernance, même si ce point ne ressort pas du contrat d'objectifs et de moyens.
Si l'ensemble constitue une construction équilibrée en termes de représentation des acteurs de la mobilité internationale, on peut cependant regretter une surreprésentation des administrations au conseil d'administration. De même, la présence du CNOUS, qui n'a pris part que deux fois aux délibérations du conseil, ne se justifie guère.
En revanche, l'absence totale de représentants du monde économique, au conseil d'administration comme au conseil d'orientation, apparaît dommageable. De la même manière, il serait souhaitable, compte tenu du rôle de Campus France en matière de délivrance des visas, que le ministère de l'intérieur y dispose d'un siège.
Pour l'ensemble des raisons exposées et en dépit de ces quelques remarques, je vous propose de donner un avis favorable à ce premier contrat d'objectifs et de moyens, dont il conviendra de suivre avec attention la mise en oeuvre.
En revanche, vous l'aurez compris mes chers collègues, compte tenu du sous-dimensionnement de l'enveloppe budgétaire aux ambitions culturelles françaises à l'étranger, je ne puis vous proposer de donner un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 185 « diplomatie culturelle et d'influence » au sein de la mission « Action extérieure de l'État ».
Par ailleurs, j'aurais souhaité que nous puissions entendre la ministre déléguée à la francophonie avant de nous prononcer.

Le responsable de ce programme est le ministre des affaires étrangères lui-même.

Je comprends parfaitement les réticences exprimées sur les réductions de crédit proposées lorsqu'il s'agit de culture et de rayonnement de la France à l'étranger mais ce domaine, comme les autres, doit se confronter à la réalité d'un environnement économique difficile et faire l'effort de participer également au redressement des comptes publics. Il me semble, en outre, que le projet de budget pour 2014 permet encore à la France d'assumer des ambitions culturelles élevées.

Il y a quelques années, à l'occasion d'un déplacement dans le Caucase, un interlocuteur m'avait fait cette remarque : « Nous n'aimons pas les Américains mais ils nous aident. Nous aimons les Français mais ils ne nous aident pas. » Dans le contexte actuel de réduction des crédits destinés au rayonnement de la France à l'étranger, cette affirmation n'en a que plus de sens. Il me paraît d'ailleurs révélateur d'avoir été récemment interpellé par un ambassadeur de cette région en vue de participer, dans le cadre de la réserve parlementaire, au financement d'une association locale de promotion de la langue française.

Certes, l'environnement économique est difficile mais la fuite en avant dans l'austérité que propose le projet de budget pour 2014 ne représente pas une solution efficace pour revenir à la croissance. J'estime à cet égard particulièrement regrettable que les crédits destinés aux politiques culturelles soient à nouveau sacrifiées alors même que ces dernières sont indispensables au « vivre ensemble ».

Il est exact que certains domaines de l'action extérieure de la France, notamment pour ce qui concerne l'immobilier diplomatique, peuvent encore être rationalisés. En revanche, il ne faut pas négliger la diplomatie d'influence au bénéfice de la seule diplomatie économique. À long terme, les effets négatifs d'une telle politique sur le rayonnement de la France et du français pourraient bien être définitifs, d'autant qu'à la faiblesse des crédits s'ajoute l'absence de grandes fondations françaises à l'international, à l'instar de celles qui existent en Allemagne et au Royaume-Uni. À titre d'exemple, la commission des affaires européennes du Sénat a récemment reçu une délégation du Sénat italien. Il y a 20 ou 30 ans, l'ensemble des parlementaires invités auraient maîtrisé la langue française. Aujourd'hui, seul le président de la délégation possédait quelques notions de français.

Si nul ne peut contester la priorité donnée par le Gouvernement aux politiques culturelles, la nécessité globale de réduire les dépenses publiques ne peut non plus être occultée, comme le fait notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin. Je m'étonne également de la position paradoxale de notre collègue Jacques Legendre, qui critique la réduction des crédits alloués en 2014 à l'action culturelle extérieure, tout en approuvant ceux qui contestent toute augmentation de la pression fiscale.
J'estime, s'agissant du présent programme, que des économies supplémentaires peuvent encore être réalisées par la poursuite des efforts de rationalisation afin d'éviter de réduire par trop les investissements.

Je partage entièrement l'analyse de notre collègue André Gattolin : la francophonie ne se limite pas à la culture ; elle transmet également des valeurs. Toutefois, la diplomatie économique ne doit pas être négligée. Lors d'un déplacement au Cambodge, j'ai ainsi constaté que, depuis le financement de cours d'anglais dans les écoles par Toyota en lieu et place des anciens coopérants français, les voitures Peugeot avaient disparu.

Si le rapport que je vous ai présenté est celui de notre collègue Louis Duvernois, il ne diffère en rien de l'opinion qui est la mienne. Je m'inquiète en effet depuis de nombreuses années de l'érosion progressive des crédits destinés à l'action culturelle extérieure, et ce quelle que soit la majorité au pouvoir. J'ai notamment déjà dénoncé devant notre commission les difficultés de fonctionnement de certains postes culturels à l'étranger.
Plus largement, les gouvernements successifs ont réduit, ces dix dernières années, les moyens alloués à la diplomatie française profitant du caractère légitimiste des diplomates. Or, l'exercice atteint aujourd'hui ses limites : le budget du ministère des affaires étrangères ne correspond plus aux ambitions affichées. C'est pourquoi je vous propose, chers collègues, d'aider le ministère à défendre les moyens de son action en donnant un avis défavorable aux crédits du programme 185 inscrits au projet de loi de finances pour 2014.
Contrairement à la position du rapporteur pour avis, la commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Action extérieure de l'État ».

La création de Campus France devait constituer un facteur de rationalisation des coûts en matière de coopération universitaire et d'accueil des étudiants étrangers. Toutefois, force est de constater que l'installation de l'opérateur fut quelque peu agitée entraînant même la démission de son président Christian Demuynck. Ces temps difficiles ont passé : la nomination d'une nouvelle présidente, la modernisation de l'organisation interne et l'élaboration d'un contrat d'objectifs et de moyens en sont la preuve.
Ce premier contrat est le résultat d'un rapprochement des deux ministères de tutelle et du développement bienvenu d'une concertation efficace avec la Conférence des présidents d'université (CPU), qui contribue également à la politique de rayonnement universitaire de la France grâce à des partenariats avec des établissements étrangers.
En outre, un accord d'établissement a été signé avec les représentants des personnels, il instaure une grille unique de classification des emplois de l'opérateur.
Par ailleurs, la situation financière de Campus France ne constitue pas à ce jour une source d'inquiétude : si les ressources issues des produits d'exploitation diminuent le résultat net de l'établissement demeure positif et devrait s'établir à 1,5 million d'euros en 2014. À cet égard, il convient de rappeler que les contraintes budgétaires qui s'imposent à l'opérateur ne sont pas sans rapport avec les conditions chaotiques de son installation, d'une part, et l'assouplissement récent des conditions d'accueil des étudiants étrangers, d'autre part.
Si des progrès demeurent nécessaires, notamment en matière de formation des agents locaux, j'estime que le bilan d'activité de Campus France est positif et que les crédits dont il disposera en 2014 devraient, grâce à un effort de rationalisation du fonctionnement, être suffisants.
Conformément à la position du rapporteur pour avis, la commission émet un avis favorable au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 de Campus France.
Puis la commission examine le rapport pour avis de M. Pierre Martin sur le projet de loi de finances pour 2014 sur les crédits « Jeunesse et vie associative » au sein de la mission « Sport, jeunesse et vie associative.

J'invite M. Pierre Martin à nous présenter les crédits consacrés à la jeunesse et à la vie associative au sein de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » dans le projet de loi de finances pour 2014.

Les crédits du programme 163 « Jeunesse et vie associative » s'établissent, dans le projet de loi de finances pour 2014, à un peu plus de 229 millions d'euros en crédits de paiement, contre 232 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2013, soit une diminution légèrement supérieure à 1 %. Si l'on tient compte du rapatriement sur le service civique de trois millions d'euros supplémentaires issus du reliquat du fonds d'expérimentation de la jeunesse obtenu par la ministre, la diminution est ramenée à 0,3 %, après extraction de la réserve parlementaire. Les dépenses d'intervention dans les secteurs de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont donc globalement préservées. Ce sont les services déconcentrés du ministère qui supportent l'effort le plus important de réduction des dépenses de fonctionnement.
Les moyens du programme 163 sont complétés par les crédits inscrits sur le nouveau programme 411 « Projets innovants en faveur de la jeunesse », à hauteur de 100 millions d'euros, en vue de favoriser, par le biais d'appels à projets, la conception et la mise en oeuvre de politiques de jeunesse intégrées et coopératives à l'échelle des territoires. Je souligne, néanmoins, que les premiers appels à projet ne seront pas lancés avant début 2015, l'année prochaine devant être consacrée à la réflexion avec l'ensemble des partenaires.
Le comité interministériel de la jeunesse (CIJ) du 21 février 2013, placé sous la présidence du Premier ministre, a élaboré un plan « Priorité jeunesse » définissant treize chantiers prioritaires et 47 mesures destinés à soutenir l'intégration, l'autonomie et l'employabilité des jeunes. Ce plan se caractérise par l'expérimentation de trois mesures phares :
- les emplois francs, qui reposent sur une aide forfaitaire de 5 000 euros pour l'embauche en CDI d'un jeune de moins de trente ans résidant dans les zones urbaines sensibles ;
- le service public régional de l'orientation, qui est expérimenté dans huit régions pilotes depuis septembre 2013 ;
- et la « garantie jeunes », expérimentée à partir d'octobre 2013 dans dix territoires afin d'apporter aux jeunes de moins de 25 ans un accompagnement intensif et des propositions adaptées de formation et d'emploi, ainsi qu'une garantie financière légèrement inférieure au revenu de solidarité active (RSA). Cette garantie préfigure, en quelque sorte, l'allocation de revenu minimum promise par le Président de la République aux jeunes de moins de 25 ans.
À ces dispositifs expérimentaux d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, s'ajoutent les emplois d'avenir et les contrats de génération. Face à la multiplication et à la fragmentation des dispositifs destinés au renforcement de l'autonomie et de l'employabilité des jeunes, il faut néanmoins se poser la question de la cohérence.
En particulier, comment s'assurera-t-on que l'engagement de service civique demeurera attractif auprès des jeunes les moins qualifiés, face à la multitude de dispositifs d'emplois aidés et de revenu minimum qui s'offrent à eux ? Il faut clairement distinguer et éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes de moins de 25 ans entre, d'une part, le service civique qui constitue d'abord et avant tout un dispositif d'insertion civique et de sensibilisation à la notion d'intérêt général, et, d'autre part, les différents types de contrats aidés et de revenu minimum qui visent l'insertion professionnelle des jeunes les plus défavorisés. On est sur deux logiques bien distinctes, mais parfois concurrentielles, en particulier pour les jeunes les plus défavorisés.
N'oublions pas que les marges de progrès en termes de mixité sociale parmi les volontaires du service civique sont encore très importantes : seulement 25 % des engagés de service civique ont un niveau inférieur au baccalauréat, alors que 41 % ont un niveau supérieur au bac. Il faut donc faire attention à ce que le service civique, et plus largement l'engagement des jeunes au service de l'intérêt général, ne soit pas le privilège d'une poignée de jeunes diplômés ou poursuivant des études supérieures et que les jeunes les moins qualifiés et les plus vulnérables soient, eux, cantonnés aux dispositifs de contrats aidés.
J'en viens ainsi à l'évolution des moyens consacrés au développement du service civique. Le service civique continue de constituer le poste de dépenses le plus important du programme avec 149 millions d'euros prévus en 2014, soit quatre millions d'euros de plus qu'en 2013 et 64 % des moyens mobilisés au sein du programme 163.
Le problème le plus préoccupant est bien celui de la soutenabilité budgétaire de la montée en charge de ce dispositif.
En effet, le coût total d'une mission de service civique pour l'État est aujourd'hui d'environ 970 euros. Il sera ramené prochainement, après simplification du régime des cotisations retraite par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, à 820 euros. Compte tenu de la durée moyenne d'un contrat de service civique qui s'établit à huit mois, la prise en charge d'un volontaire par l'État pendant un an revient à 6 560 euros. Dans ces conditions, pour satisfaire l'objectif de 100 000 volontaires effectuant un service civique en année pleine, il faudrait accorder à l'Agence du service civique 656 millions d'euros.
Nous sommes très, très loin du compte, et la Cour des comptes n'a pas manqué de s'en inquiéter dans son rapport sur l'exécution budgétaire de 2012 et le rappellera prochainement dans les conclusions de son contrôle sur les finances de l'Agence du service civique. Rappelons que la loi de programmation triennale ne prévoit à terme, en 2015, qu'une augmentation de 70 millions d'euros pour la mission « Sport, jeunesse et vie associative ». En admettant que l'augmentation ne bénéficie qu'au service civique, elle demeurerait bien insuffisante pour remplir l'objectif de 50 000 engagés de service civique en 2015 : il manquerait à l'agence encore 100 millions d'euros !
La Cour des comptes recommande la réduction du coût unitaire des missions de service civique. Mais je vois mal comment on pourrait aller plus loin dans cette réduction, sauf à choisir de diminuer le montant de l'indemnité de service civique pour le jeune, ce qui n'est certainement pas souhaitable, on en conviendra tous. On ne peut pas non plus diminuer les aides consenties aux structures d'accueil, puisque les associations doivent précisément permettre au jeune, via le tutorat, d'assumer en pleine autonomie l'exécution de sa mission, sans être en situation de subordination hiérarchique. C'est bien l'apprentissage de la responsabilité qui est au coeur du service civique. Les marges de réduction du coût des missions me semblent donc très faibles. Nous allons droit au mur si nous n'assurons pas une montée en charge puissante sur le plan budgétaire du dispositif pour être à la hauteur de l'ambition.
Malgré cette inquiétude forte sur la soutenabilité budgétaire du service civique, on peut relever quelques signes encourageants pour la jeunesse et la vie associative :
- la mobilité internationale des jeunes est confortée, puisque l'Office franco-allemand pour la jeunesse bénéficie de deux millions d'euros supplémentaires, consentis à parts égales par chacun des deux gouvernements partenaires, la France et l'Allemagne ;
- les dépenses fiscales en faveur du tissu associatif sont renforcées par l'augmentation de 6 000 à 20 000 euros de l'abattement de la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations, soit 314 millions d'euros supplémentaires de dépenses fiscales. Dans ces conditions, 70 % des associations ne paieront plus de taxe sur les salaires.
N'oublions pas que les collectivités territoriales, en particulier les communes et les départements, sont au coeur de l'action en faveur des jeunes et du mouvement associatif. Or, j'ai le sentiment qu'on leur envoie un signal assez négatif lorsque l'État diminue le montant des crédits consacrés aux politiques partenariales locales de jeunesse et d'éducation populaire de presque 20 % par rapport à 2013 et de 26 % par rapport à 2012. Ce soutien est pourtant crucial car il permet d'accompagner les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de leurs politiques éducatives locales et l'amélioration de la qualité de l'accès des jeunes aux loisirs.
Le ministère justifie cette baisse significative par la montée en charge des dispositifs de droit commun dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires : 250 millions d'euros au titre de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la mise en place du « fonds d'amorçage » par l'État. Toutefois, de lourdes incertitudes continuent de peser sur la capacité des collectivités territoriales, elles-mêmes exposées à d'importantes contraintes budgétaires, à mettre en place des projets éducatifs territoriaux ambitieux et à développer l'offre d'activités périscolaires.
Je rappelle, par exemple, la situation préoccupante que connaissent certains départements en matière d'accueil collectif des mineurs. Confrontés à un phénomène de saturation des capacités d'accueil de leurs centres de loisirs et de vacances, des départements tels que le Loiret, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, la Mayenne et la Moselle ont été contraints de limiter l'accueil de nouveaux mineurs étrangers, en remettant en question le dispositif de répartition des jeunes étrangers isolés et le manque de transparence sur les quotas affectés à chaque département pour l'accueil de mineurs étrangers. Il faut donc alerter le Gouvernement sur les difficultés croissantes rencontrées par certains départements pour assurer une prise en charge éducative de qualité de l'ensemble des mineurs et, en particulier, des mineurs étrangers qui souffrent d'isolement.
En conclusion, je vous proposerai de donner un avis défavorable à l'adoption des crédits de la jeunesse et de la vie associative en raison des lourdes incertitudes qui pèsent sur la soutenabilité budgétaire de la montée en puissance du dispositif de service civique.

Je crois que, dans son réquisitoire, le rapporteur fait un amalgame entre plusieurs sujets pour n'en souligner que les aspects qui peuvent à première vue apparaître négatifs en raison de transferts de crédits d'une ligne à l'autre. Vous soulevez la question des besoins de financement des associations pour faire face à la réforme des rythmes scolaires. Certes, le milieu associatif sera fortement impliqué dans la mise en place des nouveaux rythmes, mais je rappelle que la CNAF contribue à hauteur de 54 euros par élève et par an versés aux écoles qui mettent en oeuvre la réforme, à partir d'une enveloppe de 250 millions d'euros créée pour soutenir le développement des activités périscolaires.
Il est vrai que nous devons financer, dans un contexte contraint, la montée en charge du service civique, qui témoigne d'un véritable engouement des jeunes pour ce dispositif. Mais n'oublions pas que la tension sur le plan budgétaire aurait été encore plus forte si c'était l'objectif de 150 000 jeunes engagés dans le service civique, défendu par la précédente majorité, qui devait être mis en oeuvre. Quand on constate que la durée moyenne des contrats de service civique avoisine les sept mois et demi, au lieu des neuf mois initialement envisagés, on peut imaginer que des économies pourront être faites sur la durée de l'engagement.
L'augmentation de l'abattement de la taxe sur les salaires, de 6 000 à 20 000 euros, offrira une véritable bouffée d'air à plus de 70 % des associations, sollicitées de façon croissante pour la formation des bénévoles et l'organisation d'activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Nous ne partageons pas l'analyse sévère que le rapporteur fait de ce budget et les membres du groupe socialiste voteront les crédits de cette mission.

J'aurais souhaité quelques explications sur le type d'associations intervenant dans l'accueil collectif des mineurs étrangers isolés.

Pour rebondir sur les remarques de M. Magner sur les conditions de maîtrise du coût de l'engagement de service civique, je rappelle qu'un certain nombre d'associations insistent sur la nécessité de ne pas réduire la durée du contrat en-dessous d'un certain seuil car elles investissent fortement dans la formation des volontaires qu'elles accueillent dans l'exécution de leur mission. Une fois formés, ces volontaires, épanouis, deviennent une aide précieuse pour l'association. À trop diminuer la durée, on prend le risque d'une coopération un peu vaine pour l'une et l'autre parties.

À nos collègues de l'opposition qui sont très précis dans leurs critiques du projet de loi de finances, je rappelle que la révision générale des politiques publiques conduite sous le précédent gouvernement a saigné dramatiquement les moyens des services déconcentrés de l'État. La ministre est consciente de l'état de nos relais dans les territoires et s'emploie à restaurer les conditions d'un travail efficace de partenariat avec les collectivités territoriales à la hauteur des enjeux.
Même si la majorité gouvernementale a changé, les problèmes se sont amplifiés. On ne peut pas, d'un côté, dire que le Gouvernement n'est pas en capacité de faire les bons choix et de réaliser les économies qui s'imposent, et, de l'autre, appeler aux augmentations de crédits sur tous les plans. Le projet de budget doit procéder à une réduction des dépenses de 15 milliards d'euros en 2014, cela a nécessairement des répercussions. Préférons les discours de vérité compte tenu des responsabilités qui sont les nôtres, en tant que parlementaires, quelle que soit notre couleur politique.

Mes chers collègues, je vous rappelle que les crédits que nous discutons aujourd'hui s'insèrent dans la mission « Sport, jeunesse et vie associative » pour laquelle notre commission se prononcera par un seul vote le 26 novembre, à la suite de l'examen des crédits du sport et la présentation de l'avis de notre collègue Jean-Jacques Lozach.

J'aimerais insister sur la difficulté à disposer d'indicateurs budgétaires fiables, face à tous ces transferts et changements de périmètre qui compliquent fortement la lisibilité du budget d'une année sur l'autre.

Le labyrinthe de Bercy est contesté une fois de plus de façon unanime par notre commission.

Il est parfaitement légitime pour un rapporteur de l'opposition, quelle qu'elle soit, de porter un regard plus aigu sur un budget que ne l'aurait fait un rapporteur de la majorité. Je n'ai pas souvenir que les membres de notre commission appartenant à la majorité sénatoriale, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, aient fait de cadeaux au budget de la majorité de l'époque. L'exercice auquel nous nous prêtons est justement l'occasion de comparer les analyses des uns et des autres et de nous forger notre opinion de façon éclairée.
Je crois que la pensée de notre collègue Dominique Gillot a dépassé ses propos lorsqu'elle a déclaré que, bien que la majorité ait changé, les problèmes se sont amplifiés.

Vous sortez ma remarque de son contexte, qui valait pour un autre sujet.

Je partage l'observation de Mme Gonthier-Maurin, la complexité des aides et des dispositifs qui se multiplient et se cumulent est préoccupante.

Reconnaissons que le paysage de l'ensemble des dispositifs qui s'adressent aux jeunes, entre le service civique, les emplois d'avenir, les contrats de génération et d'autres encore, est pour le moins confus. Le jeune sans emploi à la recherche d'une solution se gratte la tête devant la multitude de ces dispositifs qui correspondent, à chaque fois, à une logique, un traitement et une forme de soutien différents.
Comme le fait remarquer M. Magner, le milieu associatif sera fortement sollicité dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Nous disposons déjà de remontées d'associations qui s'interrogent sur leur capacité à rémunérer leurs intervenants pour conduire les activités périscolaires. Nous n'allons pas rouvrir le débat sur les rythmes scolaires, une mission commune d'information a été constituée au sein de notre assemblée sur ce sujet. À titre personnel, je comprendrais mal qu'on exige de nos enseignants qu'ils disposent d'un master pour exercer et que, dans le même temps, on appellent des personnels à encadrer nos jeunes dans leurs activités périscolaires sans que soit requise une qualification ou une formation spécifique. Quoi qu'il en soit, pour financer l'ensemble de ces besoins, on en est rendu, aujourd'hui comme hier, à prendre à Pierre pour donner à Paul.
Pour répondre à Mme Laborde, les départements s'appuient, pour la mise en oeuvre du dispositif d'accueil des mineurs étrangers isolés, sur les associations agréées « Jeunesse et éducation populaire » spécialisées dans l'accompagnement socio-éducatif, l'aide sociale à l'enfance et l'hébergement d'urgence des mineurs isolés.
Les responsabilités partagées de l'État et des associations dans l'accueil et la formation des volontaires de service civique et les bénéfices que les associations peuvent légitimement espérer retirer de ce tutorat auxquels faisait référence Mme Blandin, pourront être utilement rappelés et précisés dans la nouvelle charte d'engagements réciproques entre l'État, les collectivités territoriales et les associations, en cours d'élaboration.
Le véritable problème, pour la cohérence de notre politique en faveur de la jeunesse et de la vie associative, est de savoir clairement quels sont nos objectifs et comment nous entendons raisonnablement les atteindre. N'oublions pas que les collectivités territoriales, fortement impliquées dans ce secteur, sont en droit d'attendre de l'État cet effort de cohérence, en particulier sur le plan financier.
Le vote de l'avis sur les crédits est réservé.
Enfin, la commission procède à un échange de vues sur la création d'un groupe de travail conjoint avec la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, sur la situation de l'Université des Antilles et de la Guyane.

Notre collègue Serge Larcher, président de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, sur une proposition du sénateur Jean-Étienne Antoinette s'alertant de la situation troublée que connaît à l'heure actuelle l'Université des Antilles et de la Guyane, a souhaité que nous mettions en place une mission d'information sur ce sujet. L'installation d'une telle structure me semble difficile, compte tenu à la fois de notre manque de moyens et du fait que le législateur n'a pas forcément vocation à intervenir dans le règlement de chacune des crises aiguës que connaissent, du reste, d'autres universités, comme Montpellier III et son antenne de Béziers. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche nous a indiqué, au cours de son audition, s'employer à régler au plus vite la situation afin de mettre un terme aux blocages de l'université. Avant-hier, un protocole d'accord entre l'intersyndicale et le collectif des étudiants et le ministère a été signé et contre-signé par tous les élus locaux et nationaux de ce territoire. Il vise à sanctuariser les moyens et dessiner les perspectives d'autonomisation du pôle universitaire guyanais.
Pour donner suite à la demande de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, il nous a semblé préférable au niveau de notre commission de constituer un mixte de travail conjoint à notre commission et la délégation, au sein duquel seraient représentés tous les groupes politiques et dont le rapporteur, pour la commission, pourrait être notre rapporteure des crédits de l'enseignement supérieur Dominique Gillot.
Il en est ainsi décidé.