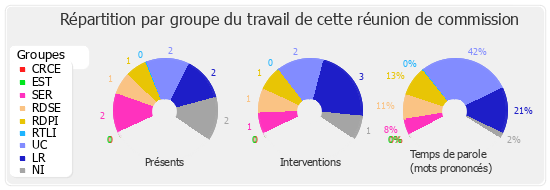Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 27 mars 2013 : 3ème réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission entend M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale, sur le projet de loi n° 441 (2012-2013), adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

Nous vous auditionnons, monsieur le ministre, sur le projet de loi d'orientation et de refondation de l'école de la République, texte très attendu, au sujet duquel nous avons - ce matin - également auditionné le rapporteur du Conseil économique, social et environnemental. Je regrette fortement la suppression de l'article 3 à l'Assemblée nationale.

Nous étions tous présents à 17 heures dans cette salle pour vous entendre, monsieur le ministre, et je tiens à marquer notre étonnement devant votre retard ainsi que celui des membres du groupe socialiste.
Je vous prie d'excuser ce retard ; il est d'ailleurs assez coutumier dans ma façon d'être.
Ce texte a pour objectif la réussite de nos enfants. Les travaux réalisés ces dernières années ont permis d'aboutir à un diagnostic partagé sur les difficultés : le nombre trop élevé des décrocheurs, la hausse des inégalités, etc. Dès lors que le consensus prévaut, des réformes sont possibles, à l'image de la loi de 2004 interdisant le port des signes religieux à l'école, votée par l'ensemble des groupes, sur laquelle le Conseil d'État vient de s'appuyer pour revenir sur la décision du tribunal de Melun.
Priorité au primaire, tel est le maître mot. L'enjeu n'est pas négligeable, au vu de l'histoire de notre système éducatif, même si entre une loi et les réalités, l'écart est parfois grand. Est-ce simplement une affaire de moyens ? Certes il manque des enseignants : nous créons 27 000 postes supplémentaires. Nous manquons comme jamais de professeurs en primaire, notamment en cours préparatoire. Les postes créés à la rentrée 2013 serviront souvent à reconstituer le vivier de remplaçants. Mais notre réforme traduit aussi le principe du « plus de maîtres que de classes ». Elle s'accompagne d'un changement de la pédagogie et de la relation maître-élève. La priorité au primaire englobe la maternelle et les conditions spécifiques de l'accueil des petits.
Deuxième objectif : la formation des enseignants. Comme pour la réforme du temps scolaire, il ne s'agit pas de revenir à la situation antérieure. La création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) s'appuie sur les bonnes pratiques. Elles permettront une entrée progressive et professionnalisante dans le monde enseignant. Mon ministère travaille à l'élaboration, non seulement des maquettes de ces écoles, mais aussi de nouveaux référentiels de métiers, et à la refonte des concours. Ces écoles doivent porter notre ambition en matière de pédagogie : outre les disciplines fondamentales, la psychologie des enfants, la didactique, le numérique, la laïcité que doivent connaître les enseignants du XXIe siècle.
Cette loi inclut aussi un volet de programmation ; elle octroie des moyens, détermine leur affectation dans le temps en fonction des priorités affichées.
La réforme des rythmes scolaires, d'ordre réglementaire, ne relève pas de cette loi, mais participe du même esprit d'ambition pour la réussite.
La loi se donne aussi comme ambition de mettre en place un service public numérique éducatif, facteur de réussite éducative et élément important dans la compétition internationale. D'autres pays le font très bien. Si nous n'y parvenons pas, le secteur privé s'en chargera.
La réforme de l'orientation constitue le dernier chantier. Cette loi a-t-elle accouché d'une souris, comme certains l'ont affirmé à l'Assemblée nationale ? Il ne s'agit pas de reconstruire la maison de la cave jusqu'au plafond, mais de poser des jalons consensuels. L'instauration d'un parcours d'orientation et d'information dès l'entrée au collège, pour surmonter le clivage entre l'école et l'entreprise, n'est-ce pas une réforme importante ? De même, le parcours d'éducation artistique et culturelle, l'enseignement de la morale, l'enseignement des langues étrangères dès le CP, la généralisation des conseils pédagogiques entre l'école et le collège constituent autant d'avancées.
Nous nous inscrivons à cet égard dans la continuité. L'idée des cycles, introduite par la loi Jospin de 1989, est reprise par tous. De même, nous faisons nôtre l'idée du socle commun de connaissances, défini par la loi Fillon de 2005, mais qui en réalité n'a pas été mise en oeuvre. La loi, avec la modification du socle, le Conseil supérieur des programmes, ou le Conseil national d'évaluation des programmes, nous donne les instruments nécessaires à la réussite, à l'évolution des pratiques, sans déclencher de polémique. Nous avons ainsi ajouté, après de nombreuses discussions, la culture au socle : tout le monde soutenant cette initiative, elle sera mise en oeuvre, loin des critiques qui avaient entouré cette notion lors de sa définition. Nous avançons de manière pragmatique !
Je n'assisterai pas aux travaux en commission. Il est important que la France parle de l'école. L'école n'appartient à personne car elle appartient à tous. Peu de débats parlementaires ont eu lieu, même si le Parlement compte des spécialistes. Je souhaite que le débat soit riche au Parlement. La procédure accélérée n'a pas été engagée sur ce texte ; tous les points de vue pourront s'exprimer, et seront les bienvenus.

« L'école appartient à tous » : tel est bien en filigrane la philosophie de ce projet de loi qui s'efforce de mettre en place une école ouverte sur son territoire et ses partenaires.
La place des parents dans les parcours d'orientation est peut-être insuffisamment reconnue. Il est pourtant nécessaire qu'ils soient associés. Or, les enfants qui réussissent sont ceux dont les parents sont présents, associés et confiants dans l'école. Pensons à ces liens de confiance entre l'institution et les parents, notamment au sujet de l'orientation ou de la situation des enfants handicapés. Sans minimiser la place des enseignants, la réussite est meilleure dans un climat de dialogue et de confiance.
L'accueil des enfants dès deux ans concerne de manière prioritaire les zones d'éducation prioritaires, urbaines ou rurales. Or, dans les zones rurales et péri-urbaines, les enfants de deux à trois ans sont parfois accueillis dans des classes enfantines, et non maternelles. Si les enfants ne peuvent être accueillis, les parents, qui travaillent dans les centres urbains, se détourneront de l'école publique.
Nous devrons sans doute réfléchir également à la promotion des langues régionales. Dans certains départements, comme la Gironde, elles sont nombreuses et vivantes.
Enfin, l'école pour tous suppose la mixité sociale. Comment seront accueillis les enfants de milieux défavorisés et de situations familiales difficiles ? Il ne faudrait pas qu'ils aient le sentiment d'être exclus deux fois.

Ce débat est essentiel. Le souci d'améliorer l'avenir de nos enfants doit l'emporter sur les divisions politiques.
Vos objectifs sont modestes : « Réduire de moitié le nombre d'élèves sortant du système scolaire sans qualification ». Il y a trente ans, on m'avait demandé de construire un système dans lequel aucun enfant ne devait sortir sans qualification. Quelle évolution !
De même, amener 80 % d'une classe d'âge au bac : l'objectif est presque atteint. Faire en sorte que 50 % soient diplômés de l'enseignement supérieur : mais que deviennent les autres ; comment les valoriser et non les enfoncer ? Quid des 30 % qui n'entreprennent pas d'études supérieures, notamment parmi les titulaires du bac professionnel : pourront-ils reprendre une formation s'ils le souhaitent ? Comment associer réforme du système éducatif et adaptation du système de formation continue ?
Il est pertinent, comme le montre de nombreuses études, telle celle de Claude Hagège, de vouloir développer l'apprentissage des langues étrangères de façon précoce. Mais n'oublions pas notre combat pour la diversité culturelle et linguistique. Cet enseignement ne doit pas favoriser exclusivement l'anglais.
N'oublions pas non plus les langues régionales. J'appartiens à la commission nationale pour la promotion des langues régionales et la valorisation de la diversité linguistique installée par Mme Filippetti. Dans les académies où cela se justifie, la possibilité d'apprendre des langues étrangères ou des langues régionales doit être ouverte selon les traditions locales.

Loi de « refondation », le terme est justifié ! Son ambition est de faire reculer l'échec scolaire, lié aux inégalités sociales, et d'améliorer l'accès au savoir et donc à la citoyenneté. École et société ont partie liée. Chacun s'accorde à souhaiter plus d'école. Encore faut-il s'entendre sur ses missions. Ce texte comporte des éléments positifs mais nourrit des attentes et des inquiétudes.
Je suis inquiète d'une organisation du système scolaire plus territoriale et de l'accroissement des liens avec le milieu économique. L'école a avant tout pour mission d'améliorer les connaissances.
Quelle sera l'articulation entre le scolaire et le périscolaire, voire l'extrascolaire ? Je soutiens l'idée de parcours, mais tous n'ont pas la compétence pour enseigner.
Quel sera l'avenir du lycée professionnel ?
La priorité au primaire ? Oui, mais il faut revoir le cursus vers la réussite. Le transfert de la carte les formations aux régions m'inquiète. Confirmez-vous que l'État gardera la main ? Nous devons rechercher la continuité du service public.
Nous travaillerons avec notre rapporteure pour contribuer à améliorer le texte.

Comment développer les coopérations entre élèves, entre élèves et adultes, entre parents et enseignants ?
Concernant la prise en charge du handicap, quelle est précisément votre appréciation de la place des enseignants par rapport aux parents ?

Comment s'articuleront la formation continue et la formation initiale des enseignants ?
L'apprentissage dès 14 ans a été supprimé. Je le regrette beaucoup. Cette mesure permettait pourtant une entrée progressive dans la vie active, avec, à la clef, un diplôme, parfois le seul d'ailleurs.
Le système d'orientation actuel n'est pas satisfaisant. Les chiffres du décrochage le montrent. Mais à la sortie du collège les élèves sont orientés presque systématiquement vers les voies généralistes.
Je crois comme vous qu'en développant le sens moral et l'esprit critique, on construit l'homme et le citoyen. L'enseignement agricole constitue un exemple à cet égard : la réussite aux examens, comme l'insertion professionnelle, sont remarquables.
La place des parents n'est pas assez affirmée. Comment la conforter ?
L'article 33 dispose que les collèges peuvent préparer les élèves de 3e à une formation professionnelle, grâce, éventuellement, à des stages contrôlés par l'État et accomplis auprès de professionnels agréés. C'est une mesure excellente. Mais qu'en est-il des élèves de 4e ?
Sans anticiper sur le projet de loi sur l'acte III de la décentralisation, les régions auront à gérer la formation. Comment sera effectuée la cohérence avec le niveau national qui détiendra les moyens? Certaines filières de l'enseignement agricole relèvent-elles du niveau régional plutôt que national - je pense, par exemple aux filières hippiques ou d'élevage canin ?
Enfin, je suis favorable à la réforme des rythmes scolaires. Mais elle se révèle inapplicable dans mon village, qui rassemble dans un pôle les enfants de cinq communes. Les intervenants manquent. De plus, le conseil général ne peut pas augmenter l'offre de transport scolaire. Les enfants conserveront donc la même amplitude horaire, le mercredi en plus, et ne profiteront pas de la réforme.

L'accueil des enfants de deux ans est une idée qui m'est chère. Nouveau ministre, nouveau langage : je note avec satisfaction que les instituteurs ne sont plus là pour changer les couches...
Le Parlement ne comporte pas que des spécialistes, heureusement. Un travail de pédagogie est nécessaire pour lever les confusions entourant la refondation de l'école, la modification des rythmes scolaires, l'articulation avec les temps périscolaires.
S'agissant du handicap, j'interviendrai en temps voulu sur l'autisme.
Vous avez évoqué les contributions de l'Assemblée nationale : n'oublions pas les rapports du Sénat sur le métier d'enseignant ou la carte scolaire !
La refondation ne peut faire l'économie d'une réflexion sur les programmes. La création des ESPE implique un changement des concours, de nouveaux modules, parmi lesquels je note avec satisfaction la laïcité. Je soutiens l'idée du socle de connaissances. Avant de réfléchir à une répartition territoriale des enseignements, définissons-le ! Lors de chaque débat, chacun est prompt à envisager de confier à l'école une nouvelle attribution. Je crois beaucoup, en outre, à des modules d'enseignement numérique, utiles pour apprendre à apprendre.
Enfin, quid de la formation professionnelle ? Elle semble absente de ce texte.
Les débats sur l'école sont porteurs de contradictions. Chacun souhaite attribuer à l'école l'enseignement de telle ou telle nouvelle matière, tout en déplorant les rythmes scolaires trop lourds. D'autres ambiguïtés demeurent s'agissant de l'accueil des enfants handicapés ou de l'enseignement des langues régionales. Nous devons répondre à ces demandes tout en préservant la capacité de l'école à accomplir ses missions essentielles.
Madame Cartron, le rapport annexe aborde la question des parents. Des associations de parents d'élèves souhaitent accroître le rôle des parents en matière d'orientation. Dans le même temps, certains rapports soulignent la nécessité de protéger les professeurs contre les parents, ou déplorent leur manque d'autorité. En ce domaine, l'action des parents n'est pas univoque : certains parents, de milieux sociaux modestes, dans un mécanisme d'intériorisation et de reproduction, témoignent d'un manque d'ambition à l'égard de leurs enfants, à la différence parfois des enseignants. L'inverse peut être vrai.
Il est difficile, de surcroît, de gérer les flux scolaires en cédant aux souhaits des parents, idée certes généreuse, car chacun risque de vouloir la même chose. L'instauration d'un parcours d'orientation et d'information résout cette difficulté. Il existe des grandes inégalités sociales : certains milieux sont démunis pour guider et offrir un aperçu exact des filières professionnelles et des débouchés. Le système ne comble pas cette lacune, comme en témoigne le décalage entre les représentations des élèves à l'égard des métiers et la réalité. Dans un lycée de centre-ville, les parents sont conviés à présenter leur métier. Il en va différemment dans d'autres lycées. Tous les enfants doivent avoir accès à cette connaissance. Inutile de rallumer la guerre scolaire en retirant cette mission d'orientation aux enseignants, revendication d'une association de parents d'élèves. Nous procéderons néanmoins à une expérimentation à la rentrée pour apprécier si ce système produit les effets pervers attendus ou contribue à mieux réguler les attentes des parents.
Sur l'accueil des enfants handicapés, nous nous inscrivons dans la continuité de la loi de 2005, et des dispositions ont été ajoutées, comme sur l'école inclusive. Un amendement parlementaire sur les prescriptions des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) a fait polémique à l'Assemblée nationale. La situation est complexe. Des postes seront ouverts dans le cadre du plan autisme à venir. Certaines écoles maternelles seront dotées de plateformes d'accueil adaptées et de personnels spécialisés. Si la France fait ce choix, alors l'éducation nationale doit recevoir les moyens d'accueillir ces enfants dignement. Les bonnes intentions doivent s'appuyer sur un budget : comment former les auxiliaires de vie scolaire ? Quelles perspectives leur donner ? Même les spécialistes débattent de l'école inclusive. Je soutiens cette idée, mais tel n'est pas le métier premier des enseignants. Certains textes envisagés attribuaient aux professeurs des responsabilités médicales. Quelle responsabilité ! Depuis la loi Handicap de 2005, un effort a été fait mais nous manquons d'auxiliaires de vie scolaire.
Nous devons faire preuve de responsabilité dans ce débat. L'école sera confrontée à de fortes attentes, à commencer par celles, poignantes et parfois empreintes de colère, des familles concernées. Certaines associations réclament un suivi individuel permanent. La charge en incombera aux collectivités locales. J'ai organisé un réseau des coordinateurs dans nos académies. Madame Férat, la coordinatrice de la Marne m'a alerté sur les difficultés à répondre aux demandes. La demande sociale excède nos capacités de réponse.
Un rapport demandé à Mmes Carlotti et Pau-Langevin paraîtra bientôt. Nous devrons en tirer les conséquences. Donnons-nous les moyens de nos choix. Tout le monde s'accorde avec des trémolos dans la voix à réclamer une meilleure prise en charge, peu seront d'accord pour en acquitter le prix, dans un contexte budgétaire contraint.
Sur les langues régionales, des avancées sont là. Un article 27 bis a été introduit à l'Assemblée nationale. Depuis vingt ans, leur enseignement a progressé, quoique de manière inégale selon les régions. Le nombre de postes au Capes sera relevé ; elles feront l'objet d'une sensibilisation en maternelle au même titre que les autres langues ; l'information sera meilleure. Certains amendements se sont révélés anticonstitutionnels. L'avis des parents est tout de même nécessaire ! D'autres avancées peuvent concerner les moyens ou les coefficients des épreuves.
Monsieur Legendre, j'ai des réserves à afficher des objectifs, à plus forte raison quand on ne peut pas les atteindre, car cela entraîne des découragements. Mes objectifs sont classiques, à l'exception de cet indicateur judicieux sur la diminution des écarts entre les élèves de zones sensibles et les autres.
Que faire de ceux qui n'atteignent pas ces objectifs ? Telle est, en effet, la question fondamentale de tout système éducatif. Nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux de diminuer les sorties sans qualification de 20 000 à la prochaine rentrée ; c'est plus que l'Europe à l'horizon de 2020.
Les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs se sont révélées utiles, permettant de repérer les élèves sur le point de décrocher. Nous développons une offre à leur attention, en lien avec les régions ou l'Onisep.
En ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères, notre mot d'ordre est évidemment la pluralité. Le choix des parents, toutefois, se porte dans 90 % des cas sur l'anglais.
Ce texte n'a pas vocation à traiter tous les sujets. Le lycée professionnel fera l'objet d'une réforme à venir. Avant de réformer, il faut évaluer ce qui existe, et créer le consensus. J'ai reçu les principaux acteurs : ce consensus n'existe pas encore sur la réforme du lycée, ni sur celle du lycée professionnel.
Vous avez évoqué le lycée agricole : j'étais hier dans l'un d'entre eux, en Seine-et-Marne, avec le ministre de l'agriculture. En France, nous avons longtemps cru qu'il fallait séparer les élèves pour qu'ils réussissent, à tous les niveaux. On ne cesse de critiquer l'individualisme et de réclamer de l'individualisation sans y voir de contradiction. Or, j'ai vu dans cet établissement un internat qui réunit des formations professionnelles et des filières générales. Stupéfaction de voir cohabiter des jeunes des quartiers difficiles en formation horticole et des jeunes de Terminale scientifique, tous réunis par la République et partageant des moments de vie ! Nous avons d'excellents lycées professionnels : leur réputation de filière de rebut n'est pas justifiée. Nous contribuons sans le vouloir à véhiculer l'idée que la culture générale, l'une des rares choses que l'éducation nationale exporte, n'a rien à y faire, alors que les entreprises ne cessent de réclamer des salariés sachant parler et rédiger correctement, et connaissant éventuellement plusieurs langues étrangères. Nous avons une grande ambition en la matière. Il ne s'agit pas de rafistolage.
Les régions contribuent au service public. Elles seront impliquées davantage dans la définition de l'offre de formation professionnelle, avec l'État, qui conserve la maîtrise des moyens. Les partenaires doivent mieux se respecter.
Madame Bouchoux, vos questions sont très générales. Comment changer les valeurs et les représentations de notre système éducatif ? À l'issue de la concertation, on n'a eu de cesse de parler d'école de la confiance et de la bienveillance. Force est de constater qu'il y a aujourd'hui une forte défiance, y compris entre les personnels de l'éducation nationale eux-mêmes. D'aucuns parlent, par exemple, d'inculquer l'esprit d'entreprise à l'école : s'il s'agit d'initiative, de coopération, de responsabilité, j'y suis évidemment favorable.
Les débats sur l'école sont porteurs de contradictions. Chacun souhaite attribuer à l'école l'enseignement de telle ou telle nouvelle matière, tout en déplorant les rythmes scolaires trop lourds. D'autres ambiguïtés demeurent s'agissant de l'accueil des enfants handicapés ou de l'enseignement des langues régionales. Nous devons répondre à ces demandes tout en préservant la capacité de l'école à accomplir ses missions essentielles.
Madame Cartron, le rapport annexe aborde la question des parents. Des associations de parents d'élèves souhaitent accroître le rôle des parents en matière d'orientation. Dans le même temps, certains rapports soulignent la nécessité de protéger les professeurs contre les parents, ou déplorent leur manque d'autorité. En ce domaine, l'action des parents n'est pas univoque : certains parents, de milieux sociaux modestes, dans un mécanisme d'intériorisation et de reproduction, témoignent d'un manque d'ambition à l'égard de leurs enfants, à la différence parfois des enseignants. L'inverse peut être vrai.
Il est difficile, de surcroît, de gérer les flux scolaires en cédant aux souhaits des parents, idée certes généreuse, car chacun risque de vouloir la même chose. L'instauration d'un parcours d'orientation et d'information résout cette difficulté. Il existe des grandes inégalités sociales : certains milieux sont démunis pour guider et offrir un aperçu exact des filières professionnelles et des débouchés. Le système ne comble pas cette lacune, comme en témoigne le décalage entre les représentations des élèves à l'égard des métiers et la réalité. Dans un lycée de centre-ville, les parents sont conviés à présenter leur métier. Il en va différemment dans d'autres lycées. Tous les enfants doivent avoir accès à cette connaissance. Inutile de rallumer la guerre scolaire en retirant cette mission d'orientation aux enseignants, revendication d'une association de parents d'élèves. Nous procéderons néanmoins à une expérimentation à la rentrée pour apprécier si ce système produit les effets pervers attendus ou contribue à mieux réguler les attentes des parents.
Sur l'accueil des enfants handicapés, nous nous inscrivons dans la continuité de la loi de 2005, et des dispositions ont été ajoutées, comme sur l'école inclusive. Un amendement parlementaire sur les prescriptions des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) a fait polémique à l'Assemblée nationale. La situation est complexe. Des postes seront ouverts dans le cadre du plan autisme à venir. Certaines écoles maternelles seront dotées de plateformes d'accueil adaptées et de personnels spécialisés. Si la France fait ce choix, alors l'éducation nationale doit recevoir les moyens d'accueillir ces enfants dignement. Les bonnes intentions doivent s'appuyer sur un budget : comment former les auxiliaires de vie scolaire ? Quelles perspectives leur donner ? Même les spécialistes débattent de l'école inclusive. Je soutiens cette idée, mais tel n'est pas le métier premier des enseignants. Certains textes envisagés attribuaient aux professeurs des responsabilités médicales. Quelle responsabilité ! Depuis la loi Handicap de 2005, un effort a été fait mais nous manquons d'auxiliaires de vie scolaire.
Nous devons faire preuve de responsabilité dans ce débat. L'école sera confrontée à de fortes attentes, à commencer par celles, poignantes et parfois empreintes de colère, des familles concernées. Certaines associations réclament un suivi individuel permanent. La charge en incombera aux collectivités locales. J'ai organisé un réseau des coordinateurs dans nos académies. Madame Férat, la coordinatrice de la Marne m'a alerté sur les difficultés à répondre aux demandes. La demande sociale excède nos capacités de réponse.
Un rapport demandé à Mmes Carlotti et Paul-Langevin paraîtra bientôt. Nous devrons en tirer les conséquences. Donnons-nous les moyens de nos choix. Tout le monde s'accorde avec des trémolos dans la voix à réclamer une meilleure prise en charge, peu seront d'accord pour en acquitter le prix, dans un contexte budgétaire contraint.
Sur les langues régionales, des avancées sont là. Un article 27 bis a été introduit à l'Assemblée nationale. Depuis vingt ans, leur enseignement a progressé, quoique de manière inégale selon les régions. Le nombre de postes au Capes sera relevé ; elles feront l'objet d'une sensibilisation en maternelle au même titre que les autres langues ; l'information sera meilleure. Certains amendements se sont révélés anticonstitutionnels. L'avis des parents est tout de même nécessaire ! D'autres avancées peuvent concerner les moyens ou les coefficients des épreuves.
Monsieur Legendre, j'ai des réserves à afficher des objectifs, à plus forte raison quand on ne peut pas les atteindre, car cela entraîne des découragements. Mes objectifs sont classiques, à l'exception de cet indicateur judicieux sur la diminution des écarts entre les élèves de zones sensibles et les autres.
Que faire de ceux qui n'atteignent pas ces objectifs ? Telle est, en effet, la question fondamentale de tout système éducatif. Nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux de diminuer les sorties sans qualification de 20 000 à la prochaine rentrée ; c'est plus que l'Europe à l'horizon de 2020.
Les plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs se sont révélées utiles, permettant de repérer les élèves sur le point de décrocher. Nous développons une offre à leur attention, en lien avec les régions ou l'Onisep.
En ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères, notre mot d'ordre est évidemment la pluralité. Le choix des parents, toutefois, se porte dans 90 % des cas sur l'anglais.
Ce texte n'a pas vocation à traiter tous les sujets. Le lycée professionnel fera l'objet d'une réforme à venir. Avant de réformer, il faut évaluer ce qui existe, et créer le consensus. J'ai reçu les principaux acteurs : ce consensus n'existe pas encore sur la réforme du lycée, ni sur celle du lycée professionnel.
Vous avez évoqué le lycée agricole : j'étais hier dans l'un d'entre eux, en Seine-et-Marne, avec le ministre de l'agriculture. En France, nous avons longtemps cru qu'il fallait séparer les élèves pour qu'ils réussissent, à tous les niveaux. On ne cesse de critiquer l'individualisme et de réclamer de l'individualisation sans y voir de contradiction. Or, j'ai vu dans cet établissement un internat qui réunit des formations professionnelles et des filières générales. Stupéfaction de voir cohabiter des jeunes des quartiers difficiles en formation horticole et des jeunes de Terminale scientifique, tous réunis par la République et partageant des moments de vie ! Nous avons d'excellents lycées professionnels : leur réputation de filière de rebut n'est pas justifiée. Nous contribuons sans le vouloir à véhiculer l'idée que la culture générale, l'une des rares choses que l'éducation nationale exporte, n'a rien à y faire, alors que les entreprises ne cessent de réclamer des salariés sachant parler et rédiger correctement, et connaissant éventuellement plusieurs langues étrangères. Nous avons une grande ambition en la matière. Il ne s'agit pas de rafistolage.
Les régions contribuent au service public. Elles seront impliquées davantage dans la définition de l'offre de formation professionnelle, avec l'État, qui conserve la maîtrise des moyens. Les partenaires doivent mieux se respecter.
Madame Bouchoux, vos questions sont très générales. Comment changer les valeurs et les représentations de notre système éducatif ? À l'issue de la concertation, on n'a eu de cesse de parler d'école de la confiance et de la bienveillance. Force est de constater qu'il y a aujourd'hui une forte défiance, y compris entre les personnels de l'éducation nationale eux-mêmes. D'aucuns parlent, par exemple, d'inculquer l'esprit d'entreprise à l'école : s'il s'agit d'initiative, de coopération, de responsabilité, j'y suis évidemment favorable.
L'appât du gain ou la tyrannie de l'argent, non en effet. L'Assemblée nationale a bien mené ce débat. À cela vont s'ajouter les questions d'évaluation, des devoirs, des pratiques interdisciplinaires, l'enseignement moral, les parcours d'orientation.
Madame Férat, je suis navré que la question des rythmes scolaires ne soit pas réglée dès 2013. Le décret prévoit qu'on peut appliquer la réforme en 2014...
Le président de l'association des maires ruraux de France, qui n'est pas de ma sensibilité politique, applique la réforme dès 2013. Le président du conseil général du Gers vient de m'indiquer que 85 % des communes du département - très rural - feront de même. À l'inverse, je vois des grandes communes urbaines qui ne rentreront pas dans le nouveau dispositif cette année. On a mis en avant un clivage entre les communes urbaines et les communes rurales : force est de reconnaître qu'il ne fonctionne pas.
Exactement. Ensuite, on a opposé les communes pauvres et les communes riches. En réalité, de nombreuses communes rentrent dans le dispositif dès 2013, comme Denain, qui a pourtant le potentiel fiscal le plus faible. Il doit donc y avoir une autre explication. Chaque commune a son histoire ; nous trouverons le temps d'avancer. Notre principal souci est que cela vaille le coup pour les élèves ; ce n'est pas une lubie de notre part.
S'agissant des programmes, le plus dur consiste à harmoniser le socle. Je ne voulais pas de débat parlementaire similaire à celui de 2005, à l'issue duquel le Haut conseil à l'éducation a pris la main. Les parlementaires doivent donner leur avis : notez que c'est la première fois qu'ils siègent au conseil supérieur des programmes. Deuxième problème : l'articulation entre le socle et les programmes. Nous y travaillons. Enfin, il faut articuler tout cela avec l'évaluation des élèves. Le Conseil supérieur des programmes me semble la bonne instance pour traiter ces sujets, à condition d'y nommer les personnes les plus compétentes possibles - vous les reconnaîtrez. Les programmes seront revus, dans le laps de temps qui permettra d'y associer tout le monde, car il ne s'agit pas de modifier les programmes tous les quatre ou cinq ans. J'ai demandé au recteur Boissinot, donc dans une démarche non partisane, une note sur le Conseil supérieur des programmes, dont nous nous inspirerons.
À l'issue du débat, lorsque les structures seront mises en place, nous nous pencherons sur ce qu'on enseigne et sur la façon dont on l'enseigne. Un travail considérable commencera alors sur les programmes, qui sera fortement lié à la réforme du lycée et du collège.

Le groupe socialiste soutiendra le projet de loi.
Nous souhaitons que le cahier des charges des écoles supérieures du professorat garantisse une formation qualifiante appuyée sur l'alternance des pratiques de terrain, dans les classes ou dans les associations d'éducation populaire, et des cours universitaires. Nous appelons également de nos voeux une politique de sensibilisation au métier d'enseignant dès la terminale pour attirer les lycéens vers des formations dont la maquette sera modifiée dès la licence pour assurer leur professionnalisation. Ces métiers n'attirent pas suffisamment les jeunes des couches populaires.
Enfin, notons la hausse des inscriptions aux concours d'enseignement pour 2014 : pour le premier et second degré, elle atteint 46 %, soit 44 000 candidats supplémentaires. L'augmentation est encore plus significative dans le premier degré, où elle atteint 57 %.

Dans votre livre, vous indiquez que les ministres passent mais que l'administration reste. Vous concernant, il restera votre photo dans le grand escalier du ministère de l'éducation nationale et votre nom sous le titre du projet de loi.
J'ai toujours plaidé pour des formations qualifiantes plutôt que diplômantes. La formation des maîtres en est un exemple flagrant : elle a été assurée par les écoles normales, puis par les IUFM, elle le sera désormais par les écoles supérieures du professorat. L'objectif reste de bien former les maîtres. Or la pédagogie, on l'a ou on ne l'a pas. Certaines personnes intellectuellement brillantes ne feront jamais de bons maîtres ! Auparavant, le brevet élémentaire, puis le bac, étaient suffisants pour y prétendre. On parle désormais de mastérisation... Est-ce vraiment utile ? La réponse fréquemment apportée consiste à dire qu'en période de chômage, c'est une façon de gérer les problèmes d'emploi. Ce ne peut être un objectif de formation, car un vrai maître est d'abord animé d'une passion qui le rend doublement utile : il motive les enfants, et mobilise les parents, dont on sait l'importance dans l'éducation des enfants. Sous ce rapport, parler de parents plus ou moins déshérités n'a pas de sens : il n'y a que des parents plus ou moins impliqués.
J'ai conduit une mission avec Mme Papon sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans. Je pense que cette appellation est impropre : il s'agit davantage d'accueil des enfants de moins de trois ans. Cela nécessite un personnel spécialement formé. Au-delà de trois ans, la maternelle est là pour préparer l'entrée à l'école élémentaire. C'est de plus un souhait des parents.
M. le ministre a défendu un jour une classe d'Airaines menacée de fermeture. Rallié à sa cause, j'avais alors plaidé le dossier devant le conseil départemental de l'éducation nationale. Mais voilà qu'aujourd'hui, on veut fermer une classe dans ma commune, ce qui aura pour effet de porter le nombre moyen d'enfants par classe de 21 à plus de 26 !
À Hallencourt ? Le message est passé !

J'ai toujours dans ma commune une école élémentaire et une école maternelle. Cette dernière est pleine, et on me ferme une classe élémentaire ! J'ai promis à l'administration qu'il n'y aurait pas de manifestation, car ce n'est pas le genre de la maison, mais enfin, je suis un peu vexé.

Je souscris aux propos de Mme Laborde. La confusion des esprits a été entretenue par la décision de diviser la réforme des rythmes scolaires en trois volets : le premier sur l'allongement des vacances de la Toussaint, le deuxième sur la modification des rythmes hebdomadaire et quotidien, le dernier sur les grandes vacances. Une articulation de la réforme avec le texte sur l'école aurait permis aux acteurs de s'approprier le changement. Pourquoi les avoir dissociés ?
Y a-t-il des perspectives financières pérennes offertes aux petites collectivités - qui ne sont pas opposées à la réforme ? On sait que ce peut être un facteur d'inégalités. En outre, comment cette réforme s'articule-t-elle avec l'annonce faite par la ministre de la culture sur l'éducation artistique et culturelle ? Le texte repose la question de la formation initiale et continue des enseignants : c'est opportun car elle est incomplète. Peut-on avoir des détails sur les écoles supérieures du professorat : sont-elles de nouveaux IUFM ?
Le plan numérique suscite des interrogations sur l'évolution des métiers de l'éducation nationale. Comment envisagez-vous à cet égard l'avenir des documentalistes et de conseillers d'orientation - souvent motivés par les perspectives ouvertes par le numérique ?
Quelle évaluation réelle fait-on des fondamentaux, socle et programmes ? L'évaluation est nécessaire : elle permet au professeur de savoir où en est la classe, au directeur où en est l'école, à l'inspecteur d'académie où en est le département, au recteur où en est l'académie. Elle constitue donc un outil de progression, plutôt qu'un instrument de stigmatisation des mauvais élèves. L'inspection a-t-elle rendu des rapports à ce sujet ?
La réforme des rythmes scolaires risque d'entraîner la disparition des deux heures d'aide personnalisée. Les rapports de l'inspection générale sur la question sont-ils publics ? Enfin, quid de l'accompagnement éducatif au collège ? Son installation n'est pas finalisée.
Les internats d'excellence attestent globalement d'une belle réussite. Un nouveau a été inauguré récemment. Que vont-ils devenir ?
Enfin, il faut sensibiliser le corps enseignant à la question de l'accueil des enfants handicapés. Leur sensibilisation à ces publics pourrait faire partie de leur formation à l'école supérieure du professorat. Nous tenons à votre disposition tous les moyens nécessaires à la formation des auxiliaires de vie. Sur ce plan, on ne peut que déplorer l'amendement n° 274 qui a été adopté à l'Assemblée nationale, il y a quelques jours. Les familles qui élèvent un enfant handicapé s'en sont émues : nous devrons les rassurer.

Attention à ne pas transformer l'éducation nationale en structure spécialisée, ni les enseignants en éducateurs spécialisés. Les enfants handicapés ont, pour une partie d'entre eux, besoin d'un accompagnement spécifique. Je crains que certains parents d'enfants handicapés n'aient placé trop d'espoirs dans la loi de 2005, qui leur permet théoriquement de scolariser leur enfant dans l'école du quartier. Les bienfaits tirés de la scolarisation en milieu ordinaire doivent être évalués sérieusement ; ce n'est pas une fin en soi. Il faut préserver la capacité de l'école à assurer ses missions premières.
Les enfants sourds ont besoin de reformulation dans leur langage, langue des signes ou langage parlé complété. Je porterai un amendement dans ce sens.
S'agissant de la réforme des rythmes scolaires, dans le Val d'Oise, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (Dasen) n'exerce absolument pas son rôle de portage de la loi ; elle dissuade les maires de rentrer dans le dispositif des rythmes scolaires en 2013 au motif que la commune d'à-côté n'aurait choisi d'y entrer qu'en 2014. Je crains que nous ne soyons guère nombreux à engager précocement la réforme.
C'est le cas, en effet.

S'agissant des langues régionales, comment développer la formation des enseignants bilingues ? On en trouve de moins en moins.
Le texte initial a été largement modifié pour y inclure un volet relatif à la santé scolaire. C'est un progrès, car les familles touchées par la précarité rognent souvent prioritairement dans leurs dépenses de santé. Des amendements ont été adoptés à l'Assemblée nationale, mais ce volet du texte reste flou : la santé scolaire reste-t-elle dans le giron de l'éducation nationale ? Quelles missions lui seront dévolues ? Nous avons évoqué l'accueil des enfants handicapés : cette mission n'est pas prise en compte dans le temps de travail des personnels médicaux en milieu scolaire.
Autre point : l'apprentissage précoce d'une langue vivante démultiplie les capacités linguistiques. Dans cet apprentissage, ce que vous avez appelé la morale, etc.

pourrait comprendre un volet consacré aux bonnes pratiques hygiéniques, comme autrefois, que les familles ont parfois abandonné. Je pense, par exemple, à se laver les mains ou se brosser les dents. À terme, il pourrait être élargi à l'éducation sexuelle, en fonction de l'âge de l'enfant.
Ce n'est pas tout à fait l'idée que j'avais de la morale laïque, mais admettons.

L'article 25 du projet de loi élargit le dispositif d'aide aux élèves qui en ont besoin sous la responsabilité des équipes pédagogiques. Or j'ai organisé une réunion il y a quelques jours avec l'inspecteur d'académie, la direction départementale de l'éducation nationale, les enseignants et les parents d'élèves, dont il est ressorti que le nouveau temps de travail personnel pour les élèves en difficulté passerait de 60 heures à 36 heures. Avez-vous des précisions à ce sujet ? Cela semble de nature à pénaliser les enfants les plus en difficulté, et par surcroît, en contradiction avec le discours officiel.
Nous avons voulu que la mastérisation soit professionnalisante et qualifiante. Nous avons réalisé un cahier des charges qui définit ce que l'on attend de l'enseignant de demain. Cette tâche est nouvelle pour les présidents d'université nouvellement autonomes. Les choses progressent. La perfection ne sera sans doute pas atteinte à la rentrée 2013. Nous expérimenterons un dispositif nouveau, voilà tout.
Monsieur Magner, j'ai lu votre rapport sur le pré-recrutement. Il contient beaucoup d'idées dont nous comptons nous inspirer. Notre souci commun est celui de la mixité sociale, y compris dans le corps enseignant. C'est un facteur de réussite. Nous ferons le point lors des débats parlementaires sur les emplois d'avenir professeurs et cette filière de pré-recrutement, qui nous aident pour les recrutements de demain. Les écoles supérieures du professorat accueillent les étudiants dès la deuxième année de licence. Nous sommes à 3 800 emplois d'avenir sur les 4 000 prévus. Beaucoup d'entre eux manifestent une vive envie de servir le pays et de rendre ce que l'école de la République leur a donné, de participer à la machine d'intégration qui existait autrefois. Nous souhaitions professionnaliser cette formation. Nous n'allions pas tourner le dos à l'université, ni négliger l'apport des praticiens. Tous les rapports de l'inspection générale sont publics, nous n'avons rien à cacher. Nous regarderons quels sont nos moyens en termes de maîtres formateurs, qui font la richesse de notre système, pour en étendre le principe au secondaire. Dans le cadre du débat sur le métier d'enseignant, nous valoriserons ces tâches de formation.
Vous avez une inquiétude sur le recrutement. Le niveau master 1 est un atout supplémentaire. Nous verrons ce qui peut être fait en termes d'attractivité globale : discours, conditions de carrière, ressources humaines, mutations, première affectation. L'argent n'est certes pas la première motivation, mais elle n'est pas négligeable. Les déséquilibres territoriaux vont rester considérables, il faudra en tenir compte.
Les internats d'excellence coûtent très cher et ne permettent pas de réaliser des progrès considérables car les élèves sont déjà sélectionnés sur leur niveau scolaire. Le rapport de l'inspection générale nous invite à faire évoluer le dispositif. Celui-ci a de plus été très consommateur d'investissements d'avenir, alors qu'il ne concerne qu'un très faible nombre d'élèves.
Je veux vous tenir un discours de vérité sur les enfants handicapés. Il n'y a pas d'un côté ceux qui sont accueillants à leur égard, et les autres. Ces problèmes sont très lourds.
Nous portons ensemble, avec la ministre de la culture, le parcours d'éducation artistique et culturelle. Nous réunirons prochainement les Directions régionales de l'action culturelle (Drac) et les recteurs pour définir les tâches qui incombent à chacun. Nous sommes encore dans la phase de conception. Nous n'avons certes pas, avec le ministère de la culture, les mêmes traditions, mais le dialogue est noué.
Nous aurons l'occasion de revenir sur la question des enfants sourds et malentendants. D'aucuns ont pris la parole sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Il y a là un problème de principe : nous accueillons tout le monde, mais faisons-nous tous les métiers, et acceptons d'une société qu'elle se décharge sur l'école de problèmes qu'elle ne sait pas traiter ?
Nous avons l'avantage d'avoir de plus en plus d'enseignants diplômés du supérieur qui parlent plusieurs langues étrangères. Nous avons certes un problème ponctuel de recrutement de professeurs d'anglais. Nous veillerons à développer les formations bilingues, ainsi que les échanges, à l'instar de ce que permet la convention signée cette année avec l'Allemagne.
S'agissant de l'article 25 du projet de loi : nos estimations indiquent, comme les vôtres, que l'aide personnalisée, la journée de six heures, plus l'aide personnalisée aux élèves en difficulté ne donnaient pas les meilleurs résultats. Nous avons gardé l'idée d'un dispositif spécifique pour traiter les difficultés scolaires, avec 36 heures plus souplement réparties. L'aide personnalisée avait des défauts et était inégalement pratiquée selon les écoles. 7 000 postes dédiés à l'école primaire, les activités pédagogiques supplémentaires et le dispositif « plus de maîtres que de classes » témoignent de notre implication pour traiter la difficulté scolaire.
Le gouvernement est dispendieux en matière d'éducation. On lui en fait parfois le reproche. Reste que si nous avons évolué en matière de santé scolaire, nous ne répondons toujours pas à nos obligations. En la matière, les solutions ne dépendent pas exclusivement de l'éducation nationale. Nous réfléchissons, avec Marisol Touraine, à un cadre plus large pour résoudre ces questions.