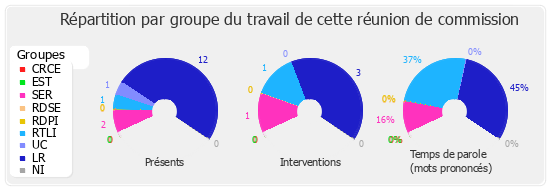Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 8 mars 2016 à 15h21
Sommaire
La réunion
La commission auditionne sur la Russie : M. Thomas Gomart, directeur de l'Institut français des relations internationales et M. Camille Grand, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique.

Notre audition est diffusée en direct, et en vidéo à la demande, sur le site du Sénat. Nous entendons deux chercheurs réputés, Thomas Gomart et Camille Grand, avec lesquels nous avons déjà eu l'occasion de travailler, sur la question de nos relations avec la Russie.
Un récent rapport d'information de notre commission sur ce thème, présenté par Josette Durrieu, Robert del Picchia et Gaëtan Gorce, constate la dialectique qui s'impose à nous entre la nécessaire fermeté qu'appelle le comportement préoccupant de la Russie en Crimée, en Ukraine et ailleurs, et l'exigence fondamentale du dialogue stratégique avec un partenaire incontournable - que ce soit dans le cadre du format Normandie, au Levant, ou dans ses relations très tendues avec la Turquie, membre de l'OTAN.
Transmis à nos partenaires russes dans le cadre de ce dialogue, le rapport a été traduit par les soins du président de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchev, que nous allons rencontrer demain. Voilà un exemple intéressant de diplomatie parlementaire, dont nous avons pu mesurer les mérites dans d'autres circonstances. C'est pour préparer cette réunion que nous vous entendons, à la recherche d'une pensée objective qui n'entrave pas un dialogue fécond.
Merci de votre invitation. Bien que les quelques années écoulées aient transformé, et détérioré, nos relations avec la Russie, nous devons en effet maintenir un dialogue constructif avec cet acteur majeur sur la scène internationale.
Il n'y a, à mon sens, pas d'option de retour à la normale, c'est-à-dire à l'état des relations précédant la crise en Ukraine. Nous ne sommes ni dans une nouvelle guerre froide, ni dans la situation d'après-guerre froide, où le paradigme dominant était celui de la coopération et du partenariat. La Russie n'est pas un ennemi, ni un partenaire : elle se pense avant tout comme un rival stratégique qui ne partage ni nos valeurs, ni nos intérêts. L'Ukraine est ainsi symptomatique d'une volonté de recomposer la donne stratégique européenne : le comportement de la Russie dans ce conflit est sans précédent depuis l'après-guerre froide et même une partie de la guerre froide ; au-delà de la réaffirmation de la puissance russe, c'est une mise en cause fondamentale de la vision de l'Europe et du monde que nous, Européens de l'Ouest, portons depuis plusieurs décennies.
En Crimée, le fait le plus emblématique, et le plus problématique, est la révision par la force d'une frontière européenne, inédite depuis 1945, et très rare au niveau international. Lors du conflit géorgien, cette étape n'avait pas été franchie, puisque les républiques d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud sont réputées séparatistes : en soutien de leur position, la Russie invoque la situation du Kosovo.
L'annexion de la Crimée est une violation directe des accords d'Helsinki qui posaient l'inviolabilité des frontières dans ces termes : « Les États participants tiennent mutuellement pour inviolables toutes leurs frontières ainsi que celles de tous les États d'Europe et s'abstiennent donc maintenant et à l'avenir de tout attentat contre ces frontières. En conséquence, ils s'abstiennent aussi de toute exigence ou de tout acte de mainmise sur tout ou partie du territoire d'un autre État participant. » C'est d'autant plus frappant que la diplomatie soviétique, puis russe y était particulièrement attachée à l'objectif du maintien des frontières issues de la deuxième guerre mondiale. Mais c'est aussi une violation de la Charte des Nations-Unies et, quand l'affaire a été portée devant le Conseil de sécurité, la Russie a opposé son veto - montrant ainsi que la force primait désormais, pour elle, sur le droit. Bien que les tensions en Ukraine se soient partiellement résorbées, cela doit nous rester en mémoire.
Le contrôle des armements et la stabilité nucléaire, consacrés par le Traité sur les forces intermédiaires nucléaires de 1987 puis le traité sur les forces conventionnelles en Europe de 1990 qui interdisait la course aux armements, visaient à rendre impossible une nouvelle guerre en Europe. Or en 2007, la Russie a suspendu sa participation au second traité ; passée inaperçue à l'époque, cette décision a ouvert la voie à un redéploiement militaire de grande ampleur dans le Caucase et sur les rives de la mer Noire, près des frontières respectives de la Géorgie et de l'Ukraine, et fait disparaître l'appareil d'inspection mis en place par l'accord.
Enfin, par le Mémorandum de Budapest, signé en 1994, la Russie s'engageait à ne pas remettre en cause la souveraineté de l'Ukraine, en échange d'un abandon par cette dernière de son arsenal nucléaire - le troisième stock mondial à l'époque. Certes, il ne s'agit pas d'un traité en bonne et due forme mais d'une garantie de sécurité politiquement négociée ; il reste que l'Ukraine a abandonné un élément important de sa puissance contre un engagement violé vingt ans plus tard.
Le second acte de la pièce est le retour de la Russie au Moyen-Orient : son intervention en Syrie est la première au-delà des anciennes frontières de l'URSS, si l'on met de côté la crise du Kosovo. Elle a combiné l'usage de la force et de la diplomatie au service de ses objectifs, qui sont distincts des nôtres mais occasionnellement convergents. Ainsi de la lutte contre la radicalisation, marquée par une forte présence de citoyens russes - caucasiens ou non - au sein de Daech, qui forment le premier contingent non arabe ; la Syrie n'est qu'à 800 kilomètres du Caucase russe...
Le deuxième objectif est le maintien de Bachar el-Assad : l'intervention russe a eu lieu au moment où l'on se demandait si la zone contrôlée par Bachar el-Assad resterait continue, de Lattaquié à Damas en passant par Tartous. Elle a rétabli le contrôle du régime sur la plus grande partie de cette Syrie dite utile.
Troisième objectif, affaiblir l'opposition dans toutes ses composantes, y compris modérées.
Quatrième objectif : rétablir l'influence russe au Moyen-Orient et son statut d'acteur central - une réussite incontestable.
La Russie a aussi démontré de ses capacités militaires, pas seulement aériennes et sol-air, mais aussi par des tirs de missiles de croisière depuis la mer Caspienne et la Méditerranée. Au-delà du théâtre syrien, les Russes nous rappellent leurs capacités militaires spectaculaires, résultat d'une augmentation de 200 % en quinze ans du budget militaire de la Fédération. Aujourd'hui, ce budget est trois fois supérieur à celui de la France, tout en restant très inférieur à ses niveaux de l'époque soviétique. La Russie veut enfin rétablir le duopole américano-russe, au détriment des acteurs régionaux, au premier rang desquels une Europe douloureusement marginalisée.
Ces manoeuvres russes se caractérisent par leur cohérence ; elles reposent sur l'utilisation de tous les instruments de la puissance, en contraste avec une politique occidentale hésitante sur ses objectifs et ses moyens : frappes indiscriminées sur la population, soutien militaire sans faille au régime, et diplomatie très active. Ses priorités sont différentes des nôtres, puisque la Russie vise surtout l'opposition à Bachar el-Assad. La Russie a pris de véritables risques stratégiques, avec plus de 5 000 soldats déployés en Syrie et exposés à des attaques.
Son action se distingue aussi par une vision à court terme - le soutien à Bachar el-Assad - dont la soutenabilité n'est pas certaine. Le PIB de la Russie est désormais équivalent à celui de l'Italie. Quelle est, pour reprendre une expression militaire, « l'état final recherché » de cette stratégie ? Le maintien de Bachar el-Assad ne rétablira pas la stabilité dans un pays qui compte 4 millions de réfugiés, 7 millions de déplacés intérieurs au terme d'un conflit qui a fait 250 000 morts.
Quant aux Européens, ils ont été pris à contrepied. Poutine a tourné la page de l'après-guerre froide, dominée par le partenariat pan-européen et euro-atlantique, pour ouvrir une ère de compétition géopolitique se caractérisant par le refus de la Russie d'être intégrée dans l'espace européen. Nous entrons dans une logique de blocs concurrents, l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) faisant pendant à l'Otan, et l'Union économique eurasiatique à l'Union européenne. Les Occidentaux ont bien tenté un « reset » des relations bilatérales après le conflit russo-géorgien. En 2010, dans son concept stratégique adopté à Lisbonne, l'OTAN définit la Russie comme un partenaire majeur ; elle ne considère « aucun pays tiers comme son adversaire » et estime que « la zone euro-atlantique est en paix, et la menace d'une attaque conventionnelle contre le territoire de l'OTAN est faible ». Désormais, les interrogations sont nombreuses. La question d'une éventuelle application de l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord préoccupe particulièrement les pays baltes et la Pologne.
Il faut désormais penser en termes de rapport de force : une situation où des sanctions croisées sont prises, et où l'Union européenne est contrainte de faire de la géopolitique, ce qui n'est pas dans son ADN, et de traiter avec un acteur qui n'adhère pas à ses valeurs.
C'est pourquoi nous sommes dans cette situation de « paix froide », théorisée par Raymond Aron, où la guerre n'est pas probable mais où la coopération n'est pas pour autant le modèle dominant. C'est une mutation douloureuse, qui comporte plusieurs écueils : une perte de crédibilité politique et l'émergence d'une rhétorique de guerre froide faisant écho à la rhétorique nationaliste de Poutine. Ne cédons pas pour autant au romantisme de l'alliance franco-russe d'autant que la France est une cible de choix pour la reconstruction d'un dialogue entre la Russie et l'Occident ; regardons la réalité, et combinons la dissuasion, lorsqu'elle est nécessaire, et la coopération quand nos intérêts convergent. La Russie se pense comme un rival stratégique ayant des intérêts différents des nôtres et engagé avec les Occidentaux dans un jeu à somme nulle qui rend difficile de travailler ensemble.
Autre impératif, empêcher la déstabilisation de l'ordre européen, ce qui implique de nous montrer dissuasifs, ce qui renvoie à notre posture militaire, qui a été l'objet du sommet de l'OTAN qui s'est tenu en 2014 au pays de Galles et qui sera aussi à l'ordre du jour du prochain sommet de l'OTAN à Varsovie, mais également aux sanctions économiques ; stabiliser la situation en Ukraine par un mélange de pressions et de coopération ; coopérer à chaque fois que c'est possible, en s'appuyant sur l'exemple des négociations menées sans accroc avec l'Iran : en somme, compartimenter les différents aspects de la relation.
Défendons nos intérêts comme la Russie sait le faire ; c'est une relation à l'ancienne, entre des puissances qui se pensent comme rivales. Il ne suffit pas de dire que Poutine pense comme au XIXe siècle : il faut en prendre acte et agir en conséquence.
Camille Grand et moi-même sommes en accord sur la plupart des points ; je me contenterai donc d'élargir la perspective.
La Russie a fait une démonstration de force globale à travers son intervention en Syrie, le maintien d'une présence militaire en Ukraine, des opérations régulières aux abords des pays de l'OTAN, une intensification de son travail d'influence et enfin une multiplication des signaux d'intimidation nucléaire. Il importe par conséquent de ne pas réduire l'analyse à la Syrie ou à l'Ukraine. La Russie a utilisé l'intervention en Syrie à la manière dont la France et le Royaume-Uni l'ont fait pour la Libye : comme une vitrine de ses systèmes d'armes ainsi dotés de la « preuve opérationnelle » (combat proven). Les hostilités ont cessé, la Russie a pris le leadership et son action consiste surtout à soutenir les structures étatiques davantage que Bachar el-Assad lui-même ; elle a la main, c'est un succès.
Sur l'Ukraine, je suis plus pessimiste que les membres du format Normandie dans leurs déclarations : la Russie et l'Ukraine ont adopté une stratégie de désengagement des négociations, un dialogue de sourds déploré par la France et le Royaume-Uni.
Le calendrier international doit être pris en compte : nous traversons une zone de turbulence dont nous ne sortirons pas avant la prise de fonctions du prochain président des États-Unis, en janvier 2017 ; d'ici là auront lieu le G7 au Japon, auquel la Russie ne participera pas, le sommet de l'OTAN à Varsovie, les jeux olympiques et enfin, au mois de septembre, le G20.
Focalisée sur ses difficultés internes engendrées par l'afflux de réfugiés, l'Europe a du mal à comprendre les ressorts de la politique russe. Celle-ci repose, à mon sens, sur une dialectique entre une grande stratégie et des guerres limitées, donnant une impression d'efficacité et de constance destinée à acquérir un ascendant psychologique. Cela appelle trois questions : l'impression est-elle trompeuse ? Ces choix s'expliquent-ils par une anticipation prématurée par la Russie du déclin américain, et une volonté de saisir ce qui peut l'être avant la nouvelle élection, compte tenu du comportement de l'administration américaine en ce moment ? Enfin, trois mois les attentats de Paris, où en est la grande coalition voulue par nos autorités ?
Soucieux de comprendre la vision russe du monde, l'Ifri suit de près la production doctrinale dans ce domaine. Le document sur la stratégie de sécurité nationale publié en décembre 2015 insiste sur la menace directe que représente l'Occident ; considère le système international comme polycentrique mais marqué par une instabilité croissante ; anticipe une intensification de la compétition pour le contrôle des ressources, marchés et voies de communication ; met l'accent sur le recours à la force militaire et l'usage des nouvelles technologies d'information et de communication à des fins géopolitiques, et dénonce enfin explicitement le renversement de régimes politiques légitimes. C'est une vision que l'on peut qualifier d'à la fois hétérophile et mixophobe, fondée sur l'idée que les civilisations peuvent cohabiter mais que le multiculturalisme est un échec ; défendant les droits des peuples de préférence aux droits des individus.
Pour Poutine, la sécurité du pays s'assimile à celle du groupe dirigeant, composé d'une dizaine de personnes. Il exprime au niveau international une exaspération profonde et partagée hors de la Russie face au comportement des Occidentaux, déclarant ainsi en septembre 2015, à la tribune de l'assemblée générale de l'ONU : « Avez-vous au moins conscience de ce que vous avez fait ? Je crains que cette question ne reste en suspens, parce que ces gens n'ont pas renoncé à leur politique basée sur une confiance exagérée en soi et la conviction de son exceptionnalité et de son impunité. » Ce discours s'inscrit dans une dénonciation constante, et abondamment relayée, de ce que les Russes considèrent comme l'hypocrisie occidentale.
Autres éléments de cette vision, le wahhabisme, en particulier celui de l'Arabie saoudite et des émirats du Golfe, considéré comme une matrice de déstabilisation, et l'idée que la seule alternative à l'autoritarisme est la domination étrangère.
En matière d'articulation des enjeux de sécurité, la Russie adopte un comportement mimétique de l'Occident ; ainsi la production doctrinale russe évoque un « problème occidental » comme nous le faisons du « problème russe » ; l'analyse n'est pas confinée à l'espace euro-atlantique, mais étendue aux espaces eurasiatique et à l'Asie-Pacifique. La Russie veut aussi tester la cohésion de l'OTAN en s'appuyant sur des forces politiques opposées au lien transatlantique. La Turquie appelle une attention particulière au sein de l'alliance atlantique et nécessite un dialogue avec la Russie : c'est une zone de très haute tension.
Le principal problème, en Ukraine, est la mise en oeuvre des accords de Minsk, marquée par un dialogue de sourds et des manoeuvres d'obstruction : à l'Europe de demander une attitude plus constructive. L'Ukraine demande la sécurité, c'est-à-dire une frontière garantie, avant la mise en oeuvre de tout processus électoral ; la Russie dénonce l'absence de volonté de mise en oeuvre de certaines mesures prévues par les accords de Minsk, comme le statut spécial de certaines régions russophones. La situation risque par conséquent de dégénérer.
En Syrie, la Russie voulait remettre en selle Bachar el-Assad, en mettant en scène un affrontement binaire entre le régime et les djihadistes, sans la troisième force des rebelles modérés soutenue par les Occidentaux. Les objectifs diplomatiques sont atteints avec le retour à une relation directe avec Washington, dont l'éviction de la diplomatie européenne est le corollaire.
Quatrième dimension de la politique sécuritaire russe, un investissement renforcé dans le nucléaire et un antiterrorisme conçu en termes militaires - ce durcissement n'a, au demeurant, pas protégé la Russie des attaques.
Troisième volet de mon propos, l'émergence d'une certaine confusion entre les aspects géopolitiques et géoéconomiques de nos relations avec la Russie. Dans une curieuse convergence idéologique, un anti-américanisme relevant d'une vision totalisante et excluant toute contingence se fait jour dans les médias. Les droits de l'homme font l'objet d'un discours de rejet au profit d'une désignation de l'ennemi américain, comme le font les Russes. C'est un discours plus prescriptif que descriptif vis-à-vis duquel la vigilance s'impose.
La Russie souhaite rétablir une sorte de directoire reposant sur la triangulation Pékin-Washington-Moscou. Richard Nixon s'était en son temps tourné vers Mao pour affaiblir l'URSS. La Chine était alors la pointe faible du triangle ; désormais, c'est la Russie qui tient ce rôle et essaie de se maintenir au niveau des deux autres. En 1999, la Chine représentait 7 % du PIB mondial ; elle représentera 20 % en 2020. Les États-Unis passent de 21 % à 15 % ; la Russie, de 3 % à 2,7 %. La Russie veut accompagner ce rétrécissement en maintenant une relation spécifique, qui repose surtout sur le nucléaire, avec Washington et Pékin. Le contre-choc pétrolier a entraîné une stagnation, voire une récession ; l'économie ne s'est pas modernisée ni diversifiée ; la Russie a du mal à se positionner sur le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) et le Traité trans-pacifique (TPP) ; enfin, son économie n'est pas en mesure de s'adapter à la transition énergétique engagée par l'Union européenne qui reste son principal partenaire commercial.
Je partage les préconisations de Camille Grand. Faisons preuve d'ouverture et de fermeté ; les liens de toute nature avec la Russie doivent être maintenus, sans tolérer pour autant les comportements inacceptables, en particulier sur notre territoire. Attention au « Why not », c'est-à-dire à la capacité de Poutine de saisir à son profit toute occasion présentée par la situation stratégique.
Rompons avec les discours lénifiants sur les relations franco-russes, pour prendre en compte les enjeux stratégiques globaux.
Enfin, mettons du réalisme, de la cohérence et de la constance dans notre politique étrangère. Il n'est pas de sécurité possible en Europe et au Moyen-Orient sans la Russie ; mais celle-ci n'a pas à elle seule un pouvoir de structuration suffisant pour assurer la stabilité.

Vous avez appelé de vos voeux, monsieur Grand, un positionnement sur le processus de Minsk et le Format Normandie ; mais semblé aussi évoquer un conflit gelé...
Poutine veut se positionner en rival stratégique, avez-vous dit ; l'est-il en réalité ? La vision de l'Europe s'appuie encore largement sur les accords d'Helsinki ; n'est-il pas temps de revoir les négociations passées sur les frontières européennes ?

Pour tenir compte des recompositions de frontières en Allemagne, dans les Balkans et plus récemment au Kosovo, nous proposons un Helsinki II. Faut-il accepter pour autant l'annexion de la Crimée ? Il faut en tout cas aller plus loin. La levée des sanctions sur les individus est souhaitable, du moins un geste pour les parlementaires. Il est vrai que de telles mesures ne font pas l'unanimité.
La volonté russe de démontrer une force globale est appuyée par une véritable propagande, témoins les sujets sur les nouvelles armes fréquemment publiés par le site de l'agence de presse Spoutnik.
Enfin, est-il vrai que nous n'ayons pas de relations fortes et normalisées avec la Russie, et le cas échéant comment les avoir ?

Quel est votre avis sur les informations du Monde d'après lesquelles une société russe assurait, en collaboration avec Daech, l'exploitation d'un champ gazier en Syrie ?
Il y a un écart entre la stratégie définie par les écrits doctrinaux, approuvés par Poutine et le gouvernement, et la réalité qui témoigne d'une mise à mal de la collaboration avec l'Union européenne, voire les États-Unis. L'OTAN et l'Union européenne semblent identifiées comme les nouveaux ennemis.

Combien de temps Poutine pourra-t-il tenir son cap ? Il méprise l'Europe et les États-Unis « décadents » mais semble surestimer ses possibilités et sous-estimer ses insuffisances : crise économique profonde marquée par une dévaluation du rouble, dilapidation des ressources pétrolières et gazières, partenariat déséquilibré avec la Chine. Vous l'avez dit, le PIB de la Russie est équivalent à celui de l'Italie ; ajoutons que son budget militaire reste huit fois inférieur à celui des États-Unis. Les Russes ne pourront pas tenir plusieurs fronts indéfiniment : il est par conséquent urgent pour eux de montrer leurs possibilités. C'est un jeu de poker plutôt qu'une stratégie d'échecs.
Je reste étonné par la bienveillance des responsables politiques français, aux deux extrêmes mais aussi dans les rangs de la droite républicaine et de la gauche souverainiste, à l'égard de Poutine. Elle est relayée par une tolérance importante dans de larges secteurs de l'opinion publique. Est-ce l'effet d'un anti-américanisme traditionnel, ou d'une perte d'influence de la notion de droits de l'homme au profit des droits des peuples ou du souverainisme ?

Viol des engagements internationaux, ostentation de la panoplie militaire, dénonciation constante de l'Occident, émergence d'une oligarchie qui confine à la ploutocratie : comment qualifiez-vous ce système ?
Les relations russo-chinoises évoluent-elles ?

Poutine incarne-t-il le Mal ou seulement les aspirations de son peuple, en particulier un besoin de reconnaissance de la force passée de la Russie ?
Les Russes ont leurs responsabilités dans les difficultés d'application des accords de Minsk, mais l'absence de majorité à Kiev en vue de voter la réforme constitutionnelle relative à la décentralisation n'est-elle pas la cause principale de l'échec ?

Peut-on mesurer le rôle des sanctions de l'Union européenne dans les difficultés financières de la Russie, au premier chef la chute du rouble ?

Le comportement de Poutine n'est-il pas une fuite en avant au regard de la situation intérieure en Russie ? Je m'associe aux propos de Claude Malhuret sur l'appui russe à des mouvances politiques à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite, mais aussi au centre. Est-ce bien à ces forces que vous avez fait référence ?

Les questions posées relèvent de deux thématiques : le sujet politique de l'appréciation du régime russe, et l'évolution économique qui met en cause la durabilité du système.
La question de l'influence russe réclame un regard historique. La diplomatie tsariste, soviétique puis post-soviétique a toujours entretenu une compréhension fine de notre establishment - Dominique Lieven l'a bien montré dans un ouvrage passionnant sur la campagne de Russie. J'ai consacré ma thèse aux relations franco-soviétiques durant la guerre froide, quand l'une des principales forces politiques françaises, le PCF, était financée par Moscou. Aujourd'hui, la première ou deuxième force politique, suivant les élections, est dans la même situation sans que l'on s'en émeuve. La France n'est pas seule concernée.
Or c'est une activité qui relève clairement de l'ingérence, même si d'autres pays sont très influents à Paris : élargissons notre réflexion à la manière dont notre politique étrangère est influencée. Dans ce domaine, l'ambassade de Russie a démontré un savoir-faire remarquable.
Poutine est-il un rival stratégique ? Il le dit. Il s'inscrit dans l'histoire russe à travers le choix de la « puissance pauvre » reposant sur des dépenses militaires excédant de beaucoup le potentiel économique - un système décrit par Georges Sokoloff, qui a conduit certains, dont le ministre des finances Alexeï Koudrine démissionnaire en septembre 2011, à sonner l'alarme. La dégradation de la situation économique, bien loin de faire céder la Russie, engendre une surenchère. Mais Poutine se place aussi en rupture avec cette histoire : depuis la mort de Hugo Chavez, il est le principal critique de l'Occident au niveau international ; il porte un discours du Sud contestant l'ordre occidental. Or les élites russes avaient toujours été très intégrées à l'ordre européen.
L'Union européenne reste pourtant le principal partenaire commercial de la Russie ; et le peuple russe aspire à un mode de vie européen.
Ne nous leurrons pas sur la popularité de Poutine ! Lui aussi, Ben Ali était populaire.
L'évolution de la relation sino-russe est cruciale et doit être considérée dans le cadre d'une triangulation avec les États-Unis. Le système international est en train de se structurer autour de la relation sino-américaine. La position de la Russie, est importante, mais sa capacité d'influence reste limitée, au-delà du nucléaire et des incantations autour d'une alternative idéologique.
La Russie a ainsi fortement politisé l'émergence des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), interprétée comme le signe d'un déclin occidental inexorable. Mais la convergence avec la Chine n'est que ponctuelle, car l'asymétrie s'aggrave. En 1990, les économies des deux pays étaient de poids équivalent. Aujourd'hui, le PIB russe représente un huitième de celui de la Chine. La Russie souffre de sa taille immense et de sa position eurasiatique, au moment où la Chine lance le projet One Belt, One Road, de nouvelle route de la Soie, provoquant déjà des tensions en Asie centrale.

Notre diplomatie n'est pas assez attentive à l'émergence des Brics, qu'elle a longtemps considérés comme un ensemble bancal. Ces pays ont beaucoup de points communs, à commencer par un développement paradoxal associant une grande richesse à une grande pauvreté, des émissions importantes et un investissement dans les nouvelles énergies. Ils progressent. De plus, ils ont créé un outil financier qui fera émerger des solidarités, même si les tendances historiques freinent le rapprochement.
La relation russo-chinoise se caractérise par un déséquilibre économique et démographique. Dans l'Extrême-Orient russe, 7 millions de Russes font face à 100 millions de Chinois le long de la frontière. Évoquant les ventes de technologie, un de mes collègues russes a comparé la situation de la Russie face à la Chine à celle d'un homme condamné à la pendaison, qui se trouve être aussi le vendeur de corde : il vend, mais pas assez pour qu'on puisse faire le noeud !
Une grande partie de la rhétorique internationale de la Russie est en réalité adressée à la Chine. La Russie insiste par exemple sur le maintien des armements nucléaires, surtout tactiques, pour compenser son infériorité en matière d'armement conventionnel sur le front asiatique. Il y a beaucoup de non-dits.
La fuite en avant de Poutine se matérialise par le risque militaire que présente un régime sur la défensive à l'intérieur de ses frontières. C'est une différence fondamentale avec la Chine, qui a le temps pour elle. La Russie, elle, se pense comme déclinante et veut conserver son influence ; d'où une prise de risque excessive, surtout dans le domaine nucléaire où le pays a parfois recours à une rhétorique inacceptable. L'ambassadeur russe au Danemark a tout simplement menacé Copenhague d'une attaque militaire s'il rejoignait le bouclier de défense antimissile de l'Otan ! À l'époque soviétique, de telles déclarations auraient valu à leur auteur une relégation dans un endroit perdu en Sibérie. Là, rien. Ce sont des comportements déraisonnables venant d'une puissance nucléaire.
Rival stratégique, la Russie l'est par sa puissance militaire et sa capacité d'action jusqu'au Levant. C'est l'un des quatre ou cinq pays qui comptent sur la scène mondiale. En revanche, elle ne le sera sans doute pas à long terme à cause de sa démographie et de son économie. C'est une situation difficile à gérer pour nous.
Faut-il revoir les frontières européennes ? La fin de l'URSS, la dissolution de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie avaient déjà donné lieu à des ajustements ; mais la Crimée, c'est une annexion par la force. Un Helsinki II est envisageable si nous nous y présentons les yeux ouverts et si nous reprenons le principe des « corbeilles » : droits de l'homme et droits politiques, sécurité et stabilité en Europe et coopération économique. Il ne l'est pas dans les termes proposés par Medvedev et Poutine : un nouvel ordre - entendu comme celui de Poutine, ou pas d'ordre du tout ! Au sein de l'OSCE, nous avons rédigé un rapport sur le thème avec des collègues allemands, polonais et russes ; ces derniers poussaient fortement en ce sens.
La politique russe - et celle de Bachar el-Assad - vis-à-vis de Daech porte l'empreinte d'un profond cynisme. Le dictateur syrien a donné des passeports à des membres de l'organisation pour qu'ils rejoignent l'Europe en tant que réfugiés. Il existe des réseaux souterrains entre ces entités.
La durabilité et la soutenabilité du projet poutinien est la question centrale. On estime que la Russie a des réserves de change pour environ un an. Là encore, la Russie est dans un calendrier serré.
L'effet économique des sanctions est mesurable ; Simon de Galbert, du Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, l'estime à un point de PIB, ce qui n'est pas négligeable. Mais la crise russe est principalement attribuable à la chute du prix des hydrocarbures.
Quant au poker et aux échecs, Garry Kasparov, devenu un opposant de Poutine, a dit un jour que dans les échecs, il y a des règles et on ne connaît pas le vainqueur ; avec Poutine, c'est le contraire !
La politique d'influence russe, qui a pour objectif l'échec du projet européen, passe par un appui aux partis populistes et souverainistes. La Russie nous considère en effet comme un adversaire dégénéré, avec ses Conchita Wurst et sa bureaucratie bruxelloise... Et quand nous disons que l'accord avec l'Ukraine est indispensable au retour de la transparence de la démocratie, les Russes pensent que ce discours cache une menace. Ils ont une vision complotiste de nos relations avec eux.
Les membres de la commission applaudissent les intervenants.