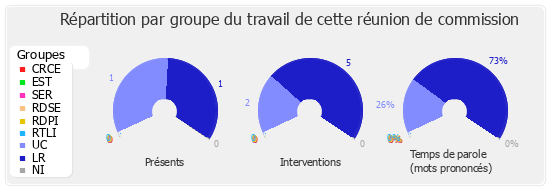Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
Réunion du 7 mars 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Financement des établissements de santé
- Audition de mm. denis fréchou président de la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier cndch et alain hériaud président de la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires chru sur le financement des établissements de santé (voir le dossier)
- Audition de mm. francis fellinger président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et guy moulin président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires sur le financement des établissements de santé (voir le dossier)
La réunion
Financement des établissements de santé
Audition de Mm. Denis Fréchou président de la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier cndch et alain hériaud président de la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires chru sur le financement des établissements de santé

Nous sommes heureux d'accueillir M. Alain Hériaud, président de la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires (CHRU) et M. Denis Fréchou, président de la conférence des directeurs de centre hospitalier (CNDCH), dont nous souhaitons connaître l'opinion sur la tarification à l'activité (T2A).
Ce mode de tarification a-t-il des incidences sur le fonctionnement des établissements hospitaliers, leur activité, leur situation financière ? Quels en sont les avantages et les limites ? Les nouveaux modes de gestion qu'il induit sont-ils compatibles avec la meilleure prise en charge des patients ?
D'autre part, les dotations aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac) sont-elles satisfaisantes ? Faut-il accroître ou réduire leur part dans les ressources hospitalières ?
Les hospitaliers ont apprécié et même souhaité la T2A, pour mettre fin au côté aveugle du budget global, qui, à la limite, incitait à travailler le moins possible puisque la dotation globale était déconnectée de la réalité de l'activité.
Dans son esprit, la T2A est un outil pertinent, puisqu'elle tend à mettre en adéquation des moyens attribués aux établissements et leur activité, quantitativement et qualitativement. Un système peu ou prou similaire est d'ailleurs appliqué dans la plupart des pays industrialisés.
Grâce à la T2A, la comptabilité analytique hospitalière a déjà évolué et un effort considérable a été effectué pour mieux appréhender la formation des coûts ; une vision plus dynamique de l'activité permet une comparaison plus assurée entre ce qu'il faut bien appeler les « parts de marché » des secteurs public et privé. Enfin, la nouvelle organisation interne associe mieux les équipes médicales à la gestion des établissements. Il est vrai qu'en ce domaine, la loi hôpital, patients, santé et territoires (HPST) a aussi joué son rôle dans un processus législatif devenu presque permanent, au point qu'il serait sans doute sage d'en maîtriser plus complètement le rythme.
J'en viens aux aspects moins positifs, dont le principal est que la T2A s'inscrit dans un système contraint et fermé avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), ce qui a pour conséquence ultime d'inciter à une activité inflationniste : plus on travaille, plus on a de ressources. Les tarifs n'évoluant guère, le seul moyen d'augmenter les recettes est d'accroître l'activité. A défaut, tandis que les charges ne cessent d'augmenter, le risque de déficit se mue en certitude.
Quant aux Migac, nous souhaitons qu'elles soient mieux identifiées, mieux quantifiées, plus réalistes, avec des enveloppes couvrant le coût des missions de service public qu'assument les seuls hôpitaux publics.
Sans surprise, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterai toutefois quelques compléments.
Asseoir le financement des hôpitaux sur l'activité paraît relever du simple bon sens. C'est pourquoi nous l'avons souhaité. Tout le monde y souscrit, y compris le corps médical, notamment avec la mise en place des budgets de pôles. Cependant, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) a critiqué, de même que la Cour des comptes dans son récent rapport, un système devenu extrêmement complexe et opaque. En effet, le calcul des tarifs conduit à s'interroger sur les modalités de la prise de décision, même si l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih) disposera, semble-t-il, d'un comité destiné à assurer davantage de transparence.
Un autre aspect de la T2A pose problème : lorsqu'ils fixent les tarifs, les représentants de l'Etat surestiment les prévisions d'activité. Cette surestimation prive le monde hospitalier de ressources dont il a besoin. Tel a notamment été le cas en 2011. A cet effet global s'en ajoute un autre au niveau local : l'établissement isolé dont l'activité n'est pas susceptible de s'accroître subit le blocage tarifaire à l'instar de tous les hôpitaux publics, au nom d'une hausse activité qui ne viendra pas !
Une autre critique porte sur l'absence de volonté politique dans les tarifs, car la dictature des moyennes n'incite guère, par exemple, au développement de la chirurgie ambulatoire. La dialyse à domicile est moins bien rémunérée que l'acte en poste, alors que 80 % des patients admis à l'hôpital pour dialyse devraient pouvoir en bénéficier. C'est un vrai problème.
Les gros investissements ne sont pas pris en compte dans la T2A. Il en va de même pour la recherche et le développement d'activités nouvelles, ce qui handicape surtout les CHU. En ce domaine, les aides à la contractualisation ne sont guère utilisées. De façon générale, les missions d'intérêt général (Mig) sont mal repérées ; les études de coûts ne sont pas réalisées. Dans l'ensemble, tout cela est mal financé.
Enfin, une partie non négligeable de l'activité hospitalière, psychiatrie, soins de suite et de rééducation (SSR) n'est pas financée en T2A - alors qu'elle représente plus de 30 % de l'activité hospitalière.

Je note que le monde hospitalier est satisfait de la T2A, du moins en son principe, d'éventuels problèmes relevant à votre sens de ses modalités d'application. Je ne suis moi-même pas persuadé de sa pertinence, mais je vous entends.
Pensez-vous qu'il faudrait établir un lien direct plus fort entre les tarifs et les coûts réels des groupes homogènes de séjour (GHS) ? Il semble que l'écart s'accroisse, au point que l'on est en droit de s'interroger sur l'intérêt des coûts repérés au niveau des établissements - même avec une comptabilité analytique plus performante.
Jugez-vous pertinente la modulation ciblée des tarifs effectuée en 2011 ? A-t-elle permis de mieux appréhender, par exemple, les changements de tarification ? Serait-il opportun de revoir l'échantillon des établissements de référence utilisé pour l'échelle nationale des coûts (ENC) ? Un des objectifs de l'Atih est-il que les coûts par GHS se rapprochent le plus possible du périmètre tarifaire, sachant qu'en sont exclues par exemple les Mig ?
Souhaitez-vous l'arrêt complet de la convergence tarifaire, ce que demande la fédération hospitalière de France (FHF) ? Préconisez-vous une pause ? Votre préférence va-t-elle à une redéfinition de cette convergence ? In abstracto, quel serait le financement idéal des établissements, qu'ils soient publics ou privés ?
Partagez-vous l'inquiétude de la FHF, qui évoque des conséquences graves de la convergence sur l'activité des CHU dans certaines disciplines comme le traitement des accidents vasculaires cérébraux ou des cancers ?

La FHF émet un avis négatif sur la convergence inter-sectorielle, pas sur la convergence intra-sectorielle. Partagez-vous son point de vue ?
Vous avez évoqué un toilettage de la loi HPST, dont j'ai été le rapporteur ; qu'entendez-vous par là ?
Si la revalorisation des actes allait jusqu'au bout, comment équilibrer les budgets ?
Avec ces questions, il y aurait de quoi alimenter un colloque de plusieurs jours !
Bien sûr, la situation économique ne peut être sans incidence sur le sujet qui nous occupe. Les dépenses de santé ne peuvent par trop excéder le rythme d'évolution du PIB, mais le vieillissement de la population est aussi une réalité, tout comme le coût du progrès technique ou des traitements émergents. Et la bienveillance dont bénéficient certains laboratoires pharmaceutiques lorsqu'ils lancent un traitement innovant n'est guère compatible avec l'évolution tarifaire. Théoriquement, des financements spécifiques et des dérogations existent, mais la T2A n'est pas suffisamment souple et adaptée à la réalité des coûts.
L'échantillon utilisé pour établir l'ENC est insatisfaisant, notamment parce que les CHU y sont sous-représentés. En effet, une particularité française est que le CHU joue le rôle du centre hospitalier de proximité pour les habitants des grandes métropoles régionales. Pour en illustrer les conséquences, je prendrai l'exemple de la maternité. Tout CHU dispose d'une maternité du niveau 3, donc à même de prendre en charge les parturientes dont le cas pose le plus de difficultés ; c'est son rôle et son devoir. Lorsqu'une jeune femme y accouche par voie basse sans complication, le prix de revient subit les coûts fixes induits par l'équipement de niveau 3, qu'il s'agisse du matériel ou du personnel. C'est vrai dans d'autres disciplines. Clairement, les tarifs moyens ne prennent pas en compte ces surcoûts. De leur côté, les Migac sont totalement sous-évaluées, en particulier les missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation (Merri).
A mon sens, la convergence est à l'origine d'un faux débat. Certes, l'homme de la rue ne comprend pas qu'une appendicectomie ne coûte pas la même somme à la clinique et à l'hôpital, mais les règles du jeu ne sont pas identiques dans le secteur public et dans les établissements privés à but commercial : le tarif appliqué à l'hôpital public inclut les salaires des médecins, alors que celui des cliniques ne prend pas en compte les honoraires ; les Samu sont rattachés aux seuls centres hospitaliers publics ; les personnes en grande détresse sociale sont accueillies à l'hôpital public. Dans le même esprit, si les établissements privés revendiquent le droit d'accueillir des internes - les premières expériences semblent d'ailleurs donner satisfaction - ils ne sont aucunement intéressés par des étudiants en pré-internat, car il s'agit d'une activité chronophage exigeant en outre d'effectuer des actes supplémentaires à visée purement pédagogique. A mon sens, la convergence ne peut tout simplement pas s'imaginer.
Au demeurant, que nous partagions le point de vue formulé par la FHF ne signifie pas que l'hôpital ne doive pas devenir plus performant, ni se dispenser d'une réflexion sur la pertinence des actes et des séjours. Certains malades restent hospitalisés faute de structures d'aval. A tous égards, mieux vaudrait qu'ils aillent ailleurs ; encore faut-il disposer de places ! Leur insuffisance est l'une des difficultés majeures de notre organisation.
Je comprends la pertinence de l'Ondam sur le plan des principes mais l'enveloppe étant fermée, la régulation porte nécessairement sur les prix.
Les hôpitaux généraux ont la même position.
La convergence tarifaire irrite beaucoup les hospitaliers. La logique de comparaison des coûts est acceptable, mais la manière dont elle est appliquée n'a rien de positif. Certains inconvénients sont si caricaturaux qu'on se demande si on ne cherche pas à mettre des établissements en difficulté. Dans les faits, la convergence se borne à réduire les tarifs appliqués dans le secteur public lorsqu'ils sont supérieurs à ceux du privé, mais pas dans la situation inverse... Plus de deux cents tarifs du privé sont supérieurs à ceux du public sans avoir jamais fait l'objet de mesures de convergence.
Qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables est très irritant. Certaines activités sont très peu réalisées dans le secteur privé ou le sont dans des conditions très différentes de celles du public. Pour illustrer mon propos, je reste dans le domaine des accouchements. Le taux de césarienne est jusqu'à deux fois supérieur dans les maternités privées ; les Françaises sont-elles à ce point morphologiquement différentes selon qu'elles s'adressent à une structure ou à une autre ? Dans les maternités publiques, un tiers des accouchements ont lieu la nuit, mais ils se passent presque toujours pendant la journée dans le secteur privé : pour des raisons de coût et de confort, on y rend programmable une activité qui n'a pas à l'être.
On veut aligner les tarifs du public sur ceux du privé alors même que plus de 40 % des établissements privés sont en déficit. Où est la logique ? Que les établissements se comparent entre eux ne peut avoir que des effets positifs, à condition toutefois que leur activité soit comparable, notamment quant aux pathologies prises en charge. Il existe des outils permettant de faire des comparaisons pertinentes ; la certification des établissements par la Haute Autorité de santé donne une vision détaillée du fonctionnement et des activités de chacun.
Il est tout à fait légitime de tenir compte dans la tarification de la pertinence et de la qualité des soins - deux notions cousines mais non identiques. Je participe à un groupe de travail sur l'évolution du mode de financement, piloté par la direction générale de l'offre de soins, qui réfléchit à de possibles indicateurs de qualité ; une expérimentation devrait être lancée au début de l'année 2013. Les professionnels savent que ce peut être l'occasion de faire des économies intelligentes et d'améliorer la prise en charge des malades.
Pas plus qu'à la T2A, les praticiens hospitaliers ne sont opposés dans le principe au contrôle de l'assurance maladie. C'est après tout le principal payeur, même si sa part diminue, et même si de nombreux Français croient que l'Etat finance les hôpitaux et l'assurance maladie le secteur privé : en réalité, c'est toujours le même qui paie ! Mais la question est de savoir qui contrôle, comment et sur quelles bases. Jusque récemment, le contrôle s'exerçait toujours à charge : les surfacturations donnaient lieu à des pénalités, les sous-facturations n'étaient pas compensées. Des textes récents ont théoriquement mis fin à cette injustice ; nous verrons ce qu'il en sera.
Les sanctions très lourdes qui sont quelquefois prononcées réduisent à néant les efforts des CHU pour améliorer leur gestion. C'est parfaitement anti-pédagogique ! L'assurance maladie se réfugie parfois derrière les décisions de l'agence régionale de santé... Les sanctions doivent être prononcées avec davantage de mesure et surtout de pertinence. Les médecins hospitalo-universitaires sont pour la plupart extrêmement compétents, il n'est pas sûr que ceux de l'assurance maladie le soient tous autant. Il est dommage qu'une structure externe, moins partiale, ne soit pas chargée de décider si telle codification est pertinente ou non. Les professionnels hospitaliers supportent mal d'être traités comme des bandits de grand chemin. Dans le secteur public, personne ne se remplit les poches, même si la presse a mis en lumière quelques aberrations exceptionnelles liées aux activités libérales exercées à l'hôpital ! Ce climat nuit aux relations entre l'assurance maladie et les hôpitaux ; certaines affaires ont même été portées devant les tribunaux... Pourtant, nous sommes tous au service de la population souffrante. Il est vrai que les relations de l'assurance maladie avec le secteur privé ne sont pas meilleures, il y a bien là convergence...
Les investissements courants sont évidemment compris dans les tarifs. L'Etat y contribue peu tandis que la politique des collectivités territoriales est très variable. Certains conseils régionaux considèrent qu'il est de leur responsabilité de subventionner les équipements lourds, d'autres non. De même, certains conseils généraux estiment que leur compétence se limite aux secteurs social et médico-social, d'autres aident les hôpitaux, comme j'ai eu l'occasion de le constater outre-mer. Il serait souhaitable que toutes les collectivités suivent la même ligne de conduite.
L'Etat participe aux gros investissements, comme avec le plan hôpital 2007. La plupart du temps cependant il n'accorde pas de subventions, mais aide au remboursement des emprunts, et son taux de contribution n'est jamais supérieur à 50 %, se situant plutôt entre 20 % et 40 %. Les hôpitaux sont conduits à s'endetter, ce qui les met parfois, comme on le voit aujourd'hui, dans une situation difficile. La vétusté des établissements rendait indispensable le plan hôpital 2007, même si l'on peut critiquer telle ou telle réalisation : j'ai entendu parler de « cathédrales hospitalières »... Il revenait sans doute à l'Etat d'être plus attentif à certains dossiers. Quoi qu'il en soit, les hôpitaux ne sauraient se passer de son aide sur ce type d'opérations.

Je suis d'accord pour dire que l'Etat devrait financer les gros investissements pour qu'ils n'aient pas de répercussion sur les coûts, dont le décalage avec les tarifs s'accentue déjà. Je m'interroge en revanche sur le rôle des collectivités. J'ai été surpris d'apprendre que certains conseils généraux d'outre-mer contribuaient aux investissements, alors que cela n'entre pas dans leurs compétences ; les départements assument déjà de lourdes charges dans le secteur social et médico-social.
C'est de moins en moins vrai...

Ils n'ont plus d'argent ! Ils financent par exemple l'allocation personnalisée d'autonomie à 70 % au lieu des 50 % prévus à l'origine... Quant aux régions, elles pourraient sans doute participer à des financements croisés avec l'Etat, mais pour l'instant elles n'en ont ni la compétence ni les moyens.
Que pensez-vous des partenariats public-privé et de l'exemple de l'hôpital Sud Francilien ? Il semble que ce genre de montage coûte plus cher en définitive qu'une opération classique.
J'aimerais aussi entendre votre point de vue sur le rapport publié en septembre 2010 par la Cour des comptes. Celle-ci estime que les déficits des hôpitaux sont dus à un effet de ciseaux entre l'évolution des charges et celle des recettes : non que l'activité stagne, mais le codage des actes n'est pas toujours fiable, et il existe aussi des problèmes de facturation et de recouvrement. Ces dysfonctionnements occasionneraient de lourds manques à gagner et des difficultés de trésorerie, aussi bien dans les CHU que dans les établissements moyens.

Les médecins procèdent-ils eux-mêmes au codage des actes ? Si c'est le cas, n'est-il pas dommage qu'ils perdent ainsi un temps précieux alors que leur métier est de soigner ? Sinon, le personnel en charge du codage a-t-il les compétences médicales nécessaires ?
Depuis l'enquête de la Cour des comptes, le codage des actes s'est beaucoup amélioré, ce qui n'est pas étranger à la baisse des déficits des établissements, des CHU notamment. Nous avions des progrès à faire, car contrairement au secteur privé, le codage n'était pas traditionnellement à la source de nos financements. Nul mieux que le médecin ne peut remplir cette tâche, car nul ne sait mieux que lui ce qu'il a fait. L'acte médical ne s'arrête d'ailleurs pas au moment où l'on quitte le patient ; les médecins libéraux remplissent eux aussi des papiers. Mais une chose est de procéder au codage, une autre est de l'enregistrer dans le système informatique. La situation, à cet égard, diffère d'un établissement à l'autre. Certains établissements petits et moyens centralisent la codification. Ailleurs, on a créé - par redéploiement - des postes de techniciens d'information médicale, qu'il a fallu former, pour renforcer les services dédiés ; à Bordeaux par exemple, le service de l'information médicale ne compte que quatre ou cinq médecins pour 3 500 lits. Nous avons affecté un technicien d'information médicale à chaque pôle. Il assure l'interface entre les actes effectués par le médecin et leur traduction en codification.
De moins en moins d'établissements sont déficitaires. Le volume des déficits diminue et se concentre sur un petit nombre d'établissements. Est-ce dû à une mauvaise gestion ? Non. Certains hôpitaux généraux ont dû consentir des investissements massifs pour mettre leurs bâtiments aux normes de sécurité, les désamianter, etc. Or le financement de l'Etat ne prend pas en compte les frais financiers qui, pour un emprunt à trente ans, peuvent représenter la moitié du coût de l'opération.
En outre, la situation géographique de plusieurs hôpitaux généraux - c'est moins vrai des CHU - explique que certaines de leurs activités soient structurellement déficitaires. Elles devraient être financées par les Mig, dont c'est la vocation. La nature même des activités est parfois en cause : ainsi, presque tous les services de néonatologie perdent de l'argent, parce que des normes imposent la présence permanente d'un nombre minimal de médecins, d'infirmiers, de puériculteurs. On a calculé qu'un service de néonatologie devait compter plus de douze lits pour amortir ses frais ; or presque aucun d'entre eux n'est dans ce cas !
Si on estime indispensable de les maintenir, il faudrait les financer par le biais des Mig : on le fait partiellement pour les services d'urgence, mais presque jamais pour ceux de néonatologie.

Il faudrait identifier ces activités et prévoir les compensations nécessaires.
Absolument. Je prendrai un autre exemple : celui de la neurochirurgie à l'hôpital Sainte-Anne. C'est une activité généralement déficitaire. Les CHU parviennent à compenser par d'autres activités, mais ce n'est pas le cas de Sainte-Anne, alors que la neurochirurgie représente une partie importante de son activité. Pour parvenir à l'équilibre, l'hôpital devrait renoncer à d'autres missions au détriment des patients.

Pour financer ces activités déficitaires, pourquoi ne pas augmenter les tarifs de base ?
Le système ne le permettrait pas. J'ajoute que l'évolution des coûts diffère beaucoup d'une activité à l'autre. Les tarifs sont alignés sur la moyenne des coûts ou sur les coûts les plus bas. Or, si en biologie médicale ou en imagerie le coût marginal diminue très vite à mesure que le nombre d'actes augmente, ce n'est pas le cas pour les consultations. Ce peut même être l'inverse, car il y a des effets de seuil. Dans les maternités, par exemple, si l'on dépasse le seuil de deux mille accouchements, il faut recruter un obstétricien, un anesthésiste, un pédiatre supplémentaires...
Ils ont pu apparaître à une époque comme le moyen, pour des établissements incapables de s'autofinancer, de réaliser des investissements sans s'endetter lourdement. Mais on s'est vite aperçu que c'était un marché de dupes. Dans le contexte financier actuel, ce n'est certainement pas la bonne solution. Il y a eu pourtant un certain engouement... La mission d'aide à l'investissement hospitalier du ministère a incité les établissements à y recourir : j'en ai moi-même fait l'expérience au CHU de Bordeaux. Peut-être tous les exemples ne sont-ils pas aussi catastrophiques que celui de l'hôpital Sud Francilien...
Le monde hospitalier considère globalement que les PPP ne sont pas adaptés à la construction de bâtiments vastes et complexes, destinés à évoluer. En revanche, j'y ai eu recours pour une maison de retraite, en partenariat avec une société d'économie mixte HLM, et je n'ai pas eu à le regretter. En tout état de cause, il faut travailler avec des entreprises qui ont l'expérience du domaine médical. Dans le cas de l'hôpital Sud Francilien...
il est patent que les bâtiments n'ont pas été conçus par des professionnels hospitaliers, et outre le problème financier, on s'apercevra très vite des difficultés de fonctionnement.

Ce n'est pas du tout ce qu'on entend d'ordinaire. On prétend en général que les PPP sont adaptés aux opérations techniquement complexes, où il est nécessaire d'associer d'emblée le constructeur et les futurs utilisateurs.
Bien peu de professionnels savent concevoir de très gros projets hospitaliers. Sollicité par la Caisse des dépôts et consignations pour évaluer un projet de cette envergure, j'ai répondu qu'il était impossible de le faire seul en une après-midi, car il faut recueillir l'avis de gens aux compétences très diverses.

Nous avons rencontré récemment certains de vos collègues, qui nous ont tous fait part de leurs difficultés de financement et notamment de trésorerie. Ils souhaiteraient que les établissements soient autorisés à émettre des billets de trésorerie. La situation s'est-elle améliorée ?
Certains établissements ont souscrit des emprunts dits « toxiques » et sont dans une situation délicate. La Caisse des dépôts s'est jusqu'ici surtout préoccupée des collectivités qui ont contracté de tels emprunts, et j'espère qu'un meilleur équilibre sera trouvé à l'avenir entre les sollicitations des collectivités et celles des hôpitaux.
Nous pâtissons aussi de l'encadrement du recours à l'emprunt. Certes, le décret à ce sujet doit être revu. Mais les banques se réfugient souvent derrière de faux arguments, excipant par exemple du fait qu'il faut l'autorisation expresse de l'ARS...
Il existe enfin des problèmes de trésorerie. Sans doute les hôpitaux doivent-ils apprendre à facturer plus vite. Mais la typologie des patients accueillis explique aussi les difficultés de recouvrement, sans compter l'aide sociale. Lorsqu'un hôpital demandait naguère une ligne de trésorerie, il obtenait entre trois et cinq propositions, ce qui lui permettait de faire jouer la concurrence. Aujourd'hui, une banque tout au plus répond et impose ses conditions ! La conférence des directeurs généraux de CHU a attiré l'attention du ministère sur ce problème, et des contacts ont été pris par l'intermédiaire de Bercy avec l'Agence française des banques pour encourager celles-ci à assouplir leur position et à modérer leurs taux.
Les délais de paiement des CHU sont de cinquante jours en moyenne.
Le paiement des fournisseurs ne représente qu'une petite partie des décaissements des hôpitaux : les salaires et les charges en constituent l'essentiel.

Les retards de paiement peuvent mettre en difficulté les fournisseurs...
Le problème financier ne se limite pas à la trésorerie courante. Quelques établissements ont engagé des travaux très importants en comptant lever des fonds au fur et à mesure de leur avancement. Faute de financement, ils doivent aujourd'hui les arrêter ! Cela arrive même à des hôpitaux dont la situation financière générale est saine. Celui que je dirige est très peu endetté et n'a aucun problème pour payer ses fournisseurs ; il se contente de lever chaque année quelques millions d'euros pour financer l'équipement courant. Or nous n'obtenons plus de réponse des banques, même de celles avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Il est vrai qu'elles disposent de peu de liquidités.

Il faut tenir compte du risque de faillite, et de la difficulté de renégocier un prêt.
Les hôpitaux généraux n'ont pas les mêmes moyens techniques que les CHU, et ceux qui ont souscrit des emprunts toxiques étaient souvent peu armés. Je suis donc réservé sur ce type d'instrument pour les établissements hospitaliers.

Merci de vos réponses. Je retiendrai ce que vous avez dit du contrôle exercé par l'assurance maladie, qui m'a rappelé une précédente audition...
Financement des établissements de santé
Audition de Mm. Francis Fellinger président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et guy moulin président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires sur le financement des établissements de santé

Nous sommes heureux d'accueillir M. Guy Moulin, président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des CHU et M. Francis Fellinger, président de la conférence des présidents des CME des centres hospitaliers, dont nous voulons connaître l'opinion sur la tarification à l'activité (T2A).
Que pensez-vous des exigences en matière de codage associées à la T2A ? Que vous inspirent les contrôles effectués par l'assurance maladie ? Pensez-vous souhaitable et possible de compléter les tarifs par des indicateurs de qualité ? Ce mode de tarification présente-t-il des avantages et comporte-t-il des limites ? Quels correctifs jugez-vous utile d'apporter ?
Les dotations aux Migac sont-elles d'un montant satisfaisant ? Faut-il accroître ou réduire leur part dans l'ensemble des ressources des établissements ?
La T2A est équitable en son principe, mais devient inéquitable dès lors que l'on néglige les surcoûts directs ou indirects, notamment les activités à fort impact social comme les patients en situation de précarité ou les personnes âgées. A cet égard, le codage proposé est très imparfait, puisqu'il ne prend pas en compte la dimension sociale.
De même, l'importance de l'activité non programmée est laissée de côté, cependant que les forfaits censés couvrir des activités très spécialisées ou de dernier recours restent inférieurs à la réalité des dépenses. De façon générale, la T2A ne prend en compte ni l'incidence de décisions statutaires, ni l'activité d'expertise, ni le temps consacré aux tâches médico-administratives, ni la participation à des réunions comme celle que nous avons en ce moment.
En revanche, la T2A a une vertu managériale incontestable ; elle a fait prendre conscience des dérives budgétaires et des surcoûts ; elle a obligé nombre d'hôpitaux à revoir et rationaliser leur organisation. Je regrette toutefois que les coefficients de transition utilisés dans les plans de retour à l'équilibre soient aussi instables d'une année sur l'autre - ce qui relativise les résultats budgétaires.
Alors qu'elle a commencé par être facteur de désorganisation, la T2A est aujourd'hui appropriée par les équipes des pôles, au point que parfois l'exercice comptable devient un objectif en soi, même pour les médecins. Les inévitables contraintes de la gestion comptable imposent des regroupements inadaptés qui peuvent altérer la qualité des soins et incitent à une pratique inflationniste parfois déshumanisante. Les incidences sont évidemment fortes sur les ressources humaines : de nombreux CHU manquent aujourd'hui de personnel non médical, dont l'effectif est sans doute une variable d'ajustement des plans de retour à l'équilibre.
Le processus d'optimisation n'est pas sans conséquences. A titre d'exemple, le développement de la prise en charge ambulatoire s'opère par transfert d'activités, non par une offre supplémentaire, et débouche parfois sur un manque de lits. Pensez à ce qui est paru dans la presse sur l'engorgement des urgences : il peut conduire à repousser l'activité programmée, avec un coût social et médico-social évident.
La T2A est certes un système évolutif, mais il n'est pas envisageable de la rendre encore plus complexe. Les modalités de construction tarifaire sont déjà incompréhensibles et les règles changent trop souvent, qui plus est de façon inopinée.
Quant à la convergence intersectorielle, elle s'opère dans un seul sens, celui de l'alignement du public sur le privé, ce qui réduit les ressources des hôpitaux publics.
En conclusion, la T2A devrait être un outil d'aide plus que de contrôle. Il faut sans doute plus de Migac dans les CHU et moins de convergence pour tout le monde.
J'étais jusqu'à une date récente cardiologue dans un centre hospitalier alsacien, je suis président de la conférence des présidents de CME depuis 2003, mon mandat expire la semaine prochaine.
Globalement, la T2A est un progrès par rapport au système précédent, qui était aveugle. C'est une modalité de partage de l'Ondam hospitalier ; dans l'idéal, elle devrait conférer à ce partage davantage d'objectivité, de transparence et d'équité. Mais tout n'est pas aussi rose qu'on a pu le rêver. La transparence notamment n'est pas au rendez-vous. La construction tarifaire est obscure, même au regard du référentiel des coûts. Nul ne maîtrise totalement le système, tant il est complexe. Songez donc : il y a 2 300 tarifs ! Dès que l'on modifie un tarif, il est difficile d'en mesurer l'impact sur les ressources des établissements. En pratique, le pilotage est extrêmement difficile, tant pour les autorités de tutelle que pour les gestionnaires hospitaliers et les médecins.
Notre point d'indice synthétique activité (ISA) est de 20 % inférieur à la moyenne, si bien qu'on nous a enlevé au départ 15 % du tarif T2A, mais nous arrivons aujourd'hui à 100 %. Nous sommes même légèrement excédentaires, sans savoir pourquoi. Il est donc difficile d'effectuer une planification pluriannuelle à deux ou trois ans.
La T2A présente l'avantage d'obliger les établissements à examiner leurs coûts de production. Les responsables médicaux, à la différence sans doute des médecins de base, ont appris très vite, trop vite même, puisqu'ils ont parfois adopté des conduites d'opportunité et d'optimisation. Dans les centres hospitaliers, on raisonne désormais en termes médico-économiques, ce qui n'était pas du tout le cas il y a dix ans et rarement il y a cinq ans. Il n'y pas eu d'étude précise sur le sujet, mais une concurrence s'est établie entre pôles. J'observe au demeurant que, selon la prise en compte ou non de coûts de structure, le pôle cardio-vasculaire où je travaille est déficitaire ou excédentaire... C'est difficile à accepter pour un scientifique.
La T2A constitue plutôt un progrès, mais il est difficile d'obtenir un véritable référentiel des coûts dans le secteur public ; c'est totalement impossible dans le privé. Qu'est-ce qu'un coût de référence ? Qu'est-ce qu'un coût de prise en charge cohérente ? La moyenne constatée dans un échantillon non représentatif ou le prix d'une prise en charge conforme aux derniers acquis de la science ?
J'en viens aux limites de la T2A. D'abord, elle décourage la coopération au profit de comportements individualistes, tant de la part des équipes médicales que des établissements. Ainsi, les directeurs sont évalués sur le résultat de leur établissement, non sur celui de l'ensemble du système. Incitant à capter le maximum de patients, la T2A est un obstacle à l'organisation pertinente d'un parcours de soins. Au demeurant, le fonctionnement même de structure n'incite pas à la coopération interhospitalière. A titre d'exemple, un médecin qui assure des consultations dans un autre établissement perçoit une prime spécifique, qui disparaîtra si les deux hôpitaux sont regroupés. On pourrait multiplier les exemples.
Autre limite, la mauvaise prise en compte de l'urgence, dont le codage est particulièrement ardu et difficilement contrôlable. D'où l'utilisation d'une tarification au coût moyen avec une part pour l'urgence, qui n'est pas sans conséquence selon que l'établissement fait beaucoup de « programmé » ou beaucoup d'urgence.
Enfin, les tarifs sont la variable d'ajustement du système, susceptibles de mouvements aux motifs obscurs, avec des effets indirects, comme lorsque l'augmentation d'un tarif de chirurgie est répercutée sur d'autres GHS pour rester dans l'enveloppe fermée.
De par son asymétrie, la convergence intersectorielle est inéquitable aux yeux des hospitaliers publics, puisqu'elle consiste exclusivement à réduire les tarifs pratiqués dans le secteur public lorsqu'ils sont supérieurs à ceux du privé. Dans ma discipline, la cardiologie interventionnelle est bien moins chère à l'hôpital public. Trois GHS - la coronarographie simple, l'angioplastie avec infarctus et l'angioplastie sans infarctus - présentent des différentiels tarifaires avoisinants 50 %. Vu le fort volume d'actes réalisés par nos confrères privés, l'incidence budgétaire globale avoisine 100 millions d'euros. Comment comprendre pareils arbitrages ?
J'en viens au codage des actes. Cette opération compliquée occupe, dans mon service, l'équivalent de six semaines de travail d'un médecin par an, en comptant 10 à 15 minutes par dossier. Il nous faut davantage de techniciens d'information médicale.
Les contrôles effectués par l'assurance maladie sont certes indispensables, mais le fait qu'ils soient systématiquement effectués à charge est très mal vécu. En l'absence de référentiel universel, le médecin contrôleur - rarement un spécialiste - dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation, mais pas nécessairement d'arguments scientifiques. La mise en accusation systématique est donc ressentie comme délétère, au point que l'assurance maladie est vue comme un « ennemi de classe » par les hospitaliers, alors que c'est elle qui garantit la pérennité du système. Bien qu'ils ne soient pas médecins, les délégués de l'assurance maladie prétendent nous dire comment il faut faire, eux dont la formation est particulièrement brève...
Quant aux modalités de prise en charge, je ne pense pas qu'elles aient fondamentalement changé, car la déontologie médicale demeure. Aucune étude n'a été réalisée, mais certaines équipes sous pression ont pu se réorienter vers des filières plus rémunératrices. Globalement, je ne pense pas qu'il y ait là un problème majeur dans l'immédiat. A terme, c'est une autre affaire.
Les indicateurs de qualité font l'objet d'un débat de fond. Je suis partisan d'un contrôle de la pertinence des actes plutôt que de leur volume, mais le premier problème auquel se heurtent les indicateurs concerne le recueil de l'information. Il y a tant d'indicateurs que c'en devient ubuesque. La Haute Autorité de santé (HAS) vient d'en ajouter une centaine par dossier... Nous ne pouvons plus suivre ! Les indicateurs automatiques sont inadéquats, un système déclaratif ne garantit pas la sincérité. Comment l'agence régionale de santé (ARS) peut-elle d'ailleurs exploiter des centaines d'indicateurs ? Nous pourrions raconter n'importe quoi ! Le codage représente du temps médical perdu pour le soin. Face aux excès actuels, je m'attends un effet de balancier pour l'avenir.
Les Migac incluent les Merri, pratiquement réservées aux CHU, alors que les centres hospitaliers assument une mission d'enseignement à titre bénévole. Nos files actives ne sont pas exploitées. C'est dommage. Il faut inciter les centres hospitaliers non universitaires à s'investir dans la recherche clinique.
La permanence des soins fait l'objet d'une très forte différence de rémunération entre les secteurs publics et privés. Un cardiologue interventionnel qui prend en charge un infarctus du myocarde à l'hôpital public vers deux heures du matin est rémunéré 160 euros, alors qu'un praticien libéral perçoit environ 1 300 euros, il est vrai avec les charges - environ 700 sans elles. Le sentiment d'injustice est très fort. J'ajoute que deux mouvements se conjuguent, la démographie médicale qui incite à regrouper les urgences et les plateaux techniques, et la sur-spécialisation. Il faut donc disposer d'équipes mutualisées pluri-professionnelles, tout en conservant une offre de proximité.

La convergence intrasectorielle est-elle aussi difficile à réaliser : songez à l'exemple offert par les CHU de Nice et de Marseille, dont les clientèles sont très différentes.
Que pensez-vous d'une régionalisation de la tarification ?
La convergence intrasectorielle est possible entre Marseille et Nice. Je ne sais pas si Monaco y participe... Les pires difficultés concernent certaines disciplines comme la pédiatrie ou la périnatologie.
Faut-il une tarification régionale ? Peut-être, mais la T2A est basée sur des moyennes nationales. L'écart entre CHU s'explique surtout par le poids de la précarité, qui varie grandement d'une ville à l'autre et même au sein d'une même ville - je pense aux quartiers nord et sud de Marseille par exemple - d'où un fort biais sur la convergence intrasectorielle. La réduction de l'aide médicale d'Etat (AME) a des incidences très négatives, car les CHU prennent en charge une partie du financement sur leurs moyens propres. La tarification régionale risquerait d'être difficile à mettre en place et comporterait autant de biais que la tarification nationale.
Le codage des diagnostics a fait de grands progrès. Il est décentralisé, réalisé par les équipes médicales dans les hôpitaux publics, alors qu'il est centralisé dans les établissements privés. Le codage décentralisé est plus précis, mais ceci minore le temps médical. Il est en revanche moins efficace en termes de performance du codage. L'absence de professionnalisation est un vrai problème, vu ses conséquences budgétaires.

Vous dites que la tarification régionale comporterait des biais semblables à la tarification nationale. On pourrait faire un test sur une grande région... Toute moyenne est trompeuse, mais peut-on raisonner sur une autre base ?
Ce matin, le président de la conférence des directeurs généraux de CHU et le président de la conférence des directeurs de CH ont approuvé le principe de la T2A, pour ses avantages sur la dotation globale. La question est donc : comment améliorer le dispositif ? Pensez-vous que certains coûts soient statistiquement trop incertains pour figurer dans le référentiel ? Faudrait-il alors les extraire du système ? Il semble aussi que le sous-financement systématique de certaines activités perturbe la mécanique d'ensemble.
Ne faudrait-il pas revoir l'échantillon utilisé pour établir l'échelle nationale des coûts, y faire par exemple une place plus grande aux CHU ? C'est le support de tout le dispositif !
Le codage s'est professionnalisé ? Peut-être dans les CHU... Pour rendre les tarifs moins contestables, ne faudrait-il pas instituer à l'Atih un comité scientifique composé de personnalités indépendantes ?
Les tarifs viennent d'augmenter de 0,19 % après trois ans de stagnation. Cette évolution vous permettra-t-elle de faire face aux dépenses ?
Il n'y a aucune raison de repousser la convergence intrasectorielle, à condition de surmonter deux difficultés. La première concerne le passif immobilier, qui peut être lourd lorsque le patrimoine n'est pas aux normes ; à ce premier boulet s'ajoute celui du passif financier, hérité de la gestion passée. Enfin, la charge des créances irrécouvrables est parfois lourde.
Les tarifs n'ont que très peu évolué : alors que l'Ondam progressait de 2,5 %, ils n'ont augmenté que de 0,19 %, après trois années de stabilité totale. Parallèlement, les Migac ont été significativement réévaluées. Résultat : un établissement dont l'activité est concentrée en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) subit la contrainte financière de plein fouet. La réévaluation relative des Migac s'est opérée au détriment des tarifs, qui sont ainsi devenus variables d'ajustement.
Comment se comparer avec elles ? Dans ces établissements, les honoraires médicaux posent problème...
Il faut de la transparence : pourquoi tel tarif est-il ce qu'il est ? Correspond-il à la réalité ? Je partage votre avis sur l'échantillon : il faut le revoir, car il ne serait pas accepté par un statisticien de première année. Les établissements volontaires ont été sélectionnés parce qu'il disposait d'outils de gestion, mais certains, qui ne font par exemple pas de réanimation, y figurent ; cela a une influence sur le tarif ! Nous regrettons que certains CHU aient quitté l'échantillon. A défaut d'obligation, il faudrait au moins que les hôpitaux soient incités à le rejoindre pour qu'il soit davantage représentatif.
Les tarifs pour 2012 ont été publiés le 29 février, date limite légale. Dans ces conditions, comment établir un budget prévisionnel sérieux... à compter du 1er mars ? Nous préférerions avoir le temps de la réflexion pour envisager le développement d'une activité, investir. Comment faire, si les tarifs sont incertains ? Qui plus est, les tarifs sont annuels ; nous aimerions avoir un peu plus de visibilité à moyen terme.

Il me semble que l'on recherche par trop l'exhaustivité : l'existence de 2 300 tarifs est une aberration ! Ne pourrait-on réunir une sorte de conférence de consensus pour établir une liste d'indicateurs vraiment maîtrisables ? Consacrer au codage six semaines par an, c'est prélever beaucoup de temps sur les soins.
En ce qui concerne les indicateurs de qualité, on est parti de rien tout en voulant la perfection. D'où la constitution d'équipes scientifiques de pointe et l'élaboration d'indicateurs par la HAS. Alors que les médecins sont déjà surchargés, la nouvelle obligation de saisie suscite leur incompréhension. Mieux aurait valu se limiter à quelques indicateurs simples et robustes. Bien sûr, certains spécialistes veulent utiliser ces indicateurs, mais les autres médecins ne voient que l'alourdissement de la saisie.

Comment établir un coût de référence réellement opposable ? Vous dites par ailleurs que le système actuel incite à l'individualisme, alors que la loi HPST a précisément pour but de développer la coopération.
Incontestablement, la T2A incite l'établissement à conserver ses patients plutôt qu'à organiser un parcours de soins.

Cette observation nous conduit tout droit à la facturation individuelle.
qui poserait d'autres problèmes. Il est souhaitable qu'une réflexion soit engagée sur le sujet ; il faudrait pouvoir valoriser d'une façon ou d'une autre la prise en charge coordonnée du parcours.
Le coût de référence représente le modèle le plus simple, pourvu que l'échantillon soit représentatif.
Je suis dubitatif face à la régionalisation tarifaire, qui serait source de bureaucratie. Mieux vaut utiliser les aides à la contractualisation pour prendre en compte les spécificités locales.
Il faut nuancer les incidences sur la prise en charge des patients - je pense par exemple à la chirurgie ambulatoire... Le « saucissonnage » des actes peut être une réalité. Je suis radiologue. Le forfait d'hôpital de jour ne prend pas en compte la radiologie, ce qui réduit les recettes de l'établissement ; dans le secteur privé, on fait revenir le patient plusieurs fois.
Le financement des Mig augmente, mais reste sous-évalué. C'est un vrai problème pour toutes les missions d'intérêt général, notamment la permanence des soins. Concrètement, les Mig bénéficiaires financent les Mig déficitaires ; ces missions deviennent des variables d'ajustement intra-hospitalier, ce qu'elles ne devraient pas être. Nous voulons qu'elles soient financées à leur juste mesure. Selon la tutelle, le sous-financement des Mig atteint 8 millions d'euros sur les 80 millions qui leur sont consacrés à Marseille. Comme l'établissement applique un plan de retour à l'équilibre, certaines missions sont négligées.
Tarifs comme Mig deviennent des variables d'ajustement...

Il me semble que les Migac augmentent cette année de 3,33 %. Certains disent que cette hausse vise à financer les RTT des médecins. Mais une chose au moins est certaine : cette évolution se fait au détriment de la tarification, qui reste quasiment stable avec 0,19 %.
En début d'année, quelque 150 millions d'euros destinés à l'aide à la contractualisation ont été réservés. Ils ont été prélevés uniquement sur l'activité hospitalière. L'hôpital subit donc un considérable manque à gagner.

Nous devons expertiser la T2A. Faut-il conserver cette tarification ? Faut-il l'améliorer ? Nous avons compris qu'elle suscitait une certaine concurrence et que la convergence entre secteurs public et privé butait sur les honoraires médicaux.

Au cours des auditions, nous avons entendu tout est le contraire de tout sur la convergence !

On dit souvent que l'hôpital coûte cher ; mais la médecine de ville aussi ! On pourrait sans doute réaliser des économies sur le secteur privé.

On cherche aujourd'hui à préserver la qualité des soins en utilisant au mieux l'argent public. L'une des solutions est le parcours de soins, qui tend à éviter les redondances et à recentrer les soins sur la prise en charge de proximité. Or, vous avez dit que la T2A était un obstacle à la mise en place de parcours de soins...
Le mot « obstacle » est un peu fort. Le responsable d'un établissement doit évidemment produire des soins accessibles et de qualité, mais il est aussi en charge d'une très grande structure économique, souvent principal employeur du département, plus gros acheteur du territoire et son principal restaurateur... Il doit optimiser l'utilisation des ressources publiques. A cette fin, soit il réduit les ressources en interne si elles sont affectées à des activités en surcoût, soit il augmente le volume d'activité pour gagner sur les coûts marginaux. Il préfèrera accueillir cent malades supplémentaires plutôt que de les voir partir vers la clinique d'à côté ou un autre hôpital public, fût-il dirigé par un collègue et néanmoins ami de trente ans...
Tout serait différent si les financements prenaient en charge non un séjour, mais un parcours. Ce serait sans doute compliqué. Pour avancer, on pourrait envisager des expérimentations régionales portant sur certaines pathologies lourdes comme le cancer ou les pathologies cardio-vasculaires. Les confrères de ville sont nos principaux clients, avant même les patients. Nous avons donc en réalité tout intérêt à favoriser une coopération, mais ce n'est pas toujours simple : ni le médecin de ville, ni l'hôpital ne tient par exemple à prescrire un transport médical. Ainsi, le débat relève du plan national plus que du niveau local.

Comment pourrait-on faire évoluer un tarif à l'acte vers un tarif de parcours ?
Commençons par expérimenter, sur l'infarctus du myocarde par exemple.
Trouver une clé de répartition...
L'évaluation des coûts sera difficile...
Pourquoi ne pas définir un parcours moyen organisé, appuyé sur la pertinence des soins ?
Il faudrait au moins se prononcer sur la pertinence des soins, ce qui suppose un indicateur plus solide que la qualité.
Non : l'indicateur de qualité renseigne seulement sur la manière dont l'acte a été réalisé, pas sur sa justification.

Après le prix de journée et le budget global, nous en sommes à la T2A. Et voilà que vous proposez un tarif de parcours, alors que les directeurs auditionnés ce matin se sont plaints des modifications législatives incessantes !
Je propose une simple adaptation du régime tarifaire.

Venons-en au patrimoine immobilier. A quel niveau intervient-il dans le budget ? Vous semble-t-il envisageable d'opérer une séparation sur le modèle qui a vu la SNCF donner naissance à RFF, pour isoler le passif immobilier et ne pas faire peser l'investissement sur le financement de l'activité ?
Sur le plan architectural, les établissements construits dans les années 70 et 80 ne sont pas conformes aux normes actuelles, ce qui occasionne un surcoût très élevé. Il faut inclure cet élément dans la réflexion.
L'important est de préserver la capacité évolutive de la structure. Je ne suis pas certain que son externalisation atténue la difficulté provoquée par une utilisation de l'espace que nul n'avait anticipé il y a dix ou quinze ans.

Les patrimoines immobiliers ne sont pas homogènes. Ils rentrent dans la tarification par le biais des amortissements et des annuités d'emprunt. Ne pourrait-on en extraire ces boulets ? L'incidence d'une construction est très élevée en raison de durées d'amortissement qui n'ont pas été revues depuis longtemps...
Autrefois, la sécurité sociale finançait en partie l'investissement, même les équipements lourds. Il y a aujourd'hui de temps à autre des plans financés par l'Etat, mais ils ne suffisent pas.
Enfin, certains emprunts passés pèsent très lourd, notamment dans les budgets de CHU. On aboutit à un décrochage entre les coûts et les tarifs.
Voulez-vous externaliser la gestion de l'immobilier vers un opérateur privé ?
Une sorte de RFF hospitalier ? Alors que des opérateurs de transport autres que la SNCF peuvent utiliser les voies de chemin de fer, rien d'équivalent n'est envisageable à l'hôpital.
Je distingue le patrimoine et le passif pour souligner la diversité des situations. La construction hospitalière est un vrai problème, car on construit pour quinze, vingt ou trente ans, alors que l'on ignore comment on fonctionnera dans cinq ans.

Le montage SNCF-RFF est intellectuellement séduisant, mais il est aujourd'hui critiqué par référence au modèle allemand, où la séparation est bien moins tranchée.
Je vous remercie pour vos interventions, riches et diverses.