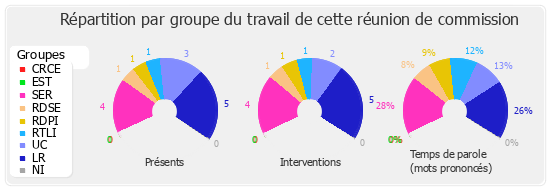Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Réunion du 14 février 2018 à 16h30
Sommaire
La réunion

Je comprends de votre réponse que l'État actionnaire s'entretiendra prochainement avec Orange et répondra aux lettres des parlementaires relatives à ce problème. Merci monsieur le ministre, j'espère que nous continuerons à travailler ensemble sur ces sujets.
La réunion est levée à 13 heures.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
- Présidence de M. Hervé Maurey, président -
La réunion est ouverte à 16 h 30.

Nous accueillons Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Je vous remercie, madame la ministre, d'avoir répondu à notre invitation, pour évoquer la question de l'accès aux soins, qui, au même titre que celle de la couverture numérique du territoire, que nous avons abordée ce matin avec M. Denormandie, est un sujet majeur d'aménagement du territoire.
Notre commission est, comme vous le savez, très mobilisée sur cette question de l'accès aux soins et sur le problème de la désertification médicale. Son premier rapport d'information, en 2013, Déserts médicaux, agir vraiment, portait d'ailleurs sur ce sujet. Nous proposions, à l'époque, seize mesures pour enrayer cette évolution, déjà préoccupante. Certaines ont reçu un timide écho - je pense au développement de la télémédecine, à l'allongement de la durée d'activité des médecins, au transfert d'actes entre professionnels de santé - mais d'autres n'ont malheureusement pas prospéré. Tel est le cas de notre proposition de mieux évaluer et de réorienter les aides à l'installation, de réformer les études de médecine, à partir du constat que l'on forme davantage de futurs praticiens hospitaliers que des médecins de ville, d'instaurer, enfin, un système de régulation à l'installation.
Quelques années plus tard, notre collègue Jean-François Longeot, rapporteur pour avis du projet de loi de modernisation du système de santé, proposait un certain nombre d'amendements, adoptés à l'unanimité par notre commission, pour mettre en place, notamment, un système d'apprentissage, et revenir à la charge sur l'idée du conventionnement sélectif, auquel nous sommes attachés.
Ces amendements n'ont pas prospéré dans l'hémicycle, parce que depuis 25 ans, les gouvernements successifs ne veulent pas sortir d'une politique purement incitative dont on mesure pourtant chaque jour les limites. Dans 148 cantons, il n'y a plus, aujourd'hui, aucun médecin généraliste, contre 91 en 2010. Il faut, selon les derniers chiffres dont je dispose, 18 jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous avec un pédiatre, 40 pour un gynécologue, et 133 pour un ophtalmologiste. Selon un sondage, 64 % des Français ont renoncé à se faire soigner compte tenu de ces délais.
Alors que je mettais beaucoup d'espoir dans les annonces du Premier ministre, qui avait dit, très tôt, que la lutte contre les déserts médicaux était une priorité, j'ai été déçu par le dispositif retenu, qui s'inscrit dans la même logique que les mesures mises en oeuvre jusqu'à présent et qui, restant centrées sur l'incitation, ne sont pas de nature à relever le défi auquel sont confrontés nos territoires, les élus et les citoyens. J'ai lu que le Premier ministre aurait récemment annoncé un texte sur les déserts médicaux. Si tel est le cas, contiendra-t-il enfin des mesures adéquates ?
Nous nous rejoignons sur l'enjeu, mais pas sur les solutions. La situation de la médecine n'est pas une question d'aménagement du territoire comme une autre. La profession médicale est sous tension démographique, situation qui perdurera jusqu'en 2025 parce que les décisions sur le numerus clausus n'ont pas été prises à temps : il faut entre dix et quinze ans pour former un médecin. Or, dans les années 1990, le numerus clausus était très restreint, à 3 000 ou 4 000 médecins par an, en vertu d'une politique qui visait à réduire le déficit de la sécurité sociale avec l'idée que moins de médecins produiraient moins d'actes... Personne n'a anticipé le vieillissement de la population, l'accroissement des pathologies chroniques, l'évolution du mode d'exercice des médecins qui veulent une meilleure articulation entre temps professionnel et temps personnel - et pas seulement du fait de la féminisation de la profession -, si bien que l'on a réagi trop tard. Aujourd'hui, le numerus clausus a plus que doublé et nous sommes, depuis 2005, à 8 000 médecins par an. La démographie médicale restera donc faible jusqu'en 2025, avant de repartir à la hausse dans des proportions importantes. Nous devons par conséquent faire face à un creux d'une dizaine d'années, et trouver des moyens intelligents pour répondre, durant cette période, aux besoins de santé de la population.
La profession médicale n'est pas une profession comme les autres. Elle tient certes au principe de liberté d'installation, mais là n'est pas l'unique difficulté. Il a existé des tentatives de régulation des professions médicales au Canada, en Allemagne, pays qui a mené, il y a une dizaine d'années, une politique d'installation coercitive telle que vous la proposez. Cela a abouti à réduire l'installation en zones bien dotées, mais sans jouer sur les zones désertifiées, les installations n'ayant augmenté qu'en zones périurbaines : les médecins ont contourné l'obligation, et se sont installés à la périphérie des zones surdotées.
Quel élu considère, aujourd'hui, que son territoire est surdoté et juge qu'il ne faut plus d'installations sur son territoire pour accroître la quantité de médecins dans d'autres territoires ? Lorsque l'on pose la question, peu d'élus lèvent la main, même parmi les élus parisiens, car y compris à Paris, l'accès à certains spécialistes devient difficile. Seules deux ou trois villes en France peuvent ainsi réellement être considérées comme surdotées. Pour le dire autrement, ce n'est pas en déshabillant Nice que l'on va habiller le reste du pays.
Le troisième problème tient au fait que les médecins terminent leurs études à l'âge de trente ans au plus tôt. Un âge où beaucoup ont fait leur vie, ont des enfants, un époux, si bien qu'il est difficile de leur demander de s'arracher au lieu où ils sont installés. Quand un territoire n'est pas attractif pour un médecin, il l'est encore moins pour un époux qui doit chercher du travail... Comment ces médecins réagiraient-ils à un système coercitif ? Il y a fort à parier qu'ils prendraient des postes salariés, qui sont pléthore puisque nous manquons de milliers de médecins du travail, de médecins scolaires mais aussi de médecins dans l'industrie. Sans compter qu'un quart des diplômés, faut-il le rappeler, n'exercent pas la médecine au sortir de leurs études et trouvent d'autres orientations.
La profession a donc des spécificités qui ne sont pas celles de la profession d'infirmière, pour laquelle des mesures coercitives ont pu être prises parce que c'était une profession surdotée. On forme énormément d'infirmières et elles terminent leurs études à 21 ou 22 ans, un âge où l'on peut encore orienter le lieu d'installation.
Nous avons, avec le Premier ministre, présenté un plan le 13 octobre, qui vise à changer de paradigme. Pas plus qu'à la coercition je ne crois à l'incitation, qui provoque des effets d'aubaine, comme on l'a vu pour beaucoup de professionnels formés à l'étranger, et n'a pas montré grande efficacité. Nous considérons que la solution passe plutôt par l'organisation des soins. Un médecin peut donner du temps médical sur un territoire sans pour autant y vivre. C'est ainsi que nous envisageons d'exporter du temps médical sur certains territoires. Nous entendons mettre en place de fortes incitations pour que les médecins installés autour d'un bassin de vie sous-doté aillent y donner de leur temps.
Notre deuxième orientation consiste à favoriser les coopérations interprofessionnelles pour couvrir un territoire sous-doté. Beaucoup de pathologies, notamment chroniques, pourraient bénéficier d'un suivi partagé avec d'autres professionnels de santé. Des infirmières pourraient ainsi se voir déléguer certaines tâches, comme cela se pratique dans les maisons pluriprofessionnelles, pour le suivi de diabètes, par exemple, ou de traitements anticoagulants qui ne nécessitent pas forcément une consultation médicale.
Troisième orientation : libérer la télémédecine pour raccourcir les délais de consultation, en dermatologie, par exemple. La téléconsultation et la télé-expertise entreraient ainsi dans le droit commun. Une négociation conventionnelle avec les médecins libéraux est en cours pour fixer un tarif, qui permettra une mise en oeuvre dès la rentrée 2018.
Ne pas penser en termes d'installation mais de temps médical donné aux territoires ; voir dans le temps médical un temps donné par les professionnels de santé, selon une organisation pluriprofessionnelle - ce qui passe par le développement des maisons de santé - ; permettre à des médecins un cumul emploi-retraite, dont le projet de loi de financement de la sécurité sociale a quadruplé les possibilités : tel est le changement de paradigme que nous proposons. Le plan d'accès aux soins comprend 25 mesures incitatives à cette fin, qui permettront de mettre en place ces organisations innovantes.
Enfin, nous pensons que tous les territoires doivent se mobiliser. Nous avons demandé aux agences régionales de santé (ARS) d'organiser avec leurs délégués territoriaux, les élus de chaque territoire, les unions régionales des professionnels de santé (URPS) et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), qui rassemblent les professionnels, de travailler à des réponses opérationnelles appropriées à chaque territoire. Car chaque territoire a ses spécificités. Les besoins d'un territoire rural très isolé ne sont pas les mêmes qu'en zone périurbaine, où le frein à l'installation peut tenir à l'insécurité. Les mêmes différences se retrouvent dans l'offre de soins, certains territoires comptant beaucoup de médecins libéraux et peu d'offre hospitalière quand la situation est inverse dans d'autres. C'est pourquoi nous proposons, dans le plan d'égal accès au soin, de mettre en place des postes d'assistant partagé, pour que les médecins hospitaliers aillent donner du temps médical dans les territoires sous-dotés, et de promouvoir les stages en médecine libérale, assortis d'une aide, afin que les externes et les internes s'approprient l'intérêt de la médecine libérale de premier recours.

Notre commission n'a jamais prôné la coercition mais la régulation. Il ne s'agit pas d'obliger un médecin à s'installer quelque part mais, comme cela existe pour nombre de professions de santé, de prévoir un certain nombre de mesures pour faire en sorte que les médecins s'installent plutôt dans certaines zones que dans d'autres.
J'ai été très étonné de vous entendre déclarer, comme vous l'avez fait dans l'hémicycle, que les zones surdotées n'existent pas. Ce n'est pas une notion que nous avons inventée : elle est reconnue par les ARS. On sait fort bien que dans certaines zones géographiques, on peut avoir un rendez-vous du jour au lendemain quand il faut, ailleurs, attendre des mois.
Je ne puis vous suivre lorsque vous dites que le problème tient au nombre de médecins. Je crois qu'il tient plutôt à leur répartition. Vous rappelez le principe de liberté d'installation ? En Allemagne, où ce principe est inscrit dans la Constitution, la Cour constitutionnelle n'en a pas moins considéré que l'intérêt général l'emportait sur ce principe. Il serait temps que la profession médicale en juge de même.

Dans la réflexion sur l'aménagement du territoire, il est vrai que la question de l'accès aux soins a une coloration toute particulière. Nous entendons beaucoup parler, depuis de nombreuses années, de démocratie sanitaire. Les élus locaux, que notre assemblée représente, ont pris toute leur part à ce débat, pour tenter de répondre à la demande de nos concitoyens. L'opinion publique a beaucoup évolué : comme pour la météo, il faut aussi prendre en compte la température ressentie. Vous aurez beau dire que le nombre de médecins est suffisant sur tel territoire, si ses habitants ont le sentiment d'être laissés pour compte, cela n'y changera rien. J'appartiens à un département, le Pas-de-Calais, qui, avec 1,4 million d'habitants, est dépourvu de centre hospitalier universitaire (CHU) et voit des centres hospitaliers publics contraints de fermer certains services, et non des moindres. C'est le cas du service de cardiologie du centre hospitalier de Beuvry, ou du service de pneumologie du centre hospitalier de Lens. Tout cela parce que les médecins spécialistes n'en peuvent plus d'exercer dans ces conditions. Alors que la médecine de ville est défaillante, la population de la région a conservé le souvenir du régime minier, qui irriguait l'ensemble du territoire de médecins salariés, et se sent orpheline de ce dispositif. Je lance un cri d'alerte. Dans les arrondissements de Lens et de Béthune, qui, avec plus de 650 000 habitants, sont plus peuplés à eux deux qu'un tiers des départements français, les élus des trois agglomérations principales ont pris leurs responsabilités pour constituer un pôle métropolitain. J'aimerais que la directrice de l'ARS vienne expliquer comment elle peut répondre aux attentes de la population dans le cadre de ce pôle.

Je viens d'une zone sous-dotée des Pyrénées, où les problèmes sont analogues. Lors de l'inauguration de l'IRM de l'hôpital de Saint-Gaudens, sous-préfecture du département, le professeur Lareng, l'un des pères du Samu, a quitté son fauteuil roulant pour monter à la tribune et clamer, en brandissant un poing rageur : « Des soins égaux pour tous ! » En dépit des alertes, la situation sur le terrain continue de se dégrader, l'accès aux soins recule et nous sommes à l'aube d'une catastrophe sanitaire.
La présence et la disponibilité des médecins généralistes sont la première condition de l'accès aux soins. Saint-Gaudens comptait 26 généralistes en 2010, ils ne sont plus que 16 aujourd'hui, dont il ne restera que 8 en 2020. Ceux qui exercent sont dans une situation déplorable et peuvent être amenés à faire plus de 60 actes par jour.
Nous comprenons que vous souhaitiez éviter le conflit avec les syndicats de médecins et que la coercition soit pour vous une ligne rouge, mais à force de céder sans cesse au corporatisme médical et de reculer devant les décisions difficiles, les déserts médicaux gagnent de plus en plus de terrain.
Parmi les mesures que vous proposez, la plus effective me semble être le doublement des maisons de santé. Nous ne doutons pas de votre volonté de les voir harmonieusement réparties sur le territoire, et bien dotées en médecins, mais n'est-ce pas là un premier pas vers une régulation dont vous ne voulez pas entendre parler ? L'ordre, les syndicats, la profession reconnaissent leur échec en matière de couverture du territoire. N'est-ce pas au législateur à prendre ses responsabilités, qui seront engagées en cas de crise sanitaire ? Comptez-vous faire passer l'intérêt des médecins devant celui de la population ? Ne pensez-vous pas qu'au-delà de l'augmentation du numerus clausus, il serait grand temps d'isoler une filière de généralistes dès la première année, avec des critères de sélection plus pragmatiques que les fameux QCM, comme le fait la Roumanie, où les stages de terrain sont nombreux et font fleurir des vocations ? Pourquoi, enfin, ne pas reconnaître le succès de certaines expériences de régulation, comme celle des pharmacies ?

Je rejoins les propos de notre président. Nous avons mission, comme sénateurs, de défendre nos territoires. L'installation des médecins ne relève pas, à mon sens, du seul ministère de la santé, mais aussi du ministère des territoires.
Alors que je présentai, en séance, un amendement qui n'avait rien de coercitif, vous m'avez répondu que vous ne saviez pas ce qu'était un secteur sous-doté ! Allez donc le demander aux ARS, madame la ministre, elles vous en montreront la cartographie. Comment comprendre que l'on accepte que de jeunes médecins s'installent dans des secteurs surdotés alors qu'ils sont conventionnés ? Il ne s'agit pas de les forcer à s'installer quelque part, mais seulement de les empêcher de s'installer en secteur surdoté. Il n'est pas question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de déshabiller ces secteurs. Dans l'amendement que j'évoque, il était prévu qu'il ne puisse y avoir d'installation qu'en remplacement d'un médecin sur le départ : un pour un. Je crois que vous commettez une erreur, et suscitez, chez nos concitoyens, le sentiment que ce sont les médecins qui décident.

N'opposons pas les territoires. Comme vient de le rappeler M. Vaspart, nous n'avons jamais proposé d'interdire l'installation dans les zones surdotées, mais de ne remplacer que sur la base de un pour un.
L'augmentation du numerus clausus n'aura d'effets que dans quinze ans. Sans compter que 25 % des étudiants en médecine ne vont pas jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans certains territoires, les habitants ne bénéficient d'aucun soin, parce qu'ils n'ont pas de médecin. Comme l'a dit Pierre Médevielle, les officines de pharmacie ont fait l'objet d'une régulation, si bien que la desserte est correcte. Tel n'est pas le cas de la médecine libérale, où la désertification peut se trouver amplifiée, de surcroit, par des particularités locales. A Pontarlier, dans le Haut-Doubs, les élus font ce qu'ils peuvent, mais nous sommes frontaliers de la Suisse, où des chasseurs de tête s'emploient à attirer chez eux les médecins : nous sommes doublement pénalisés. Il faut traiter le problème. Les parlementaires que nous sommes doivent engager des mesures pour un aménagement du territoire cohérent, qui réponde au mieux à l'attente de nos concitoyens.

Sans ajouter à ce tour de France des pleurs et des grincements de dents, je veux faire entendre la voix normande de l'élu cherbourgeois que je suis. Et je suis préoccupé, même si quelque optimisme me revient à constater que depuis ces deux derniers jours, un certain nombre de lignes semblent bouger. Le relèvement du numerus clausus, même si ses effets mettront du temps à se faire sentir, est un signe fort, qui s'inscrit dans une réflexion sans tabou sur les études supérieures de médecine. Certes, le numerus clausus était tombé à 3 500 en 1993, mais il était auparavant, en 1977, de 8 700. Le rattrapage ne s'est donc pas opéré, alors que la population a cru de 22 %. Au point que 1 500 médecins diplômés hors de France viennent exercer dans notre pays - parfois même des Français qui ont ainsi contourné la difficulté d'accès en deuxième année de médecine. Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, que cette réflexion sans tabou annoncée par le Premier ministre va bien s'engager ?
Ma deuxième préoccupation concerne la révision annoncée de la tarification à l'activité. Alors que le déficit des hôpitaux publics avoisine 1,5 milliard et que certains hôpitaux, comme celui de Cherbourg, en sont à ne plus pouvoir honorer leurs charges sociales, prévoyez-vous un plan d'accompagnement en attendant cette révision ?

Je suis élue de la Nièvre, où les patients en situation d'urgence risquent désormais leur vie. C'est dire combien l'alarme est forte. Le président de l'Ordre national des médecins, durant la campagne présidentielle, avait dit : « il faut former les médecins dont nous avons besoin dans les territoires, et non les internes dont les centres hospitaliers ont besoin. » Je rejoins ce que disait mon collègue sur les études de médecine. Il me semble que comme dans toutes les formations d'excellence, les jeunes des milieux urbains sont favorisés par rapport aux jeunes ruraux qui, pour des raisons souvent matérielles, en viennent même à s'autocensurer et ne passent pas les concours. Il serait intéressant de savoir combien d'urbains et de ruraux réussissent respectivement le concours. Comment, chez des jeunes qui ont toutes leurs attaches en ville, naîtrait soudain une vocation pour aller exercer la médecine générale au fin fond de la Nièvre ? Telle est la question que je me pose. Si mon soupçon se confirme, j'estime qu'il faudrait donner plus de facilités aux jeunes ruraux, via des formations de proximité ou une régionalisation du numerus clausus, pour rendre leurs chances à ces jeunes, attachés à leur territoire.

Le désert médical avance, et j'en veux pour preuve le cas d'un territoire très rural, le Lot. Les faits sont têtus, madame la ministre, et j'attire à nouveau votre attention sur le courrier que vous a adressé la commune de Cressensac, dont les deux médecins partent cette année à la retraite sans avoir trouvé de successeur. Les médecins qui exercent à proximité, déjà surchargés, ne pourront suivre leurs patients. La commune manquera, compte tenu du fait que les jeunes médecins ont de nouvelles exigences horaires, de trois ou quatre médecins.
La commune a beaucoup investi - école, crèche, médiathèque - pour attirer de nouveaux couples ; elle s'est dotée d'une maison de santé pluridisciplinaire. Qu'adviendra-t-il de cette commune et des habitants des 27 communes environnantes qui y étaient suivis ? L'effort de relocalisation engagé, qui était couronné de succès, va connaître un coup d'arrêt. Les pouvoirs publics doivent imposer une logique de solidarité collective aux médecins. C'est la seule sortie de crise possible. Il y faut du courage.
Je veux aussi évoquer la formation. Quel pourcentage d'enfants d'ouvriers, d'agriculteurs, retrouve-t-on parmi les médecins ? C'est un chiffre qu'il serait intéressant de connaître. Je pense que ce pourcentage est en recul, ce qui pose, ensuite, des problèmes d'installation, car s'ils étaient issus des territoires, les jeunes médecins y retourneraient plus volontiers.
Une remarque, pour finir. J'ai été professeur toute ma vie. Les professeurs sont nommés sur un poste, et heureusement, car il n'y en aurait pas partout s'il en était autrement. Sans compter que les mesures incitatives sont très onéreuses.

Il serait en effet intéressant de disposer de chiffres sur les origines socio-professionnelles et géographiques des médecins. Je pense, en effet, que là aussi, les inégalités se creusent.

On voit bien qu'il n'existe pas de solution miracle, et qu'il faut s'orienter vers un mix médical. Vous dites, madame la ministre, que pour garantir un égal accès aux soins dans les territoires, vous tablez, notamment, sur la généralisation de la téléconsultation et de la télé-expertise. Mais ce matin, M. Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires, nous a rappelé les engagements du gouvernement pour réduire la fracture numérique, qui recouvre malheureusement bien souvent d'autres fractures territoriales. Parmi ces quatre priorités, j'ai retenu la deuxième, qui consiste à mettre en oeuvre la révolution numérique en santé pour abolir les distances. Mais cela suppose que tous les territoires puissent accéder à la télémédecine. Travaillez-vous avec les ministères en charge de ces dossiers, et comment ?
Si les travaux engagés sur la télémédecine pour les patients résidant en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) se poursuivent, a-t-on chiffré le coût de l'équipement de tous ces établissements d'ici à 2020, comme cela est l'objectif ? Reste aussi le problème des personnes âgées maintenues à domicile, qui n'auront pas accès à ce dispositif. Quelle forme pourrait prendre une assistance à leur bénéfice ? Cela suppose des compétences des intervenants, souvent salariés d'associations, qui devront être formés. Est-il envisagé de travailler avec les CCAS, les centres communaux d'action sociale ? Quelles sont, en bref, vos orientations en faveur de l'accès à l'outil numérique des personnes âgées, souvent isolées et qui risquent d'être victimes d'une sorte de double peine.

J'apprécie, monsieur le président, vos propos énergiques sur la régulation et l'intérêt général.
Les maisons de santé, madame la ministre, sont un instrument de régulation nécessaire. Or, elles ne font pas l'objet d'une véritable planification. Seuls les territoires les plus innovants se lancent dans de tels projets qui, lorsqu'ils sont bien échafaudés, joue un rôle de pôle d'attraction pour les professionnels les plus dynamiques d'un secteur. Cette concurrence devrait être mieux régulée, peut-être dans le cadre des schémas départementaux d'accessibilité aux services, ou par les ARS. J'ai vu, dans mon département, échouer de beaux projets parce que certains professionnels n'avaient pas envie de bouger.
Les transferts opérés en quelques années de l'État vers les collectivités locales en matière de politique de santé suscitent de réelles difficultés, qui conduisent également à poser la question de l'appui en ingénierie que peut leur apporter l'ARS.
La crise récente des Ehpad a rappelé qu'un des problèmes montants du XXIème siècle était le grand âge. Les déserts médicaux cumulent bien autres handicaps - le numérique, la mobilité, les services à la population. Ne serait-il pas bon d'établir un plan plus offensif encore au profit de ces zones éloignées des aires métropolitaines, pour permettre à nos aînés de choisir leur lieu de fin de vie ?

Dans la presse du jour, vous faites état, madame la ministre, d'une souffrance généralisée dans le monde hospitalier. De fait, dans mon département, au centre hospitalier de Laval, la situation est, comme dans beaucoup d'établissements, très tendue, les déficits importants, et beaucoup d'agents sont moralement et physiquement épuisés. C'est le cas au service des urgences, très sollicité dans un département classé parmi les déserts médicaux. Comment allez-vous investir davantage dans les hôpitaux alors que vous annoncez une baisse des tarifs de rémunération ?
J'entends bien votre raisonnement qui veut qu'en matière de démographie médicale, nous traversions une période de transition qui prendra fin en 2025, et je veux bien croire que la coercition, selon la manière dont on l'entend, ne soit pas la solution miracle, mais entendez, de votre côté, que comme celle de l'accès à la téléphonie mobile, la question de l'accès aux soins préoccupe au plus haut point les élus locaux et les habitants. Il convient donc de trouver des mesures très concrètes, avec des incitations fortes, car il y a urgence.
Quel message, enfin, pouvez-vous apporter aux personnels des Ehpad, à la suite des mouvements de contestation qui s'y sont manifestés ?

La Seine-Maritime, dont je viens, connait aussi des problèmes de désertification, tant en milieu rural qu'en banlieue.
Dans l'augmentation annoncée du numerus clausus, prenez-vous en compte la féminisation de la profession, qui est une bonne chose, mais avec ce corollaire qu'un plus grand nombre d'entre elles n'exercent pas ou exercent à mi-temps ?
J'ajoute qu'un certain nombre de jeunes Français qui souhaitent s'engager dans la profession ne le peuvent pas, du fait du numerus clausus, et en viennent à faire leurs études en Roumanie ou en Belgique. Or, il semblerait qu'il leur soit plus difficile de revenir exercer en France que ce ne l'est de s'y installer pour les étudiants originaires de ces pays, qui ont pourtant fait le même parcours. Comment l'expliquer ?

Les maisons de santé motivent beaucoup d'élus. Il y faut des bâtiments, pour lesquels les collectivités et intercommunalités font des efforts financiers importants - c'est ainsi que le conseil régional Rhônes-Alpes-Auvergne a mis en place une aide de près de 200 000 euros dans les contrats de ruralité pour les collectivités qui s'engagent dans cette voie - mais il y faut aussi des professionnels de santé. Or, bien souvent, les collectivités commencent par mettre en place un bâtiment, qu'elles ont ensuite du mal à peupler. Parmi les solutions à ce problème, vous évoquez la possibilité d'un partage d'activités entre le secteur hospitalier et la médecine libérale. Avez-vous prévu des mesures incitatives, pour qu'une telle solution profite aux petites communes menacées de désertification ?

Je ne suis pas persuadée que la coercition soit une étape indispensable. Au terme de leur sixième année d'études, les étudiants, s'ils ne sont pas encore docteurs en médecine, sont bel et bien médecins, et appelés à exercer comme internes. Or, cet internat reste hospitalo-centré, le plus souvent sur des CHU, et font tourner la médecine hospitalière de notre pays. De fait, ils travaillent, et énormément, cinq ans durant, à l'hôpital. Ne pourrait-on prévoir des stages qui les fassent sortir des hôpitaux, pour les mettre sur des territoires mal dotés, qui ont leurs attraits et où ils peuvent être accueillis par des maîtres de stage compétents ? Ne serait-il pas bon d'inciter à l'accueil de ces jeunes médecins, et de doter ces territoires de maisons de santé pluriprofessionnelles accueillantes - car l'exercice isolé n'est plus la règle aujourd'hui, en médecine, et d'autant moins que tous les médecins aspirent à un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ?
On ne règlera pas les problèmes avec les solutions d'hier. Je crois beaucoup en l'innovation, y compris en la télémédecine, qu'il est bon de faire entrer dans le droit commun mais sans oublier de lever tous les freins. Or, j'ai le sentiment que l'on remet le pied sur le frein, tant les actes en télésanté sont cadrés : patients en affection de longue durée, mais pas tous, sur certains territoires mais pas tous, sur certains aspects mais pas tous. Ne faudrait-il pas lâcher un peu de lest ?

Entre coercition et régulation, ne pourrait-on innover en mettant en place des postes de médecins salariés ? Un exemple : les maisons de santé ont du mal à démarrer faute de trouver des médecins désireux de s'y installer. Si certaines de ces structures pouvaient proposer des postes salariés à des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'installer ou à des médecins en fin de carrière qui souhaitent s'alléger de l'administratif pour se consacrer au soin, cela ouvrirait un espace.

Vous avez évoqué l'idée, madame la ministre, que des médecins hospitaliers puissent exercer, une partie de leur temps, dans les campagnes. Je m'interroge sur cette proposition. En Vendée, à l'hôpital de Challans, les urgences, prévues pour 12 000 accueils sont saturées, avec plus de 18 000 accueils en raison, essentiellement, du manque de médecins traitants dans le secteur proche, qui voit, de surcroît, sa population multipliée par trois ou quatre en période estivale. Si bien que cet hôpital, comme d'autres, doit faire appel à des médecins de garde, à des coûts exorbitants, qui pèsent lourdement sur les budgets. Comment envisager d'extraire les médecins hospitaliers de l'hôpital quand, à l'inverse, ce sont des médecins extérieurs qu'il faut recruter, à grands frais, pour faire face ?

Madame la ministre, vous aurez constaté que tous nos collègues, sauf une - mais elle vient de la commission des affaires sociales ! - ont fait part de leur conviction qu'il fallait changer de logique et favoriser non pas la coercition, mais la régulation des installations.
Je suis convaincu que nous y viendrons, parce que la situation actuelle est facteur de drames sanitaires. Un jour, une chaîne comme TF1 se penchera sur ses conséquences et le Gouvernement se dira alors qu'il est temps de changer de braquet. N'attendons pas d'en arriver là pour prendre la mesure du problème !
Madame la ministre, je sais que nous n'allons pas vous convaincre, mais j'attends que vous répondiez à cette question : quand allez-vous dresser le bilan des mesures que vous avez prises et à quelle échéance en attendez-vous des effets positifs ? Deux, trois, quatre, cinq ans ? Si - ce que je ne souhaite pas ! - de tels effets ne se produisaient pas, considérerez-vous enfin qu'il sera temps d'adopter une autre logique ?
Nous partageons le constat qui a été fait. Je suis en poste depuis huit mois, et ma priorité a été de réfléchir à un plan d'accès aux soins. J'ai travaillé d'arrache-pied avec mes services pour identifier les mesures favorisant un changement de paradigme et une libération des énergies afin que le terrain s'organise.
Monsieur le président, j'ai l'habitude de rendre des comptes, je l'ai fait dans mes fonctions précédentes, en particulier au sujet du plan Cancer. Le plan que j'ai présenté comporte des indicateurs chiffrés qui sont encore en cours de conception par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DREES. Ceux-ci s'attachent, par exemple, au temps d'accès, à la proportion de médecins, au nombre de transferts aux urgences, etc. Ils seront publiés dès que ce travail aura abouti.
J'ai mis en place un comité de pilotage stratégique de ce plan qui réunit les syndicats médicaux, les fédérations hospitalières, car certains hôpitaux ont la capacité de projeter un médecin dans un territoire pour donner du temps médical, l'ensemble des ordres des professions de santé, y compris ceux des kinésithérapeutes, des infirmières ou des sages-femmes. En effet, on ne peut pas se contenter de mettre l'accent sur les seuls médecins, tous les pays modernes se sont organisés de façon pluriprofessionnelle. Une infirmière peut ainsi assurer le suivi d'une hypertension artérielle en rencontrant le médecin dans une maison de santé sans que celui-ci ne prenne la tension. Les élus y sont également représentés par l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France et l'association France urbaine, l'association Régions de France et l'Assemblée des départements de France.
En outre, nous avons lancé trois délégués territoriaux - une sénatrice, Élisabeth Doisneau, un député, Thomas Mesnier, et une jeune médecin généraliste, Sophie Augros, ancienne présidente de syndicat - dont le rôle est de suivre les initiatives de terrain permettant de répondre aux besoins. Partout, des initiatives diverses sont mises en oeuvre, comme à Pontarlier, par exemple, où la mairie a monté un cabinet éphémère qui a débouché sur l'installation pérenne d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Ailleurs, une maison de santé attachée à un hôpital permet aux médecins de partager leur temps entre exercices libéral et salarié. Le plan doit faciliter tous les modes d'exercice, comme l'ouverture de plusieurs cabinets, afin que les médecins puissent exercer en différents endroits en fonction des jours.
J'ai dit aux professionnels que j'allais libérer la réglementation qui freine les organisations innovantes. L'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale prévoit d'ailleurs des expérimentations financées par la sécurité sociale.
Je rendrai des comptes publiquement sur toutes ces mesures.
Réguler l'installation alors que la profession est aujourd'hui sous-dotée ne fonctionnera pas. Nous devons faire avec une démographie faiblissante jusqu'en 2025, conséquence de décisions prises en 1995. Nous n'allons pas inventer 25 000 médecins supplémentaires, nous devons donc chercher des organisations innovantes.
Beaucoup d'entre vous ont évoqué la question de la formation, et, par extension, du numerus clausus. L'effet d'une éventuelle ouverture serait en tout état de cause différé. Or je ne sais pas ce que seront les besoins en 2030, avec les progrès de l'intelligence artificielle et de la lecture informatisée d'images, qui vont entraîner une modification considérable des pratiques. Avant de toucher au numerus clausus, nous avons besoin d'un bilan prospectif. Toutes les lectures d'images vont être informatisées. Je ne veux pas prendre, à mon tour, de mauvaises décisions qui pèseront sur la France de 2035.
Sur ce point, le sujet touche aussi aux modes de sélection et donc à la définition des médecins que nous souhaitons former. Faut-il sélectionner sur les mathématiques et la physique ? Faut-il introduire plus de sciences humaines ? Les études de médecine ne sont pas adaptées aux pathologies chroniques, à l'exercice coordonné pluriprofessionnel. De même, nous avons prévu de multiplier les stages, en particulier en zones rurales.
J'ai présenté hier, avec le Premier ministre, un plan global de transformation de notre système de santé. Il comprendra une loi, en 2019, relative à l'ensemble des études médicales. Aujourd'hui, par exemple, un étudiant qui obtient zéro à l'examen national classant de fin d'études obtiendra un poste d'interne. Reconnaissons que ce n'est pas très sécurisant... Je n'ai pas encore annoncé que j'allais ouvrir le numerus clausus, la concertation commence à ce sujet, et nous devons nous projeter vers 2030 ou 2035.
Beaucoup ont évoqué les maisons de santé pluriprofessionnelle, qui sont l'avenir de la médecine, ainsi que les centres de santé accueillant des médecins salariés. Demain, les médecins n'exerceront plus seuls et devront se coordonner, face aux pathologies chroniques et au vieillissement des patients.
L'expérience montre toutefois que ce type d'organisation ne fonctionne que s'il est porté par un leader médical. Il faut donc parvenir à inciter un médecin à jouer ce rôle. Pour permettre cela, nous comptons augmenter considérablement le nombre de stages des internes, mais aussi de jeunes médecins généralistes et des externes, en zone rurale, dans les maisons de santé pluriprofessionnelle, afin de susciter leur intérêt. Nous allons également travailler avec les jeunes médecins pour les inciter à porter des projets coopératifs. Un budget de près de 400 millions d'euros est prévu dans le grand plan d'investissement à ce titre, mais rien ne pourra se faire sans un projet médical.
Nous avons demandé aux ARS d'identifier, avec les élus, les territoires en tension et de travailler avec les doyens pour pousser les jeunes médecins à s'y installer. Aujourd'hui, en effet, l'âge d'installation recule, les jeunes étant rebutés par l'ampleur des tâches administratives. Nous avons donc lancé une mission de simplification.
S'agissant de l'hôpital, il subit le rabot depuis des années. Il pâtit de la tarification à l'acte, qui n'est pas valorisante pour les équipes, pour lesquelles elle apparaît comme une perte de sens de leur mission. Nous allons diminuer de 50 % sa part dans le financement des hôpitaux, ce qui signifie qu'il faudra trouver ailleurs 50 % du budget.
Il faut ainsi passer à une tarification au forfait, en particulier en matière de soins ambulatoires. Aujourd'hui, ceux-ci font perdre de l'argent aux hôpitaux, alors que tout le monde devrait y gagner. L'hôpital doit s'insérer dans les bassins de vie, ce que ne favorisent pas les modes de financement actuels en silo.
Nous allons donc favoriser les tarifications au parcours, qui intéresseront l'ensemble de professionnels de santé et concerneront la médecine de ville comme l'hôpital ou, éventuellement, le secteur médico-social. Ces réformes seront menées en lien avec l'assurance maladie, puisqu'elles toucheront à la rémunération des médecins libéraux. Il s'agit de favoriser la coopération et les interactions.
Monsieur Mandelli, vous avez évoqué le coût des intérimaires à l'hôpital, qui concerne en particulier les anesthésistes et des urgentistes. J'ai signé un décret pour plafonner les rémunérations afin de mettre un terme à la pratique de ces médecins mercenaires, qui est coûteuse et délétère pour les équipes.
Vous me soupçonnez de manquer de courage face aux syndicats, mais je ne cherche pourtant pas à les défendre. Je n'ai qu'un devoir : répondre aux enjeux et aux besoins des citoyens. J'ai à l'esprit le risque de crise sanitaire et je souhaite lui apporter des réponses du vingt et unième siècle en modifiant l'exercice médical pour que, demain, on fasse plus de prévention et que les professionnels de santé choisissent la coopération plutôt que la compétition. Je ne manque pas de courage, je crois l'avoir prouvé, et ce plan global de transformation de notre système de santé ne vise en aucune manière à protéger une profession.
Mme Nadia Sollogoub suggérait la création de PACES (premières années communes aux études de santé) de proximité. Cela a déjà été fait, par exemple au Havre ou à Corte, pour la Corse. L'objectif est de faciliter l'accès aux études médicales pour les habitants des zones rurales. De même, le numerus clausus pourrait être adapté en fonction des facultés et des territoires. Sur ces sujets, sur la réforme à venir des études de médecine, nous commençons les négociations avec, entre autres, les syndicats de jeunes médecins et d'étudiants.
Pour récapituler, dans le cadre du plan global de transformation de notre système de santé nous lançons une concertation sur cinq grands chantiers.
Le premier concerne la qualité et la pertinence des soins, le second, la tarification de l'hôpital et de la médecine de ville.
Le troisième chantier est le numérique. La « e-santé » requiert, en effet, un bon équipement du territoire. Mon collègue Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, est particulièrement sensibilisé à cette question. Chaque Ehpad peut déjà bénéficier de 30 000 euros pour s'équiper en télémédecine, mais l'efficacité de cet investissement repose sur la qualité du réseau dans les territoires.
Les ressources humaines constituent le quatrième chantier. Il s'agit, d'une part, de modifier les études médicales par une loi en 2019, et, d'autre part, d'améliorer la gestion des ressources humaines à l'hôpital. La concertation dans ce domaine se terminera fin mai.
Enfin, le cinquième chantier consiste à organiser les territoires en filières de soins, plutôt que d'assister à la compétition des établissements entre eux. Il s'agit également de proposer une gradation des soins : nous ne ferons pas tout partout, il faut l'assumer. La médecine de premier recours se fera là où elle est nécessaire, mais les soins d'excellence et les plateaux techniques de haute technicité se trouveront ailleurs. Ce qui compte, c'est la coopération entre les établissements, que la tarification à l'acte ne permet pas. Le plan sera donc proposé cet été, probablement par le Président de la République.
Je crois avoir maintenant répondu à toutes vos questions.
Cela varie en fonction des mesures. Certains décrets ont été pris en janvier, mais deux ou trois mesures nécessitent des modifications législatives pour lesquelles j'espère trouver un vecteur avant l'été.
J'ai demandé aux ARS, que je rencontre chaque mois, de prendre en main en priorité le premier chantier. Elles ont établi une feuille de route indiquant leur stratégie pour associer les élus et les professions de santé afin d'animer une réflexion sur les bassins de vie en tension. J'attends leurs remontées dans le cadre du comité de suivi. De même, nos trois délégués territoriaux sont particulièrement mobilisés. Nous rendrons compte, indicateur par indicateur, du déploiement du plan.
Nous souhaitons mettre en place des assistants partagés entre l'hôpital et les cabinets en ville, sur deux mi-temps. Aujourd'hui, les chefs de clinique sont purement hospitaliers et ces postes n'existent donc pas. Nous souhaitons en créer deux cents cette année, mais il nous faut pour cela un vecteur législatif.
En revanche, les mesures permettant, par exemple, aux médecins retraités d'exercer en étant exonérés de charges ont déjà fait l'objet de décrets.

Pouvez-vous nous dire que la situation s'améliorera dans deux ou trois ans ?
Je ne sais comment répondre à cette question, qui me semble un peu sarcastique !

Elle ne l'est absolument pas. Quand sentirons-nous les effets positifs de votre plan ? Quand sera-t-il plus facile d'obtenir un rendez-vous médical ? J'ai posé ce matin la même question à votre collègue, M. Denormandie, au sujet de la couverture du réseau de téléphonie mobile.
Ce n'est pas la même chose de signer un accord avec trois opérateurs de téléphonie mobile ou avec 8 000 médecins qui sortent chaque année du cursus et plusieurs milliers de communes ! J'espère constater des progrès dès la prochaine réunion du comité de suivi, j'en rendrais compte et je souhaite que tous les indicateurs connaissent une évolution favorable.
Je ne peux toutefois pas m'engager aujourd'hui pour l'ensemble des territoires français, qui connaîtront sans doute des dynamiques différentes. J'espère pouvoir vous apporter des données chiffrées tous les six mois pour illustrer l'évolution de ce plan.
Il reste à évoquer un point sur les Ehpad, dont les difficultés, que nous connaissons, ont été aggravées par un changement de tarification. Beaucoup d'argent a été consacré par l'État à la partie « soins », reste désormais la partie « dépendance », laquelle repose sur les départements. Cela pose problème, même si les situations sont très diverses.
Je souhaite ouvrir l'immense chantier de la dépendance dans les mois qui viennent. Nous savons qu'il s'agit du défi des cinquante prochaines années. En 2050, en effet, plus de 5 millions de Français seront âgés de plus de 85 ans !

Merci madame la ministre. La réforme des études de médecine nous semble être une avancée très positive, de même que la progression dans la délégation d'actes. Vous le voyez, nous ne sommes pas hostiles par principe à votre politique, nous craignons seulement qu'elle ne soit pas suffisante.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Au titre des questions diverses, je voudrais vous faire un bref compte rendu de la dernière réunion du bureau de la commission, mercredi dernier.
Nous avons évoqué d'abord le déplacement de la commission à l'étranger. Au vu de l'actualité qui sera celle de notre commission cette année, les membres du bureau ont estimé qu'il serait plus intéressant de se déplacer au Japon qu'en Inde, destination initialement arrêtée.
Une délégation de notre commission se rendra donc en Inde, entre le 9 et le 15 septembre prochains, pour étudier les politiques publiques mises en oeuvre notamment en matière de sûreté nucléaire, de mobilités et de développement numérique. En application d'une répartition proportionnelle sur les 3 ans à venir, cette délégation sera constituée, outre votre serviteur, de deux membres du groupe Les Républicains, un membre du groupe Socialiste et Républicain, un membre du groupe de l'Union centriste et un membre du Rassemblement démocratique et social européen. J'ai reçu les candidatures :
Pour le groupe Les Républicains, de MM. Cornu et Chaize ; pour le groupe socialiste et républicain, de M. Olivier Jacquin ; pour le groupe de l'Union centriste, de Mme Michèle Vullien, pour le groupe du RDSE, de M. Éric Gold.
S'agissant des déplacements de la commission, nous avons entériné un déplacement à la RATP, jeudi 15 mars, pour lequel vous avez reçu une invitation ; un déplacement à Marcoule, à l'invitation de notre collègue Pascale Bories, sur le site du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), sur le thème de la gestion des déchets radioactifs, le lundi 16 avril ; un déplacement sur le thème du véhicule autonome à Rouen, autour du projet d'expérimentation du véhicule autonome qui doit commencer au printemps.
Le Bureau a également autorisé la reconstitution du groupe de travail relatif aux négociations internationales sur le climat et l'environnement, sous la présidence de Jérôme Bignon, en proposant d'élargir son champ d'étude au contrôle de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable.
Le Bureau a proposé par ailleurs la tenue de deux tables rondes : l'une sur l'eau, en lien avec les Assises de l'eau, et l'autre sur la sûreté nucléaire.
S'agissant du programme de contrôle, je rappelle que deux groupes sont d'ores et déjà constitués : le groupe de travail commun avec la commission des lois sur la sécurité routière, qui a tenu sa réunion constitutive jeudi dernier, et le groupe de travail sur la politique européenne de cohésion, avec les commissions des finances et des affaires européennes.
Le bureau a proposé la création de trois groupes de travail internes à la commission.
Un groupe de travail « flash » sur la qualité de l'air, en lien avec l'ouverture de procédures contre la France par la Commission européenne, et l'injonction faite par le Conseil d'État au Gouvernement d'élaborer et de mettre en oeuvre d'ici au 31 mars 2018 les plans relatifs à la qualité de l'air : sur ce sujet, nous aurions un président appartenant au groupe socialiste et républicain et un vice-président du groupe Les Républicains ; j'ai reçu les candidatures de Mme Nelly Tocqueville et de M. Cyril Pellevat, qui seront respectivement présidente et vice-président.
Un groupe de travail sur le véhicule « propre », avec un président issu du groupe Les Républicains et un vice-président issu du groupe La République en marche : j'ai reçu les candidatures de MM. Gérard Cornu et Frédéric Marchand, qui seront respectivement président et vice-président.
Un groupe de travail sur les déserts médicaux, avec un président du groupe Union centriste et un vice-président du groupe Communiste, républicain, citoyen et écologiste : j'ai reçu les candidatures de MM. Jean-François Longeot et Guillaume Gontard. Je souhaiterais également, sur ce sujet, coprésider le groupe avec notre collègue Jean-François Longeot.
Il en est ainsi décidé.
La réunion est close à 18 h 10.