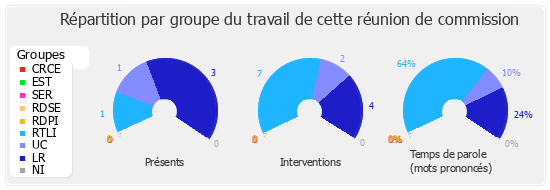Mission d'information sur la pénurie des médicaments et des vaccins
Réunion du 5 juillet 2018 à 10h15
Sommaire
- Audition du docteur patrick maison directeur de la surveillance et de mme dominique debourges ancienne cheffe du pôle défaut qualité et rupture de stock de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ansm (voir le dossier)
- Audition de la professeure dominique le guludec présidente de la haute autorité de santé has de mme catherine rumeau-pichon adjointe à la directrice de l'évaluation médicale économique et de santé publique de la has du professeur norbert ifrah président de l'institut national du cancer inca et de m. thierry breton directeur général de l'inca (voir le dossier)
La réunion
Audition du docteur patrick maison directeur de la surveillance et de Mme Dominique deBourges ancienne cheffe du pôle défaut qualité et rupture de stock de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ansm
Audition du docteur patrick maison directeur de la surveillance et de Mme Dominique deBourges ancienne cheffe du pôle défaut qualité et rupture de stock de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ansm

Notre mission d'information débute ses travaux par l'audition de deux représentants de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le docteur Patrick Maison, directeur de la surveillance, et Mme Dominique Debourges, ancienne cheffe du pôle défaut qualité et rupture de stock.
Cette audition sera l'occasion d'un premier cadrage de l'action des pouvoirs publics face à un phénomène qui a pris une ampleur considérable ces dix dernières années. Le nombre de signalements de ruptures et risques de rupture de stock de médicaments essentiels a, en effet, été multiplié par dix entre 2008 et 2014 et vient d'atteindre un nouveau record en 2017, avec 530 signalements recensés par l'ANSM. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a renforcé les obligations des différents acteurs de l'offre et de la distribution dans la notification, la prévention et la gestion des pénuries. Nous pourrons ainsi dresser un premier bilan de sa mise en oeuvre et de l'efficacité du dispositif législatif et réglementaire.

Nous souhaiterions des précisions sur la durée - moyenne et maximale - des ruptures de stock ces dernières années ? La majorité d'entre elles sont résolues rapidement. L'augmentation du nombre de pénuries est exponentielle depuis dix ans.
Comment distinguez-vous rupture de stock et rupture d'approvisionnement, et comment se répartissent-elles dans le temps ? Les dépositaires de médicaments - acteurs peu connus de la chaîne de distribution - jouent-ils un rôle dans les phénomènes de pénurie ?
Dr Patrick Maison, directeur de la surveillance de l'ANSM. - Le périmètre de l'agence ne recouvre pas l'ensemble des ruptures - notamment d'approvisionnement - car l'agence traite des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM), dont l'absence peut créer une perte de chance pour le patient, et des ruptures de stock au niveau national - l'incapacité pour le fabricant ou l'exploitant d'approvisionner le territoire national. Elle ne gère donc pas les ruptures d'approvisionnement, qui concernent l'impossibilité pour une pharmacie d'approvisionner un patient dans les 72 heures. Entre les deux, tout le circuit de distribution et la répartition nationale ne relèvent pas des missions de l'agence.
Le contexte mondial joue un rôle certain, de même que les fabricants, les exploitants, la chaîne de distribution et le marché global. Nous effectuons une analyse des risques sur le marché, sur les étapes de fabrication et sur un produit, en fonction de ses différentes indications et des alternatives, disponibles ou non.
Les durées de pénurie sont très variables, des épisodes de risque de rupture de stock, sans rupture matérialisée ou pour une période très courte, à des situations qui peuvent durer plusieurs mois voire plusieurs années, où il est nécessaire d'importer des médicaments pour compenser.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les différences entre rupture de stock et rupture d'approvisionnement ?
Dr Patrick Maison. - La première étape porte sur le stock et repose sur la capacité de l'exploitant à approvisionner le territoire pour répondre aux besoins au niveau national. La deuxième étape concerne la distribution et la répartition au niveau territorial : la rupture d'approvisionnement correspond alors à l'incapacité du pharmacien à répondre à la demande d'un patient dans un délai de 72 heures. Il existe des cas de figure pour lesquels, en dépit d'un stock national suffisant, la répartition au niveau territorial peut entraîner localement des difficultés d'approvisionnement.
À cela s'ajoutent parfois des ruptures de fabrication.
Dr Patrick Maison. - Oui, en amont. Parfois, le niveau de fabrication diminue sans aboutir à une rupture de stock, mais il est alors difficile de couvrir l'ensemble du territoire. Nous mettons alors en place un contingentement quantitatif ou qualitatif : par exemple, nous approvisionnons les hôpitaux, car il est plus facile de réguler les stocks et la distribution d'une pharmacie d'hôpital que ceux de multiples officines.

Lorsque le patient ne trouve plus en pharmacie ou à l'hôpital les médicaments qui lui ont été prescrits, il y a deux types de cause possible : une surconsommation ou une sous-évaluation des besoins de médicament dans la durée. Dans ce cas, la responsabilité des uns et des autres n'est pas engagée. Parfois, les laboratoires peuvent avoir une stratégie commerciale et financière de ralentissement de la fabrication de médicaments qui procurent un profit insuffisant. Dans les situations connues de rupture, pouvez-vous distinguer entre ces deux hypothèses ? Existe-t-il une troisième cause ?
Dr Patrick Maison. - Les ruptures sont multifactorielles, il est difficile d'avoir une vision exacte des causes. On nous rapporte surtout des déséquilibres entre la demande et la production et des arrêts de commercialisation. Les arrêts de commercialisation sont rarement la cause des ruptures de stock ou des risques de rupture. Un arrêt de commercialisation peut fragiliser le secteur, faute d'alternative, et aboutir à une tension d'approvisionnement ou à une rupture de stock. Si l'alternative a une faible part du marché, il est difficile de subvenir rapidement aux besoins. En-dessous de 20 % de parts de marché, il est difficile à un acteur de répondre rapidement à la demande globale. Le déséquilibre entre production et demande est la cause de 25 % des ruptures, et 20 % sont dues à un problème dans la chaîne de production, de la matière première au conditionnement. Peuvent également entrer en jeu des défauts de qualité, et enfin, dans 15 % des cas, une insuffisance de matières premières produites par un nombre d'acteurs limités pour répondre à une demande mondiale qui augmente.
Ont été portés à notre connaissance des exemples de ruptures de stock de médicaments en établissement hospitalier, dont l'un pour lequel l'alternative existait probablement sous forme générique et était fournie par un autre laboratoire qui n'avait pas répondu au marché initial et qui a cédé son produit pour un prix jusqu'à dix fois plus cher que le prix initial. Avez-vous eu écho de telles situations abusives, voire scandaleuses ?
Lorsqu'un laboratoire répond à un appel d'offres hospitalier, un prix de marché, négocié, est fixé entre l'hôpital et le laboratoire. Lorsqu'un laboratoire subvient à des difficultés d'approvisionnement, il n'intervient pas dans le cadre d'un marché. Le prix peut donc être supérieur mais le laboratoire défaillant doit alors absorber la différence de prix entre le prix négocié par lui et le prix du médicament de substitution.
Tout à fait.
Dr Patrick Maison. - Il peut se produire l'inverse. Un centre hospitalier peut s'engager auprès d'un nouvel acteur à acheter un stock à un certain prix, en pensant que le laboratoire défaillant va rembourser. Toutefois, lorsque celui-ci peut réapprovisionner le marché, ce laboratoire refuse de rembourser les achats. Son obligation cesse, mais peut mettre l'hôpital en situation financière difficile.

La loi santé de 2016 a mis en place des plans de gestion de pénurie (PGP). Qu'en est-il en réalité ? Les laboratoires appliquent-ils la loi ?
Dr Patrick Maison. - Oui, les laboratoires mettent en oeuvre des PGP, mais tous ne sont pas forcément efficients. À l'heure actuelle, nous effectuons un important travail d'harmonisation pour rendre ces plans efficients. Pour un certain nombre de mesures, notamment celles concernant le cycle de production, il faudra du temps avant d'apprécier leur efficacité. La première étape est l'analyse du risque, et trouver des solutions immédiates pour gérer la pénurie. Dans un second temps, il faut prévoir et anticiper. Évaluer l'efficience des PGP prendra donc du temps.
Les laboratoires prennent des mesures à moyen et long terme : augmenter la capacité de production d'une usine prend plusieurs mois, voire des années ; qualifier un nouveau fournisseur de substances actives également, de même qu'avoir des stocks supplémentaires. Les PGP sont exigibles depuis janvier 2017 : la profession respecte la réglementation. Cela aura des effets positifs pour la prévention à moyen terme.

Lors de l'inspection des sites de production, peut-on évaluer la capacité du fabricant de répondre à la demande et à ses éventuelles variations, et vérifier l'inventaire ainsi que l'adéquation des plannings de production aux projections de la demande ? Qu'en est-il lorsque les sites de production sont hors de France ou de l'Union européenne ?
Dr Patrick Maison. - Nous vérifions d'abord le respect par les exploitants et fabricants de leurs obligations. Ils doivent signaler une pénurie, élaborer un PGP et tout mettre en oeuvre pour y remédier. En termes d'efficience de ces mesures, il n'existe pas de contrainte réglementaire, la seule est de faire le signalement dans les temps. Ils doivent déclarer l'état de leurs stocks et le suivi selon les posologies et les formes galéniques des produits. On vérifie la qualité mais pas les capacités de production.
Les inspections, en France ou hors de l'Union européenne, vérifient le respect des bonnes pratiques de fabrication et de distribution et permettent de délivrer, le cas échéant, un certificat de bonnes pratiques de fabrication ou de distribution. L'analyse de la demande et la gestion de la planification de la production se fait globalement, et pas forcément sous la juridiction d'une inspection.

Si l'ANSM intervient uniquement sur le territoire national, existe-t-il néanmoins des mécanismes d'alerte et d'intervention pour faire face aux problèmes plus ponctuels et concentrés au niveau local ? Certaines régions moins denses ne souffrent-elles pas de difficultés récurrentes d'approvisionnement ?
Le regard de l'agence est national. Nous intervenons en cas de tensions à ce niveau. Dans ce cas, nous privilégions certains canaux pour assurer l'équité des approvisionnements sur le territoire.
Au quotidien, les grossistes-répartiteurs ont une obligation de service public de fournir les officines avec un stock d'au moins deux semaines, et ont un délai de livraison d'une demi-journée.
Dr Patrick Maison. - Nous disposons d'informations sur les difficultés locales. L'agence vérifie alors si le problème est local ou national. Cela peut être important pour les territoires d'outre-mer.

L'échelle européenne est souvent invoquée dans le secteur médical. Quel est votre sentiment sur l'état de la coopération européenne dans la prévention et la gestion de pénuries de médicaments et de vaccins ? Le développement du commerce parallèle de médicaments dans le marché intérieur et l'externalisation croissante de sites de production en dehors de l'Union européenne obligent-ils à une coopération renforcée ?
Dr Patrick Maison. - Ces difficultés de marché ou de rupture de stock dépassent le cadre national en raison de la mondialisation des marchés, et ces négociations européennes sont nécessaires. Pour certains produits et notamment ceux avec une autorisation de mise sur le marché centralisée, la gestion des ruptures de stock ou des risques de rupture est centralisée au niveau européen. Cela concerne une minorité de médicaments, surtout les plus anciens. Des travaux ont débuté sur le partage des critères pour les médicaments à suivre et sur la définition des ruptures de stock, ainsi que sur la gestion au niveau national des ruptures de stock.
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a créé un premier groupe de travail en 2013 pour dresser un état des lieux, à l'échelle européenne, des ruptures de stock, définir ce qu'est une rupture et voir comment elles sont gérées au niveau national. Un deuxième groupe de travail développe une vision et une coordination européennes des ruptures d'approvisionnement. Les structures des laboratoires sont globalisées : il faut apporter des réponses plus larges.
L'EMA travaille aussi à des plans de prévention européens correspondant aux PGP français. Les règlementations ont évolué simultanément et de manière coordonnée. Même si ces plans de prévention ne sont pas encore rendus obligatoires en Europe, les recommandations ont été prises au sérieux par de nombreuses associations industrielles internationales.

L'Europe n'est pas dans une situation optimale actuellement, mais on peut donc considérer qu'il existe une volonté commune, un travail commun et des avancées sur cette question.

Certains patients, déjà angoissés par leur maladie, font face à l'impossibilité de poursuivre leur protocole à cause des ruptures d'approvisionnement. J'ai notamment été saisie d'un problème de pénurie par de nombreux patients atteints d'un cancer de la vessie. Depuis que le laboratoire Sanofi a cessé de produire et de commercialiser l'Ametycine® au niveau mondial, un laboratoire japonais a été autorisé à importer en France un produit destiné initialement au marché britannique, Mitomycin-C Kyowa®. Mais, depuis quelque temps, ont été observées des ruptures d'approvisionnement, compromettant ainsi la réalisation de protocoles de soins établis. Sans médicament, ces patients se retrouvent face à un mur. Quelles sont les solutions ?
Dr Patrick Maison. - L'un des points importants, dans la gestion des pénuries, c'est la communication, à l'endroit des professionnels de santé et des patients. L'agence s'emploie à monter en puissance sur cet aspect de la gestion de crises, car il s'agit de traiter l'angoisse que vous évoquez et de trouver très rapidement des alternatives, par l'importation de produits ou par l'adaptation des protocoles mis en place par les professionnels de santé.
Nous avons récemment mis en place des outils de communication en temps réel et nous organisons des échanges avec les associations de patients et avec les sociétés savantes. Nous proposons notamment d'adapter les traitements sans perte de chance, même si nous savons que la modification d'un protocole est toujours angoissante.
La gestion des ruptures de stock est souvent une course à l'information qui varie au cours du temps. Elle exige des efforts d'adaptation de la part de tous les acteurs ; d'où l'accent mis sur la communication.
Nous avons eu des contacts fréquents avec la société française d'urologie pour gérer les périodes de pénurie que vous avez évoquées. Des mesures d'importation et des mesures palliatives ont été mises en place. Même si nous savons que ce n'est pas toujours facile pour les patients, nous nous efforçons d'approvisionner au mieux le marché dans une période difficile.

En tant que pharmacienne d'officine qui exerce encore un peu, imaginez le ras-le-bol, permettez-moi l'expression, des équipes officinales et des patients. Les professionnels de santé, notamment les pharmaciens d'officines, n'ont pas toujours l'information sur la nature de la rupture de stock et sur la date de retour prévisionnelle. Ce défaut d'information n'est pas acceptable. Les grossistes choisissent parfois, lorsqu'ils ont une date de retour, de ne pas la communiquer, de peur de créer un épuisement immédiat des nouveaux stocks à la date du réapprovisionnement. Les pharmaciens d'officines se trouvent donc dans l'incapacité de répondre à leurs patients. Quel est le rôle de l'agence en la matière ? Les pharmaciens ont au moins besoin d'une information sur la nature de la rupture et d'une date de retour dans le circuit pharmaceutique.
Dr Patrick Maison. - Les fabricants et les exploitants sont soumis à une obligation d'information, via les centres d'appels d'urgence ; nous veillons à ce qu'ils l'assument. L'agence joue un rôle d'accompagnement ; elle participe à l'amélioration des canaux d'information. La difficulté est néanmoins la suivante : cette information est mouvante. C'est pourquoi je parle de course à l'information, et même de course-poursuite. D'une heure à l'autre, la résolution de la problématique aux différentes étapes de la production et de la distribution ou le moindre grain de sable peuvent faire varier l'état des stocks ou perturber la distribution. Il n'est pas simple d'informer en temps réel.
Nous allons tâcher d'étendre notre programme d'information, que nous avons mis en place pour certains produits depuis 2018, à l'ensemble des produits en rupture ou en risque de rupture de stock. Nous travaillons également, sur ce sujet, avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP).

Je suis également, comme ma collègue et consoeur Corinne Imbert, pharmacienne d'officine de profession.
Existe-t-il une différence significative entre les taux de rupture de stock respectifs des médicaments de ville et des médicaments d'hôpital ? Par ailleurs, s'agissant des vaccins, identifiez-vous des causes de rupture ? Enfin, les laboratoires « contingentent »-ils toujours la fabrication de certains médicaments, ce qui pourrait expliquer qu'on observe des ruptures plus fréquentes en fin d'année ?
Dr Patrick Maison. - Nous avons analysé l'augmentation du nombre de signalements en 2017 et le marché hospitalier est nettement plus affecté que le marché officinal par les ruptures. Je précise toutefois que l'agence surveille les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ce qui introduit un biais dans notre analyse.
Souvent, les établissements de santé passent des contrats sur un seul produit, y compris sur des marchés où il existe des alternatives, ce qui produit des déséquilibres et limite la capacité à réagir en cas de problème.
Le marché des vaccins est particulier : peu d'acteurs sont présents, et la chaîne de fabrication est longue, avec une capacité à s'adapter plus difficile puisqu'il faut 18 mois à deux ans pour modifier une chaîne de production. En outre, la demande mondiale évolue et les calendriers vaccinaux varient d'un pays à l'autre.
Le risque de rupture est important toute l'année. Sur les six premiers mois de 2018, nous avons déjà recueilli un très grand nombre de signalements.
Les deux pharmaciennes d'officine que nous sommes, Corinne Imbert et moi, constatent pourtant des ruptures plus fréquentes en fin d'année.

Vous nous avez laissé entendre que le laboratoire titulaire d'un marché ne pouvait être rendu comptable du paiement du « delta » éventuel entre le prix dudit marché et celui du marché de substitution conclu par l'hôpital avec un autre laboratoire, en cas de pénurie.
Vous avez indiqué qu'il peut arriver que le laboratoire titulaire d'un marché se trouve dans l'incapacité de livrer la quantité de médicaments contractuellement prévue pendant une certaine période de temps ; or il semble que - c'est du moins ce que j'ai compris de vos propos -, lorsque la livraison normale reprend, ce laboratoire soit dégagé de l'obligation d'indemniser l'hôpital.
Par ailleurs, vous nous avez présenté les dispositifs que vous avez mis en place pour tenter de prévenir les pénuries ; avez-vous pu en mesurer les effets ?
Dr Patrick Maison. - Une rupture évolue au gré de la succession des arrêts et des reprises. J'ai parlé de 530 signalements, mais le même produit peut être signalé plusieurs fois.
J'ai cité l'exemple d'établissements qui, en cas de rupture de stock d'un produit, passent un marché avec le fabricant d'un produit alternatif ; le contrat initial peut ne pas prévoir le remboursement de cet achat. Lorsque la pénurie cesse, le premier fabricant peut se retrouver en difficulté, s'il ne parvient pas à écouler sa production devenue inutile ; inversement, l'établissement peut lui aussi connaître des problèmes au moment où le contrat palliatif perd son utilité. Ces situations sont néanmoins exceptionnelles.
Nos dispositifs ont des effets en termes de communication et d'analyse de risques. Les effets des mesures de compensation ne peuvent pas encore être mesurés ; en revanche, l'analyse des risques en amont permet d'améliorer la capacité des laboratoires à réagir rapidement. On observe également une amélioration en matière de visibilité des secteurs les plus fragiles, dont les stocks doivent être surveillés en amont.

L'obligation imposée au laboratoire défaillant de combler le delta né d'une situation de pénurie existe dans le cadre des marchés publics ; existe-t-elle aussi pour les établissements privés ?
Je n'ai pas la réponse exacte, mais j'aurais tendance à penser que cette obligation concerne les marchés publics.

Nous avons constaté une augmentation très importante des pénuries depuis une dizaine d'années, avec des pics en 2013 et en 2017. Comment l'expliquez-vous ? Ces hausses sont-elles liées à l'évolution des obligations de signalement ? Quelles mesures préconiseriez-vous pour régler ces problèmes ?
Dr Patrick Maison. - Il nous est difficile d'expliquer le premier pic ; c'est au moment de ce pic que l'agence s'est organisée en guichet, avec un recueil des différents signalements qui n'existait pas auparavant. Nous disposons depuis lors d'un recueil plus exhaustif, ce qui a mécaniquement produit une augmentation. L'évolution de la réglementation constitue sans doute une deuxième cause. Enfin, troisième cause, le contexte est celui de la mondialisation, d'une complexification des circuits et d'une augmentation de la demande globale. Il nous est toutefois difficile de faire la part de ces trois causes.
Sur le deuxième pic, celui de 2017, le travail est en cours avec les principaux exploitants qui ont fait l'objet de signalements, sachant que l'organisation de l'agence n'a pas changé. L'augmentation du nombre de signalements est-elle liée à une évolution de la sensibilité, donc des méthodes de travail, des déclarants, ou à un changement de réglementation ?
Quelles mesures suggérez-vous ?
Dr Patrick Maison. - Trois axes d'amélioration existent : d'une part, l'obligation de communication des exploitants et des fabricants ; d'autre part, les plans de gestion de pénurie - leur mise en place ne date que d'un an : il faut attendre pour en mesurer les effets ; l'Europe, enfin : il faut promouvoir une gestion plus globalisée de ces risques de rupture.

Ma question pourra paraître hors-sujet : je souhaiterais connaître votre avis sur le cannabis, dont les vertus thérapeutiques sont de plus en plus reconnues - la ministre a elle-même ouvert ce dossier.
Dr Patrick Maison. - L'agence étudie la balance bénéfice-risque des produits disponibles, et notamment des nouveaux produits. Sur le cannabis, spécifiquement, je suis dans l'incapacité de vous répondre.

Nous avons bien compris qu'une application stricte de la loi constituerait déjà une avancée.
Au chapitre des préconisations, certaines mesures coercitives devraient-elles être prises vis-à-vis des laboratoires ? Que proposez-vous, sachant que nous sommes dans un contexte européen ?
Dr Patrick Maison. - Les mesures coercitives sont difficiles à mettre en oeuvre. Sur les problèmes de fabrication, il est compliqué d'intervenir. La vision de l'ANSM est limitée ; la promotion de solutions d'approvisionnement du marché serait plus facile au niveau européen qu'au niveau national. Des discussions ont lieu sur la localisation des sites de fabrication.
Le sujet des marchés, là encore, dépasse largement le champ d'action de notre agence. Les disparités en termes de marchés peuvent créer des difficultés, mais nous ne voyons pas quelle solution coercitive pourrait être envisagée. Ma réponse ne vous aidera pas beaucoup, j'en suis tout à fait conscient ; elle est révélatrice du caractère complexe et multifactoriel de ce problème. Aucune solution ciblée ne permettra de répondre à toutes les situations.
L'industrie pharmaceutique a changé de modèle depuis dix ou vingt ans, avec une mondialisation de la production et une diminution du nombre de sites fabriquant des substances actives et des produits finis. Le modèle de fonctionnement a changé. Nous travaillons à mieux comprendre la situation actuelle, afin de voir comment les laboratoires peuvent s'organiser pour y répondre. Cette question dépasse de beaucoup le cadre de l'ANSM ; nous travaillons sur ces sujets en lien avec la direction générale de la santé (DGS), la direction générale de l'offre de soins (DGOS), l'Institut national du cancer (INCa) ou les associations industrielles.
Nous avons travaillé notamment sur la sécurisation des approvisionnements, notamment pour les antibiotiques et les anticancéreux, avec une déclinaison de mesures possibles : relocalisation d'usines en Europe, mise en place de stocks de sécurité nationaux. Les choses ne sont pas encore stabilisées, mais il y a une prise de conscience générale.

Vous avez bien compris que je n'ai pas été convaincu par votre réponse. Fabriquer des médicaments, quelles que soient les évolutions, c'est une responsabilité. C'est l'essence même de la protection humaine ! Le monde des médicaments semble être devenu un monde exclusivement économique, si ce n'est spéculatif. Où est l'éthique ? Où est l'humanisme ? Je suis un peu gêné d'entendre que des mesures sont prises pour des raisons exclusivement économiques ; un regard différent est nécessaire.
Il est difficile de mettre en place des mesures coercitives et d'harmoniser les dispositifs au niveau européen, certes, mais la France aurait tout à gagner à adopter une posture novatrice pour assurer cette fourniture de médicaments. Je n'irai pas jusqu'à défendre la nécessité de la réquisition, quoique...
Dr Patrick Maison. - Nous sommes d'accord avec vous, monsieur le rapporteur. Le point de vue de l'agence n'est pas du tout économique ; il nous est donc difficile de vous fournir des éléments tangibles sur l'efficacité de telle ou telle mesure. La pluralité des acteurs et la complexité de la situation rendent notre vision trop limitée et notre diagnostic très parcellaire. D'où le caractère peu satisfaisant de nos réponses.

Les laboratoires sont aujourd'hui des entreprises dans un système économique mondialisé ; ils ont la liberté de fabriquer ou de ne pas fabriquer, et de contingenter. Certains médicaments sont mis sur des marchés européens, mais pas sur le marché français. Avez-vous identifié des cas de rupture où un laboratoire a décidé d'arrêter la fabrication du médicament pour des raisons de rentabilité économique ?
L'agence gère à la fois les ruptures de stock et les arrêts de commercialisation, qui ne sont pas traités par les mêmes équipes. Lorsqu'une déclaration d'arrêt de commercialisation est émise, l'agence engage une discussion avec le laboratoire pour tenter de contrer cette mesure, notamment pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Les laboratoires sont contraints par la réglementation d'avertir l'agence un an avant l'arrêt effectif. Dans un certain nombre de cas, mais pas dans tous, l'agence a réussi à contraindre le laboratoire à poursuivre la fabrication.
Le cas des ruptures d'approvisionnement est différent : il s'agit plutôt de difficultés de production.

A-t-on des exemples de laboratoires qui décideraient de réserver un médicament à un certain marché et de le retirer d'autres marchés ?
Nous n'avons pas de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement globale d'un laboratoire. Nous savons ce qui se passe sur notre territoire ; en revanche, nous n'avons pas forcément connaissance des médicaments alloués aux autres marchés.

Si vous aviez d'autres propositions à nous faire, je vous prie de bien vouloir nous les communiquer. Nous ne vous demandons pas nécessairement d'être force de proposition, mais nous souhaiterions recueillir vos avis.
Audition de la professeure dominique le guludec présidente de la haute autorité de santé has de Mme Catherine Rumeau-pichon adjointe à la directrice de l'évaluation médicale économique et de santé publique de la has du professeur norbert ifrah président de l'institut national du cancer inca et de M. Thierry Breton directeur général de l'inca
Audition de la professeure dominique le guludec présidente de la haute autorité de santé has de Mme Catherine Rumeau-pichon adjointe à la directrice de l'évaluation médicale économique et de santé publique de la has du professeur norbert ifrah président de l'institut national du cancer inca et de M. Thierry Breton directeur général de l'inca

Nous poursuivons nos travaux par l'audition conjointe de deux agences d'expertise sanitaire et scientifique : la Haute Autorité de santé (HAS), représentée par sa présidente, la professeure Dominique Le Guludec, et Catherine Rumeau-Pichon, adjointe à la directrice de l'évaluation médicale, économique et de santé publique, et l'Institut national du cancer (INCa), représenté par le professeur Norbert Ifrah, président, et Thierry Breton, directeur général. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation au niveau le plus élevé de vos agences. Vos éclairages nous permettront de mieux cerner l'impact des pénuries de médicaments essentiels et de vaccins sur la prise en charge des patients et de prendre la mesure de la difficulté à mettre en oeuvre des traitements alternatifs ou des solutions palliatives. Les risques de rupture de stock affectent d'abord les médicaments anticancéreux et anti-infectieux, ainsi que les produits agissant sur le système nerveux pour lesquels les alternatives sont rares, voire inexistantes.

En complément au questionnaire qui vous a été envoyé pour servir de trame à nos échanges, je souhaiterais connaître votre position sur la définition des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) utilisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans la gestion des ruptures de stock et d'approvisionnement et sur la nécessité qu'il pourrait y avoir à l'élargir. J'aimerais également connaître votre appréciation des mesures de substitution prises dans certaines situations de pénurie, notamment sur les garanties de sécurité et d'efficacité qu'elles présentent pour les patients concernés. En matière de vaccination, enfin, estimez-vous que la récente extension de l'obligation vaccinale puisse avoir un effet positif sur les pénuries et que préconisez-vous en cas de rupture de stock ?
Pr Dominique Le Guludec, présidente de la HAS. - Je précise à titre liminaire que la HAS ne dispose, à rebours de l'ANSM, d'aucune compétence dans la gestion des pénuries de vaccins ou de médicaments. Nous ne disposons, en conséquence, pas d'une visibilité qualitative ou quantitative sur ces phénomènes. Nous sommes, en revanche, amenés à ajuster ou à modifier la stratégie vaccinale pour répondre à des situations de pénurie.
Pr Norbert Ifrah, président de l'INCa. - L'INCa n'intervient que lorsque l'ANSM ou le ministre de la santé demande son concours à l'occasion d'une pénurie, mais ne dispose d'aucune mission en la matière.
Pr Dominique Le Guludec. - Je n'ai aucune remarque à formuler sur la définition des MITM.
Pr Norbert Ifrah. - La définition des MITM possède naturellement une dimension évolutive car les produits comme les indications sont amenés à changer au gré des innovations : un produit plus efficace ou mieux toléré peut remplacer le précédent. Il apparaît donc nécessaire de réinterroger régulièrement la définition des MITM, comme le fait d'ailleurs l'ANSM.
Pr Dominique Le Guludec. - Lorsque nous sommes saisis d'une situation de pénurie de vaccins, nous proposons des ajustements ou des modifications de la stratégie vaccinale, voire une priorisation des populations, selon le produit en cause. Les adaptations mises en oeuvre se sont toujours révélées efficaces mais il est probable que, dans le contexte de l'extension de l'obligation vaccinale, il existe un risque supplémentaire non pas de rupture de stock mais de détérioration d'image, dans une période où il est important de regagner la confiance des Français dans les vaccins et donc d'assurer la cohérence de la stratégie vaccinale.
Il existe différentes sortes de pénuries : celles conjoncturelles, pour certains vaccins vivants, liées à un problème survenu dans un processus de fabrication complexe et ne résultant donc ni d'une stratégie des laboratoires ni de l'extension de l'obligation de vaccination ; celles qui découlent d'un désintérêt des industriels pour des vaccins anciens ou peu rémunérateurs, bien qu'ayant toujours leur place dans la stratégie vaccinale et dont les indications peuvent demeurer importantes ; celles, enfin, qui ressortent des choix commerciaux des laboratoires ou de la répartition des stocks entre pays et peuvent évoluer au gré des obligations vaccinales. Au-delà de cette typologie, je ne puis en revanche vous livrer des éléments quantitatifs sur chaque situation, même si, à mon sens, les pénuries liées à la fabrication de produit doivent être plus fréquentes.
Pr Norbert Ifrah. - Les malades en protocole de soin pour un cancer sont directement concernés par la politique vaccinale. Dans une moindre mesure, les conséquences existent également en matière de prévention. De fait, les traitements anticancéreux entrainent fréquemment une sévère immunodépression. Or, 400 000 cancers se déclarent chaque année, tandis que trois millions de Français souffrent ou ont souffert de cette maladie qui a fragilisé, parfois définitivement, leur système immunitaire. La responsabilité sociétale de l'entourage des malades ou des anciens malades, comme des personnes greffées, est donc considérable : l'obligation de vaccination relève de la morale collective. Le sujet est d'importance pour l'INCa qui défend vigoureusement la vaccination et l'absence de rupture dans la stratégie vaccinale. Je crains le jour où des malades du cancer décèderont du fait d'une épidémie de rougeole contre laquelle existe pourtant un vaccin...
Pr Dominique Le Guludec. - Je vous propose d'illustrer ma topologie des pénuries par trois exemples : la pénurie de Rouvax®, vaccin contre la rougeole administré aux nourrissons, est due à la décision du fabricant, compte tenu de l'étroitesse du marché, d'en cesser la production ; celle, conjoncturelle, des vaccins contre les infections à pneumocoque résulte d'une fabrication complexe ; celle, enfin, du vaccin contre l'hépatite B administré aux adultes ressort d'une extension des indications et, partant, d'un déséquilibre temporaire entre l'offre et la demande de produit.

Vos exemples sont éclairants et permettront utilement d'étayer nos travaux. Pour faire face à des risques de pénurie liés à des défauts de qualité, l'agence sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), a déjà autorisé le maintien d'un produit injectable défectueux, sous réserve de l'utilisation d'un filtre n'affectant pas le fonctionnement de son principe actif. Quelle est, en France, l'approche retenue lorsqu'un médicament essentiel, pour lequel il n'existe aucun substitutif, est menacé de retrait en raison d'un défaut de qualité ou de fabrication ?
Pr Dominique Le Guludec. - Votre question dépasse le champ de compétence de la HAS. Elle concerne l'ANSM qui évalue la gravité d'un défaut et propose un palliatif.
Pr Norbert Ifrah. - Il peut certes arriver que l'INCa soit interrogé sur un substitut à un produit ou sur une solution provisoire de traitement, mais votre question ne relève pas non plus de nos missions.
Lorsque la pénurie est limitée à un ou deux pays, est-il envisageable de prévoir temporairement une rotation des stocks entre États membres de l'Union européenne ? Certains établissements de santé ont-ils pour habitude de venir en aide à des établissements européens confrontés à une grave pénurie ?
Pr Dominique Le Guludec. - Une gestion des stocks plus collective et à une échelle plus large que celle du territoire national semble effectivement une idée intéressante.
Lors de la pénurie de vaccins contre l'hépatite B, une solidarité s'est organisée en Europe. La gestion des stocks à l'échelle européenne existe au niveau de chaque laboratoire et, parfois, des États membres.
Pr Norbert Ifrah. - Il peut arriver que l'ANSM travaille avec les agences d'autres pays mais, encore une fois, l'INCa n'est pas sollicité avant que n'émerge une solution alternative de traitement sur laquelle il peut être consulté.

Existe-t-il une coordination au niveau européen entre agences sanitaires pour la définition de procédures et de bonnes pratiques à destination des professionnels de santé ? Les agences nationales s'entendent-elles, par exemple, sur l'orientation vers d'autres solutions thérapeutiques d'attente ou sur des conseils dans l'ajustement des protocoles et du dosage lorsque cela est possible ?
Pr Dominique Le Guludec. - À ma connaissance, un tel niveau de collaboration n'a pas cours en matière de recommandation sur les bonnes pratiques ni d'adaptation de la stratégie vaccinale en cas de pénurie. Des groupes de travail réunissent, certes, les agences nationales d'évaluation des médicaments, mais sur d'autres sujets.

Selon vous, les professionnels de santé et les populations sont-ils suffisamment informés en cas de pénurie, tant sur le produit concerné que sur la durée de l'événement ?
Pr Dominique Le Guludec. - Il est certainement possible d'améliorer la communication dans ce domaine afin de mieux informer les usagers des difficultés d'approvisionnement et des alternatives envisageables. Les pharmaciens, parfois, remplissent cette mission auprès des professionnels de santé. Lorsque la stratégie vaccinale est modifiée, ce rôle est tenu par le ministre de la santé. Pour le grand public, je ne crois pas qu'il existe de dispositif de communication institutionnelle.
Hélas, les pharmaciens eux-mêmes ne disposent parfois pas des informations nécessaires...
Pr Norbert Ifrah. - Le cas des malades du cancer apparaît atypique, puisqu'un parcours personnalisé de soins est établi dans un cadre interdisciplinaire. Dès lors, le patient est informé de toute modification de son protocole, qu'elle soit liée à une pénurie de médicament, à une intolérance au produit ou à une rechute. Le plan de traitement est alors revu, bien que tout changement représente malheureusement, pour ces pathologies, une perte de chance pour le malade.
Pr Dominique Le Guludec. - Les informations relatives aux pénuries sont recensées sur les sites Internet de l'ANSM et de la HAS, mais il revient aux professionnels de santé de prendre l'initiative de les consulter. En outre, il conviendrait également de les informer tant des ruptures que des reprises d'approvisionnement. En tout état de cause, la solution réside, en partenariat avec les industriels, dans une optimisation de la gestion des stocks fondée sur une connaissance fine de l'existant et des besoins.
Pr Norbert Ifrah. - Imaginez qu'au cours de la dernière année, nous avons recensé une pénurie pour quarante médicaments anticancéreux essentiels, basiques pour certains. Il s'agit bien d'un problème d'envergure !

Quelle fut la durée de ces pénuries ?
Pr Norbert Ifrah. - Les pénuries et les tensions ont duré plusieurs mois et nous ont amené à proposer, en dialogue avec les sociétés savantes, le meilleur traitement de substitution - ou le moins mauvais - et à hiérarchiser les indications.

Concernant les produits de substitution pour les personnes atteintes de cancer, j'aimerais connaître votre avis sur l'opportunité que pourrait constituer le cannabis thérapeutique utilisé dans de nombreux pays pour ses effets analgésiques, antispasmodiques ou anti-inflammatoires.
Pr Norbert Ifrah. - Le cannabis n'entre pas tout à fait dans le champ de la pénurie de médicaments qui présentent un intérêt vital... Il est souvent fait état des avantages du cannabis, mais il faut également signaler les problèmes liés à son usage : une seule bouffée est susceptible de décompenser et ainsi d'entraîner l'irréversibilité des maladies psychotiques. Il convient par ailleurs de distinguer la part de l'effet de mode et de l'efficacité réelle du cannabis thérapeutique. Une étude hollandaise réalisée sur quelques centaines de malades a notamment montré qu'il était moins efficace comme antiémétique que le Primpéran® et les corticoïdes. Je ne crois pas enfin qu'il existe une pénurie de cannabis en France !
Pr Dominique Le Guludec. - Il convient de distinguer des produits vendus comme des médicaments des autres produits. Par ailleurs, aucun dossier de dérivé du cannabis n'ayant été déposé auprès de la commission de la transparence en vue d'un remboursement, aucune évaluation médico-scientifique n'a été réalisée à ce jour par la HAS.

En cas de pénurie, certains laboratoires se livrent-ils à une forme de spéculation afin de vendre aux pays susceptibles de payer plus cher ? Sommes-nous capables de déterminer l'origine de la pénurie de médicaments ? Compte tenu des conséquences parfois létales d'une telle situation, il est indispensable que nous puissions identifier les cas de spéculation. C'est là toute l'utilité de notre mission d'information.
Pr Norbert Ifrah. - Un pays prêt à payer plus cher sera effectivement placé en meilleure position sur la liste d'attente. Par ailleurs, j'ai du mal à croire que les tensions ne soient jamais organisées. Il arrive, par exemple, que certains médicaments très anciens et donc peu chers disparaissent du marché pendant quelques mois avant d'être de nouveau commercialisés trente à cent fois plus cher par un autre laboratoire.

Le médicament n'est alors pas du tout modifié ?
Pr Norbert Ifrah. - C'est le même principe actif ! Ce sont des comportements voyous, qui nous amènent parfois à réaliser des acrobaties pour traiter les malades dans l'intervalle.
Pr Dominique Le Guludec. - La stratégie commerciale des fournisseurs demeure opaque aux institutionnels. Nous ne pouvons exclure, bien que cela soit rarement démontré, qu'il existe des politiques de vente privilégiée.
La pénurie de vaccin n'a, à ce jour, causé la mort d'aucun patient car des stratégies de substitution et un effort collectif d'adaptation des recommandations et des populations ont permis d'y répondre.
Pr Norbert Ifrah. - Il existe énormément de causes aux pénuries : rupture de principe actif - dont la production est largement délocalisée, notamment en Asie -, problème de production de lots de produits finis, effets pervers de la concurrence ou des monopoles, en particulier quand des groupements d'achat se portent sur un produit au risque d'amener d'autres laboratoires à désinvestir le champ. Il suffit alors que le seul laboratoire produisant un médicament rencontre un problème technique pour qu'il y ait pénurie. L'INCa n'a toutefois aucun moyen de connaître la part respective de chacune de ces causes.
Certains sites de production en Asie ne respectent pas les critères de qualité, ce qui peut causer des pénuries. De manière générale, dans un système de production où les médicaments sont largement fabriqués hors de France, les discussions des filiales françaises avec leurs partenaires étrangers sur la gestion des pénuries des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur sont parfois difficiles. Par ailleurs, l'ANSM a souvent des difficultés pour obtenir des laboratoires l'élaboration de plans de gestion de pénurie.
Pr Dominique Le Guludec. - La chaîne de production d'un médicament ou d'un vaccin est de plus en plus complexe, ce qui est source de tensions.

Pourriez-vous nous donner des exemples de médicaments anciens qui ont disparu puis sont réapparus ?
Pr Norbert Ifrah. - Le BiCNU®, utilisé pour le conditionnement de greffe de cellules-souches hématopoïétiques, a disparu avant d'être remis sur le marché à un prix beaucoup plus élevé. Je crois qu'il en va de même du Melphalan®.
Pour quelle raison les principes actifs sont-ils majoritairement produits en Inde ou en Chine ?
Pr Dominique Le Guludec. - Du fait de logiques de regroupement industriel et de baisse des coûts de production.

Avez-vous identifié les causes des ruptures ou des tensions pour les quarante molécules anticancéreuses mentionnées précédemment ?
Il me semble que, pour les médicaments d'officine, ce n'est pas tant la rupture que l'absence de visibilité sur la durée qui est gênante.
Enfin, quel est, selon vous, le lien entre une éventuelle stratégie des fournisseurs et leurs enveloppes autorisées aux remboursements ?
Pr Norbert Ifrah. - Le travail sur la gestion de la tension et la durée de celle-ci relève de l'ANSM. L'INCa n'est sollicité qu'en cas de rupture pour trouver, en lien avec les sociétés savantes et les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique (Omédit), des solutions de hiérarchisation ou de substitution, comme ce fut le cas lors de la pénurie de L-asparaginase d'Erwinia.
Pr Dominique Le Guludec. - L'ANSM et le fournisseur apprécient la durée de la rupture en fonction de la cause.
Concernant les stratégies des fournisseurs, la HAS a proposé la revalorisation du prix de certains médicaments anciens pour lutter contre ces ruptures « de désintérêt », sous réserve d'une appréciation de leur apport thérapeutique.

Lors de la mise en place des nouvelles politiques de vaccination, nous avons beaucoup entendu parler des vaccins sans aluminium. Ces vaccins sont-ils plus sûrs et posent-ils des difficultés d'approvisionnement ?
Pr Dominique Le Guludec. - À ma connaissance, l'effet délétère que vous évoquez n'a jamais été démontré avec un niveau de preuve correct. En revanche, une efficacité différente et moindre, liée à l'adjuvant, avait été constatée. À ce jour, les vaccins sans cet adjuvant ne font donc pas l'objet d'une recommandation d'utilisation préférentielle compte tenu de la diminution de l'efficacité vaccinale et de l'absence de démonstration du sur-risque.
Pr Norbert Ifrah. - Idem, absolument idem. Et je n'ai non plus jamais vu d'étude de qualité comparant la toxicité d'un vaccin avec de l'aluminium en injection et celle des capsules de certaines machines à café.

Les mesures de substitution prises en cas de pénurie présentent-elles toutes les garanties de sécurité et d'efficacité pour les patients ? Quelles mesures pourrait-on préconiser pour améliorer la gestion des tensions ? Par ailleurs, les difficultés relatives au Lévothyrox® sont-elles liées à un enjeu de pénurie de médicaments ?
Pr Norbert Ifrah. - N'étant pas compétent, je ne répondrai pas à cette dernière question.
Concernant les médicaments anticancéreux, nous essayons de faire au moins mal. Nous avons souvent des substituts de très grande qualité, quand des traitements analogues existent mais avaient été écartés parce que leur administration était plus longue, ou exigent un réapprentissage - celui-ci pouvant toutefois entraîner un sur-risque. Il arrive qu'il n'existe pas de substitut, comme pour l'Erwinase®, qui est utilisé lorsque le patient est allergique ou intolérant à la L-asparaginase « de base ». Pendant plusieurs mois, nous avons dû hiérarchiser les besoins et nous entraider. Il s'agit d'un médicament rare produit dans un seul endroit, qui a été en rupture du fait d'un problème de fabrication.
Les rares comportements étranges que nous avons relevés sont l'exception et non la règle. Ils sont fermement condamnés par les institutions, mais aussi par les industriels du médicament qui se soucient de leur image.
L'ANSM, la HAS et l'INCa travaillent ensemble à des mesures d'adaptation pour faire face à ces situations, y compris la constitution de stocks qui seraient éventuellement « renouvelables » afin qu'ils ne se périment pas, car il peut s'agir de médicaments dont le prix unitaire n'est pas faible.
Quelles sont vos préconisations pour lutter contre ces ruptures - il peut s'agir de mesures coercitives, voire de réquisition ?
Pr Norbert Ifrah. - Nous avons listé les mesures suivantes : la consolidation d'une liste de médicaments anticancéreux d'intérêt thérapeutique majeur faisant l'objet d'un risque de pénurie ; la cartographie des sites de fabrication de matières premières et de produits finis ; le repérage des sources de tension et de pénurie ; la sécurisation de l'approvisionnement en principes actifs et en produits finis à travers différentes mesures de clarification des besoins et de renforcement de l'attractivité de notre pays pour la production et l'approvisionnement ; la constitution de stocks renouvelables, éventuellement sanctuarisés chez les industriels ; enfin, la mise en place d'une structure légère de pilotage afin d'anticiper les pénuries.
J'attire votre attention sur la relative quadrature du cercle que représentent les achats unifiés par les hôpitaux ou les établissements de soin d'un médicament. S'ils permettent d'en réduire le prix, ils ont également pour effet de faire disparaître l'intérêt de la concurrence pour ce produit. Le moindre problème technique dans la production peut alors causer de grandes difficultés. C'est le cas de certains vaccins, de médicaments anticancéreux, mais aussi des médicaments dérivés du sang et des immunoglobulines qui sont en situation de très grande pénurie en France.
Pr Dominique Le Guludec. - La reformulation du Lévothyrox® ayant été demandée par l'ANSM afin d'améliorer la biodisponibilité du médicament, elle n'est pas a priori liée à une crainte de rupture ou de pénurie.
En matière de substitution, de nombreux dispositifs ont été mis en place et les industriels ont fait des efforts de coordination. Par exemple, malgré les tensions qui existent sur leur approvisionnement, il n'y a pas eu jusqu'à ce jour de pénurie d'immunoglobulines car nous sollicitons différents fournisseurs. C'est pourquoi il est important qu'il n'y ait pas de monopole.
Lorsque j'étais médecin nucléaire dans les hôpitaux, nous avons vécu une période de tension sur l'approvisionnement de technétium, qui permet de faire de nombreux examens. Nous avons traversé cette période grâce à l'élaboration de recommandations de stratégies de priorisations et d'alternatives entre institutionnels et sociétés savantes, et à une entente rapide entre industriels pour grouper leur production et la répartir de façon homogène. Cela montre à quel point il ne faut pas être dépendant d'un seul industriel.
Les mesures de substitution portant sur les vaccins nous ont conduits à trouver des substituts ou des stratégies alternatives qui nous ont permis d'éviter des catastrophes.
Pour l'avenir, je ne peux qu'insister sur l'importance de l'anticipation, en particulier de l'augmentation de la demande, sur l'intérêt d'une entente européenne et éventuellement, de la réévaluation de produits anciens.

Ce que l'on perdrait en augmentant le prix de ces médicaments constituerait certainement une économie substantielle pour l'avenir !
Pr Dominique Le Guludec. - Je signale tout de même que la HAS n'est pas en charge des prix !
Je vous remercie de nous avoir accompagnés ce matin dans nos travaux.
La réunion est close à 12 h 45.