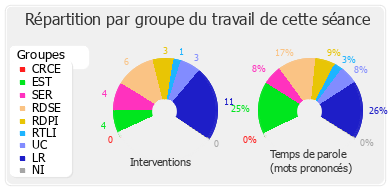Séance en hémicycle du 3 octobre 2019 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande de la délégation sénatoriale à la prospective, sur les conclusions du rapport d’information Adapter la France aux dérèglements climatiques à l ’ horizon 2050 : urgence déclarée.
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je rappelle que les auteurs de la demande disposent d’un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, l’auteur de la demande dispose d’un droit de conclusion pour une durée de cinq minutes.
Dans le débat, la parole est à M. Jean-Yves Roux, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective, auteur de la demande.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’inertie du système climatique mondial fait que l’histoire du climat des trente prochaines années est déjà écrite dans ses grandes lignes.
S’il est indispensable que tous les pays, particulièrement les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, prennent des mesures d’atténuation pour éviter un effondrement climatique dans la deuxième partie du siècle, ces mesures n’auront pas un effet immédiat sur les évolutions climatiques en cours. Toutes les prévisions montrent que nous n’éviterons pas, d’ici à 2050, un réchauffement global de l’ordre de 2 degrés par rapport à la période préindustrielle. La France doit donc se préparer à absorber un choc climatique inévitable.
Le rapport que j’ai réalisé avec Ronan Dantec décrit ce que signifie concrètement un tel réchauffement pour notre pays, nos territoires et nos concitoyens. Nous y dressons la carte de France des dérèglements climatiques à venir et de leurs impacts, notamment en matière de risques naturels, de canicule, de sécheresse des sols ou de tensions sur les ressources hydriques. Nous identifions les défis économiques, sanitaires et sociétaux que la France, dans sa diversité territoriale, devra relever pour faire face à cette situation. Enfin, nous formulons dix-huit propositions pour donner un nouvel élan à nos politiques d’adaptation climatique, notamment au niveau des territoires, car c’est en grande partie à ce niveau que se jouera le succès de l’adaptation.
Je voudrais, pour lancer le débat de notre assemblée autour de ce rapport, évoquer plus particulièrement trois enjeux.
Le premier concerne l’adaptation du bâti et de l’urbanisme.
Dans les outre-mer, le sujet central est l’évolution des normes de construction et des mécanismes d’assurance pour tenir compte d’un risque cyclonique qui va s’intensifier.
Dans les zones soumises à un risque d’inondation ou de submersion, l’évolution des normes et des mécanismes assurantiels constitue également un objectif central.
Mais c’est sur un troisième point que je voudrais surtout insister ici : l’adaptation du bâti à des vagues de chaleur plus intenses, plus longues et plus fréquentes. L’importance de cet enjeu a été soulignée par les deux canicules historiques de cet été. Il est particulièrement marqué en ville en raison du phénomène d’îlot de chaleur urbain. Il va devenir plus aigu à cause du réchauffement, mais aussi du vieillissement de la population. Or, jusqu’à présent, ce sujet est resté assez largement absent des réflexions des professionnels et des pouvoirs publics.
Nous proposons donc d’inscrire la question du confort thermique d’été au centre de la définition de la norme RT 2020. Cela peut être l’occasion d’engager l’évolution des représentations et des pratiques de l’ensemble des acteurs de la chaîne de la construction. Notre réflexion doit également inclure la question des outils et des moyens financiers nécessaires pour soutenir la transformation du bâti, notamment à l’occasion des rénovations.
Un deuxième enjeu majeur de l’adaptation concerne les politiques de l’eau.
Il y a un consensus pour dire qu’elles doivent donner la priorité à une utilisation plus économe de la ressource, ainsi qu’aux solutions fondées sur la nature, telles que la désartificialisation des sols, la restauration des haies ou la préservation des zones humides. Nous n’y parviendrons pas sans faire évoluer les mécanismes de tarification de l’eau. C’est un chantier nécessaire, mais sensible.
Cela ne se fera pas non plus sans préserver les moyens des agences de l’eau et, à ce sujet, j’attire l’attention du Gouvernement sur les dangers des mesures budgétaires de court terme.
Par ailleurs, parce que les politiques de l’eau se définissent concrètement au niveau des bassins hydrographiques, il est indispensable de mobiliser plus activement tous les acteurs concernés localement pour faire émerger, sur cette question, des visions communes et des projets de territoire. Des exercices de prospective, comme Garonne 2050, peuvent aider à enclencher ces dynamiques locales.
Enfin, il faut oser poser la question du stockage. Pourrons-nous faire face partout aux besoins uniquement par des mesures d’économie de la ressource ou d’autres qui s’appuient sur la nature ? Je n’en suis pas sûr. Il ne faut donc pas exclure a priori les solutions de stockage, mais plutôt soumettre chaque projet à une condition : faire la preuve qu’il est nécessaire et que sa réalisation ne se fait pas au détriment de solutions d’adaptation alternatives.

Je terminerai par l’adaptation de l’agriculture. Ce secteur sera le plus perturbé par le changement climatique. Pour autant, nous ne devons pas adopter une position défensive et pessimiste. J’ai la conviction que l’agriculture constitue un atout dans la transition climatique. Elle n’est pas le problème, mais une partie de la solution, si elle engage les transformations nécessaires.
En même temps, l’agriculture française est vulnérable ; elle est confrontée à une concurrence internationale féroce de pays qui ne respectent pas toujours des normes aussi exigeantes que celles qui lui sont imposées. Il n’y aura donc pas d’adaptation de notre agriculture, si nous ne soutenons pas les agriculteurs par un plan national d’adaptation.

Nous soulignons ainsi qu’il faut intégrer l’enjeu de l’irrigation de manière responsable, en développant le stockage de surface, là où il est nécessaire, mais en le conditionnant à des pratiques agricoles plus économes de l’eau et plus respectueuses de la biodiversité.
Enfin, il faut faire évoluer les mécanismes de couverture assurantielle pour qu’ils deviennent un outil incitatif qui encourage les exploitants agricoles à réaliser les efforts d’adaptation nécessaires.
Applaudissements sur des travées des groupes RDSE et Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

La parole est à M. Ronan Dantec, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la délégation, mes chers collègues, comme l’a indiqué Jean-Yves Roux, notre rapport présente, sans faux-semblant, l’ampleur des défis que notre pays doit relever pour faire face aux effets d’un réchauffement global d’environ 2 degrés en 2050 par rapport à l’ère préindustrielle.
Notre rapport n’est ni catastrophiste ni fataliste ; il est néanmoins sévère sur les retards pris dans la mobilisation des acteurs publics et des filières économiques, au-delà de quelques grandes structures scientifiques qui, pour leur part, sont engagées dans la réflexion et produisent des préconisations précises.
Il montre ainsi que les défis de l’adaptation au changement climatique ne sont pas insurmontables. Nous avançons dix-huit propositions pour la mener avec succès. Mon collègue Jean-Yves Roux a présenté plusieurs réponses sectorielles, concernant notamment l’agriculture ou le bâti. J’évoquerai pour ma part des leviers d’action plus transversaux.
Le premier d’entre eux est une mobilisation plus large des territoires dans les politiques d’adaptation.
Nous en avons fait une priorité du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique – Pnacc 2 –, en appelant les territoires à adosser un volet précis lié à l’adaptation dans leurs plans climat-air-énergie territoriaux – PCAET. Mais vous n’ignorez pas, madame la ministre, le retard pris dans leur élaboration et leur adoption. Il est plus que temps de systématiser l’engagement des territoires au-delà des quelques collectivités pionnières, car c’est à cette échelle que se construisent les réponses pertinentes.
Chaque territoire a en effet ses vulnérabilités particulières ; il a ses ressources propres et son projet de développement spécifique. L’adaptation ne peut donc pas être uniforme : elle se construit sur la base d’un diagnostic territorial précis, propose des réponses sur mesure et s’appuie sur un projet porté et partagé localement.
Pour autant, les territoires ont besoin d’accompagnement sur les méthodologies et l’ingénierie. L’État doit être à leurs côtés, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Ademe – et l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique – Onerc – ayant également un rôle très important à jouer.
Il faut aussi conforter la fonction d’orientation stratégique des régions par la généralisation de prospectives régionales sur l’excellent modèle aquitain AcclimaTerra – on ne le citera jamais assez ! – ; ces prospectives portent un diagnostic précis des évolutions prévisibles à l’échelle de la région. Nous avons besoin de démonstrateurs régionaux et de contractualisation d’objectifs d’adaptation dans les financements régionaux.
Le deuxième levier transversal de mobilisation sur lequel je veux insister est le soutien à la recherche et la simplification de l’accès aux données. Dans toutes les auditions réalisées avec le milieu scientifique, nous avons entendu le même cri d’alarme : les crédits ne sont pas à la hauteur des enjeux de connaissance ; même des crédits de coordination modestes ont été supprimés – j’ai souvent alerté le Gouvernement à ce sujet –, ce qui provoque l’incompréhension de la communauté scientifique.
Or nous avons évidemment besoin d’évaluer tous les impacts du changement climatique sur la nature, la santé et l’économie et de comprendre les évolutions dans le temps, facteur clé des stratégies d’adaptation. Nous avons donc besoin de connaissances pour nourrir notre action et nous avons surtout besoin que ces données soient rendues plus accessibles aux acteurs de terrain – c’est la clé de la mobilisation.
Nous faisons pour cela plusieurs propositions : accentuer le soutien financier à la recherche et à l’expertise scientifiques ; accorder un accès gratuit, et surtout beaucoup plus facile, aux données nécessaires à l’élaboration des politiques d’adaptation territoriales, notamment aux scénarios de Météo France. Il y a, dans le Pnacc 2, l’idée d’un grand portail d’information de l’adaptation. Il doit associer l’ensemble des services et opérateurs compétents de l’État et être un véritable guichet unique d’un service public de l’adaptation – c’est une véritable priorité.
Le troisième point essentiel concerne l’utilisation accrue du secteur assurantiel comme levier de transformation. Il faut s’engager dans une évolution des modalités de prise en charge par les assurances du coût des sinistres climatiques. Ce n’est pas seulement une question d’enveloppe globale, mais aussi de modulation des franchises et des primes. Le secteur assurantiel doit contribuer aux évolutions en cours et à l’adaptation des territoires et des acteurs. L’existence d’une sécurité, d’un parapluie, ne doit pas constituer de fait un facteur d’immobilisme et de retard dans la prise en compte des risques. Nous aurons évidemment ce débat, lorsque nous évoquerons l’extension de l’assurance agricole.
Je conclurai en évoquant une dernière proposition forte de notre rapport : un projet de loi-cadre sur l’adaptation de la France au changement climatique devrait être présenté au Parlement. Son examen pourrait être l’occasion d’inscrire enfin ce thème au cœur du débat public et d’en examiner de façon cohérente et transversale tous les aspects.
Jean-Yves Roux a cité il y a quelques instants la question de l’eau. C’est un excellent exemple. Sur ce point, sans un compromis dynamique et une compréhension mutuelle entre acteurs, nous allons à l’affrontement – nous en avons déjà de douloureux exemples.
Cette loi doit fournir le cadre de cette concertation et donnera un signal fort sur le caractère prioritaire des politiques d’adaptation, en renforçant aussi, évidemment, la place du Parlement.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à saluer la qualité de ce rapport qui dresse un constat sans appel, mais lucide, des impacts déjà observés en France et de ceux à venir. Ces constats sont cohérents avec les bilans que le GIEC, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, a dressés dans ses trois derniers rapports spéciaux parus en octobre 2018 et en août et septembre 2019.
On peut les résumer ainsi : nous devons poursuivre avec acharnement la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle, mais nous devons également nous préparer aux impacts que nos émissions passées rendent désormais inéluctables.
Je souhaite vous présenter l’action conduite par le Gouvernement et l’accélération que j’ai l’intention de lui donner.
La France est l’un des pays les plus avancés en matière de planification de l’adaptation : après une stratégie nationale en 2006, elle s’est dotée d’un premier plan d’action en 2011.
En décembre 2018, le Gouvernement a publié le deuxième plan national d’adaptation au changement climatique, le Pnacc 2. Axe 19 du plan climat, il a pour objectif général de mettre en œuvre les actions nécessaires pour adapter la France dès 2050 à une hausse de la température moyenne de la Terre de 2 degrés par rapport à l’ère préindustrielle, en cohérence avec les objectifs de l’accord de Paris, mais à un horizon temporel plus proche de façon à ne pas exclure des scénarios de changement climatique plus pessimistes.
Le Pnacc 2 comporte quatre priorités : la territorialisation de la politique d’adaptation, l’implication des filières économiques, le recours aux solutions fondées sur la nature et les outre-mer. Il comprend cinquante-huit actions réparties en six domaines : gouvernance ; prévention et résilience ; nature et milieux ; filières économiques ; connaissance et information ; international.
Les douze ministères concernés prévoient de consacrer 1, 5 milliard d’euros sur cinq ans pour engager les actions de ce plan contre 171 millions d’euros pour le précédent, enveloppe à laquelle s’ajoutent les 500 millions d’euros par an que les agences de l’eau et leurs comités de bassin ont prévu d’investir à travers leur onzième programme d’intervention 2019-2024 dans des actions d’adaptation au changement climatique.
Les leçons tirées du premier plan national d’adaptation au changement climatique nous ont montré qu’un suivi régulier du plan était nécessaire pour s’assurer de sa bonne mise en œuvre par les nombreux acteurs impliqués. C’est pourquoi il fait l’objet d’une déclinaison opérationnelle avec un programme de travail annuel présenté à la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, chargée de son suivi – elle est présidée par M. le sénateur Ronan Dantec.
Le bilan d’avancement du plan sera également présenté chaque année à la commission spécialisée et fera l’objet d’un avis du CNTE. Une série d’indicateurs de suivi est en cours en définition avec la commission spécialisée et une application informatique de suivi des actions a été développée par mes services et mise à la disposition des pilotes ministériels.
Depuis décembre dernier, de nombreuses actions ont d’ores et déjà été lancées. On peut ainsi citer : le développement avec le Cérema – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement –, l’Ademe et Météo France d’un centre de ressources sur l’adaptation au changement climatique qui sera prêt en novembre prochain ; l’intégration du climat futur dans les modélisations de la stratégie nationale bas carbone ; le suivi de l’élaboration de trois normes internationales ISO sur l’adaptation au changement climatique ; le lancement avec l’Ademe et le Commissariat général à l’égalité des territoires, le CGET, de plusieurs études ; et le renforcement des actions de prévention des risques naturels, tant en métropole qu’outre-mer.
L’élaboration du Pnacc 2 ayant fait l’objet d’une concertation de deux ans avec près de trois cents représentants de la société civile, experts, représentants des collectivités territoriales et des ministères concernés, il est cohérent avec les dix-huit propositions de la délégation à la prospective du Sénat.
On y retrouve notamment des actions relatives à l’éducation et la formation, ce qui rejoint la proposition 2 du Sénat, la volonté de synergie entre les actions d’atténuation et d’adaptation – proposition 3 –, le portage de cette problématique au niveau européen – proposition 4 –, la formation des élus – proposition 12 –, l’intégration du confort d’été dans les travaux sur la prochaine réglementation des bâtiments neufs – proposition 16 – et la question de la ressource en eau.
Il me semble cependant que nous devons accélérer nos efforts. Les épisodes récents de canicule et de sécheresse ont rappelé que la France est d’ores et déjà exposée aux conséquences du changement climatique et que notre niveau de préparation à ces impacts doit encore être amélioré.
Les territoires d’outre-mer sont particulièrement concernés par le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer. La submersion marine peut y être aggravée par les cyclones. Le cyclone Irma a également mis en lumière les risques auxquels ces territoires sont exposés.
C’est pourquoi je souhaite que le Pnacc 2 soit renforcé et que sa mise en œuvre soit accélérée. Plusieurs actions nouvelles ou anticipées seront donc lancées.
Je souhaite tout d’abord qu’un retour d’expérience exhaustif des deux épisodes de canicule de 2019 soit réalisé. Il permettra de vérifier si le contexte législatif et réglementaire actuel est suffisant pour anticiper les impacts présents et à venir du changement climatique. Il permettra également d’analyser la façon dont le plan national canicule pourrait être étendu aux impacts autres que sanitaires selon les niveaux de vigilance de Météo France.
La question du confort d’été devra également être intégrée dans le champ des réflexions en cours sur la rénovation des bâtiments publics. Un kit d’information ainsi qu’un parcours de formation seront proposés aux nouveaux élus communaux et intercommunaux en 2020 dans le cadre de leur droit à la formation.
La prévention des risques naturels est évidemment un enjeu crucial. Bientôt dix ans après la tempête Xynthia, nous ferons un point des nombreuses actions conduites et de ce qui doit être renforcé dans un contexte de hausse accrue du niveau des mers que le récent rapport du GIEC a bien mis en valeur la semaine dernière. Je veillerai à ce que les moyens requis, qui bénéficient en premier lieu aux collectivités locales, acteurs majeurs de la prévention des risques, soient préservés, accrus si besoin, et utilisés le plus efficacement possible au travers du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le FPRNM.
Enfin, pour les territoires de montagnes, nous allons finaliser un plan de prévention des risques d’origine glaciaire et périglaciaire.
Les suites du Livre bleu des outre-mer mettent en avant la question de l’encadrement des constructions pour diminuer la vulnérabilité aux cyclones.
Je souhaite aussi que la résilience de nos systèmes de transports, déjà dotés de plans de continuité, entre autres, à la SNCF et à la RATP, soit renforcée au niveau des infrastructures, des matériels et de la gestion des pics de chaleur.
Des actions sont conduites sur les réseaux électriques, tant pour les situations de forte chaleur que pour celles liées à des inondations. Un bilan sera utilement conduit pour voir si des accélérations sont nécessaires.
Et nous avons bien d’autres idées ; je ne les citerai pas maintenant, mais je pourrai le faire durant notre débat.
Je tiens à saluer la qualité du rapport présenté par MM. les sénateurs Dantec et Roux. C’est un sujet transversal qui concerne l’ensemble des ministères ; ils doivent naturellement être mobilisés, mais le Gouvernement ne pourra pas à lui seul réussir l’adaptation de la France au changement climatique. Je souhaite une mobilisation de tous les acteurs. Le rôle des collectivités territoriales, que ce soit à travers les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou les plans climat-air-énergie territoriaux, doit être rappelé et soutenu.
Il pourrait être utile de faire un point régulier sur ces aspects, par exemple en organisant un séminaire annuel à destination des collectivités locales et de leurs associations, ainsi que des parlementaires intéressés.
Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement mobilisé pour réussir l’adaptation de notre pays au changement climatique.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et Les Indépendants, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
Dans le cas où l’auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires à la condition que le temps initial de deux minutes n’ait pas été dépassé.
Dans le débat interactif, la parole est à M. Guillaume Gontard.

L’adaptation au réchauffement climatique est une nécessité que j’ai envie d’illustrer par un sujet concret.
Ce week-end, j’étais invité à la pendaison de crémaillère d’un logement particulièrement intéressant : un bâtiment comportant plusieurs logis, intégré dans son environnement, économe en foncier, écologique et local.
Ses matériaux sont issus du territoire : du bois de nos forêts, des blocs de chanvre pour les murs, de la terre issue des fondations pour les enduits et une toiture végétalisée intégrant des panneaux solaires et permettant la récupération d’eau. Ces matériaux biosourcés, trouvés sur place, peu chers, peu transformés, dont le bilan carbone est extrêmement faible, permettent de stocker des quantités de carbone considérables.
Ces logements passifs, grâce à une isolation performante qui procure un confort thermique inégalable été comme hiver, ne nécessitent pas ou peu de chauffage. Cette maison respire, son hygrométrie lui permet de rafraîchir et d’assainir l’air ambiant. Pas besoin de système de ventilation gourmand en énergie ni de climatisation.
Et si, demain, cette maison devait être démolie, elle retournerait là d’où elle vient, le sol ! Pas ou peu de déchets, puisque ces matériaux complètement biodégradables termineront leur cycle.
Pour l’alimentation, nous utilisons l’expression « du champ à l’assiette », ici, ce serait plutôt « du champ au logis », avec la création de formes architecturales propres à chaque territoire, s’éloignant de l’uniformisation qui a déjà gommé les spécificités de nos régions.
Ces habitations, madame la ministre, n’ont rien d’exceptionnel ; elles relèvent simplement du bon sens, principe qui est cher à cette assemblée. Et pourtant, ce type de construction est encore marginal. Il est nécessaire de lever les obstacles pour créer de véritables filières locales, faciliter la labélisation et la délivrance d’avis techniques pour ces matériaux, accompagner la mise en place d’une gestion durable de la ressource en bois, valoriser l’utilisation de la paille ou la culture du chanvre encore entravée par une réglementation absurde, ou encore adapter la formation des artisans en lien avec les besoins et les capacités de leur territoire plutôt qu’avec la standardisation des géants du BTP.
Il s’agit d’une réponse concrète et d’une politique sociale et écologique, une politique qui peut être développée à l’échelon local à condition que l’ingénierie et les moyens financiers soient disponibles.
Développer des filières de matériaux biosourcés présente un intérêt évident, à la croisée des enjeux d’atténuation et d’adaptation, et la France avance sur ces sujets.
Par exemple, s’agissant du chanvre, nous sommes le premier pays producteur en Europe avec 50 % de la surface totale cultivée et 1 280 agriculteurs concernés. C’est une ressource très intéressante qui repose sur une agronomie saine, efficace et sans produits phytosanitaires et qui permet d’améliorer la capacité en eau des sols, en les fractionnant en profondeur. Le chanvre peut être utilisé à la fois pour l’alimentation, pour le béton avec ses tiges et pour l’isolation avec son enveloppe extérieure. Par ailleurs, cette production en circuit court fournit des emplois qui sont non délocalisables.
Je pense que la France pourrait se fixer l’objectif de devenir leader dans ce domaine. Je précise que l’État investit beaucoup pour les produits biosourcés : ainsi, 200 000 euros sont prévus dans le programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique.
La construction en bois présente aussi de nombreux atouts : c’est un levier de développement économique des territoires ruraux et forestiers qui permet de stocker du carbone, ce qui constitue un levier important pour nos objectifs de neutralité carbone.
C’est pourquoi la France s’est dotée, en 2017, d’un cadre stratégique pour l’ensemble de la filière au travers du programme national de la forêt et du bois qui précise les orientations stratégiques liées à la forêt et à l’ensemble de la filière bois. Les objectifs sont ambitieux : adapter les forêts au changement climatique, conserver le potentiel d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et sécuriser en qualité, en quantité et en régularité les approvisionnements en bois de l’industrie.
La nouvelle réglementation environnementale des bâtiments permettra de valoriser le stockage du carbone biogénique dans l’évaluation environnementale des bâtiments neufs.
Je pense que nous pouvons encore progresser en la matière et nous devrons suivre avec attention la mise en œuvre de ce programme.

Je n’ai pas pris le temps de le faire dans ma question, mais je tiens à saluer le rapport présenté par la délégation sénatoriale à la prospective.
Madame la ministre, depuis trente ans, les choses avancent en ce qui concerne la transition en matière énergétique et agricole, ainsi qu’en matière de mobilités – vous êtes bien placée pour connaître ce sujet –, mais nous sommes encore à la traîne pour le bâti. Ainsi, notre pays importe encore beaucoup de bois, alors que nous sommes un pays forestier.
Pourtant, nous avons à notre disposition des solutions écologiques, sociales et locales qui constituent souvent des opportunités pour nos territoires. Il est donc temps de mettre en œuvre, en lien avec les collectivités locales, un véritable plan national en faveur du secteur du bâtiment.

J’aimerais à mon tour remercier Ronan Dantec et Jean-Yves Roux pour la qualité du travail qu’ils ont accompli avec la délégation à la prospective et pour l’ensemble des propositions qui sont présentées dans leur rapport. Leur travail, que nous devrons faire partager à nos concitoyens, va être extrêmement utile ; leurs propositions devront être approfondies et adaptées à nos territoires. La perception de ces sujets est en train d’évoluer et ce type de document est très utile pour cela.
Il ne faut plus tarder ! Les nouveaux modèles de simulation numérique du climat évoquent un réchauffement pouvant aller jusqu’à 7 degrés en 2100 – c’est ce qu’une récente étude a montré – et, même si certains sont sceptiques, nous savons dorénavant que la vie va devenir insoutenable. Nos sociétés doivent donc changer et ce rapport comme les réponses du Gouvernement vont dans le bon sens pour mutualiser les connaissances et traiter les sujets qui nous préoccupent comme la submersion marine ou l’érosion des côtes.
Madame la ministre, ma question concerne les outre-mer : comment mieux prendre en compte les sentinelles avancées que sont ces territoires ?
Hier matin, j’étais sur les îles Glorieuses, après être passé les jours précédents par les îles de Juan de Nova et d’Europa, dans le canal du Mozambique. Ces endroits sont de véritables merveilles du monde et constituent des sentinelles avancées pour la protection de la biodiversité et l’observation du réchauffement climatique. Les savants et militaires qui y travaillent sont des passionnés et des défenseurs de la souveraineté de la France ; en même temps, ils sont au cœur des préoccupations qui sont les nôtres : le réchauffement de l’eau, l’absence d’eau douce, les pertes animales…
La France a une responsabilité particulière en raison de ses territoires ultramarins qui sont répartis sur l’ensemble de la planète, dont les îles Éparses que je viens d’évoquer.
Je partage tout à fait ce que vous avez dit. Effectivement, le dernier rapport du GIEC sur les océans et la cryosphère montre que le besoin d’adaptation est urgent. Ce rapport est dans un sens assez effrayant, puisqu’il nous indique que, même si nous n’émettons plus un gramme de CO2 à partir d’aujourd’hui, l’effet des émissions antérieures sur des systèmes inertes comme les océans nous oblige tout de même à gérer un certain nombre de conséquences inéluctables pour le siècle actuel, et, sans doute, pour les suivants.
Cette action d’adaptation doit être menée avec beaucoup de détermination, notamment dans les outre-mer, qui sont particulièrement concernés. Chacun a en tête la catastrophe Irma, il y a deux ans. Quand ce rapport du GIEC a été présenté par les scientifiques dans mon ministère, le ministre de l’environnement de la Polynésie française était présent. Or, dans ce territoire, un certain nombre d’atolls sont appelés à disparaître.
Nos outre-mer sont donc en première ligne sur ces questions d’adaptation au changement climatique, mais, en même temps, ils doivent être à l’avant-garde des solutions à développer, fondées sur la nature. Je pense aux mangroves, aux récifs de corail, qui sont au cœur des réflexions que mènent les collectivités. Il faut appuyer ce mouvement.

Ronan Dantec et Jean-Yves Roux ont brillamment restitué, le 16 mai dernier, devant la délégation à la prospective, leurs travaux concernant les dérèglements climatiques. Les impacts du réchauffement sont ciblés, cartographiés selon les différentes régions de France, exposant clairement ce à quoi l’on peut s’attendre d’ici à 2050 et après.
Considérant l’urgence et la nécessité du concours de chacun pour lutter contre les conséquences dramatiques du changement climatique, madame la ministre, ne pensez-vous pas qu’il faille créer une compétence « réchauffement climatique » dévolue à l’État, aux régions, aux départements, aux EPCI et aux communes, afin que chacun saisisse dès maintenant l’occasion d’anticiper et d’intégrer ces changements dans tout projet ? Par exemple, il faudrait permettre aux communes, à l’occasion de travaux ou de constructions, de prévoir des ouvrages de drainage ou de stockage d’eau, qui atténueront les inondations ou alimenteront les sites arides.
Votre ministère peut, dès à présent, donner ses directives sans perdre des années dans l’élaboration d’un énième schéma régional. Certaines actions sont aussi simples qu’urgentes, et je crois qu’il serait judicieux de compter sur le bon sens local, celui des communes et des intercommunalités, notamment, pour mettre en place, au fur et à mesure de leurs réalisations, les moyens de lutter contre des fléaux parfois déjà installés. Encore faut-il leur en donner la compétence, les inciter et les accompagner financièrement dès à présent.
Comme l’indique le rapport, les sujets de l’adaptation et de l’atténuation sont éminemment transversaux, et touchent l’ensemble des compétences et des secteurs. La priorité est bien de coordonner les différentes actions en la matière.
Les compétences sont aujourd’hui déclinées aux différents niveaux de collectivités. J’en suis convaincue, la réussite de l’adaptation au changement climatique passe par une mobilisation non seulement de l’État, mais aussi des régions et des intercommunalités. Précisément, la loi NOTRe a confié aux régions l’élaboration d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un Sraddet, dans lequel doivent figurer les orientations sur l’adaptation au changement climatique.
De leur côté, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants doivent élaborer un plan climat-air-énergie territorial, un PCAET, avec une série d’actions pour se préparer aux impacts du changement climatique.
En tant que chefs de file climat-air-énergie, les régions ont naturellement vocation à animer, sur leur territoire, la thématique de l’adaptation au changement climatique.
Par ailleurs, s’agissant des projets, ceux qui ont des impacts sur l’environnement doivent être accompagnés d’une évaluation environnementale et stratégique, puis faire l’objet d’une consultation du public avant d’être autorisés. Depuis 2016, cette évaluation doit, en particulier, analyser les incidences du projet sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique. Ce diagnostic est nécessaire pour identifier et anticiper les fragilités des aménagements et de leurs usages. Cela permet ensuite de prévenir les dommages consécutifs au changement climatique sur les infrastructures en les adaptant.
Vous le voyez, nous avons aujourd’hui les outils ; maintenant, il faut passer aux actes !

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse encourageante. Comme on l’a fait pour la mise en œuvre de l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées, il faudrait rendre systématique la prise en compte des effets du changement climatique pour tous les marchés publics, puis, en conséquence, pour les travaux dans toutes les collectivités.
Au-delà du soin apporté à la qualité des bâtiments, il faut se prémunir aujourd’hui des inondations, de l’assèchement, de la disparition de nos forêts, car les scolytes et autres parasites y font actuellement des ravages incommensurables. Il nous faut donc agir conjointement et immédiatement en libérant les actions locales.

Que cela nous plaise ou non, il faut faire la révolution, en commençant par nos grandes villes, nos métropoles. Pendant des années, pour éviter le mitage des territoires, on nous a recommandé de construire en hauteur, de manière très dense. Bref, il fallait faire en sorte que les villes ne prennent pas d’espace. Résultat des courses : aujourd’hui, le réchauffement climatique est un drame dans ces villes. Très logiquement, on nous dit désormais qu’il faut des poumons verts et la présence d’eau pour que les villes respirent.
C’est donc une inversion des demandes par rapport à celles qui étaient adressées aux métropoles et aux grandes villes voilà vingt ou trente ans. Or, si tous les textes votés ces dernières années sur le logement et l’urbanisme traitent de la soutenabilité financière de la construction ou de l’équilibre urbain entre les quartiers, en réalité, très peu de textes sont extrêmement clairs et précis sur la capacité de nos métropoles à respirer mieux, à subir, à supporter le réchauffement climatique.
Madame la ministre, est-ce que le Gouvernement envisage des modifications des textes sur le logement et l’urbanisme, ce qui impliquera, évidemment, pour les collectivités, des modifications de leurs règlements d’urbanisme et de construction ?
Vous soulevez un vaste sujet : finalement, au regard des enjeux de climat et de biodiversité, vaut-il mieux poursuivre une politique pour une ville dense ou faut-il y renoncer, donc accélérer une politique d’étalement urbain, ce qui ne me semble favorable ni au climat ni à la biodiversité ?
Pour ma part, je suis convaincue qu’il faut, avec détermination, et en articulation avec les régions dans le cadre de leur Sraddet, avec les intercommunalités dans le cadre de leur réflexion sur la planification urbaine, lutter contre l’artificialisation des sols. Ces modèles sont néfastes pour la biodiversité et entraînent des modes de vie qui sont extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre. On a pu voir aussi qu’ils peuvent être très coûteux pour nos concitoyens.
Cependant, il faut très certainement mener cette réflexion sur la conception de nos villes denses en intégrant mieux ces enjeux de « renaturation » et de circulation de l’air dans les espaces urbains. C’est ce que fait le Gouvernement avec la thématique « La nature en ville ». Cela recouvre différents dispositifs techniques liés au végétal, à l’animal, à l’eau et aux sols, qui offrent des atouts pour les habitants en matière de bien-être, de qualité de l’air, de fraîcheur et de paysages. Cela concourt aussi à atteindre nos objectifs en faveur de la biodiversité.
J’y insiste, ces modèles de ville doivent être repensés pour s’adapter au changement climatique et favoriser une plus grande biodiversité en ville.

Madame la ministre, je suis d’accord avec vous, mais alors, il faut prendre les mesures nécessaires. Aujourd’hui, les communes qui veulent végétaliser, notamment les toits des immeubles – j’en connais beaucoup dans les Hauts-de-Seine –, n’ont pas le sentiment d’être très accompagnées ni au niveau réglementaire ni au niveau financier. Il faut probablement que la réflexion sur le maintien des villes telles qu’elles sont – on ne va pas les démolir pour les étendre – débouche sur une vraie politique dynamique et une vraie sensibilisation de nos élus, qui, jusqu’ici, construisaient dense, étant moins tournés vers la respiration.

Le dernier rapport du GIEC du 26 septembre nous alarme sur l’augmentation du niveau de la mer et des océans. La France figure parmi les zones géographiques les plus menacées par la submersion et l’érosion des côtes.
Notre pays compte en effet de nombreux kilomètres de littoral. Aujourd’hui la densité de population est 2, 4 fois plus élevée sur le littoral que la moyenne nationale et, d’ici à 2040, d’après l’Observatoire national de la mer et du littoral, 40 % de la population vivra sur les bords de mer.
Je salue le rapport de la délégation, qui permet de donner une vision globale de l’ensemble des défis auxquels la France et le reste du monde devront faire face d’ici à quelques années, et qui nous donne également l’occasion d’interpeller le Gouvernement sur les risques climatiques et la gestion des catastrophes naturelles.
En effet, avec les dérèglements climatiques, les catastrophes naturelles, qui sont souvent définies comme des épiphénomènes, vont devenir de plus en plus courantes dans les années à venir. Les Français et les élus locaux sont déjà, et seront de plus en plus confrontés aux dérèglements climatiques, et donc aux aléas climatiques comme les tempêtes, les sécheresses, les inondations, etc.
Au vu de ces enjeux et de ces défis, il semble crucial de réorienter les politiques publiques dès maintenant et d’investir dans le service public pour protéger et accompagner les populations et les élus des territoires.
C’est pourquoi les dispositifs de prévention et d’accompagnement des élus locaux et des sinistrés doivent être placés à la hauteur des enjeux.
Les changements climatiques entraînent des bouleversements profonds de nos écosystèmes au-delà des nécessaires évolutions de nos modes de vie ; ils bouleversent toute l’organisation de notre société.
Madame la ministre, à quand des politiques ambitieuses, qui permettront d’accompagner ces changements en faisant les efforts nécessaires pour prévenir les conséquences du dérèglement ?
C’est tout l’objet du plan national d’adaptation au changement climatique de prévenir l’ensemble des conséquences, que l’on sait désormais inéluctables, de ce réchauffement climatique, que l’on peut d’ores et déjà constater.
Je le répète, il faut mener avec détermination nos politiques d’atténuation. C’est tout le sens des objectifs de neutralité carbone, qui sont désormais inscrits dans la loi énergie-climat, et qui se déclinent non seulement dans cette dernière, en ce qui concerne la rénovation thermique et la lutte contre les passoires thermiques, mais aussi dans la loi sur les hydrocarbures, la loi d’orientation sur les mobilités ou la loi Égalim, qui propose des mesures importantes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Dans le même temps, les mesures proposées par le plan national d’adaptation au changement climatique sont tout aussi indispensables. Vous le savez, l’État agit pour accompagner nos concitoyens face à ces risques naturels qui peuvent s’aggraver. C’est le cas, par exemple, avec la surveillance des cours d’eau, des prévisions étant publiées sur le site Vigicrues. Près de 12 000 communes sont également couvertes par un plan de prévention des risques. Enfin, l’État accompagne aussi les communes avec le fonds Barnier, qui est un outil majeur de financement de la politique de prévention des risques naturels. Il apporte en effet un soutien aux actions des collectivités locales. À ce titre, il sera un levier très important, alors que nous devons nous préparer à des risques croissants, tels que les crues ou les subversions marines, en raison du dérèglement climatique.

Je remercie Mme la ministre de sa réponse. Je suis d’accord, le fonds Barnier est un outil majeur de prévention. Nous aurons l’occasion de vérifier s’il n’est plus ponctionné à l’avenir comme il l’a été jusqu’à présent dans le cadre des lois de finances. Il doit vraiment servir à mettre en œuvre les plans de prévention nécessaires au regard des problématiques climatique.

Le rapport de nos collègues Jean-Yves Roux et Ronan Dantec apporte un éclairage précis sur les conséquences des dérèglements climatiques auxquels notre pays devra faire face dans les prochaines décennies.
Parmi ces dérèglements figure la survenue de vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus sévères.
Nous en avons vécu deux successives cet été, qui ont aggravé une situation de sécheresse déjà bien présente depuis l’an dernier. Nos agriculteurs peuvent malheureusement en témoigner. Le rapport confirme ce que nous craignons tous : une augmentation de l’intensité, mais aussi de la durée, de la sécheresse des sols, qui passerait de deux mois actuellement, soit de mi-juillet à mi-septembre, à quatre mois d’ici à 2050, c’est-à-dire de mi-juin à mi-octobre. Et je parle ici de moyennes, puisque des restrictions d’eau sont encore imposées aujourd’hui dans bon nombre de départements.
Le 21 août, le ministère de l’agriculture a autorisé l’exploitation des terres en jachère pour nourrir les bêtes, en raison de niveaux de stocks de fourrage particulièrement bas. Aujourd’hui, au-delà de ces mesures d’urgence, il est indispensable de penser et de mettre en œuvre des solutions à long terme pour garantir la survie de l’agriculture française, qui est un modèle pour de nombreux pays.
Parmi les idées qui émergent figurent les retenues d’eau, ou retenues collinaires. Ces structures sont destinées à recueillir l’eau de pluie et de ruissellement, notamment en automne et en hiver, pour la restituer à l’agriculture lorsque la pluie se fait plus rare. Une soixantaine de retenues devraient être autorisées par le ministère d’ici à 2022.
Ma question est donc double : pensez-vous que le stockage de l’eau soit la solution appropriée à encourager ? Plus largement, pensez-vous qu’en raison du changement climatique profond que nous vivons, il faudra, dans certaines régions, envisager une évolution globale des pratiques agricoles ?
Vous avez raison de souligner que l’agriculture est un des secteurs particulièrement exposés au dérèglement climatique et aux modifications hydrologiques qui l’accompagnent. Je pense qu’il est important, et même essentiel, de réduire la vulnérabilité de l’agriculture à un risque accru de manque d’eau dans ce contexte. Vous le savez, le Gouvernement porte une attention particulière à la gestion durable de la ressource en eau. C’est tout le sens des travaux menés dans le cadre des Assises de l’eau, qui ont permis de donner les grandes orientations sur les politiques publiques relatives à la gestion de la ressource.
Le Gouvernement veillera à ce que l’instruction de mai 2019, publiée conjointement par mon ministère et le ministère de l’agriculture, soit suivie d’effets sur l’ensemble de ces points, plus particulièrement sur le volet relatif à la recherche d’économies d’eau et d’adaptation des cultures. Les services de l’État sont mobilisés pour accompagner les territoires dans l’élaboration de projets de territoire pour la gestion de l’eau, les PTGE.
Il est indispensable que toutes les solutions soient considérées. La recherche de sobriété et d’optimisation de l’utilisation de l’eau passe notamment par des réflexions sur des variétés mieux adaptées aux territoires, les solutions de stockage ou de transfert, et donc sur la transition agroécologique, qui est porteuse de solutions pour une meilleure résilience de l’agriculture face aux changements climatiques.
Sur votre question très précise des retenues collinaires, je dirai que, d’une manière générale, le stockage artificiel de l’eau est une solution possible, parmi d’autres, pour répondre au problème du décalage dans le temps entre la disponibilité de l’eau et les besoins des cultures. Parmi les stockages artificiels, les retenues collinaires sont souvent préférables à des barrages en cours d’eau, un tel dispositif ayant, dans la plupart des cas, moins d’impact. Cependant, il ne faut pas oublier que cela a aussi un effet non négligeable sur le cycle de l’eau. Aussi, avant d’examiner ces solutions de stockage, il faut donc, au préalable, examiner toutes les solutions de sobriété.

J’étais hier au Sommet de l’élevage, à Clermont-Ferrand, avec le ministre de l’agriculture, et je voudrais insister sur la détresse actuelle des agriculteurs, qui ont besoin d’une politique claire, notamment en matière de stockage de l’eau et d’irrigation potentielle. Hier, j’ai ressenti une grande frustration de leur part, et je voulais ici m’en faire le porte-parole.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà quelques semaines, les images de l’Amazonie en feu ont fait le tour du monde, suscitant l’indignation internationale. Pour faire miennes des paroles si souvent prononcées ces derniers jours, je dirai que notre maison brûlait, mais que, cette fois-ci, nous la regardions brûler en direct. Dans cette même maison, en Guyane, nous sommes en guerre contre l’orpaillage illégal, véritable fléau environnemental, économique et social.
L’émotion passée, chacun s’interroge sur les conséquences terribles de ces incendies sur le climat.
La première est évidemment la libération dans l’air d’une très grande quantité de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. C’est aussi la destruction de puits de carbone essentiels et de réserves de biodiversité exceptionnelles.
La forêt amazonienne régule en partie, par son rôle fondamental dans le cycle hydrologique du bassin amazonien, le climat non seulement de l’Amérique du Sud, mais aussi du monde entier. L’assèchement provoqué par la déforestation et les feux dégrade enfin les cycles de l’eau et du climat.
Selon certains scientifiques, la multiplication des grandes sécheresses exposerait l’Amazonie à un risque de « savanisation » qui, si elle advenait, tomberait comme un couperet sur la lutte contre le réchauffement climatique.
Pour être clair, on estime aujourd’hui qu’une déforestation de 20 % à 25 % de l’Amazonie pourrait faire basculer fatalement son climat. À ce jour, la forêt aurait déjà été détruite à plus de 19 % depuis 1970.
Dans l’esprit du rapport présenté par notre délégation à la prospective, dont je veux saluer la qualité, j’estime que cette politique d’adaptation constituerait une possibilité de développement pour la Guyane.
Aussi, madame la ministre, comment la France peut-elle déployer en Guyane des politiques d’adaptation afin de préserver ce bien commune qu’est l’Amazonie ?
Effectivement, les images d’incendies en Amazonie ont ému toute la communauté internationale. C’était, si j’ose dire, une bonne chose, car cela a contribué à faire de la protection de l’Amazonie, et plus généralement des forêts équatoriales, un thème important du G7 de Biarritz. Ce sujet était également à l’ordre du jour du sommet sur le climat en amont de la dernière Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre.
Cette crise que connaît la forêt amazonienne, ainsi que, de façon générale, toutes les forêts tropicales, nous alerte, une fois de plus, sur le lien très fort entre les questions de lutte contre le dérèglement climatique et les problèmes de biodiversité.
La lutte contre la déforestation est un enjeu majeur. Vous le savez, la France est un des premiers pays à s’être doté d’une stratégie nationale contre la déforestation importée. Le Président de la République a eu l’occasion d’aborder ce sujet dans l’enceinte des Nations unies, en souhaitant que le « zéro carbone » et le « zéro déforestation » soient l’horizon des futurs accords commerciaux.
Il faut agir dès maintenant. À cet effet, le service « valorisation économique de la biodiversité », qui a récemment ouvert en Guyane, a vocation à apporter son appui pour, à la fois, permettre un développement de nos territoires et lutter contre la déforestation qui affecte encore trop souvent nos forêts équatoriales.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ma question concerne la raréfaction de la ressource en eau.
Le rapport Explore 2070 montre que la baisse de la recharge des nappes phréatiques est déjà amorcée. Deux territoires sont particulièrement affectés : le sud-ouest, dont mon département, le Lot-et-Garonne, fait partie, avec une perte de 30 % à 50 %, et le bassin de la Loire, avec une baisse de 25 % à 30 %.
L’étude Garonne 2050, menée par l’agence de l’eau Adour-Garonne de 2010 à 2013, nous apprend que ce bassin connaît un déficit annuel de 200 millions de mètres cubes. Cette étude révèle aussi que, si des mesures immédiates ne sont pas prises, cela entraînera des conflits entre les différents usagers. Ainsi, tous les usages de l’eau, c’est-à-dire la consommation humaine, l’agriculture, le tourisme, la préservation des milieux aquatiques, seront affectés.
La France est pourtant un pays d’abondance hydrique, grâce à son climat tempéré et à la multitude de ses fleuves et de ses montagnes.
Pour améliorer le rapport entre les besoins et les ressources, on pourrait engager plusieurs actions simultanées : inciter financièrement à la réduction de consommation d’eau ; partager la ressource entre les territoires où elle est plus ou moins abondante ; encourager le recyclage ; développer le stockage de l’eau en hiver avec la construction de nouvelles retenues collinaires et de haute montagne et le développement de nouvelles techniques de recharge des nappes phréatiques.
Les sécheresses survenues pendant les étés de 2018 et de 2019 sont la démonstration que l’idéologie anti-irrigation, anti-stockage de l’eau ne peut être une réponse adaptée face aux aléas climatiques que nous connaissons.
Madame la ministre, ne pensez-vous pas que faire obstacle de manière vertueuse à l’écoulement de l’eau est une nécessité absolue pour conserver une agriculture permettant de nourrir les populations et maintenir des étiages suffisants pour préserver la faune et la flore de nos fleuves, de nos rivières et de nos ruisseaux ?
Très clairement, le Gouvernement n’est pas dans une posture anti-irrigation ou anti-stockage d’eau.
Je voudrais rappeler que l’instruction conjointe du ministère de l’agriculture et de mon ministère, qui date du mois de mai, et qui est le résultat des concertations et des travaux menés dans le cadre des Assises de l’eau, prévoit bien l’élaboration de projets de territoire pour la gestion de l’eau dans une approche globale.
Vous avez bien mentionné la variété des usages et des besoins de l’eau, que ce soit pour l’alimentation en eau potable, pour le maintien de la biodiversité, ce qui suppose un certain niveau d’étiage dans les cours d’eau, pour la lutte contre les incendies, autre enjeu important découlant lui aussi du réchauffement climatique, ou pour l’agriculture.
Nous devons bien évidemment apporter des réponses à nos agriculteurs pour leur permettre de mener durablement leur activité dans de bonnes conditions.
Je le redis, tout le sens des projets de territoire pour la gestion de l’eau, c’est d’analyser l’ensemble des besoins en eau et de conduire une réflexion, qui passera, nécessairement, par l’examen de pistes pour atteindre une plus grande sobriété. Nous pouvons y parvenir en investissant, par exemple, dans des matériels agricoles ou en choisissant des variétés de plantes plus adaptées aux terroirs. Ces préalables réalisés, nous pourrons ensuite, et ensuite seulement, travailler à des projets de stockage d’eau, notamment sous forme de retenue collinaire. Nous devons aussi nous assurer de la sécurisation juridique de ces projets. En effet, j’ai bien conscience qu’ils ont fait l’objet de contestations dans de nombreux territoires.
C’est donc dans cette démarche que le Gouvernement se place pour avancer sur ce sujet.

Selon l’Agence parisienne du climat et Météo France, la Ville de Paris va être particulièrement impactée par le dérèglement climatique. Du fait de son tissu urbain très dense, la ville génère un microclimat urbain dit « îlot de chaleur urbain » – mon collègue Roger Karoutchi en a parlé. Les augmentations de températures de 2 à 4 degrés prévues d’ici à 2050 et les canicules de plus en plus fréquentes seront donc encore plus difficiles à vivre pour les Parisiens.
En outre, d’après une étude de septembre 2019 de Se Loger, Paris est la ville française où l’isolation et la consommation énergétique des logements laissent le plus à désirer, avec une consommation annuelle moyenne d’énergie de 242 kilowattheures au mètre carré, soit une étiquette énergie E. En période de canicule, comme en période de vague de froid, la majorité des Parisiens peinent déjà à maintenir leur logement à une température décente, et je parle en connaissance de cause !
Les contraintes administratives, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique de copropriété, n’améliorent pas cette situation. En effet, seuls des travaux de rénovation énergétique pourront garantir aux Parisiens un confort d’été et d’hiver. Il est donc indispensable que l’État maintienne et intensifie les outils d’incitations.
Je m’étonne donc de l’inscription dans le projet de loi de finances de la transformation du CITE en une prime attribuée en fonction des revenus des ménages. Ce nouveau dispositif ne va pas dans le sens de la lutte contre les passoires énergétiques et de l’objectif fixé par le Gouvernement, qui prévoit 500 000 rénovations énergétiques de logements par an. L’exclusion de cette prime des ménages des deux derniers déciles de revenus – soit des foyers propriétaires plus enclins à réaliser les travaux que les locataires – et l’absence totale d’aide à la rénovation globale, pourtant la plus efficace, détourne cette réforme de son objectif initial.
Madame la ministre, ma question est donc la suivante : comment le Gouvernement entend-il inciter les Français à adapter leur logement aux changements climatiques sans leur fournir des outils efficaces pour rénover énergétiquement leur habitation ?

À 10 000 euros le mètre carré, les propriétaires parisiens peuvent payer !
La rénovation thermique des logements est au cœur de notre politique d’atténuation et d’adaptation, tout comme la lutte contre les îlots de chaleur dans nos grandes métropoles. Je peux donc vous assurer de la détermination du Gouvernement à avancer. Certains outils ont d’ailleurs été prévus dans la loi Énergie-climat, notamment la sortie des passoires thermiques à l’horizon de 2028.
Les évolutions des dispositifs d’aides que vous mentionnez visent à renforcer l’efficacité et à accélérer la rénovation énergétique de nos logements. Aujourd’hui, j’en conviens, mener ces projets de rénovation énergétique relève un petit peu du parcours du combattant pour les citoyens.
Pour avoir été préfète de région, je sais la difficulté de traiter un dossier pour lequel il faut conjuguer des aides de l’ANAH, le C2E, les aides des collectivités, le préfinancement du CITE… Tout cela manque de fluidité.
La réforme portée par le Gouvernement vise donc à simplifier les aides et à les rendre plus lisibles. Le contribuable n’aura plus à faire l’avance en attendant le versement, l’année suivante, du crédit d’impôt, car il sera transformé en prime.
Soucieux de porter ces politiques au plus près des territoires, l’État a annoncé que les services de conseil et d’accompagnement seraient dotés de moyens et que 200 millions d’euros de C2E vont être mis à disposition des plateformes de rénovation énergétique.
Je le répète, la détermination du Gouvernement est totale. Nous avons besoin d’un système plus simple, plus juste et plus efficace vers lequel les dispositions contenues dans le projet de loi de finances permettront de tendre.

Je tiens moi aussi à saluer la qualité du rapport de nos collègues. Grâce à eux, nous pouvons dire que le plus dur reste à faire.
Je souhaite intervenir sur un thème qui vient d’être abordé par ma collègue, celui des passoires énergétiques.
Faute d’avoir les moyens de s’adapter, les premières victimes de cette fracture énergétique restent les plus précaires. Le dérèglement climatique accentue l’inégalité sociale. Je le dis après avoir pris connaissance de plusieurs études selon lesquelles certains de nos compatriotes s’interrogent sur le point de savoir si la priorité revient à la question sociale ou à l’aspect climatique. Les deux sujets étant liés, il faut répondre aux deux !
J’ai choisi cet exemple à dessein : lors de la campagne présidentielle, le programme du candidat Macron annonçait que 7, 4 millions de logements seraient interdits à la location à partir de 2025, le but étant de mettre fin aux passoires énergétiques. Or le dispositif mis en œuvre par la loi Énergie-climat a repoussé cette obligation à 2028, tout en évoquant l’éventualité de prendre certaines sanctions, qui restent aujourd’hui floues et ne sont donc pas clairement inscrites dans le marbre.
Quant au financement prévu, madame la ministre, vous avez évoqué l’amélioration du dispositif, qui deviendrait plus lisible. Pour autant, le montant n’est pas au rendez-vous. Les 14 milliards d’euros annoncés sur cinq ans sont loin de l’investissement nécessaire, estimé à 7 milliards d’euros par an par Institute for climate.
Outre ce que vous avez déjà annoncé à propos du projet de loi de finances, ma question est simple : au-delà des mots et de la volonté de simplifier, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre dorénavant pour permettre aux Français de mettre fin à leur passoire énergétique ?
Je vous rassure, monsieur le sénateur, il y aura un débat sur la loi de finances.
La rénovation thermique des logements est très importante dans notre politique d’adaptation au changement climatique, à la fois pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et pour assurer un meilleur confort à nos concitoyens. Avec le dérèglement climatique, il faut avoir en tête que ce problème de confort se pose l’hiver, ce à quoi nos réglementations thermiques répondaient jusqu’à présent, mais aussi l’été. Tel est bien le sens de la future réglementation environnementale sur laquelle nous travaillons, qui devra également prendre en compte le confort thermique l’été.
Des dispositions ont été adoptées par le Parlement afin de sortir des passoires thermiques à l’horizon de 2028 et de prendre en compte la réalité de la nécessaire adaptation des propriétaires. Dans la loi Énergie-climat, un dispositif progressif permettra d’atteindre cet objectif sans mettre en difficulté des millions de ménages. Cette politique doit être accompagnée par des outils simples, justes et efficaces, que vous retrouverez dans le projet de loi de finances, dont nous aurons à débattre prochainement avec vous.

Madame la ministre, vous nous dites qu’on ne peut pas parler du projet de loi de finances, mais il est publié, et il constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le débat que nous avons.
J’entends, encore une fois, votre ambition, mais, je vous le redis, vous n’y mettez pas les moyens. C’est le seul point que je voulais aborder.

Le rapport d’information, très précieux et de qualité, met en lumière la baisse du débit moyen annuel des cours d’eau, avec des débits estivaux réduits de 30 % à 60 %. En outre, le nombre de sources qui se sont taries cette année dans les campagnes françaises, c’est du jamais vu !
Je souhaite donc connaître, madame la ministre, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour développer les PTGE, les fameux projets de territoire pour la gestion de l’eau, notamment en lien avec l’objectif quantitatif qui a été fixé lors des Assises de l’eau. En effet, vous n’ignorez pas les recours actuellement conduits contre ces PTGE. J’aimerais également savoir quels moyens administratifs et budgétaires le Gouvernement souhaite y consacrer. Un certain nombre de collègues ont évoqué l’importance d’une meilleure sécurisation du dispositif.
Je vous invite à entendre ce que j’appellerai la supplique des territoires, de leurs élus, au nom de la cause agricole. Dans un temps d’agri-bashing, la période est trop grave pour balayer notre supplique d’un revers de main ou céder aux expressions les plus violentes. Il faut remettre de la raison dans le débat, et il est vraiment important que vous et vos collègues adoptiez, pour aborder les enjeux climatiques, notamment autour de l’eau, une vision beaucoup plus panoramique, avec un grand-angle à 360 degrés.
Enfin, quels financements sont-ils prévus, promis et, je l’espère, consacrés aux agences de l’eau, dont l’État a trop longtemps fait les poches ? Il faut vraiment que cela cesse !
Je partage tout à fait votre volonté de remettre de la raison dans le débat sur les ressources en eau comme sur l’incendie qui a récemment frappé l’une de nos grandes métropoles. Oui, il faut ramener de la raison dans le débat et se fonder sur les faits scientifiques !
La France a connu pendant plusieurs mois un épisode de sécheresse sans précédent. Quatre-vingt-huit départements ont été soumis, au moins sur une partie de leur superficie, à des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau. Quarante-deux départements ont pris des arrêtés de crise, imposant l’arrêt des prélèvements d’eau afin de préserver des usages prioritaires.
L’adaptation au changement climatique nous demande de repenser les différentes composantes, de la prévention des sécheresses à la gestion de crise. Nous devons donc revoir, dans sa globalité, la gestion quantitative de l’eau afin de donner une place privilégiée aux solutions naturelles. Nous devons notamment désartificialiser des sols pour augmenter leur capacité d’infiltration et limiter le ruissellement. Nous devons préserver les milieux humides pour profiter de leur capacité de stockage. Nous devons restaurer des capacités de ralentissement des écoulements par des cours d’eau pour permettre aux espèces aquatiques de résister aux périodes de stress hydrique. Nous devons nous mettre en ordre de marche pour revenir à l’équilibre dans les bassins en déficit structurel d’eau.
Tel est bien le sens de l’instruction du 7 mai 2019, prise conjointement par le ministère de l’agriculture et celui dont j’ai la charge. Elle institue une nouvelle démarche collective en vue de rééquilibrer les besoins en eau à l’étiage et la disponibilité de la ressource en eau. Elle invite aussi à réaliser des projets territoriaux pour la gestion de l’eau fondés sur des approches destinées à identifier et limiter les usages de l’eau en faisant preuve de sobriété, en mettant en œuvre des pratiques moins dépendantes de l’eau et des actions de restauration, et en se servant de l’innovation technique. Elle prévoit également la possibilité de réaliser des réserves de substitution. Ainsi, il est prévu, sur la période 2019-2024, que les agences de l’eau apportent 5, 1 milliards d’euros pour favoriser l’adaptation au changement climatique, préserver les milieux et réduire les pollutions.

Madame la ministre, vous verrez que le Gouvernement n’échappera pas à une évolution de sa posture. Il devra s’engager dans de nouvelles directions, en déployant au bénéfice des territoires des moyens financiers, structurels, solides et inscrits dans la durée.
Vous l’avez dit, la vision transversale comporte quantité d’enjeux : la santé publique, l’environnement, l’aménagement du territoire, la protection de la biodiversité, l’agriculture, sans oublier nos concitoyens.
Je terminerai en disant que j’ai compris votre allusion à l’épisode de pollution provoqué par l’incendie à Rouen. Qu’on soit bien clair, je ne mets en cause personne. Je pense simplement que, quand on attend cinq jours et qu’on a cinq expressions différentes, il y a des doutes. Vous allez voir que les analyses de l’air vont démontrer, contrairement au communiqué, …

Je veux remercier à mon tour nos collègues pour l’excellence de ce rapport.
Nous connaissons les conséquences du dérèglement climatique en France, qui sont désastreuses, notamment pour la santé.
Je voudrais aborder un sujet en particulier, celui de la pollution de l’air et des risques qu’elle entraîne sur la santé de nos concitoyens.
Les risques liés à la pollution de l’air sont nombreux. Ils le sont en particulier pour les enfants en raison de l’immaturité de leur organisme et de la fréquence de leur respiration, plus élevée que chez l’adulte. C’est le cas de Timon, neuf ans, qui souffre depuis 2011 de bronchites et de toux liées à la pollution atmosphérique dans l’agglomération lyonnaise, fortement touchée par les concentrations en particules fines. Statuant sur une demande de réparation des parents de l’enfant, le tribunal administratif avait ainsi qualifié l’État de « fautif ».
L’Unicef, qui rappelle que la principale source de pollution atmosphérique dans nos villes est le trafic automobile, fait état d’un chiffre plus qu’alarmant : trois enfants sur quatre respireraient un air pollué en France.
Deux autres études montrent également que la pollution de l’air accroît le risque de mortalité infantile et réduit la fonction pulmonaire.
Les enfants sont exposés à cette pollution au sein même des écoles de la République. En effet, la majorité des lieux d’accueil pour enfants se trouvant à proximité d’axes routiers, leur exposition à un air pollué est donc accentuée. Pourtant, des solutions existent : elles consistent à soutenir les collectivités pour développer des réseaux de mobilités plus propres, à généraliser les zones à faibles émissions dans les villes ou encore à diminuer le trafic routier à proximité immédiate des établissements scolaires.
Madame la ministre, face à l’urgence sanitaire, l’État a la responsabilité d’agir pour protéger les Français, les plus vulnérables en particulier. Aussi, pouvez-vous ici nous indiquer quelles mesures concrètes le Gouvernement mettra en œuvre durant le quinquennat pour prévenir les risques sanitaires majeurs et sensibiliser la population ?
Votre question nous éloigne un tout petit peu de l’adaptation au changement climatique. Cela étant, vous auriez pu évoquer la pollution à l’ozone, qui, pour le coup, est liée aux épisodes d’ensoleillement très importants, notamment aux canicules. Les épisodes de canicule que notre pays a connus se sont, en plus, accompagnés de pics de pollution à l’ozone.
Pour vous répondre sur la question de la qualité de l’air, qui me tient évidemment à cœur, je rappelle que notre pays était en retard dans le déploiement d’un outil qui a pourtant prouvé son efficacité chez nos voisins, les zones à faibles émissions. La loi Mobilités, dont je suis heureuse de reparler, prévoit précisément la mise en place de zones à faibles émissions.
Lorsque je suis entrée au Gouvernement, la France comptait deux zones à circulation restreinte. Quinze métropoles ont répondu à l’appel que nous avons lancé à l’été 2018. Nous accompagnons désormais vingt-trois territoires sur lesquels vivent 17 millions de Français dans la mise en place de zones à faibles émissions. Cet outil est consolidé par la loi Mobilités, dont vous aurez à reparler prochainement ici en nouvelle lecture. En outre, il est prévu de déployer des moyens de vidéoverbalisation, puis de contrôle-sanction automatiques, qui devraient se mettre en œuvre respectivement à l’été 2020 et à l’été 2021.
Je partage tout à fait votre préoccupation, qui est importante, même si elle n’est pas directement liée à l’adaptation au changement climatique. Nous devons agir en mettant en place ces zones à faibles émissions. Il faut mettre en œuvre une politique visant résolument à proposer des alternatives à l’usage de la voiture individuelle, dans nos métropoles, mais aussi sur le reste de notre territoire, là où nos concitoyens peuvent souffrir d’être dépendants de la voiture individuelle.

Je pense, au contraire, que tout est lié. L’utilisation de la voiture, qui augmente la pollution, est aussi l’une des causes du dérèglement climatique. Ma question avait donc toute sa place dans ce débat.
Je voudrais juste préciser qu’une autre étude, américaine cette fois, démontre que la pollution de l’air, néfaste pour l’organisme, pourrait, de plus, engendrer des troubles psychiatriques chez les enfants.
Bien sûr, la question de la pollution de l’air, qui est globale et nécessite une politique publique à long terme, ne se réglera pas en un quinquennat. Mais nous devons agir tous ensemble – collectivités, État – pour faire en sorte d’offrir un air pur à nos enfants, ainsi qu’aux moins jeunes.

Permettez-moi, tout d’abord, de féliciter mes collègues pour la qualité de leur rapport. Celui-ci traite à plusieurs reprises des conséquences graves et rapides du changement climatique en zone de montagne.
J’aimerais, à cet instant, revenir sur un enjeu majeur, qui aura un impact dépassant largement les zones de montagne. Il s’agit des débits d’eau.
Il y a tout juste une semaine, le GIEC dévoilait son rapport spécial sur les océans et la cryosphère. Pour les glaciers, les prévisions sont alarmistes : 80 % de la surface des glaciers aura disparu en 2100 si les émissions continuent sur cette tendance. Or « tous les grands fleuves européens prennent leur source en montage ». Les Alpes assurent ainsi 34 % du débit moyen du Rhin, 40 % de celui du Rhône et 53 % de celui du Pô.
D’ici à 2100, le réchauffement climatique devrait faire grossir les débits de ces fleuves de 20 % en hiver, les réduire de 17 % au printemps et jusqu’à 50 % en été. En d’autres termes, les populations vivant dans les plaines seront soumises à des risques accrus d’inondation en hiver et de sécheresse en été.
Cela me conduit, madame la ministre, à vous alerter sur deux sujets d’actualité.
Tout d’abord, la perspective d’ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques nous fait redouter les conséquences sur la bonne maîtrise de gestion des crues et de soutien d’étiage.
Ensuite, face à la multiplication des phénomènes violents et extrêmes, en montagne certainement plus qu’ailleurs, je vous rappelle l’impérieuse nécessité de préserver les stations locales de Météo France, comme celles de Chamonix, de Bourg-Saint-Maurice ou de Briançon, …

… encore menacées à ce jour. Au-delà de leur fonction de prévision météo, ces antennes locales sont incarnées par des agents qui disposent de la connaissance indispensable du territoire, de ses zones à risque, ainsi que de l’évolution des conditions nivologiques en période de crise. Elles fournissent, depuis des décennies et de manière irremplaçable, une prévision météo déterminante pour prévenir la survenance d’événements climatiques pouvant affecter la sécurité des populations.
Dans ces circonstances, la délocalisation de ces trois antennes locales vers un centre grenoblois serait un non-sens qui affecterait gravement le niveau de prévision et, donc, l’adaptation des mesures pour parer à ces événements climatiques. Je souhaiterais donc connaître votre position sur ces sujets.
M. Loïc Hervé applaudit.
Vous avez raison de souligner que la gestion des concessions hydroélectriques doit prendre en compte de multiples enjeux : la gestion proprement dite de la production d’électricité, mais aussi des rôles d’aménagement du territoire et de gestion hydraulique. C’est bien la complexité de ces différentes fonctions que nous mettons en avant dans nos échanges en cours avec la Commission européenne sur le devenir de nos concessions hydroélectriques. C’est également ce que nous avions mis en avant dans les discussions qui ont été conduites sur la prolongation de la concession de la CNR.
Je partage donc tout à fait votre avis sur l’importance de ces concessions d’hydroélectricité, dont le rôle va très au-delà de la simple production d’électricité, qui ne peut pas être appréhendée sous ce seul prisme.
S’agissant de Météo France, l’entreprise a travaillé sur un projet stratégique qui vise à une amélioration des techniques et des modélisations en réfléchissant notamment à la mise en place d’un nouveau calculateur. Nous allons accompagner l’établissement dans ses investissements. Ces nouveaux outils technologiques au service d’une meilleure prévision météo pour l’ensemble de nos concitoyens ont forcément des conséquences sur l’organisation de Météo France, en particulier sur son implantation territoriale.
J’ai bien en tête la présence d’agents à Bourg-Saint-Maurice, à Chamonix ou à Briançon. Les réflexions sur la réorganisation de Météo France, fondée sur des nouveaux outils, peuvent conduire à remettre en cause des implantations locales, mais le sujet des Alpes est pris très au sérieux. Des échanges se tiendront dans les prochains jours avec la nouvelle présidente-directrice générale de Météo France et les élus afin de voir quelles solutions peuvent être trouvées pour les agents actuellement présents dans ces communes.

Parmi les recommandations de l’excellent rapport de nos collègues, plusieurs d’entre elles convergent vers une nécessaire optimisation de la politique de rénovation thermique des logements et, plus globalement, des bâtiments. Je ne vais pas revenir sur le mauvais signal envoyé avec la réduction du crédit d’impôt pour la transition énergétique, qui a été évoqué par notre collègue Céline Boulay-Espéronnier.
Au croisement des politiques d’atténuation et d’adaptation, qu’il ne faut plus opposer, une véritable impulsion me semble nécessaire pour atteindre l’un des objectifs souvent cité en la matière : un rythme de 500 000 rénovations de logements par an. Pour cela, il faut clarifier le rôle des différentes structures et des différents acteurs dans le domaine et les accompagner. Or, aujourd’hui, les initiatives sont multiples et, en définitive, souvent illisibles, voire suspectes aux yeux du grand public. Vous l’avez vous-même évoqué, madame la ministre, c’est un véritable parcours du combattant.
Comme vos collègues Emmanuelle Wargon et Julien Denormandie, que j’ai eu l’occasion d’interpeller à ce sujet lors d’un congrès à Angers, vous citez les régions et les intercommunalités pour assumer ce rôle de pilote sur des programmes d’actions concrètes, que l’on ne trouve pas toujours, tant s’en faut, dans les Sraddet, les PCAET ou d’autres documents régulièrement produits mais qui peinent véritablement à être traduits de manière opérationnelle. L’idéal serait sans doute de couvrir l’ensemble du territoire de structures portées par les collectivités, à l’instar des ALEC, les agences locales de l’énergie et du climat, et, surtout, dotées de moyens humains et financiers pérennes, qui ne seraient pas soumis aux fluctuations de financements de l’Ademe, avec la fixation d’objectifs réalistes. De manière complémentaire, cette ambition me semble devoir être partagée avec les professionnels de la construction, perdus, eux aussi, parmi les labels et autres normes qu’on leur propose ou impose trop souvent.
Madame la ministre, quelle est votre vision territoriale de la décentralisation des politiques publiques dans le domaine de la rénovation thermique ?

M. Stéphane Piednoir. Qu’en est-il du plan, annoncé par vos collègues, de rénovation des établissements scolaires, qui sont souvent de véritables passoires thermiques ?
M. Jean-François Husson applaudit.
Vous avez raison de souligner que la rénovation énergétique des bâtiments en général est un enjeu majeur dans notre politique d’atténuation. Je le rappelle, le bâtiment représente 45 % de notre consommation énergétique et 27 % de nos émissions de gaz à effet de serre. Cela montre à quel point ce secteur joue un rôle crucial pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les bâtiments publics doivent être exemplaires. Un certain nombre de dispositifs ont été prévus pour accompagner les collectivités, notamment des prêts de la Caisse des dépôts et consignations et des soutiens au travers de la dotation de soutien à l’investissement local, la DSIL.
Je fais le constat que, dans certains départements, les actions de rénovation énergétique des écoles ont été largement engagées. Tel n’est pas le cas sur l’ensemble du territoire. Je pense qu’on peut s’interroger sur la façon de donner une plus forte dynamique à ces actions de rénovation énergétique de nos bâtiments publics.
En matière de logements, la politique doit être la plus efficace et la plus lisible possible. Cela passe par une simplification des dispositifs d’aide. Je continue à penser que devoir conjuguer des aides de l’ANAH, un crédit d’impôt, des certificats d’économie d’énergie, des éco-PTZ peut dissuader un certain nombre de nos concitoyens. En revanche, l’accompagnement et le conseil de proximité constituent un enjeu majeur. C’est bien le sens des concertations engagées par Emmanuelle Wargon et Julien Denormandie, ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur.
Comme dans le domaine de la mobilité, il faut un chef de file et de coordination des outils communs – ce rôle pourrait être joué par les régions –, ainsi que, sans doute, une action de proximité, qui pourrait être prise en charge par la maille communale et intercommunale.
À l’appui de ces concertations, je rappelle que nous avons donné de la visibilité aux plateformes de rénovation thermique pour les quatre prochaines années : 200 millions d’euros ont été mis en place par l’État. J’espère que l’action des collectivités permettra d’en doubler le montant.

Face aux dérèglements climatiques, il nous faut traduire l’urgence dont parlent les scientifiques de façon objective. Ayons aussi à l’esprit que le climat est un sujet extrêmement complexe, qui appelle de nous des actes concrets, mais aussi beaucoup d’humilité.
Le très bon rapport d’information de la délégation sénatoriale à la prospective aborde un sujet au cœur des tensions territoriales, déjà largement évoqué ce matin, l’adaptation des politiques de l’eau, sujet d’actualité après les deux canicules de l’été 2019 et la sécheresse qui a entraîné des mesures importantes de restriction d’eau dans nombre de nos territoires.
Les politiques de l’eau doivent donner la priorité à des usages plus économes de la ressource et à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour optimiser la recharge des nappes phréatiques et développer des équipements hydro-économes.
Quatre options permettent de mieux exploiter l’eau excédentaire des saisons pluvieuses : barrages-réservoirs, ouvrages en lit mineur, de type moulins, étangs ou plans d’eau, retenues collinaires, qui stockent le ruissellement, restauration de zones humides naturelles.
Pourtant, aujourd’hui, en vertu d’un plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’administration de l’eau a détruit plus de 150 petits barrages sur nos rivières depuis dix ans. Les conséquences d’une telle décision sont nombreuses : assèchement de rivières, disparition ou réduction d’une grande partie de la faune piscicole, fragilisation de bâtis, baisse de la nappe alluviale et disparition de certaines zones humides, avec des modifications d’écosystèmes et de biodiversité dans les vallées ayant un impact sur l’agriculture et le tourisme.
Madame la ministre, pour adapter la France aux dérèglements climatiques, nous devons nous appuyer sur le local, mais aussi sur ce patrimoine hydraulique. Quelle nouvelle politique de protection et de valorisation des ouvrages hydrauliques envisagez-vous ?
Vous avez raison de souligner le caractère crucial de la gestion de la ressource en eau.
Il faut indiquer que l’eau qui n’est pas retenue, par le biais de barrages de stockage ou de retenues collinaires, a un rôle très important pour alimenter nos nappes phréatiques, soutenir en aval les débits des cours d’eau et alimenter également les zones humides, c’est-à-dire in fine être au service de notre biodiversité.
C’est bien le sens de ma réponse à l’un de vos collègues tout à l’heure. L’alerte forte qui a soumis 88 départements à des mesures de limitation et de suspension et amené 42 départements à prendre des arrêtés de crise doit renforcer la nécessité d’avoir une vision globale des enjeux relatifs au cycle de l’eau et de tout faire pour améliorer les capacités d’infiltration, limiter le ruissellement, préserver nos milieux humides et restaurer les capacités d’écoulement de nos cours d’eau.
Monsieur le sénateur, vous évoquez les politiques de continuité écologique des cours d’eau et la contradiction qu’il peut y avoir avec les enjeux de stockage d’eau. Nous avons fixé des objectifs importants de restauration des continuités hydrauliques et des cours d’eau. Il faut les appréhender de façon pragmatique, en ayant en tête que la restauration de la continuité piscicole ne doit pas se faire au détriment du soutien d’étiage, qui est également un enjeu essentiel en matière de biodiversité.
C’est sous cette double approche – soutien d’étiage et continuité piscicole – que les sujets doivent être examinés. C’est tout le sens de l’action de mes services, et je m’assurerai que c’est bien le cas.

La situation critique de l’eau dans notre pays appelle à un objectif zéro perte nette en eau et à une exigence de protection de nos ouvrages hydrauliques qui stockent l’eau afin de recharger les sols et les nappes en eau, de recréer des milieux aquatiques et des zones humides qui contribuent à la production de biodiversité. En effet, la reconquête de la biodiversité terrestre et marine permet de lutter contre le dérèglement climatique.

Pour clore ce débat, la parole est à M. Jean-Yves Roux, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective.

Les territoires de montagne sont extrêmement vulnérables au réchauffement climatique, qui menace directement les activités au cœur de l’économie montagnarde que sont le pastoralisme et le tourisme.
Madame la ministre, vous avez évoqué dans votre introduction les risques naturels en montagne. Il s’agit d’un sujet important : ces risques vont s’accroître du fait du réchauffement climatique et il faut adapter les outils de prévention.
L’impact du réchauffement climatique va bien au-delà du risque naturel. J’appelle l’attention sur le fait que le plan national d’adaptation au changement climatique doit créer les outils qui permettront d’accompagner l’adaptation de l’économie montagnarde, notamment la diversification du tourisme vers un « tourisme de montagne en quatre saisons » et le maintien du tourisme de neige.
Pour terminer, je tiens à remercier le président Karoutchi de son soutien et Mme la ministre de ses réponses directes et franches.

La parole est à M. Ronan Dantec, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective.

Je remercie moi aussi le président de la délégation sénatoriale à la prospective, Roger Karoutchi, d’avoir apporté son soutien à ce rapport d’information.
Mes chers collègues, nous allons continuer à travailler sur ces questions. Vous pouvez d’ailleurs déjà noter sur vos agendas le programme de travail de la délégation du 31 octobre prochain : le matin, nous reviendrons sur les questions précises qui ont été au cœur de vos interventions, sur le bâti, le coût pour les collectivités territoriales de l’intégration du confort d’été, notamment dans les écoles ; l’après-midi sera consacré à un colloque avec plusieurs think tanks importants comme l’I4CE ou l’Iddri. Ce sera l’occasion de poursuivre notre dialogue et nos échanges, madame la ministre.
Mes chers collègues, les questions que vous avez posées appellent quelques remarques.
Je ne suis pas sûr qu’on mesure encore ce que sera la France en 2050 – c’était le cœur de ce rapport d’information. Aujourd’hui, beaucoup de questions se posent sur les difficultés auxquelles nous obligent à faire face le dérèglement climatique et une augmentation de la température de 1 degré par rapport à la période préindustrielle. En 2050 – c’est inéluctable au regard des inerties de nos systèmes sociétaux et du CO2 dans l’atmosphère –, cette augmentation sera plutôt aux alentours de 2 degrés.
Notre premier travail – c’était le sens de ce rapport d’information – consiste à appréhender véritablement le monde de 2050 et les problématiques qui seront au cœur de l’adaptation au changement climatique. Cela veut dire – vos questions le montrent très clairement – que nous sommes aujourd’hui face à des injonctions contradictoires, la question de l’eau l’illustre parfaitement. À ce titre, la question de notre collègue Chevrollier me semble tout à fait pertinente : comment trouver des équilibres entre biodiversité et maintien de l’agriculture ? Il en est de même de la question du président Karoutchi : notre vision de la densité urbaine est-elle en ligne avec la lutte contre les îlots de chaleur ? Ces questions sont sur la table.
Pour dépasser ces injonctions contradictoires et approfondir ces sujets, nous avons besoin de temps de débats extrêmement importants. De ce point de vue, madame la ministre, les nombreuses annonces que vous avez formulées sont capitales. Comme vous l’avez souligné, il va falloir retravailler beaucoup avec les collectivités territoriales. J’entends ce mandat donné à l’Onerc pour que nous ayons un temps de travail avec les réseaux de collectivités territoriales sur les questions d’adaptation. Le président de la commission spécialisée du CNTE que je suis est évidemment à votre disposition pour travailler dans ce sens.
Le Sénat en est conscient depuis longtemps : il faudra également réfléchir aux coûts pour les collectivités territoriales. Sur ce point, madame la ministre, je vous rejoins : investir une partie des C2E vers les collectivités pour qu’elles aient des capacités d’animation et de soutien, notamment sur toutes les questions relatives à la rénovation thermique des bâtiments devant intégrer le confort d’été, est un enjeu extrêmement important.
Nous avons donc devant nous des points de réflexion extrêmement précis. S’y ajoutent les questions relatives aux territoires ultramarins, mais aussi – c’était le travail de l’Onerc cette année – les solutions liées à la nature qui, au-delà du slogan, doivent être transformées en politiques publiques structurantes.
On le voit, les chantiers sont nombreux. Il nous faut les prendre les uns après les autres pour ne pas en rester aux déclarations, mais les traduire par des politiques publiques structurantes et applicables, ce qui correspond, je crois, tout à fait à votre culture, madame la ministre.
Enfin – et c’était l’une des grandes conclusions de ce rapport d’information –, nous devons nous demander si nous voulons créer un nouveau contrat collectif autour de l’adaptation. Une loi-cadre sera alors sans doute nécessaire. En effet, d’après les derniers chiffres du GIEC sur la montée des eaux – 1, 1 mètre –, associée peut-être à des effets de submersion plus importants avec les tempêtes ou les dépressions, il faut s’attendre à une modification en profondeur de notre littoral dans la seconde moitié du XXIe siècle. Nous devons prendre le temps d’en parler encore, même si nous avons déjà eu l’occasion d’ouvrir ce débat ce matin.

Nous en avons terminé avec le débat sur les conclusions du rapport d’information Adapter la France aux dérèglements climatiques à l ’ horizon 2050 : urgence déclarée.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures dix, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.