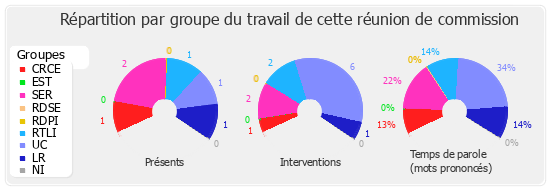Commission d'enquête Concessions autoroutières
Réunion du 24 juin 2020 à 16h35
Sommaire
La réunion
Audition de Mme élisabeth Borne ministre de la transition écologique et solidaire et directrice du cabinet de Mme Ségolène Royal ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie en 2014-2015
Audition de Mme élisabeth Borne ministre de la transition écologique et solidaire et directrice du cabinet de Mme Ségolène Royal ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie en 2014-2015

Nous poursuivons nos travaux aujourd'hui avec Madame Élisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la Ministre, les transports, qui font partie de votre portefeuille ministériel, et singulièrement les infrastructures autoroutières, qui nous intéressent dans le cadre des travaux de notre commission d'enquête, sont au coeur de vos activités professionnelles, en qualité de conseiller de plusieurs ministres puis de ministre en charge de ce secteur, sans oublier la direction des concessions d'Eiffage, l'un des principaux opérateurs en la matière.
Après vous avoir rappelé qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal, je vous invite à prêter serment de dire toute le vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites : « je le jure ».
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Élisabeth Borne prête serment.
Le sujet des relations entre les sociétés concessionnaires d'autoroutes et l'État n'est pas nouveau et le Sénat s'y intéresse depuis longtemps. Nous avons eu l'occasion d'échanger l'année dernière dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative à la nationalisation des autoroutes. Les concessions autoroutières, autorisées par la loi du 18 avril 1955, ont contribué à développer un réseau de routes à haut niveau de service et de sécurité pour l'usager. La France dispose d'un réseau de plus de 9000 kilomètres de voies concédées. Lors de l'émergence de ce modèle, nous avions un retard en termes d'équipements, la voiture était le moyen de transport privilégié et les considérations environnementales n'étaient alors pas centrales. Les sociétés autoroutières étaient pour l'essentiel publiques et leurs bénéfices permettaient de développer les investissements dans les transports. Par ailleurs, la durée des concessions était initialement d'une trentaine d'années, puis nous avons recouru à l'adossement pour créer des liaisons interurbaines moins rentables. Bien que bénéfique pour l'aménagement du territoire, l'adossement a eu pour effet de doubler la durée des concessions par rapport à celle prévue dans les années 1960. Historiquement, les sections à péage étaient loin des agglomérations et servaient aux trajets occasionnels des particuliers et aux transports de marchandises sur longues distances. Du fait de l'extension des agglomérations et des changements de mode de vies, beaucoup de Français utilisent désormais l'autoroute pour leurs déplacements quotidiens, ce qui pose la question de l'acceptabilité du modèle du péage pour ce type de trajet. Dans le même temps, le modèle d'une infrastructure financée entièrement par l'usager a un avantage, car l'acceptabilité de l'impôt est elle aussi discutée.
La décision de la privatisation en 2005 a, par construction, privé l'État des dividendes qui étaient jusque-là affectés aux investissements dans les infrastructures de transport. On peut s'étonner que cette évolution n'ait pas été précédée d'une révision des contrats. Contrairement à ce que l'on observe généralement dans les actifs régulés, ces contrats ne font en effet pas l'objet d'un recalage périodique de la rentabilité entre le concédant et les sociétés concessionnaires. Ils ont été conclus entre les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute (SEMCA) et l'État, mais régissent aujourd'hui des relations avec des groupes privés cotés dont la logique est différente. Cela explique les questions récurrentes sur le déséquilibre entre concédant et concessionnaire. Ce modèle a toutefois évolué vers une plus grande transparence sous l'effet des travaux de l'Autorité de la concurrence.
Nous sommes aujourd'hui à dix ans de la fin des premiers contrats de concessions historiques et il est légitime de penser à l'après. Si nous voulons conserver un modèle concessif, il faudra introduire des clauses de revoyure, comme pour les autres actifs régulés, afin de s'assurer de l'absence de surrentabilité. Il faut également un régulateur fort. Je plaide, en tant que ministre de la transition écologique et solidaire, pour que les sociétés concessionnaires accompagnent le développement des mobilités propres sur leur réseau, par l'implantation de bornes de recharge et en incitant les usagers au covoiturage ou aux véhicules propres.

J'aurai deux séries de questions. Tout d'abord, votre parcours nous intéresse à un triple titre : chez un concessionnaire, puisque vous avez travaillé pour le groupe Eiffage, comme directrice de cabinet de Mme Royal et enfin comme ministre de tutelle. Vous aviez par ailleurs commencé votre carrière professionnelle à l'Équipement. Pensez-vous que ce type de parcours pour un fonctionnaire soit une bonne chose ? Cela devrait-il évoluer ?
Ma deuxième question porte sur le gel des tarifs autoroutiers pour 2015. Comment cette décision a-t-elle été prise, sachant que les contrats prévoient des augmentations chaque année ? Le Premier ministre ou la ministre en charge à l'époque ont-ils pris cette décision ? Quelle en était la motivation ?
Quel a été votre rôle dans la négociation du protocole de 2015 et du plan de relance autoroutier ? De quelle façon Mme Royal a-t-elle été informée des discussions avec les SCAA? Considérez-vous que ce protocole était une bonne affaire pour l'usager et pour l'État ?
Pouvez-vous reformuler votre première question ?

Que vous inspire le fait de travailler dans un groupe dont les filiales avaient des contrats avec l'État, puis de vous trouver ensuite en position de tutelle ?
Il y a des règles en matière de conflit d'intérêts. J'ai travaillé chez Eiffage de 2007 à 2008, puis je suis intervenue en tant que directrice de cabinet de Mme Royal de 2014 à 2015 et j'ai pris des fonctions de ministre en 2017. On ne peut pas passer sans délai d'un poste à l'autre et cela me semble raisonnable. Cependant, il est important que les personnes exerçant des postes à responsabilité aient une vision de comment cela se passe ailleurs. J'apprécierais que les fonctionnaires de mon ministère, qui ont vocation à échanger avec des entreprises ou des collectivités, n'aient pas seulement un parcours au sein de l'administration d'État. Occuper des postes diversifiés permet de créer de la fluidité et de mieux comprendre ses interlocuteurs, tout en tenant compte des règles qui doivent s'appliquer.
Le gel des tarifs est une décision prise par Ségolène Royal. La question des tarifs revient régulièrement, et l'on préfèrerait souvent pouvoir s'affranchir des contrats à ce sujet. C'est ce que la ministre de l'époque avait décidé de faire. Mais les contrats s'appliquent dans un État de droit. Si l'application des contrats était aléatoire dans notre pays, peu d'entreprises viendraient s'installer en France. Le gel des tarifs a eu un effet boomerang pour l'usager qui l'a payé par des augmentations ultérieures ; l'usager n'est finalement pas gagnant. C'est le paradoxe des allongements successifs de contrats de concession : face à des contrats dont les clauses ont été conçues dans les années 1970, et prolongées d'avenant en avenant, céder à l'impulsion de ne pas appliquer les clauses d'augmentation de tarifs n'est pas dans l'intérêt des usagers.

Ségolène Royal a donc pris seule la décision de geler les tarifs, sans l'accord du Premier ministre ou discussion interministérielle ? Lorsqu'il y a un contrat, on l'applique. Qui a pris cette décision au sein du Gouvernement ?
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans le cadre de tensions avec les concessionnaires liées à une succession de décisions dans les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires. Ces tensions ont été cristallisées par l'avis de l'Autorité de la concurrence évoquant une surrentabilité des concessions. Par ailleurs, au début du quinquennat précédent, la décision d'augmenter la redevance domaniale sans compensation avait conduit les sociétés concessionnaires d'autoroutes à soulever le risque d'un contentieux. Le Président de la République de l'époque avait ensuite commencé la négociation d'un plan de relance autoroutier, négociations allongées par les notifications à la Commission européenne. Les relations entre l'État et les concessionnaires étaient particulièrement tendues, et un groupe de travail parlementaire avait été constitué pour déterminer si cette rente existait.
Des discussions avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont donc été engagées pour solder ces différents éléments ; la redevance domaniale débouchant potentiellement sur un contentieux avec les sociétés concessionnaires, la volonté du Président de la République de boucler le plan de relance dont les discussions avaient été engagées largement antérieurement, et cet avis de l'Autorité de la concurrence expliquant qu'il y aurait une surrentabilité des contrats. Dans ce contexte, la ministre de l'époque a pris la décision de geler les tarifs. . Céder à l'impulsion n'est pas dans l'intérêt des usagers. Votre question porte en creux sur l'organisation d'un gouvernement : celui-ci fonctionne soit par des réunions interministérielles dont le ministre porte alors la parole, soit parce qu'un ministre considère qu'il est de sa responsabilité de prendre une décision, le reste du Gouvernement en prend acte. C'est ce qu'il s'était passé à l'époque.

Sur votre rôle dans les négociations du plan de relance autoroutier (PRA), comment se sont passées ces négociations ? Comment la ministre était-elle informée ? Était-ce une bonne affaire pour l'État et les usagers?
Nous étions dans une situation très tendue avec les sociétés concessionnaires du fait des éléments que j'ai évoqués. François Hollande voulait faire aboutir les négociations. Il est apparu utile de trouver un chemin afin de solder les litiges en cours et de prendre appui sur l'opinion de l'Autorité de la concurrence, sur les travaux du groupe de parlementaires et sur les recommandations et les engagements pris auprès de la Commission européenne lors de la notification du plan de relance autoroutier. Ce protocole a été discuté avec le directeur de cabinet du ministre de l'économie de l'époque, moi-même, en tant que directrice de cabinet de la ministre, et Bruno Angles, que vous avez déjà auditionné et qui avait été désigné par les sociétés concessionnaires. Dans la foulée de cet accord dans le cadre de la loi dite « Macron », une autorité de contrôle des concessions autoroutières a été mise en place, disposant d'un pouvoir d'avis public sur les projets de contrats et d'avenants et sur la rentabilité du secteur autoroutier en général. Cette autorité, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), devenue l'Autorité de régulation des transports (ART), possède également un pouvoir de contrôle des marchés passés par les autoroutes.
Ce protocole est le fruit d'un processus de rééquilibrage des relations entre l'État et les concessionnaires, qui a été compliqué par la décision du gel des tarifs intervenue au milieu de sa discussion. Le bilan du protocole est sans conteste positif, car il a permis d'éviter des litiges qui auraient été forcément défavorables l'État. Mais il n'a pas pu empêcher le report du gel des tarifs en 2015 par des hausses de tarifs jusqu'en 2023. Lorsqu'on s'exonère de l'application d'un contrat, il faut également en tirer les conséquences. Autre effet positif du protocole, au cours de la négociation du plan d'investissement autoroutier en 2018, nous avons pu nous appuyer sur l'avis obligatoirement sollicité de l'Arafer, ce qui a permis de revoir à la baisse les conditions financières du plan.
Le protocole contenait des avancées importantes, notamment l'insertion d'une clause de plafonnement de la rentabilité permettant de réduire la durée des concessions en cas de surprofits, l'absence de compensation de la taxe finançant l'Arafer, le versement d'une contribution des sociétés concessionnaires d'autoroutes, la mise en place de mesures commerciales ciblées pour favoriser le covoiturage et l'utilisation des cars dits « Macron », enfin la possibilité pour l'État d'assister au conseil d'administration des sociétés.
L'objectif de ce protocole, qui était de solder les litiges en cours et de permettre un premier rééquilibrage des contrats, a été atteint.
Quant à savoir si Ségolène Royal a été informée, la ministre suivait de près ses dossiers. Je vous confirme qu'elle en était informée et qu'elle a même pris en main la finalisation de la négociation avec les sociétés concessionnaires.

Vous avez évoqué un déséquilibre dans la relation contractuelle entre le concédant et les concessionnaires. Pouvez-vous préciser ? Les concessionnaires ont le sentiment que ce déséquilibre est en faveur du concédant.
Imaginez ce qu'est la gestion d'actifs aussi importants, en volume et dans le quotidien des Français, sur la base de contrats conçus dans les années 60 et 70. Cette pratique de d'adossement et de prolongement par avenants, qui permettait de mener des travaux sans ouvrir de crédits budgétaires, conduit à exécuter aujourd'hui des contrats qui ont été conclus à cette époque. En tant que présidente-directrice générale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), j'ai pu négocier des délégations de service public au travers de contrats permettant à l'autorité organisatrice d'obtenir des clauses de rendez-vous. Les contrats tels qu'on les passe aujourd'hui donnent beaucoup plus de leviers au concédant, et permettent par exemple de réexaminer tous les cinq ans la rentabilité des contrats et au besoin d'assurer qu'elle n'excède pas celle prévue initialement.

Il y a eu des améliorations sensibles, tenant compte des expériences passées, dans le suivi et dans l'établissement des nouveaux contrats depuis 2015. Sur le protocole de 2015, êtes-vous d'accord avec le chiffrage effectué par l'ART sur le fait que les usagers auront payé au travers des suraugmentations de 2019 à 2023, pour compenser le gel des tarifs de 2015, 500 millions d'euros de plus que ce qu'ils auraient payé si les augmentations étaient restées celles initialement prévues ? Par ailleurs, avez-vous souvenir de la façon dont s'est déroulée la négociation des taux d'actualisation ? L'État proposait à l'époque un taux d'actualisation de 6,8 %, alors qu'un taux de 8 % plus favorable aux sociétés concessionnaires figure dans le contrat. Vous nous dites que le protocole a été favorable à l'usager. Pourquoi a-t-il donc été maintenu secret ? Il n'a été rendu public que deux ou trois ans plus tard, à la suite de procédures contentieuses. Enfin, après avoir tiré les leçons du passé, comment peut-on préparer l'avenir ? Si les concessions se terminaient dans trois ans, quelles seraient vos préconisations pour la gestion et l'exploitation de ce réseau autoroutier et pour préparer ce renouvellement ?
On peut supposer que le calcul de l'ART est le bon. Le bénéfice des hausses effectuées après le gel est rapporté à la situation initiale en tenant compte d'un taux d'actualisation. Les usagers payent donc finalement plus. J'ai eu ce débat en tant que ministre des transports, alors que certains élus demandent aujourd'hui un gel des tarifs, voire la gratuité. Ce n'est possible que si les sociétés concessionnaires décident de renoncer à leurs droits, ce qui est rare, y compris vis-à-vis de leurs actionnaires. Mais le droit des contrats implique que lorsqu'on prend quelque chose, on en cède une autre. Les décisions unilatérales, si elles peuvent être valorisantes politiquement, sont contreproductives dans la durée.
Les débats autour du taux d'actualisation peuvent être infinis. Si le concédant souhaite un taux le plus bas possible, les sociétés concessionnaires d'autoroutes indiquent qu'il leur faut couvrir les risques auxquels elles sont exposées. Les conditions financières doivent être prises en compte. Le point d'atterrissage était sans doute à mi-chemin entre ce que préconisait l'administration et ce que recherchait le concessionnaire. Ce taux a pour ailleurs été validé par la Commission européenne au titre du respect des règles des concessions et des règles encadrant les aides d'État qui limitent les avantages accordés à une entreprise. Dans le programme d'investissement autoroutier, nous avons fait baisser le taux envisagé sous le précédent quinquennat en nous appuyant sur les avis de l'ART. Cela montre tout l'intérêt d'une autorité de régulation puissante. Les taux d'actualisation ne sont pas une science exacte. Par ailleurs, je souligne que la validation du taux par la Commission ne m'offrait pas une marge de négociation très large pour baisser le taux en jouant sur la crainte d'un rejet de la Commission européenne.
Je ne peux pas vous répondre sur le secret du protocole. Ce n'est pas moi qui ai empêché sa publication, car cela peut créer de la crispation. Le ministère de l'économie était réticent à le publier du fait de son caractère de protocole transactionnel. Il a d'ailleurs été transposé dans les contrats de concessions qui sont, eux, parfaitement publics. Je comprends la crispation que ces motivations juridiques ont pu provoquer.
Sur la préparation de l'avenir, tout dépend si l'on juge utile le modèle concessif, ou si les services de l'État reprendront en direct la gestion des autoroutes. Le recours à ces sociétés a permis d'avoir un niveau de service échappant aux régulations budgétaires, et un réseau financé par l'usager mieux entretenu que le réseau non concédé. Ce modèle me semble présenter un intérêt. Les contrats futurs seront très différents. Lors de la conclusion initiale des contrats, les concessionnaires ont pris un risque trafic. Le réseau est aujourd'hui mature, et le contrat devrait davantage ressembler à un contrat de partenariat ; je ne vois pas l'intérêt de rémunérer un risque trafic aujourd'hui limité. Cependant, le risque trafic s'est matérialisé pendant la crise de 2008 où le trafic poids lourds a chuté dans des proportions considérables et se concrétise violemment aujourd'hui. Le risque trafic n'est donc pas un concept. Un contrat de partenariat avec des engagements appliquant davantage le principe du pollueur-payeur me paraît une piste à creuser, en tenant compte de l'acceptabilité auprès des usagers. Aujourd'hui des centaines de milliers de citoyens empruntent des trajets à péages pour se rendre au travail. Il faut prendre en compte ce paramètre.

J'ai été contacté par votre cabinet qui voulait savoir quels types de questions je comptais vous soumettre. Dans la mesure où vous êtes entendue par une commission d'enquête, j'ai été surpris par cette démarche que j'ai trouvée déplacée.
Avec le recul de quatorze années, considérez-vous que la privatisation a été une bonne affaire pour l'État et les citoyens, du point de vue financier, de la qualité du réseau, de la transparence et du service à l'usager ? La gestion par des acteurs privés n'est pas un modèle absolu. En Grande-Bretagne, les autoroutes sont gérées par une entité publique financée par l'impôt. La concession est un choix politique.
Concernant votre curriculum vitæ qui est foisonnant, j'ai été interpellé par votre année passée comme directrice des concessions du groupe Eiffage entre 2007 et 2008. Quelles étaient vos fonctions et vos missions ? Pourquoi en être partie si rapidement ? Sans vous faire de procès d'intentions, mais si d'aventure Eiffage était candidat à la concession d'Aéroports de Paris (ADP), quelle pourrait-être votre position ? N'y a-t-il pas là un risque de conflit d'intérêts ?
Les recommandations de l'Autorité de la concurrence, formulées dans son avis de 2014, ont-elles toutes été mises en oeuvre ?
Je suis désolée que vous ayez été choqué, mais nous évoquons des sujets anciens. La question de mon cabinet avait pour but de vous apporter des réponses précises. En tant que ministre de la transition écologique, mon agenda est bien rempli. Je ne peux vous répondre à brûle pourpoint sur des sujets d'il y a dix ou quinze ans.
Je ne suis pas la mieux à même pour juger de la privatisation. Ce n'est pas mon ministère qui a porté la privatisation des sociétés autoroutières. Le ministère des finances pourrait vous indiquer si les recettes qui ont été retirées étaient à la hauteur de la valeur des actifs. Je ne dispose ni des analyses de l'époque, ni des calculs que l'on pourrait faire aujourd'hui.
Au-delà d'une bonne affaire, dans le principe cela n'a pas été une bonne idée. Le code de la voirie routière dispose que l'utilisation du réseau routier est en principe gratuite, avec des exceptions sur des sections à péage. Le péage sert à développer et entretenir les infrastructures mais aussi à assurer une rentabilité à la concession. Les usagers seraient plus convaincus de l'intérêt du péage si, comme c'était le cas à l'époque, il finançait des investissements, par exemple dans le transport ferroviaire. Ne pas changer les contrats avant de changer les actionnaires des sociétés concessionnaires a été une erreur. Nous aurions dû revisiter ces contrats avant la privatisation, pour mieux les verrouiller. Nous aurions sans doute eu moins de recettes, mais cela aurait limité les débats ultérieurs sur les surprofits des sociétés concessionnaires.
S'agissant de la qualité du réseau et du service rendu aux usagers, cela n'est pas critiquable. Notre réseau est bien entretenu et de bonne qualité. Je souhaiterais que nous ayons des aires de services de cette qualité sur le réseau non concédé.
Sur mon passage chez Eiffage, on peut considérer qu'il y a deux mondes, celui de l'administration d'État et celui de l'entreprise. Ce n'est pas ma vision. Des délais de passage de l'un à l'autre sont prévus par les textes et il faut les appliquer. Pour la mise en concession de la route Centre Europe Atlantique, je me suis tournée vers la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui a indiqué que compte-tenu du délai passé, cela ne constituait pas un conflit d'intérêts. Des fonctions ne marquent pas à vie. Après plus de dix ans, on peut retrouver son indépendance de pensée.
Je suis partie du fait d'un désaccord stratégique avec le président de l'époque qui s'est alors séparé de son directeur général dont il a repris la fonction.

Étant dans la majorité présidentielle au Sénat en 2005, nous n'étions pas informés de toutes les conséquences de la privatisation. C'est une erreur majeure de M. de Villepin pour obtenir des rentrées d'argent. Je connais bien la ministre. Doit-on avoir des gens qui dirigent la France et qui n'ont aucun lien avec le privé, aucune notion du territoire ou de l'entreprise ? Dans le département de la Vienne où Mme Borne était préfète, son expérience du public et ses contacts nous ont aidés à réaliser un Center Parc. Il faut des gens qui connaissent le territoire. Quant à Mme Royal, elle décidait souvent seule : c'est dans son caractère. Enfin, pour l'avenir, avons-nous une idée des coûts globaux que représente l'allongement des contrats?

Madame la ministre n'est pas remise en cause dans sa probité et son honnêteté et nous connaissons ses états de services.
J'ai beaucoup appris en tant que préfète de Poitou-Charentes. Le patrimoine des concessions autoroutières sera une richesse quand l'État en reprendra la propriété. Ce patrimoine de 150 milliards d'euros est considérable. L'enjeu est celui des moyens que l'on consacre au pilotage des concessions. En Angleterre, il y aurait beaucoup plus de fonctionnaires et d'experts extérieurs. Le recours à un régulateur vient compléter utilement les ressources consacrées à suivre l'économie des contrats. Si le président de l'ART a demandé plus de compétences en des termes blessants pour les fonctionnaires de mon ministère, je tiens à dire que nous avons des agents de grande qualité. Ils pourraient être plus nombreux et disposer de plus de moyens.

Votre réponse sur l'épisode de 2015 me laisse sur ma faim. J'attendais des précisions sur les enjeux des négociations, des rapports de force et des arbitrages finaux. En tant que commission d'enquête, nous avons droit à des détails sur le déroulement de cette discussion.
Dans une dimension prospective, je suis effaré de la culture administrative française et de l'incapacité de l'administration française à opérer des contrôles efficaces et efficients. Nous sommes face à un imbroglio de responsabilités. Au cours d'une négociation, la discussion passe d'un ministère à l'autre. Une responsable juridique de Bercy a indiqué que la puissance publique n'avait pas les capacités juridiques nécessaires au contrôle. Les archives de même ne sont pas gérées de manière consolidée. En face, les concessionnaires sont beaucoup mieux armés. La seule solution est d'externaliser ce contrôle à des autorités indépendantes. Je m'interroge sur la pérennisation des contrats sans faire au préalable évoluer cette culture du contrôle. Par exemple, l'état des lieux des concessions qui devait avoir été effectué ne l'a pas été.
Lors des discussions sur la loi d'orientation des mobilités, le député Djebbari avait repris l'idée d'un dispositif anticipant la fin des contrats en s'endettant pour financer les infrastructures de transports. Que pensez-vous aujourd'hui de l'avenir de ce dispositif ? Comment faire pour que le droit des contrats soit respecté mais que l'intérêt général soit mieux pris en compte ?
Il est heureux que nous arrivions au terme de ces contrats. Face à des contrats aussi anciens, aussi nombreux et appuyés par des conseils que soient les agents du concédant, soit on considère qu'on peut ne pas les respecter, soit on finit par les appliquer. Ce constat est frustrant mais la réalité est là. Certes, on ne ferait plus les mêmes contrats aujourd'hui. Je pense qu'il faut arriver au terme de ces contrats, les solder et passer à autre chose pour ne pas traîner le péché originel de contrats trop anciens et passés initialement avec des sociétés publiques.
Je suis incapable de vous répondre sur la rentabilité, que ce soit celle de la concession sur toute la durée de concession, depuis la privatisation ou de la rentabilité des fonds propres investis par les sociétés privatisées. J'espère que l'ART pourra le faire. L'Autorité de la concurrence que vous avez auditionnée a depuis reconnu que sa lecture à partir des excédents d'exploitation n'était sans doute pas la bonne méthode ; la rentabilité ne s'apprécie pas sur un an. Une fois dit cela, il faut rechercher différents indicateurs de rentabilité, et nous gagnerions à nous outiller davantage, même si les fonctionnaires font du mieux qu'ils peuvent, mènent des contrôles sur pièces et sur place ainsi que des audits.

Je voudrais des précisions sur la négociation de 2015. Sur les moyens de contrôle, je vous ai interrogée sur le nombre d'agents que vous alliez recruter pour remplir votre rôle d'État stratège dans la loi sur le nouveau pacte ferroviaire. Je n'avais pas eu de réponse. Je n'accuse pas les fonctionnaires, je parle de la culture administrative française. Votre réponse me conforte dans l'idée que nous n'y sommes pas. Si on ne connaît pas la rentabilité, on ne peut pas concéder un objet dont on ne sait pas ce qu'il vaut.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les contrats reposent sur des hypothèses de trafic, d'inflation et de taux d'intérêt. Lors des négociations, les fonctionnaires ont ces paramètres en tête et négocient avec des outils. Ces contrats, modifiés par avenants pour y ajouter des questions par sections par adossement, sont des monstres. Refaire l'historique de ces contrats est extrêmement compliqué et cette méthode n'est plus la bonne.
Concernant votre question sur la SNCF, je ne vois pas le rapport. SNCF Réseau est un monopole et les régions mettront en concurrence sous le contrôle de l'ART.
Je ne sais pas ce que vous attendez de ma réponse. Je vous ai indiqué les termes du débat sur le contentieux pendant, du fait de l'augmentation unilatérale de la redevance domaniale, du plan prévoyant des travaux et validé par la Commission européenne et du gel des tarifs. Le protocole a acté que le plan de relance allait être mis en oeuvre dans les meilleures conditions possibles pour le concédant. Cela n'a pas été facile d'atteindre ces objectifs et d'obtenir le maximum en profitant de la pression de l'opinion, ce qui est le principe du versement volontaire accepté par les concessionnaires.

Depuis le début de nos travaux, nous avons le sentiment d'un rééquilibrage depuis 2015 sur la capacité de l'État à contrôler et évaluer le contrat. Il y a un avant et un après 2015 dans les relations contractuelles.
C'est une bonne chose d'avoir introduit des clauses qui réduisent la durée du contrat si la rentabilité est plus importante que celle prévue. La création d'une autorité de régulation donne un appui pour mener des négociations. Mais il ne faut pas se tromper : son rôle n'est pas de juger de la pertinence d'un échangeur supplémentaire sur la base d'une doctrine plus sévère que celle élaborée par le Conseil d'État. Je défends les régulateurs ; dans le domaine de l'énergie par exemple, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est un régulateur puissant et très précieux pour faire évoluer les tarifs et aider sur des appels d'offres, mais il est bien dans son rôle. Un régulateur doit s'assurer du bon équilibre des contrats.

Je suis sénateur de l'Essonne. Depuis vingt ans, en tant qu'élu local, nous trainons le sujet du péage de Dourdan. Ce n'est pas un péage, c'est une tirelire qui rackette les usagers. Ce péage est le plus inique de la région parisienne et le plus proche de la capitale. Je dois dire que depuis vingt ans, vous êtes de loin celle qui a la vision la plus claire parmi tous les ministres que j'ai entendus, notamment grâce à votre expérience de préfet.
Vous avez cité les quatre principaux enjeux : l'acceptabilité du péage, l'absence de recalage périodique des concessions, la nécessité d'une régulation forte et la privatisation sans relecture des contrats qui a été une erreur majeure. On fustige l'administration, mais le sujet des privatisations est politique et non administratif. Ce n'est pas la faute de l'administration, mais du politique si les contrats n'ont pas été revus avant la privatisation.
Quelle serait l'architecture de cette régulation forte que vous appelez de vos voeux ? Proposeriez-vous une solution pour atténuer le racket du péage de Dourdan ? Je comprends qu'on doive respecter les contrats. Toutefois, alors que notre pays traverse une crise grave et tient à bout de bras des entreprises, on peut faire comprendre aux concessionnaires qu'en France on ne peut se servir du contribuable comme d'une vache à lait, ce qu'il est matin et soir à Dourdan.
La régulation dépendra de la forme qu'on donnera aux contrats. Le modèle du contrat de partenariat, qui rémunère un service rendu sur la base d'indicateurs de qualité exigeants, me paraît intéressant. Cela ne veut pas forcément dire que les péages, qui peuvent être collectés pour le compte de l'État, seront supprimés. Compte tenu de la maturité du réseau, je ne vois pas l'intérêt de faire peser un risque trafic dans les prochains contrats. L'État étant son propre assureur, il a intérêt à assurer le risque trafic lui-même. Il existe d'autres solutions et d'autres modèles de contrats. En Allemagne, les contrats et les batteries de critères de qualité sont nettement plus riches que le niveau de contrôle qui est prévu dans nos contrats aujourd'hui.
Les barrières de péage ont été placées à une époque où les modes de vie et de déplacement n'étaient pas les mêmes. Le sujet que vous évoquez existe aux abords de métropoles. Un certain nombre de barrières de péage sont placées de telle sorte que l'usager est contraint d'emprunter des sections à péage pour se rendre au travail. Il faut garder cette réflexion en tête pour l'avenir. J'avais demandé aux concessionnaires une réduction de 30 % pour ceux qui faisaient plus de dix allers-retours par mois. On pourrait imaginer des modèles dans lequel le trafic local ne payerait pas. Tous les pays européens sont confrontés à ce problème. La Commission européenne a fait des ouvertures en ce sens.

Le passage aux 110 km/h n'est-il pas un risque trafic ou un risque de renoncement au paiement ? Quel est votre regard sur cette proposition de la convention citoyenne ?
Ne réduisons pas les propositions de la convention à ces quelques mesures. Après neuf mois de travail, ces 150 citoyens ont voulu porter une vision globale pour réduire d'au moins 40 % les gaz à effet de serre d'ici 2030. Ils ont mis cette proposition en avant car les études montrent que la réduction de la vitesse conduit à une réduction des gaz à effet de serre. Cette mesure a été votée à 60 %, ce qui peut paraître beaucoup mais est en deçà du taux habituel de 90 % ; cela montre qu'ils sont conscients qu'il y a un problème d'acceptabilité. Leur responsabilité est de faire des propositions fortes.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) est en train de refaire le bilan, d'un point de vue environnemental. Il y a déjà beaucoup d'utilisateurs qui se déportent sur le réseau routier gratuit.

Vous nous avez apporté des éléments de réflexion. Je voudrais insister sur la question des trajets professionnels contraints. Le péage de Dourdan est sans doute un des plus contestables de France à cet égard. Le concédant devrait discuter avec Cofiroute sur ce qui serait possible pour ne pas forcer les usagers à se reporter sur la RN 20 qui est très empruntée par les poids lourds.
Je suis déçue par le nombre d'abonnés pour ce tarif réduit, actuellement limité à 100 000. C'est le seul cas où les sociétés concessionnaires ont fait un geste sans contrepartie, et elles peuvent peut-être aller plus loin.

Je suis opposé aux 110 km/h car il n'y a aucune étude réelle et sérieuse sur les conséquences sur la pollution. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable a publié récemment une étude qui dresse un bilan socio-économique très négatif, de l'ordre de - 550 millions d'euros, et le report sur le réseau secondaire engendrera une hausse des frais d'entretien du réseau national, de la pollution et des accidents. Par ailleurs, les autoroutes sont les axes où l'on dénombre le moins d'accidents et notre priorité doit rester la sécurité routière.
Le Gouvernement est bien conscient de la sensibilité du sujet et garde en mémoire les 80 km/h.

Merci d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.
La réunion est close à 18 h 00.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.