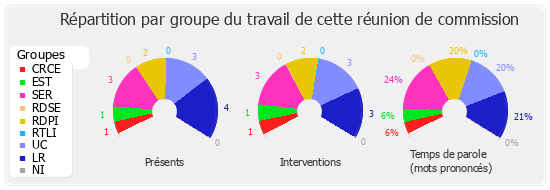Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 17 février 2021 à 10h05
La réunion
- Présidence de M. Christian Cambon, président -
La réunion est ouverte à 10 h 05.

Monsieur l'ambassadeur, notre commission a le plaisir de vous accueillir pour la première fois depuis votre nomination, en septembre dernier.
En France, on parle souvent de moteur franco-allemand de la construction européenne, voire de « couple franco-allemand », tant cette relation est importante pour nous. Quel regard portez-vous sur notre relation bilatérale, et quelles perspectives dressez-vous pour les mois à venir ?
Parmi les nombreux sujets à aborder, celui de la coopération de défense retient particulièrement notre attention.
Lors du dernier Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS), la Chancelière et le Président de la République ont souhaité que les projets communs de système de combat aérien du futur (SCAF) et de char de combat du futur (MGCS), avancent rapidement. Or ces deux briques essentielles de la composante industrielle de notre autonomie stratégique sont aujourd'hui malmenées : le partage des tâches entre Airbus et Dassault, qui nous semblait pourtant acquis et symétrique du leadership allemand sur le MGCS, est remis en cause. Notre ministre des armées déclarait avant-hier, à propos du SCAF : « c'est quelque chose que vous ne pouvez faire qu'avec de vrais amis, ceux qui tiennent parole ».
Nous pourrons également échanger sur la question du drone MALE européen (Eurodrone) et celle du standard 3 du Tigre, hélicoptère qui joue un rôle important dans nos opérations au Sahel.
En outre, nous souhaiterions aborder de nombreux sujets : le Brexit, la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique, la coopération en matière de défense, etc.
Avec le Brexit, la désorganisation des chaînes logistiques est d'autant plus dommageable que nos économies sont fortement imbriquées. Craignez-vous un effondrement des échanges ? Comment évaluez-vous le risque économique pour nos deux pays ? Par ailleurs, d'après vous, les Britanniques souhaiteront-ils participer, d'une quelconque manière, à la défense européenne ?
Les États-Unis reviennent quant à eux à des positions plus classiques, même si certaines sont constantes : le président Biden a ainsi qualifié la Chine de « concurrent le plus sérieux ». Mais c'est sur le dossier russe que le changement d'administration devrait être le plus visible ; le nouveau président américain a en effet déclaré que les États-Unis « ne se laisseront plus faire face aux agressions de la Russie ».
Sur ce sujet, la France et l'Allemagne partagent une même volonté d'autonomie ; aussi nos autorités ne remettent-elles pas en cause le projet de gazoduc « Nord Stream 2 » reliant la Russie à l'Allemagne, qui est menacé de sanctions par le Congrès américain. Toutefois, l'empoisonnement de Navalny, puis son emprisonnement, ont rendu le dialogue avec les Russes difficile. Le rôle de ce pays dans la résolution de plusieurs crises internationales nous semble important, à tel point que nous tentons, malgré tout, de maintenir le dialogue. Quel bilan tirez-vous de l'actualité des dernières semaines pour nos relations avec la Russie ?
Enfin, pensez-vous que les positions française et allemande soient convergentes pour faire émerger une véritable autonomie stratégique européenne ?
Je suis ravi de m'entretenir avec les sénateurs sur la relation franco-allemande. À mes yeux, notre coopération est plus confiante que jamais, et sans équivalent dans le monde. Nous pouvons donner un élan au projet européen afin de sortir l'Europe de la crise et de bâtir sa souveraineté. À ce titre, nous progressons dans le domaine de la sécurité et de la défense.
En matière de coopération industrielle de défense, la Chancelière et le Président de la République la considèrent comme un pilier de la souveraineté européenne. L'Allemagne a intérêt à voir aboutir les grands projets SCAF, MGCS et Eurodrone, mais encore faut-il assurer une participation égalitaire de nos deux pays. Malgré la crise sanitaire, les prochaines échéances des projets MGCS et SCAF devraient être respectées, même si les négociations ne sont pas terminées.
Le projet d'avion de patrouille maritime, qui devrait voir le jour en 2035, revêt également un caractère prioritaire. Les études de faisabilité sont en cours.
Les discussions de la coalition allemande sur l'Eurodrone devraient trouver une issue favorable au printemps prochain. L'accord sera ensuite soumis au Bundestag, ce qui sécurisera son financement.
La capacité opérationnelle de l'hélicoptère Tigre doit être préservée, mais la question de sa disponibilité mérite d'être éclaircie.
Je salue l'engagement de la France au Sahel, dont la stabilité est vitale pour l'Europe, ainsi que la mémoire de vos soldats qui ont perdu la vie dans l'opération Barkhane. Sur ce dossier, l'Allemagne a une approche globale, à la fois militaire et politique. Pour nous, seul un accord politique permettra de stabiliser la région ; c'est l'objet du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S), porté par l'Allemagne et la France. À la suite du sommet de N'Djamena, nous attendons un sursaut civil pour consolider les succès militaires ; nous sommes prêts à y contribuer.
Nous avons mis à disposition des moyens importants au Sahel, pas seulement au titre de notre aide publique au développement.
Notre contribution militaire s'opère à travers des programmes de conseil, de formation et d'équipement. En outre, jusqu'à 1 100 soldats allemands et 20 policiers sont déployés auprès de la Minusma - soit le principal contingent européen -, auxquels s'ajoutent jusqu'à 450 soldats affectés à la mission de formation de l'Union européenne au Mali (EUTM Mali). Enfin, nous avons formé les forces spéciales nigériennes, nous apportons un soutien aérien logistique aux forces françaises à Niamey, et nous prévoyons de créer un nouveau centre de formation au Mali.
En revanche, pour des raisons constitutionnelles, nous ne pouvons pas participer militairement à la task force Takuba. En effet, aux termes de la loi fondamentale allemande, nos forces armées ne peuvent être engagées que dans le cadre d'alliances existantes telles que l'OTAN, l'ONU ou l'Union européenne. Or Takuba est une coalition ad hoc, ce qui nous empêche d'y prendre part, bien que nous soutenions l'initiative sur le plan politique.
La souveraineté européenne était la priorité de la présidence allemande du Conseil de l'Union. À ce titre, nous avons travaillé sur la boussole stratégique afin de redéfinir l'ambition européenne en matière de sécurité, ainsi que sa capacité d'engagement ; le fonds européen de défense, qui est une initiative franco-allemande, participe à cet objectif. Pour notre propre sécurité, il convient d'augmenter nos dépenses militaires, tout en revitalisant nos relations transatlantiques - ce qui ne nous semble pas contradictoire. Les États-Unis constituent en effet un allié incontournable, particulièrement en matière de dissuasion nucléaire. L'administration Biden souhaite se réengager sur des sujets d'intérêt mutuel - climat, lutte contre la pandémie, Chine, Balkans occidentaux, Iran, Russie, Turquie -, dont l'agenda mérite d'être examiné.
Le président Cambon a évoqué le Brexit, dont l'accord a été conclu dans les tous derniers jours. Jamais l'Union européenne n'a conclu un accord aussi complet avec un État tiers, tout en préservant l'intégrité de son marché intérieur. Bien que les Britanniques souhaitent adopter une approche pragmatique - par exemple sur le dossier iranien -, un cadre structuré mériterait d'être défini.
S'agissant de nos relations avec la Russie, notre discours vis-à-vis de Moscou doit être clair, en suivant une double approche : fermeté des sanctions, et ouverture au dialogue. La balle est désormais dans le camp russe. Les chefs d'État européens, de même que leurs ministres des affaires étrangères, vont prochainement s'entretenir de cette question.
Nous préconisons la même approche s'agissant de la Turquie. C'est un allié aussi compliqué qu'important, mais son attitude en Méditerranée orientale doit évoluer. Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, proposera un plan lors du prochain Conseil européen. Néanmoins, les pourparlers entre la Turquie et la Grèce me paraissent encourageants.

Monsieur l'Ambassadeur, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission et vous remercie de votre présence.
Mon premier point concerne le volet industriel.
Le Président de la République et la Chancelière Angela Merkel ont pu échanger lors du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité le 5 février dernier. Il est très regrettable que le programme Tigre standard 3 n'ait pu aboutir du fait d'échéances électorales allemandes. La coopération de défense entre nos deux pays passe largement par le volet industriel, mais cela ne peut pas être exhaustif. Nos homologues allemands doivent prendre conscience que l'appartenance à l'Union européenne repose d'abord sur une volonté commune de paix, un partage d'ambition et de responsabilité politique et non uniquement sur la défense des avantages industriels nationaux.
Dans un monde aussi ouvert et où l'instabilité politique gagne même des pays considérés comme des modèles de démocratie, les 27 pays membres de l'Union européenne doivent intégrer au plus vite à leurs agendas les vrais enjeux de défense et de sécurité. Ces enjeux ne sont pas qu'industriels et quand ils le sont, le seul prisme allemand ne peut suffire.
Mon deuxième point concerne le Sahel.
Lors du sommet de N'Djamena, votre collègue a déclaré que l'effort allemand au Sahel resterait au même niveau d'engagement. L'Allemagne ayant été touchée par le terrorisme directement et indirectement via les migrations de la Turquie et de la Syrie, pourquoi la perception de la menace et de la responsabilité n'évolue pas ?
Enfin, pensez-vous que votre législation relative à l'envoi des troupes militaires au sol évoluera ?
Je vous remercie.

Monsieur l'Ambassadeur, vous avez évoqué, en conclusion de votre propos, la question de la relation avec la Turquie. Effectivement en décembre dernier, les dirigeants de l'Union européenne, dont l'Allemagne et la France, ont décidé de sanctionner les actions agressives de la Turquie en Méditerranée orientale, notamment vis-à-vis de Chypre et de la Grèce.
La Chancelière Angela Merkel n'a pas caché depuis 2017 son souhait de voir interrompre les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Pourtant, il y a quelques jours, le Président Erdogan a souhaité l'organisation d'un sommet avant la fin de la présidence portugaise, le Portugal étant considéré par Ankara comme un pays ami.
Vous avez évoqué, Monsieur l'Ambassadeur, la normalisation de la relation de l'Union européenne avec la Turquie, qui passerait effectivement par un redressement de la position turque.
Ma question est simple, Monsieur l'Ambassadeur, pensez-vous qu'aujourd'hui la normalisation de cette relation soit possible, notamment au niveau de l'OTAN ?

Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre présentation.
Le Président Cambon a posé toutes les questions relatives aux projets de constructions d'équipements militaires, je ne vais pas y revenir. Je souhaite simplement préciser que si nous ne doutons pas de la volonté politique de nos exécutifs, dans le cadre de la diplomatie parlementaire que nous faisons vivre, nos rencontres avec nos homologues créent parfois certaines inquiétudes quant à leurs motivations, et ce sont eux qui peuvent faire avancer ce sujet.
Ma question porte sur la boussole stratégique, à laquelle vous avez fait référence. C'est un sujet que notre commission a retenu comme projet de travail pour les mois qui viennent.
J'aimerais savoir quel bilan vous avez retenu de son lancement, puisqu'il a eu lieu sous votre présidence ? Est-ce que vous estimez que nous avons un socle suffisamment solide pour avancer ? Qu'est-ce que vous attendez de la présidence française à partir du mois de juin 2022 ?
J'ajoute une question sur le nucléaire. Aujourd'hui l'OTAN est le pilier de notre sécurité commune. C'est aussi une alliance nucléaire. Trois de ses membres, dont la France, sont dotés de l'arme nucléaire. Cinq pays de l'alliance, dont l'Allemagne, s'engagent à effectuer avec leurs avions, et donc leurs équipages, des missions nucléaires dans le cadre de l'OTAN.
J'aimerais savoir si aujourd'hui le nucléaire est un sujet qui est débattu au sein de l'opinion publique et, si oui, comment ? Merci.

Monsieur l'Ambassadeur, on parle maintenant de la bipolarité « Etats-Unis-Chine », alors que nous ne l'observions auparavant qu'avec la Russie.
Le Brexit a décomplexé nos amis britanniques et ils penchent vers un axe pro-américain dans leurs relations avec l'Union européenne.
Je fais un troisième constat, concernant le conseil franco-allemand du mois de février, qui a révélé un « encéphalogramme plat ». On se dit gentiment que nous nous aimons, mais guère plus.
J'aurais donc aimé vous pousser dans vos retranchements. Qu'attendez-vous de la France pour que ce moteur puisse fonctionner et en quoi devrions-nous relancer ensemble cette stratégie européenne au sein de l'OTAN que vous avez décrite ?

Monsieur l'Ambassadeur, on a déjà évoqué les questions liées à la Défense et à l'organisation industrielle. Il est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Il s'agit de la politique spatiale européenne.
Vous n'êtes pas sans savoir que l'on est passé d'une logique uniquement civile à une approche plus duale et donc stratégique. En la matière, l'Allemagne, qui a longtemps accusé un certain retard sur la politique spatiale européenne, le rattrape en partie. Elle a une politique assez active, mais on a du mal à voir aujourd'hui quelles orientations et surtout quelle coordination on peut avoir au niveau européen.
En France, on a été particulièrement choqué lorsque, en 2013, trois satellites militaires de radar allemands ont été lancés par un lanceur américain Falcon 9, alors que l'Allemagne, au titre de son implication forte dans l'Agence spatiale européenne, bénéficie à plein de ce qu'on appelle le « retour géographique », c'est-à-dire que ce qui est financé par les États membres, revient en travail et en emplois dans les États membres. D'ailleurs, les critiques qui sont faites sur Ariane 5, et bientôt Ariane 6, sur leurs coûts, sont liées au fait que l'Europe refuse toutes formes de délocalisation de production hors de ses États participants.
Aujourd'hui on voit l'Allemagne encourager des sociétés privées comme OHB-system ou ISAR, qui se lancent dans la production de mini-lanceurs. On envisage aussi la possibilité d'un port spatial allemand.
Entre subventions et compétition, comment peut-on trouver un fonctionnement harmonieux, qui nous porterait vers une approche stratégique de souveraineté européenne, dans un domaine où, avec la protection des moyens de communication et des satellites, les applications autrefois civiles deviennent de plus en plus militaires ?

Monsieur l'Ambassadeur, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont conjointement condamné, la semaine dernière, la production par l'Iran d'uranium métallique.
Alors que le monde attend des signes de la nouvelle administration américaine concernant l'accord sur le nucléaire iranien et que l'Iran s'éloigne toujours un peu plus de l'accord de 2015, quel rôle reste-il aux diplomaties européennes sur cette question ?
En tant que président du groupe d'amitié France-Afghanistan, je voudrais vous poser cette question : aujourd'hui, nos ministres de la Défense, réunis par vidéo-conférence dans le cadre de l'OTAN, doivent aborder la question de la présence de troupes de l'OTAN en Afghanistan. Alors que les Talibans exigent le départ de toutes les troupes occidentales et que votre ministre des Affaires étrangères a annoncé ce week-end que les troupes allemandes pourraient voir leurs missions prolongées après le mois de mars, pourriez-vous nous éclairer sur la position que Berlin compte adopter en Afghanistan ?

Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, pour vos propos. Au début de votre intervention, vous avez relevé le fait qu'il serait utile que nous fassions progresser, ensemble, le projet européen.
Mais sans amitié franco-allemande renforcée, sans complicité franco-allemande, je doute que cela soit possible. Les discussions et les compromis avec l'Allemagne m'apparaissent indispensables.
Cela entre en résonnance avec l'audition que l'on a faite hier après-midi avec l'ex-commissaire européen, Michel Barnier. Dans son intervention, il concluait en se demandant comment il était possible que le Brexit ait pu avoir lieu. Nous savons qu'il y a des incidences britanniques propres, mais le fait que le Brexit ait été possible, n'est-ce pas la signification d'une forme de montée du populisme dans l'ensemble des pays européens et, dès lors, comment faire pour l'éviter ?
Le moyen, selon vous, n'est-il pas de faire en sorte que nous ayons une Europe qui protège, d'une part, et une Europe qui se protège, d'autre part ?
Une Europe qui protège : nous avons pu mettre en place une Europe financière, une Europe économique, une Europe monétaire. Ne serait-il pas utile d'évoquer une Europe sociale pour se rapprocher des peuples ?
Une Europe qui se protège : il faut une Europe beaucoup plus souveraine, Pensez-vous que le dernier accord entre l'Union européenne et la Chine aille dans ce sens, d'autant plus qu'il est quasiment fait abstraction des problèmes liés aux droits de l'homme en Chine ?
Par ailleurs, une Europe qui se protège, est aussi une Europe indépendante sur le plan énergétique.
Pensez-vous que ce soit le cas avec la Russie, aujourd'hui ou demain ?

Je vous propose de répondre, Monsieur l'Ambassadeur à ce premier train de questions.
SE M. Hans-Dieter Lucas. - Sur la question de la coopération franco-allemande industrielle, vous avez tout à fait raison, cela ne suffit pas, il faut un agenda commun, une approche commune. Mais tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur le noyau dur, les capacités militaires et la stratégie. Il faut une évaluation des menaces. L'accord franco-allemand est indispensable, mais ne suffit pas. Il faut une prise de position européenne.
La Chancelière souhaite que soit trouvé un accord avec la France, afin que le Bundestag puisse adopter les actes nécessaires au développement du financement.
Sur la question de la Turquie et de l'OTAN, il faut relever que la Turquie est un allié important au sein de l'OTAN, mais aussi un allié difficile.
L'OTAN est le seul cadre institutionnel qui permette le maintien d'un dialogue avec la Turquie.
Il peut y avoir des résultats encourageants, par exemple quand le Secrétaire général de l'OTAN a joué un rôle de médiateur entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée orientale. L'OTAN est le cadre dans lequel on peut discuter de ces questions.
Sur la boussole stratégique, les travaux ont commencé sous la présidence allemande. Il faut continuer le travail. C'est notre but commun de terminer ces travaux sous la présidence française. Il y a une coopération très étroite avec la France sur la boussole stratégique. Nous allons soutenir la présidence française en ce qui concerne ce document très important, qui sera un document cadre pour définir plus en détail nos efforts dans le domaine de la politique de sécurité et de défense.
Lorsque l'on parle de la souveraineté européenne, il faut se rendre compte que cela nécessite une vue d'ensemble des menaces et de nos capacités. La boussole stratégique constitue un pas vers une plus grande souveraineté européenne en matière de sécurité.
Le nucléaire en Allemagne inspire toujours les débats, tant sur le plan civil que militaire. La position du gouvernement est tout à fait claire, en ce qui concerne le caractère de l'alliance atlantique, en tant qu'alliance nucléaire. Mais il y a aussi des tendances dans la classe politique et dans l'opinion qui sont contre. Dans certains milieux, il y a un soutien en faveur du projet de traité qui interdit les armes nucléaires, mais la position du gouvernement allemand est tout à fait claire pour ne pas ratifier cet accord et rester dans le cadre de la doctrine nucléaire actuelle.
Les relations entre les États-Unis et la Chine sont difficiles. La question est de savoir où se situe l'Europe. Notre but serait de ne pas avoir à faire un choix, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis sont notre allié et que nous partageons avec eux les mêmes valeurs.
La Chancelière a souligné que nous n'avons aucun intérêt à un découplage avec la Chine. Nous avons besoin de la Chine sur des grands sujets internationaux : réchauffement climatique, conflits régionaux.
La Chine est aussi un partenaire économique très important. Nous avons intérêt à développer avec la Chine une relation coopérative, basée sur des règles. C'est la raison pour laquelle nous avons conclu avec la Chine l'accord sur les investissements : il définit des règles qui obligent la Chine. La France et l'Allemagne peuvent contribuer à ce processus de manière substantielle. Il reste encore à l'Europe à définir une stratégie commune vis-à-vis de la Chine. La Chancelière avait souhaité avoir un Sommet avec la Chine pendant sa présidence. Ce sommet a été reporté, à cause du Covid, mais cela reste une ambition de définir à 27 une stratégie commune, qui serait idéalement concertée avec les États-Unis.
La Chine est plusieurs choses à la fois : un partenaire, un concurrent, un rival systémique.
L'espace est un sujet qui a une énorme importance stratégique. Il y a beaucoup de grands projets franco-allemands, comme l'hydrogène, le numérique, des projets d'armement, et le spatial devrait en faire partie.
Nous travaillons ensemble dans le cadre du projet Ariane. Il faut continuer avec l'achèvement d'Ariane 6, mais il faut discuter de la politique spatiale européenne dans l'avenir. Il faut des lanceurs comme Ariane, mais il faut aussi des mini-lanceurs.
Le ministre Bruno Le Maire et son homologue ont fondé un groupe de travail pour discuter de questions ouvertes. Les philosophies ne sont pas identiques, mais nous sommes d'accord sur le but : garder un accès indépendant à l'espace pour l'Europe.
Quant à l'Iran, la situation est préoccupante. L'Iran a annoncé sa décision de réduire la transparence, dans sa coopération avec l'organisation décidée à Vienne. Il faut en discuter avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie et la Chine.
La transparence est un pilier de l'accord avec l'Iran. Le sauvegarder nécessite que l'Iran respecte toutes ses obligations prévues par l'accord : limitation des capacités militaires et transparence.
Il faut sauver l'accord avec l'Iran et trouver une entente en ce qui concerne le programme de missiles en Iran et le rôle régional de l'Iran.
Il faut montrer que l'Europe fait quelque chose pour les citoyens. Le Portugal a annoncé un sommet sur les questions sociales au mois de mars. C'est important de démontrer que l'Europe n'oublie pas qu'elle doit être une Europe sociale.
Le projet d'une conférence sur le futur de l'Europe devrait atténuer l'impression d'une Europe technocratique. Cette conférence devra associer les citoyens et les parlementaires.

Notre collègue Gilbert Roger vous posait la question de savoir ce que l'Allemagne demandait à la France, mais j'inverse la question. Je crois pouvoir dire que, sur le Sahel, nous reviendrons vers vous parce que la présence française au Sahel concerne non seulement la France, mais aussi l'ensemble de l'Europe et même l'ensemble du monde, puisqu'il s'agit de combattre le terrorisme - dont l'Allemagne a d'ailleurs été victime à plusieurs reprises. Nous reviendrons donc certainement vers vous et vers d'autres pays européens pour demander un soutien plus fort. Il y a un débat en ce moment en France sur la stratégie future de l'opération Barkhane ; l'idée de réduire le nombre de militaires envoyés a été évoquée ; pour l'instant, elle ne semble pas devoir s'appliquer. Mais, d'ici un an ou un an et demi, la discussion reviendra.
Je voulais vous poser une seconde question - la première était plutôt une observation -, sur la coordination du droit européen des affaires. Il existe en effet un projet consistant à coordonner et intégrer davantage nos législations en matière de droit des affaires, ce qui est assez vaste - cela couvre le droit commercial, le droit des affaires proprement dit et même le droit des successions, par exemple. Ceci a été repris dans le traité d'Aix-la-Chapelle. L'idée est évidemment d'intégrer nos deux marchés et nos deux législations. Est-ce que vous pouvez nous informer sur l'avancée de ce projet ?

Je vais aborder un domaine qui n'a pas été évoqué - mais c'est normal, car l'Allemagne est un peu moins concernée -, il s'agit du maritime. C'est vrai que si l'espace est un domaine stratégique important, il se dit que l'avenir s'écrira avec la mer. Est-ce que l'Allemagne - vous avez évoqué à de nombreuses reprises la souveraineté européenne - aidera la France et les autres pays concernés par le maritime à ce que l'Europe soit souveraine sur ce plan ? J'aimerais connaître votre position vis-à-vis de l'Antarctique. Je vous remercie.

Étant nouvelle dans cette commission et soucieuse de l'état de santé des soldats ainsi que de leur formation, mes questions porteront sur la coopération franco-allemande en matière de défense, qui est caractérisée par des institutions et des activités diverses. Je vous remercie de nous avoir informés de la création d'un centre de formation au Mali.
En ce qui concerne mes questions, tout d'abord pouvez-vous me donner les effectifs actuels de la brigade franco-allemande BFA à Mulheim ? La Covid a-t-elle impacté cette brigade ? Des vaccinations sont-elles prévues pour les soldats français et les soldats allemands et, si oui, comment et qui organisera ces vaccinations ? Enfin, concernant les écoles franco-allemandes du Tigre au Luc en France et à Fassberg en Allemagne, ainsi que le centre de formation des contrôleurs aériens avancé de Nancy, pouvez-vous nous donner le nombre d'heures de formation réalisées ainsi que le nombre de soldats qui ont pu y participer sur l'année 2020 ? Ces heures de formation ont-elles été impactées par la Covid et quelles sont vos prévisions de formation sur ces sites pour 2021 ? Merci.

Je voudrais aborder la question, qui a été évoquée par un de mes collègues, du projet de gazoduc Nord Stream 2, avec 55 milliards de mètres cubes de gaz qui pourraient être acheminés jusqu'en Europe. On sait que les relations entre l'Europe et la Russie sont très tendues. La chancelière semble rester sur une coopération pragmatique - comme elle l'indique - avec la Russie. Cependant, le projet Nord Stream 2 ne semble pas totalement étranger, justement, à cette position plutôt prudente et l'on sait que ce projet fait débat, notamment dans le cadre de la campagne électorale, et qu'il pourrait donc influencer aussi une éventuelle coalition entre conservateurs et écologistes dans le cadre des élections de septembre. Je voudrais avoir votre avis sur l'impact que pourrait avoir un abandon de ce projet sur la stratégie énergétique allemande et son indépendance énergétique, pour un pays qui est en passe de sortir à la fois du nucléaire et de la dépendance au charbon.

En septembre dernier, je suis allé à Sarrebruck, j'avais été accueilli au Landtag sarrois par le président du Parlement Stephan Toscani. J'étais donc dans cette grande région, qui comprend notre région Grand-Est, la Sarre, le Luxembourg, qui fut le terreau de la construction européenne imaginée par les pères de l'Europe. J'ai interrogé le président Toscani sur la décision de fermeture de la frontière allemande durant la pandémie en mars 2020, qui sinon ouvert une blessure, du moins choqué les habitants venant de France et du Luxembourg. Le président Toscani a rappelé que cette décision a été prise par Berlin au plan national, mais il ne s'était pas dérobé, il avait assumé une part de responsabilité car ils avaient été consultés. Mais Stephan Toscani reconnaissait que la fermeture de la frontière était une mauvaise expérience et il ne souhaitait pas qu'elle se reproduise. Malgré tout, une décision analogue, unilatérale, vient à nouveau d'être prise à la frontière avec le Tyrol autrichien et la République tchèque. Pourriez-vous nous rassurer sur le fait qu'une telle mesure ne se reproduira pas pour la France, au niveau de la frontière entre la Sarre et la région Grand-Est ? Plus généralement, quels enseignements avez-vous tirés de la fermeture de mars, qui avait été mal vécue sur le terrain ?

Ma question concerne l'immigration. Le 20 janvier, la commission chargée de travailler sur les questions migratoires a rendu son rapport à Angela Merkel sur la capacité de l'Allemagne à intégrer ses demandeurs d'asile et à façonner une société d'immigration. Le rapport souligne d'incontestables succès, alors que l'Allemagne est le premier pays d'immigration d'Europe. Sept ans après qu'Angela Merkel a affirmé « Nous y arriverons », l'Allemagne a accueilli près de 1,5 million de réfugiés et force est de constater que la chancelière est en passe de gagner son pari.
La France est dans une situation nettement plus mitigée. Selon l'institut de recherches économiques IAB, en 2019 un quart des personnes arrivées depuis 2015 aurait trouvé du travail. De nombreux centres d'accueil d'urgence ont fermé et, sans se tarir, le flux de demandeurs d'asile s'est réduit. En un mot, la situation de crise est dépassée. Mais l'Allemagne n'est pas au bout du grand défi que représente l'accueil de ces populations. La crise et l'urgence étant passées, il s'agit maintenant d'oeuvrer à leur intégration profonde dans la société. Aussi le rapport mentionne-t-il de nombreux chantiers restants. Quelle est aujourd'hui la politique allemande vis-à-vis de l'arrivée de nouveaux migrants et pouvez-vous la resituer dans le cadre européen ? Je vous remercie.
Concernant la présence allemande au Sahel, j'ai essayé de montrer qu'elle est déjà très substantielle, et il ne faut pas oublier que ce n'est pas notre seule présence militaire. On est encore très fortement engagé en Afghanistan - l'Allemagne est le deuxième fournisseur de troupes en Afghanistan -, en Lituanie - on mène un bataillon de combat -, dans les Balkans, en Irak aussi. Dans ce contexte, notre présence militaire au Sahel est déjà très significative. Il y a un vrai changement de paradigme dans la discussion en Allemagne. On reconnaît vraiment le Sahel comme représentant un défi stratégique, pas seulement pour la France, mais aussi pour l'Allemagne et pour l'Europe. C'est la raison pour laquelle on a, d'une manière assez substantielle, élevé le niveau de notre engagement sur les plans civil, militaire et aussi financier, et cette discussion continuera. En ce qui concerne la MINUSMA, l'Allemagne est le fournisseur le plus important au niveau européen. Il y a donc là une évolution, et cette discussion va continuer. Si on regarde les engagements militaires de l'Allemagne, il faut regarder l'image complète. Il est important pour nous de voir ce que nous pouvons faire, quelles sont nos capacités.
Il y avait la question de l'importance du maritime. L'Allemagne est aussi - peut-être pas comme la France - une puissance maritime. Nous avons parfaitement reconnu l'importance de cet aspect pour notre politique de sécurité. L'Union européenne a développé une stratégie maritime, mais aussi l'OTAN. C'est pour nous une question très importante, nous avons soutenu ces deux stratégies et nous contribuons à leur mise en oeuvre.
Il y avait des questions concernant la brigade franco-allemande et la situation Covid, ainsi que le centre de formation Tigre. Vous avez demandé des chiffres très précis ; pour le moment, je n'ai pas ces chiffres mais on va s'en occuper et vous informer là-dessus.
Nord Stream 2 est une question difficile. Notre position est claire : il n'y a pas de raison pour nous de mettre fin à Nord Stream 2. Tout d'abord, c'est un projet entre des entreprises, donc ce n'est pas un projet de l'État allemand. Ce sont des entreprises européennes qui contribuent à ce projet, dont Engie, entreprise française. On est d'avis que ce n'est pas le moment de prendre la décision politique d'abandonner ce gazoduc en réaction au comportement russe. On peut avoir une discussion sur des sanctions globales économiques, mais, dans ce cas-là, il faut avoir aussi une discussion sur les exportations pétrolières russes, par exemple aux États-Unis. Économiquement, le pétrole russe est probablement plus important pour le budget russe que les exportations de gaz. C'est une discussion très difficile. Nous n'avons pas l'ambition de commencer une telle discussion au sein de l'UE. Cette discussion se retrouve aussi en Allemagne, au sein de la coalition, de la part de l'opposition et des médias. Mais, pour le moment la position du gouvernement est claire. Il y a un argument politique et il y a aussi un argument économique, que vous avez mentionné : nous avons besoin de ce gaz russe parce que nous nous trouvons dans une phase transitoire. Nous avons abandonné le nucléaire et le charbon et nous avons besoin, pour un certain temps, du gaz - comme d'autres pays. Mais il ne faut pas surestimer la dépendance au gaz russe. Pour donner un chiffre, après l'achèvement de Nord Stream 2, la part du gaz russe dans le mix énergétique allemand s'élèvera à 9 %. Ce n'est pas rien mais ce n'est pas 30 ou 40%. Il faut donc aussi se représenter les proportions.
La fermeture de la frontière avait été une mauvaise expérience, j'en suis tout à fait d'accord, et l'on ne voulait pas la répéter à la frontière franco-allemande. Il y a sur ces questions une concertation très étroite entre les capitales, mais aussi sur le plan régional : il y a des visioconférences chaque semaine entre les autorités des trois Länder, les ministères et la préfète du Grand-Est. La dernière a eu lieu hier, et tout le monde est d'accord pour éviter une nouvelle fermeture de la frontière. Par ailleurs, en ce qui concerne la République tchèque, on n'a pas fermé la frontière.
L'immigration, c'est une question qu'il faut vraiment régler dans le cadre européen. On a commencé sous la présidence allemande la discussion sur un nouveau système d'asile et d'immigration de l'Union européenne. C'était difficile, tout d'abord parce que la Commission a fait ses propositions très tard à cause du Covid. Mais il est clair que les positions sont assez divergentes au sein de l'Union européenne. Pour nous, comme pour la France, les propositions de la Commission étaient une bonne base. Elles s'appuient sur le principe d'une solidarité partagée entre les pays membres de l'UE d'accueil, mais définir cette solidarité est très difficile. Quoi qu'il en soit, il faut se mettre d'accord sur un système d'asile et d'immigration européen, car cette question ne peut être réglée que dans un cadre européen. Ensemble, avec la France, nous nous mobiliserons pour trouver un accord là-dessus. Il y a quelques mois, la chancelière a dit que trouver un accord sur ces questions était peut-être encore plus difficile que trouver un accord sur les questions financières ! La tâche est donc particulièrement ardue, mais c'est une très bonne chose que la France et l'Allemagne soient d'accord sur l'approche.

Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, pour ce premier échange. On aura l'occasion de vous revoir à d'autres moments. Dans les différentes questions et le propos introductif que nous avons tenu, je ne peux que renouveler nos inquiétudes sur l'affaire du SCAF, qui nous semble assez importante. Ce sont des discussions qui relèvent, et du niveau des exécutifs, et de celui des industriels car il s'agit de la discussion des droits de propriété intellectuelle - les fameux IPR, pour intellectual property rights - notamment entre Dassault, qui ne voit pas de raison de se priver de ses propres technologies, et nos amis allemands, qui ne se voient pas utiliser des boîtes noires sans savoir ce qu'il y a dedans, ce qui n'est pas non plus totalement contraire au bon sens. Dans tous les cas, je suis en train de procéder à des invitations à destination de nos industriels concernés par le SCAF ; espérons qu'un chemin va être trouvé, car il y a aussi des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut arrêter le SCAF et cette coopération, ce qui signerait la fin de l'autonomie stratégique, la fin de la coopération en matière de défense. Les conséquences iraient bien au-delà de ces thèmes de coopération.
M. l'ambassadeur, je voulais aussi vous dire combien nous sommes attachés à la coopération interparlementaire. Je ne vous cache pas que le Sénat a vivement regretté que, dans le traité d'Aix-la-Chapelle, le Sénat - pour des raisons constitutionnelles puisque le Bundesrat n'a pas les mêmes compétences que les nôtres - ne soit pas convié à l'assemblée parlementaire franco-allemande organisée par le traité d'Aix-la-Chapelle. Je le dis sincèrement, c'est un peu dommage. Nous conservons, avec nos collègues de l'Assemblée nationale, la possibilité de dialoguer avec les commissions du Bundesrat et, dès que la situation pandémique se sera améliorée, nous essaierons de renouer ce contact car les échanges entre parlementaires sont extrêmement fructueux et positifs.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie de nous avoir fait le point sur ces différents sujets. Comme on le comprend, le nombre de sujets de coopération entre la France et l'Allemagne est très important ; nous n'avons évoqué que ceux qui nous concernent au sein de notre commission mais nous aurions pu en évoquer bien d'autres. Ce sera l'occasion de nous revoir, vous êtes ici chez vous comme le meilleur de alliés. Encore une fois, Monsieur l'ambassadeur, je vous adresse mes remerciements et vous souhaite bonne chance ainsi qu'une complète réussite dans l'importante mission que vous avez maintenant ici, en France et à Paris.
Mes chers collègues, il a été décidé de reconduire le groupe de travail sur les enjeux spatiaux, conjoint à trois commissions : la commission des affaires économiques, la commission des affaires européennes, et la nôtre.
Ce groupe de travail sera composé de neuf sénateurs, désignés à la proportionnelle des groupes politiques, avec trois membres de chaque commission.
Au titre de la commission des affaires étrangères et de la défense, il est proposé de désigner :
- Joëlle Garriaud-Maylam, pour le groupe Les Républicains ;
- Gisèle Jourda, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ;
- et Yves Détraigne, pour le groupe Union Centriste.
Il n'y a pas d'opposition ? Il en est ainsi décidé.
La réunion est close à 11 h 30.