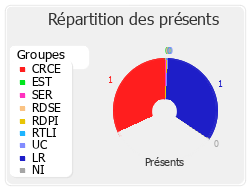Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 21 décembre 2005 : 1ère réunion
La réunion

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de Mme Monique Cerisier-ben Guiga sur le projet de loi n° 128 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse.
Après avoir remercié M. Xavier Pintat de lui avoir permis de rapporter ce projet de loi, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a rappelé que l'OFAJ avait été créé en 1963, peu après la signature du traité de l'Elysée par le chancelier Konrad Adenauer et le Président Charles de Gaulle, afin de « resserrer les liens qui unissent les jeunes des deux pays, renforcer leur compréhension mutuelle et [... ] réaliser des rencontres de jeunes ». Dans ce but, l'OFAJ suscite et appuie les échanges de jeunes mis en place par de nombreux acteurs tels que les associations pour la jeunesse, les clubs sportifs, les centres linguistiques, les organisations professionnelles, les établissements scolaires, les comités de jumelage. Ses programmes ont été ouverts en 1976 aux jeunes des autres pays de la Communauté européenne ; l'OFAJ, depuis 1991, soutient les échanges avec les pays d'Europe centrale et orientale et développe également, depuis 2000, ses activités en Europe du Sud-Est.
a regretté que le conseil d'administration, instance de décision présidée par les ministres français et allemand chargés des questions de jeunesse, ne se soit pas réuni de 2001 à 2003, et qu'aucun représentant français n'y ait été nommé depuis 2004. L'OFAJ souffre dès lors d'un dysfonctionnement chronique grave.
Le bilan de l'Office n'est toutefois pas négatif. L'OFAJ est ainsi le premier opérateur franco-allemand en matière d'échange de jeunes, particulièrement dans l'enseignement secondaire, dont 160.000 élèves sont concernés chaque année, sur un total de 200.000 jeunes bénéficiaires d'échanges. Plus de 7 millions de participants et plus de 250.000 rencontres ont été subventionnés depuis 1963. Le budget annuel de l'Office s'élevait à 22,87 millions d'euros en 2005. Il est essentiellement alimenté par des contributions des ministères français et allemand chargés de la jeunesse.
Ce bilan positif sur le plan culturel n'a malheureusement pas d'incidence correspondante sur le niveau d'apprentissage du français en Allemagne et de l'allemand en France. En France, en 2000, près de 90 % des élèves de 6e étudiaient l'anglais et moins de 9,4 % ont choisi l'allemand, soit moins d'un élève de 6e sur 10. En ce qui concerne le choix de la deuxième langue, pour l'ensemble du second degré, plus de 61 % des élèves choisissent l'espagnol et moins de 20 % l'allemand. A titre de comparaison, en 1970, l'espagnol et l'allemand étaient choisis à égalité comme deuxième langue. Ainsi, pour l'ensemble du second degré, l'anglais est étudié par 5,1 millions d'élèves, devant l'espagnol, 1,8 million, et l'allemand, qui arrive en 3e position, avec 1,1 million. La situation de l'apprentissage du français en Allemagne est presqu'aussi inquiétante.
a indiqué qu'une mission d'évaluation gouvernementale franco-allemande avait travaillé, parallèlement à une mission parlementaire mixte, composée de membres du Bundestag et de l'Assemblée nationale, afin de proposer d'éventuelles modifications des modalités de fonctionnement de l'OFAJ. Sur la base des recommandations des parlementaires, un accord a été signé lors du conseil des ministres franco-allemand du 26 avril 2005, qui est maintenant soumis à l'approbation du Parlement.
Par rapport à l'accord de 1963, les principales modifications sont les suivantes : tout d'abord, le rôle de l'Office dans l'apprentissage linguistique constitue désormais une composante importante de ses missions, alors que l'OFAJ n'avait pas vocation initialement à être une école de langues ; ensuite, la composition du conseil d'administration est modifiée, revenant de 30 à 14 membres. En plus des deux ministres chargés de la jeunesse, les 12 autres membres sont désignés à parité par chaque gouvernement : 6 sont issus des administrations publiques et 6 autres sont des personnalités qualifiées à raison de deux représentants des collectivités territoriales, deux représentants du Bundestag et de l'Assemblée nationale, enfin de deux jeunes entre 18 et 27 ans ; le système de cogestion par la société civile, qui avait fait ses preuves, n'aura donc plus cours ; par ailleurs, le conseil d'orientation, dont le rôle est seulement consultatif, est la seule instance où siègent les représentants de la société civile ; enfin, le statut du personnel, actuellement identique à celui des fonctionnaires internationaux de l'OCDE, est modifié : le personnel sera à l'avenir recruté exclusivement sur la base de contrats à durée déterminée. Cette modification, censée intervenir sans période transitoire, dès l'approbation de l'accord, constitue un « mouvement de balancier » excessif par rapport à la situation précédente qui n'était pas sans défaut.
Sous le bénéfice de ces observations, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, s'en est remise à la sagesse de la commission pour l'adoption du projet de loi.

a estimé que le fonctionnement de l'OFAJ, qui va se faire désormais sur de nouvelles bases, pourrait utilement faire l'objet d'un travail d'information de la commission.

a indiqué que le problème du rayonnement culturel français à l'étranger et de l'enseignement de notre langue ne se limitait pas à la seule Allemagne, ainsi que le prouvait la récente fermeture des cours de français à l'institut français de Vienne.

a souligné que le manque d'intérêt porté à l'enracinement de la culture française en Europe constituait une faute.

a rappelé que chaque fermeture de centre culturel privait la France d'un outil d'influence diplomatique irremplaçable. Le réseau culturel étant un atout spécifique de la France, son affaiblissement ne nuit pas qu'à la seule francophonie.

a pris acte du souhait exprimé par plusieurs commissaires d'approfondir la question de nos centres et instituts culturels en Europe et a indiqué que des auditions pourraient être engagées dans un premier temps avant de conduire éventuellement à une mission d'information sur le sujet.
Puis la commission a adopté le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse.

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Gérard Roujas sur le projet de loi n° 127 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à certaines questions immobilières.
a tout d'abord retracé l'historique du dossier des légations des pays baltes à Paris, l'accord franco-russe du 10 décembre 2004 constituant le dernier volet de son règlement définitif. Ce contentieux a ressurgi lors du retour à l'indépendance de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie, en 1990 et en 1991, la Russie ayant refusé de restituer les bâtiments où ces trois pays avaient installé leur ambassade respective à Paris durant l'entre-deux-guerres. En effet, ces bâtiments étaient occupés par les services diplomatiques russes qui s'y étaient installés dès 1940, date de l'annexion par l'Union soviétique des trois républiques baltes, en application d'une clause secrète du pacte germano-soviétique. Réquisitionnés par les Allemands en 1941, les bâtiments avaient de nouveau été remis aux autorités soviétiques à la Libération.
Après avoir considéré dans un premier temps qu'elle n'était pas directement concernée par ce différend, la France s'est fortement impliquée dans la recherche d'une solution. Les négociations conduites avec les Etats baltes d'une part et avec la Russie d'autre part, ont abouti à un schéma de règlement « triangulaire ». La France a proposé aux pays baltes de les dédommager pour les trois immeubles litigieux. Elle a par ailleurs proposé à la Russie de régulariser sa situation, en lui délivrant des titres de propriété qu'elle n'avait jamais obtenus. La Russie, pour sa part, accorderait à la France une contrepartie financière sous la forme d'une réduction de loyers et de prise en charge de travaux dans la résidence de notre ambassadeur à Moscou.
a rappelé que le Parlement français avait déjà approuvé, en mars 2003, trois accords passés avec les pays baltes aux termes desquels la France leur a versé une somme totale de 11,3 millions d'euros. Cette somme représente le prix des trois immeubles, déduction faite des dépenses que notre pays avait déjà engagées, puisqu'il avait accepté de supporter, à partir de 1991, le loyer des nouvelles ambassades baltes à Paris.
L'accord franco-russe n'a été signé, pour sa part, que le 10 décembre 2004. Il prévoit que les titres de propriété des trois immeubles litigieux seront transférés à la Russie. Cette dernière consentira à la France, pour une durée de 10 ans, une diminution du loyer de la résidence de l'ambassadeur de France à Moscou de l'ordre de 4 millions d'euros, et elle y effectuera des travaux pour un montant de 2 millions d'euros hors taxes.
Le rapporteur a relevé qu'au total, la Russie accorderait sur 10 ans un avantage de 6 millions d'euros à la France, soit environ la moitié de l'effort financier déjà effectué par la France en faveur des pays baltes. Il a souligné l'importance de la contribution française au règlement définitif de ce dossier.
Il a invité la commission à adopter le projet de loi.

A la suite de cet exposé, M. Josselin de Rohan a demandé des précisions sur les incidences de l'accord sur les conditions d'installation de notre ambassade à Moscou.

a précisé que l'accord concernait uniquement la résidence de l'Ambassadeur de France à Moscou, et non les locaux de la chancellerie diplomatique. Il a ajouté que la période de dix ans mentionnée dans l'accord est celle durant laquelle sera appliquée la réduction de loyer, la location de la résidence étant cependant appelée à se poursuivre au-delà de ces dix ans.

et Mme Monique Cerisier-ben Guiga ont ensuite effectué des remarques plus générales sur la gestion par le ministère des affaires étrangères de son patrimoine immobilier à l'étranger.

a indiqué que la commission pourrait utilement entendre sur ce sujet le secrétaire général du ministère.
La commission a ensuite adopté le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à certaines questions immobilières.
Enfin, la commission a désigné Mme Dominique Voynet comme membre appelé à faire partie de la mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années.