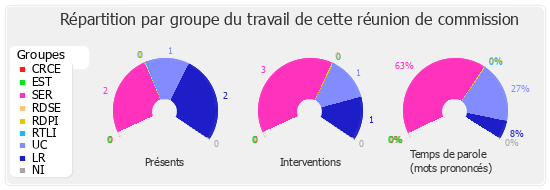Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 20 juillet 2022 à 11h15
Sommaire
- Projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'atlantique nord sur l'accession de la république de finlande et la ratification du protocole au traité de l'atlantique nord sur l'accession du royaume de suède
- Audition d'une délégation de la sous-commission sécurité et défense du parlement européen (voir le dossier)
La réunion
Projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'atlantique nord sur l'accession de la république de finlande et la ratification du protocole au traité de l'atlantique nord sur l'accession du royaume de suède
Examen du rapport et du texte de la commission

La plupart des membres du groupe SER voteront ce projet de loi demain. Les gouvernements finlandais et suédois ne font que s'adapter à la nouvelle réalité géopolitique en demandant une adhésion d'urgence. C'est un bouleversement total. Lorsque j'avais rencontré, dans d'autres fonctions, le président finlandais, il m'avait expliqué que son pays avait été occupé plusieurs fois dans son histoire par la Russie et que ce n'était pas un véritable problème, même si les avions russes survolaient régulièrement leur territoire... Leur position a totalement changé, ce qui provoquera des réactions. La frontière entre l'OTAN et la Russie s'allonge, et celle-ci ne restera pas inactive.
L'adhésion n'étant pas imposée par les États-Unis, nous ne voyons pas de raison de nous opposer à cette demande, tout en notant qu'elle marque un échec de l'Union européenne à offrir des garanties de sécurité.
Le projet de loi est adopté sans modification.
La réunion est ouverte à 11 h 15.

Mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir une délégation de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen, en présence de sa présidente, que je salue.
Nous sommes très heureux de cette opportunité d'échanges qui nous est offerte, qui se situe dans le prolongement de la conférence interparlementaire (CIP) pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), qui s'est tenue le 25 février au Sénat, avec la participation de la présidente Nathalie Loiseau.
Depuis cette date, l'ensemble des institutions européennes et des parlements nationaux de l'Union européenne ont été ébranlés par le retour sur notre continent d'une guerre de haute intensité. Nous sommes heureux de pouvoir profiter de votre analyse sur les initiatives qui ont été prises à l'échelle de l'Union européenne, d'abord pour répondre dans l'immédiat aux besoins exprimés par les forces armées ukrainiennes pour les livraisons d'armes financées en partie par des fonds européens, mais aussi pour renforcer notre stratégie commune et faire à moyen terme de l'Union européenne un acteur crédible dans le domaine de la sécurité et de la défense.
En premier lieu, nous serons attentifs à votre appréciation de la mise en oeuvre de la Facilité européenne pour la paix (FEP), qui a permis de financer par un mécanisme commun de livraison de matériel létal et non létal à l'Ukraine, pour un total estimé à ce jour à 2 milliards d'euros.
Les mesures en faveur de l'Ukraine pourraient du reste se prolonger, le Conseil des affaires étrangères de lundi ayant confirmé l'accord politique des États membres pour l'octroi d'une cinquième tranche d'aides, qui porterait le montant total à 2,5 milliards d'euros.
Vous nous indiquerez à cette occasion la position de la sous-commission sur le montant total de ce mécanisme et sur l'opportunité d'augmenter son plafond, qui avait été initialement fixé à 5,7 milliards pour la période 2021-2027.
En second lieu, vous nous direz quelles analyses vous faites de la boussole stratégique adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen des 24 et 25 mars.
Enfin, au-delà de la convergence des analyses et des objectifs stratégiques consacrés par ce document, vous nous direz quel est le programme de travail du Parlement européen et de la Commission européenne pour mettre en oeuvre ce plan d'action.
Merci, monsieur le président, de nous accueillir au Sénat. Vous avez rappelé que j'étais présente, au mois de février, pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, lors de la traditionnelle conférence interparlementaire que le Sénat a bien voulu accueillir.
Depuis lors, l'attention de l'Union européenne s'est tournée en priorité vers la guerre en Ukraine, qui met au défi les décisions prises par l'Union européenne en matière de sécurité et de défense ces dernières années et ces derniers mois.
Je salue la pertinence de la Facilité européenne de paix, instrument mis en oeuvre à toute petite échelle avant la guerre d'Ukraine, à hauteur de quelques millions par ci ou par-là, permettant d'acquérir des matériels essentiellement non létaux, des casques, des gilets pare-balles ou des instruments de déminage. En quelques heures, au début de la guerre d'Ukraine, il a été décidé de déclencher les 500 premiers millions d'euros. Comme vous l'avez dit, nous atteignons, depuis le conseil des affaires étrangères, qui en a pris la décision de principe, un montant de 2,5 milliards d'euros.
Je pense que cette Facilité remplit bien son rôle et permet à l'Union européenne d'être un facilitateur entre l'expression des besoins des autorités ukrainiennes et des disponibilités des États. Cela permet aussi une forme de solidarité entre les plus riches et ceux qui peuvent faire, le plus vite, don d'anciens matériels soviétiques, que connaissent souvent les militaires ukrainiens. Cette forme de solidarité est en train de se mettre en place et est évidemment essentielle.
Vous avez posé la question du montant total. La guerre en Ukraine confirme ce que cette sous-commission avait dit au moment de la préparation du budget multi-annuel : en matière de défense, on a vu trop petit, qu'il s'agisse du Fonds européen de défense, du financement de la mobilité militaire, dont on voit aujourd'hui à quel point elle est indispensable, ou des crédits hors budget qui ont été prévus pour la Facilité européenne de paix. Nous allons assez vite atteindre les plafonds. Il faudra donc repenser et rediscuter une modification à la marge du budget pluriannuel, sans compter que nos États sont confrontés à une diminution rapide de leurs stocks d'équipements militaires à laquelle il va falloir être en capacité de répondre.
C'est la raison pour laquelle le commissaire Thierry Breton a fait une proposition, que cette sous-commission juge intéressante, de mécanisme d'achat en commun et d'incitations financières en faveur de celui-ci. Il propose, dans un premier temps, dans l'urgence, de prendre sur deux ans 500 millions d'euros dans les marges du budget européen pour inciter les États qui vont renouveler leur stock à le faire ensemble.
Ceci permet aux États d'établir une forme d'équilibre vis-à-vis des industriels, afin que ce ne soit pas eux qui mènent la danse et fixent les conditions, ce qui est de nature à inciter les États à acheter européen, les financements, tels que proposés dans le mécanisme de la Commission, étant destinés à consolider la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE).
L'acquisition de matériels non européens ne serait possible, avec un soutien de la Commission, que si les partenaires extraeuropéens levaient leurs réserves sur l'utilisation des matériels. Ce serait le début d'un rapport de force positif pour l'Union européenne par rapport à des partenaires qui fixent sans cela des conditions qui ne sont pas, pour nous, synonymes de garantie de souveraineté. On pense bien sûr aux États-Unis, mais pas seulement.
Cette sous-commission soutient la proposition qui est faite par la Commission européenne. On en verra le détail dans les semaines qui viennent, mais elle est évidemment nécessaire. On n'en est toutefois pas à un Buy European Act, même si l'on comprend que le Fonds européen de défense est utile en matière d'innovation, de recherche et de développement. Aujourd'hui, on travaille sur un deuxième étage de la fusée, qui est celui des acquisitions et on progresse vers davantage de souveraineté européenne.
Pour autant, notre sous-commission suit avec attention la mise en oeuvre de la boussole stratégique. Arnaud Danjean, qui m'a précédée dans les fonctions que j'occupe, le sait depuis longtemps : la défense européenne fait l'objet de beaux discours, de belles déclarations d'intention, mais encore faut-il passer aux actes. La boussole stratégique est un bon texte, qui a été revigoré par la guerre d'Ukraine en surmontant les réticences des moins convaincus de la nécessité de la défense européenne. Il faut maintenant qu'elle soit mise en oeuvre, et l'échelonnement d'un calendrier, tel qu'il est proposé par Josep Borrell, nous paraît quand c'est possible devoir plus être accéléré que ralenti.
Cela signifie davantage d'entraînement, davantage d'exercices en commun, une réflexion sur des capacités de déploiement rapide. Cela signifie aussi davantage de solidarité entre États membres, en matière cyber notamment, mais aussi une capacité de réponse. On en parle beaucoup, à un moment où la guerre en Ukraine nous montre qu'elle est une guerre conventionnelle, mais aussi une guerre hybride. Être capable d'avoir une communication stratégique plus audible qu'elle ne l'est jusqu'à présent fait partie des sujets.
Étant une éternelle optimiste, je dirais que, pour l'heure, on sort enfin de la querelle sur le sexe des anges entre l'OTAN et l'Union européenne. Personne ne viendra considérer que l'OTAN n'est pas pertinente dans ce qui nous arrive. Fort heureusement, le renforcement de la présence de l'OTAN sur son flanc Est constitue une réalité et s'avère nécessaire.
Chacun, l'administration américaine actuelle comme les autres, comprend l'importance d'avoir un pilier européen fort de l'OTAN et une défense européenne, l'un et l'autre n'étant ni en compétition ni contradictoire, mais se renforçant l'un l'autre.
On est dans un alignement de planètes qui n'a pas toujours existé et qui pourrait ne pas toujours durer, dont il faut faire le meilleur usage. C'est ce à quoi nous allons veiller.
Je vous remercie de nous recevoir. Le parlementarisme est toujours une solution, en particulier en matière de sécurité et de défense, et c'est une bonne chose d'y participer. La contribution de la France à la sécurité et à la défense est exceptionnelle. Elle l'était avant la guerre, à l'échelle européenne, et je lui suis très reconnaissant pour cette action. Beaucoup de leçons ont été tirées de notre visite à Paris. Nous souhaitons poursuivre ces échanges. La France est un excellent exemple pour les autres pays. Il ne s'agit pas ici que d'une évaluation des risques. C'est une guerre sur le sol européen à laquelle on assiste, même s'il existe bien d'autres zones de conflits sur la planète.
Il est particulièrement important de parler d'autonomie stratégique. C'est pour moi le terme qui définit le mieux la question dont l'Europe devrait se préoccuper. Certains attendent de nous que l'on traite de résilience stratégique plutôt que d'autonomie stratégique - mais je ne voudrais pas que l'on soit prisonnier des mots. Le plus important, comme l'a rappelé Mme Loiseau, c'est que les fondations soient établies. À nous de construire le reste, en particulier en matière d'innovations, et surtout en termes de sécurité.
On voit ce que peut signifier l'innovation en termes de défense et de sécurité, en termes de compétitivité, mais l'Europe doit faire plus d'efforts. C'est un avis que je partage avec les électeurs de mon pays, l'Autriche. L'Europe ne doit pas simplement être une Europe de la consommation. À l'ère du numérique, la vie ne peut être uniquement fondée sur la consommation. On consomme ce qui a été inventé aux États-Unis et produit en Asie - ou parfois même inventé en Asie. Le défi collatéral de l'innovation en matière de sécurité doit vraiment être relevé en Europe.
J'apprécie donc beaucoup l'idée d'une résilience ouverte et du Fonds européen de la défense, mais il doit être largement renforcé. C'est ce que nous avons dit à nos interlocuteurs. Il faut aussi inciter le secteur bancaire à investir en matière de sécurité et de défense.
Toutefois, les décisions étant prises par des parlements élus démocratiquement, la question de la taxonomie se pose ici. Tous ces sujets sont de la plus grande importance.
Enfin, en tant qu'Autrichien, mais aussi en tant qu'Européen, j'essaie toujours d'attirer l'attention sur les Balkans occidentaux. J'apprécierais beaucoup que la vaste contribution de la France à la sécurité européenne et à celle des autres continents puisse également tenir compte de nos voisins immédiats que sont les six pays des Balkans occidentaux. Nous avons omis de les inclure depuis des décennies. Il faut vraiment apprendre de nos erreurs et tirer les leçons du passé. Agissons comme il le faut aujourd'hui. Prenons de bonnes décisions, sans quoi les Balkans occidentaux vont devenir une zone d'influence pour la Russie, la Chine, la Turquie, le Qatar, comme l'a dit hier Mme Loiseau, ainsi que pour des acteurs non étatiques violents, qui pourraient établir leur présence dans ces pays. Il faut l'éviter dans tous les cas.

Le niveau de dépenses militaires en proportion du PIB du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte ne cesse d'augmenter. Comment l'Union européenne interprète-t-elle cette évolution ? Quelle est sa position, voire sa stratégie, et dans quelle mesure estimez-vous que cette évolution peut être expliquée par des motifs de politique intérieure ? Quels sont éventuellement ces motifs ?

Madame la présidente, vous avez évoqué le Fonds européen de la défense. Or nous avons connu, sous politique finlandaise, une diminution des crédits dudit Fonds. Face à la guerre, les objectifs sont revus. Vous avez parlé de boussole stratégique : comment concilier les choses dans un contexte porteur d'une vision d'une Europe de la défense, qu'il faut faire coexister avec l'OTAN ? Y a-t-il une volonté véritable en matière de défense européenne alors que, dans notre propre camp, on achète non pas des avions français, mais des appareils américains ? Si nous voulons que la défense européenne avance sur ses deux jambes, il va falloir que les nations européennes fassent preuve d'une réelle volonté en matière de politique de défense.

Je me suis rendu à Kiev et à Borodianka le 21 avril dernier, avec quatre parlementaires européens de la délégation conduite par Guy Verhofstadt. Quand on voit les dégâts provoqués par le conflit, on se rend compte dans quel monde on vit aujourd'hui : le conflit est à nos portes. Le 22 avril, j'étais à Londres pour une conférence. J'ai pu dire qu'à Boutcha, j'avais rencontré les enfants du Londres des années 1940 !
On prend aujourd'hui conscience de la situation, mais beaucoup n'ont pas encore ce sentiment. Ils se sentent encore en sécurité, pensent que la guerre est lointaine et qu'elle ne nous concerne pas tout à fait.
Or il y a là un vrai enjeu. Vous avez mentionné les Balkans. Nous avons reçu ici l'ambassadeur de Russie, à qui j'ai demandé quelle était la politique de son pays en Bosnie-Herzégovine, où il se trouvait avec M. Dodik, défilant aux côtés des Loups gris. Il nous a déclaré être contre la réunification forcée de la Bosnie-Herzégovine et nous a expliqué vouloir mettre fin aux accords de Dayton.
Quelle est la réaction de l'Union européenne par rapport à ces déclarations, qui sont terriblement agressives par rapport au territoire européen ?
Je souscris à ce que Nathalie Loiseau et Lukas Mandl ont dit en préambule. Il me paraît très utile de bien comprendre deux points importants. Des progrès incontestables ont été opérés du fait des circonstances. La prise de conscience est aujourd'hui unanime en Europe et partagée par tout le monde. Je ne connais pas un citoyen européen, un élu européen ou un pays européen qui ne soit pas choqué par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. La prise de conscience est forte et a entraîné des réactions plutôt à la hauteur de l'enjeu, me semble-t-il, compte tenu de l'inertie habituelle du système.
Pour autant, ces progrès restent fragiles et sont réversibles. Plus le conflit va durer et s'installer dans une forme de « routine », même si c'est terrible à dire lorsqu'on enregistre 250 morts par jour, plus on risque que l'opinion publique ne s'en détourne, une fois passée l'émotion.
On va connaître d'autres problématiques : énergétiques - on en parle déjà -, alimentaires, industrielles, commerciales. Seuls 40 pays au monde sont alignés sur nos positions. Cela signifie que 150 ne le sont pas. Tout cela fait que l'effort européen va devoir être soutenu dans la durée. J'espère que nous serons prêts. Je pense que nous y sommes déjà partiellement, mais j'attire l'attention sur le fait que les progrès qu'on enregistre aujourd'hui sont parfaitement réversibles si d'autres événements entrent en collision avec cet agenda.
Cela m'amène à un autre point : je suis très reconnaissant à Lukas Mandl d'avoir fort justement dit que l'on doit passer outre sur les querelles sémantiques sur l'autonomie stratégique ou autres. L'important est de prendre nos responsabilités, mais on enregistre encore beaucoup de perplexité et de scepticisme en Europe quant à ce type d'expression et sur ce que cela recouvre vraiment.
Nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour ce qui est de la résilience et sur le fait qu'il faut diversifier nos chaînes d'approvisionnement, être moins dépendants de l'extérieur, notamment sur le plan technologique. Passer à une vraie autonomie stratégique - les mots ont un sens -, en particulier sur le plan de la défense, n'est cependant pas acquis dans la majeure partie des pays européens. C'est davantage l'OTAN qui se renforce aujourd'hui face à des défis de défense collective.
S'agissant de l'Afrique du Nord, beaucoup de mécanismes existent entre l'Union européenne et cette région du globe. Le partenariat méridional est très vivant au sein des instances européennes. Des sommes colossales sont en jeu, mais cela ne porte pas prioritairement sur des questions de sécurité, même s'il existe des coopérations en matière de contre-terrorisme assez performantes. Ce n'est pas l'Union européenne qui est aux manettes par rapport aux agendas stratégique de ces pays.
La France a un rôle beaucoup plus important à jouer que beaucoup d'autres pays européens, du fait de sa position vis-à-vis d'un certain nombre de pays, en particulier de l'Égypte, dont elle est un partenaire stratégique. Je ne crois donc pas que la réponse à votre question sur le strict plan sécuritaire passe forcément par les instances européennes. Certains pays européens ont un rôle moteur à jouer. La France, en Méditerranée orientale, s'est positionnée de façon très forte. À mon avis, elle a raison. C'est une orientation stratégique de notre pays, mais elle n'est pas forcément partagée par d'autres.
Je rappelle que d'autres grands pays européens ont été bien plus timides. De ce point de vue, il n'existe pas d'unanimité au sein de l'Union européenne sur la réponse qui doit être apportée à la militarisation de la Méditerranée. Les raisons tiennent essentiellement à des agendas nationaux. La rivalité entre le Maroc et l'Algérie doit nous préoccuper. On ne peut exclure un conflit entre ces deux pays.
L'Égypte est en guerre dans le Sinaï contre des groupes terroristes, les mêmes que ceux que nous avons combattus avec nos forces armées au Sahel ou au Levant. Ce sont ces forces qui sont à l'oeuvre dans le Sinaï, peut-être sur un périmètre plus réduit, mais il n'y a pratiquement pas une semaine sans incidents sécuritaires majeurs en Égypte.
Cette montée en puissance s'explique donc, même si elle doit être contrebalancée selon moi sur le plan civil par des efforts de développement et de coopération économique et énergétique renforcés de la part de l'Union européenne.
Quant à la Bosnie, vous avez raison. Je relativise malgré tout les choses : cela fait quinze ans que Dodik fait ces déclarations. La seule chose inquiétante en soi, c'est que le soutien russe à ce type de déclaration devient de plus en plus décomplexé. C'est selon moi la seule vraie menace vis-à-vis de la Bosnie. Il faut qu'on y soit extrêmement attentif. Cela passe par deux types de réponse, d'une part une réponse forte au niveau européen qui, je le crois, existe sur le plan politique, avec l'attachement aux accords, aux procédures et à l'intégrité de la Bosnie-Herzégovine et, d'autre part, une dissuasion pour bien faire comprendre à ceux qui seraient tentés, en particulier les Russes, que quiconque toucherait au fragile équilibre existant depuis plus de 25 ans s'exposerait à une réponse très robuste des Européens et, au-delà, de l'OTAN.
Je ne crois pas beaucoup à un dérapage sécuritaire. Sur le plan politique, on a incontestablement une détérioration de la situation, avec des personnages dont on connaît parfaitement les ressorts, face auxquels il ne faut pas surréagir, car ils s'alimentent en permanence de ce jeu de provocations et de surréactions. Pour l'instant, je trouve que la réponse européenne va plutôt dans le bon sens.

J'adhère totalement à ces éléments, notamment à la fragilité d'une opinion publique qui peut se retourner. On en voit déjà un certain un certain nombre de signes. Malheureusement, cela se vérifie dans les faits : les livraisons d'armes à l'Ukraine ne sont pas sur la pente souhaitée. Pour l'instant, ce que nous disent nos responsables militaires, c'est que la Russie se trouve plutôt en position de force jour après jour, avec des dégâts considérables.
Je voudrais profiter de la présence des membres du Parlement européen pour les interroger sur une question qui revient souvent ici, en corrélation avec ce qui vient d'être évoqué. On a parfois l'impression qu'il y a, au niveau européen, une volonté d'aller plus loin en matière de défense, mais on multiplie les embûches. Je ne citerai que la taxonomie, qui reste un élément incompréhensible dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cela pouvait être une préoccupation en temps de paix mais, malheureusement, nous sommes en train de passer à un temps de guerre. On ne peut répondre de cette façon aux citoyens européens, indiscutablement demandeurs de plus de sécurité - l'affaire de l'adhésion de la Suède et de la Finlande en est une preuve bouleversante. Quelle est la position de la sous-commission à ce sujet ?
De la même manière, certains industriels de la défense disent que le simple accès au Fonds européen de la défense représente un tel parcours du combattant qu'ils renoncent finalement à y présenter des dossiers. On aurait peut-être intérêt à donner un peu de fluidité à tout cela pour que la défense de l'Europe rattrape le retard que nous avons enregistré. Tout cela va assez lentement. Il ne faut pas que les procédures fassent changer les orientations politiques qui, plus que jamais, me semble-t-il, dans le contexte que nous connaissons, sont essentielles.
Il faut profiter de cette occasion qui, comme l'a dit Arnaud Danjean, ne reviendra peut-être pas de sitôt. Les opinions publiques peuvent très bien s'affaisser. Les voix des pacifistes sont toujours là !
Je voudrais réagir en allant dans le même sens.
Concernant la taxonomie, nous sommes nombreux à avoir donné l'alerte, comme mon collègue Lukas Mandl l'a mentionné tout à l'heure. Il s'agit là d'une contradiction. Le message est bien passé à la Commission européenne qui, en quelque sorte, a décidé de mettre de côté cette question de la taxonomie sociale s'agissant des industries de défense.
Cela ne veut pas dire que le financement des industries de défense soit devenu plus facile pour autant. Encore faut-il convaincre les banques, les investisseurs et faire évoluer le règlement de la Banque européenne d'investissement (BEI) qui, pour le moment, a été d'une très grande timidité, acceptant de financer des projets qu'elle estime être dans le domaine de la défense, comme l'isolation thermique de casernes de gendarmerie, ce qui n'est pas tout à fait dans l'épure de ce à quoi nous pensons les uns et les autres. Il y a donc encore beaucoup à faire.
S'agissant du Fonds européen de la défense, celui-ci n'a pas été diminué. Il n'existait pas : on est passé de 0 à 8 milliards d'euros, et non de 13 à 8 milliards d'euros !
Les négociations d'un budget pluriannuel sont toujours des questions de priorisation. Même les plus ardents défenseurs de la défense européenne défendent d'autres priorités, qu'il s'agisse des fonds de cohésion ou de la politique agricole commune (PAC). Nous étions dans la logique où, pour certains de nos partenaires, maintenant que les Britanniques sont partis, « smaller Union, smaller budget ». On a réussi à contrer cette logique, mais pas complètement.
Comme toujours en Europe, il faut une crise pour avancer. Malheureusement, il a fallu une guerre pour que l'Europe se dise qu'on avait finalement besoin de la défense européenne. On aurait pu préparer cela avant, mais c'est face à la crise que l'Europe est finalement assez agile et déterminée, avec toutes les fragilités qui ont été évoquées. C'est une bonne chose que l'on travaille à des achats en commun. Il est nécessaire que tous, à tous les niveaux des parlements nationaux et du Parlement européen, nous insistions sur le fait qu'il s'agit d'innovations, bénéfiques dans le secteur civil et pouvant développer l'emploi.
Nous avons intérêt à le faire en Europe concernant les achats de matériels extra-européens, notamment d'avions américains par l'Allemagne. Je rappelle qu'il s'agissait pour les Allemands de pouvoir porter des charges nucléaires et qu'ils avaient le choix entre le F16 et le F35. Ils ont choisi le plus cher, mais la question n'était pas de savoir s'ils allaient pouvoir choisir autre chose.
Je crois profondément qu'on assiste à un changement politique. J'ai été frappée de voir, au Parlement européen, les Verts européens soutenir des projets de défense, ce qu'ils n'auraient pas fait par le passé. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout, mais cela signifie qu'il existe malgré tout une conscience de ce qui se passe.
Un petit mot sur la Bosnie. Je partage évidemment l'analyse d'Arnaud Danjean, qui connaît parfaitement cette zone. J'y étais il y a une semaine. La dégradation politique y est très préoccupante. Il y a une insuffisance de présence européenne et notamment française qu'il faut absolument contrer. Il faut que nous soyons plus présents, parce que la nature a horreur du vide dans les Balkans. On voit partout des drapeaux turcs et l'influence chinoise grandit. Ce n'est pas notre intérêt en tant qu'Européens.
Je me réjouis qu'EUFOR Althea ait fait appel à la réserve et que 500 hommes supplémentaires soient présents en Bosnie. J'attire l'attention de chacun sur le fait que le mandat de la mission au Conseil de sécurité sera examiné cet automne. Je serais très étonnée que la Russie n'essaie pas de nous faire « danser » sur ce sujet, même s'il est facile de se dire que la Russie a plus intérêt à une force européenne qu'à une force de l'OTAN. La Russie gagne à montrer qu'elle peut être déplaisante et désagréable sur tous les sujets.
Il y aura donc certainement un débat sur la nature du mandat et l'ampleur de la force à laquelle il va falloir être capable de résister. On y a vraiment intérêt, pour des raisons purement géographiques. C'est au coeur de notre continent. Malheureusement, les trois leaders nationalistes ont le même intérêt à un statu quo et non à entrer dans l'Union européenne. Ils sont très bien installés dans une sorte de système autobloquant.
Arnaud Danjean parlait de Russie décomplexée. On a également face à nous une Serbie décomplexée. N'hésitons pas à dire que la Croatie elle-même est assez décomplexée. Chacun va regarder ce qu'il peut faire dans ce pays fragile qu'est la Bosnie. L'Union européenne n'a pas intérêt à sonner l'alarme, mais elle doit être présente, attentive et, si possible, plus visible, car je trouve qu'elle l'est vraiment très peu.

Un mot pour revenir sur ce que disait Lukas Mendl à propos des pays des Balkans. Il y a là aussi un changement de logiciel très important qui se fait jour, à la lumière des événements d'Ukraine. On ne peut éternellement dire à ces pays, qui font structurellement partie de l'Europe, qu'ils n'en font pas partie et leur conseiller d'attendre 20 ans encore. Nous recevons ici énormément de dirigeants de ces pays - ministres, vice-Premier ministre, etc. On sent bien qu'il existe une forte attente, même envers la France, qui n'a pas toujours été allante sur ces sujets - c'est le moins que l'on puisse dire.
Je crois qu'il nous faut faire un signe à ce sujet. Celui qui a été fait à l'Ukraine va évidemment dans le bon sens, même si les Ukrainiens eux-mêmes savent très bien que cela ne va pas se dérouler d'un coup de baguette magique. Il faut peut-être aussi réfléchir à la procédure d'adhésion, qui doit à mon sens être modifiée. Cela avait été évoqué par le Président de la République. Je pense que le dispositif actuel est dépassé. Il faudrait plutôt un dispositif d'adhésion progressive, comme de longues fiançailles.
De la même façon, la Roumanie, avec les moyens qui sont les siens, qui maîtrise ses frontières - certes, sous la pression des voisins et avec les risques qu'elle encourt -, mériterait à un moment ou un autre d'entrer dans Schengen. Il y a sûrement un certain nombre de conditions à vérifier, mais je crois qu'on pourrait ainsi ouvrir des accès nouveaux à des pays qui s'engagent à faire ces efforts, que ce soit dans le domaine du marché unique, sur le plan de la gouvernance ou sur celui de la lutte contre la corruption.
Il nous faut les entendre, et nous militons ici pour que la France ne soit pas toujours dans une position dictée par la politique intérieure et par les contraintes que nous venons de vivre, qui sont fortes. Il n'y a pas de large majorité dans ce pays pour accueillir à bras ouverts des nations nouvelles, mais je pense qu'une vision d'avenir est nécessaire, pour ne pas permettre à la Russie de les attirer dans son camp. Il faut revoir cela au niveau du Parlement européen, mais aussi des parlements nationaux. Nous sommes là pour nous exprimer et faire comprendre les choses aux opinions publiques.
Je suis très heureux d'entendre le président Cambon exprimer cette position, que je partage totalement depuis longtemps. Je rappelle que c'est le Président Chirac qui, sous présidence française, en octobre 2000, a ouvert la perspective européenne des Balkans, au sommet de Zagreb, auquel je participais. Il y a donc derrière cela une histoire française. Je rappelle que le Président Sarkozy a signé en 2010 un traité de partenariat stratégique avec la Serbie, dont la priorité absolue était d'aider au processus d'adhésion de ce pays.
Je partage donc tout à fait l'analyse de Christian Cambon. Je crois d'ailleurs que notre famille politique porte, en l'occurrence, une lourde responsabilité dans la vision un peu caricaturale qu'on peut avoir sur cette question.
Le dernier pays en date à avoir adhéré à l'Union européenne est la Croatie, il y a neuf ans de cela. Quel problème cela a-t-il créé ? Aucun ! Qui peut prétendre aujourd'hui qu'une Union européenne de 450 millions d'habitants a peur d'intégrer un Monténégro de 600 000 habitants ? Il faut remettre les choses en perspective. Il y a, je crois, tout un travail à réaliser. Les conditions stratégiques ont également changé. On ne peut condamner ces pays pour l'éternité à un purgatoire qui n'en est pas un, et qui va les faire tomber littéralement dans d'autres bras.
Puisque nous ne sommes pas en mesure d'offrir à ces pays une adhésion immédiate - ce n'est pas de cela dont il s'agit, car les conditions à remplir sont très strictes et le resteront -, j'invite à ce que nous nous penchions sur une question très importante, qui est un peu un tabou au niveau du Parlement européen.
Nos collègues, qui sont généralement rapporteurs sur ces sujets, sont tellement convaincus par l'adhésion des pays des Balkans qu'ils ne mettent pas forcément la lumière sur des points plus gênants. Je pense quant à moi qu'un des points problématiques, dans cette phase intermédiaire de non-adhésion, réside dans les instruments dont nous disposons, qui sont essentiellement financiers.
J'aimerais qu'on se penche d'un peu plus près sur la façon dont on débourse l'argent européen dans ces pays-là, afin de produire un effet transformationnel, qu'on a beaucoup mis en avant lors de l'élargissement et qui est réel lorsqu'on considère la Bulgarie, la Roumanie ou la Croatie.
Ce levier est aujourd'hui mal utilisé, et je crois qu'il faut qu'on réoriente les fonds européens vers des choses bien plus concrètes, pour que les habitants de ces pays se rendent compte de la plus-value qui existe à appartenir à la famille européenne. Aujourd'hui, un habitant de Belgrade voit plus de choses réalisées par la Chine, la Russie, voire la Turquie. Les autoroutes, la plupart des aéroports des Balkans, les infrastructures lourdes, ne sont pas financés ou réalisés par les Européens. Nos investissements sont beaucoup trop immatériels dans ces pays, et je crois qu'il y a une dilution de l'esprit européen. C'est un point extrêmement important.

Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on insiste davantage sur les relations bilatérales avec d'autres États dans les pays des Balkans, qui sont pour certains dans le processus d'adhésion. Ces processus d'adhésion sont bien trop longs.
On s'en rend compte lorsqu'on écoute notre collègue Marta de Cidrac, qui à la commission des Affaires européennes, s'occupe plus particulièrement de l'élargissement aux Balkans. L'enfer est pavé de bonnes intentions, et personne n'en voit plus le bout. Les pays concernés se tournent vers d'autres relations bilatérales.
N'oublions pas non plus notre politique de voisinage avec le partenariat oriental, largement mise à mal par la guerre en Ukraine. On a un processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie, mais quid de la Géorgie ? On ne peut laisser de côté ce pays, quelles que soient les difficultés politiques, face à l'Ossétie et l'Abkhazie, où existe une occupation militaire russe et alors qu'ils étaient dans le processus du contrat d'association et espéraient de l'Europe. Nous devrions à mon sens être plus allants pour faciliter ces processus.
Beaucoup de sujets substantiels ont été déjà évoqués mais, mes collègues l'ont déjà dit, la politique étrangère de défense constitue un élément stratégique de l'action européenne pour le Parlement européen.
Durant des années, on a expérimenté la diplomatie parlementaire, conduit des commissions d'enquête, effectué des déplacements. La France est quant à elle une puissance militaire et diplomatique. Quelles leçons votre commission sénatoriale tire-t-elle de la valeur ajoutée de la diplomatie parlementaire que vous avez conduite ? Quelle influence cela a-t-il eu sur la politique étrangère et la politique de la défense de l'exécutif ?
Ces leçons peuvent en effet être adaptées au niveau européen, la politique de défense européenne, étant donné les circonstances, étant appelée à se développer dans un avenir proche.
Je vais essayer d'être très concret. Beaucoup de choses ont déjà été dites ici, mais on peut se demander où se situe le danger. Chacun dans le monde, après l'invasion de l'Ukraine, est en droit se demander ce qui va arriver avec la Chine et Taïwan, car je suis convaincu que les Chinois sont prêts à utiliser l'opportunité que représente le conflit russo-ukrainien - mais laissons là la Chine et Taïwan et revenons-en à l'Europe.
Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir évoqué la situation inacceptable que connaît la Roumanie par rapport à sa demande d'entrée dans l'espace Schengen, mais aussi la Bulgarie et la Croatie, alors que nous avons répondu à toutes les conditionnalités techniques depuis des années.
On parlait autrefois de la corruption en Roumanie, mais nous avons aujourd'hui des procureurs élus. Certes, une procureure a été limogée à la suite de sa lutte contre la corruption, mais c'est un thème secondaire au sein de la question.
Bien sûr, l'élargissement de l'Europe à de nouveaux membres peut poser beaucoup de problèmes, surtout si on commence à parler de l'Ukraine et de la République de Moldavie, où je me trouvais récemment. C'est une véritable démocratie, mais je me demande si la majorité pourrait à nouveau remporter les élections dans la situation actuelle. Un véritable gouvernement démocratique essaye de tout faire aussi rapidement que possible.
En Ukraine, la réalité est différente. La Moldavie et la Transnistrie ont également un rapport essentiel avec le conflit russo-ukrainien.
Vous avez évoqué la Géorgie. Je suis rapporteur fictif de mon groupe pour la Turquie depuis fort longtemps. Les collègues de mon groupe ne sont pas tout à fait d'accord avec mon rapport. Avec le rapporteur socialiste, j'ai défendu activement le maintien de la Turquie dans le processus, car un dirigeant n'est jamais indéfiniment en place. Prenez le cas de Trump et du changement d'attitude de l'Amérique vis-à-vis de l'OTAN après l'élection de Joe Biden : les présidents s'en vont, les pays et les sociétés demeurent ! Je l'ai dit, si nous ne faisons rien pour préserver l'idée européenne dans ces pays, une catastrophe pourrait survenir rapidement et un esprit antieuropéen pourrait même y naître - ou y renaître ! Ce serait alors le commencement de la fin pour nous.