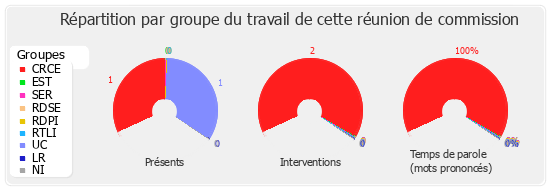Commission d'enquête Pénurie de médicaments
Réunion du 29 mars 2023 à 13h35
Sommaire
- Audition de mmes catherine simonin représentante de france assos santé juliana veras coordinatrice de médecins du monde docteurs julie allemand-sourrieu représentante du collectif santé en danger franck prouhet représentant du collectif notre santé en danger et m. christophe duguet représentant de l'afm-téléthon (voir le dossier)
La réunion
Audition de mmes catherine simonin représentante de france assos santé juliana veras coordinatrice de médecins du monde docteurs julie allemand-sourrieu représentante du collectif santé en danger franck prouhet représentant du collectif notre santé en danger et M. Christophe duGuet représentant de l'afm-téléthon
Audition de mmes catherine simonin représentante de france assos santé juliana veras coordinatrice de médecins du monde docteurs julie allemand-sourrieu représentante du collectif santé en danger franck prouhet représentant du collectif notre santé en danger et M. Christophe duGuet représentant de l'afm-téléthon

Notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française poursuit ses travaux par l'audition conjointe de plusieurs associations d'usagers et de professionnels du système de santé, dont la voix est déterminante pour notre analyse de ce problème.
Il nous est précieux, en effet, de vous entendre sur la façon dont ces tensions et ruptures d'approvisionnement, qui, depuis une quinzaine d'années, sont devenues chroniques, pèsent sur la vie des patients et des soignants : chaque occurrence de pénurie altère la qualité des soins, suscite angoisse et détresse légitimes chez les patients et leurs proches, désorganisation, incertitude et perte de temps médical pour l'équipe soignante, et peut même engendrer des pertes de chances.
Madame Catherine Simonin, vous représentez, pour France Assos Santé, l'Union nationale des associations agréées du système de santé, organisation interassociative de référence créée en mars 2017 en remplacement du Collectif interassociatif sur la santé. Regroupant près d'une centaine d'associations, France Assos Santé, interlocuteur incontournable des pouvoirs publics et des établissements de santé et acteur essentiel de la démocratie sanitaire, représente et défend les usagers du système de santé, notamment sur les questions de l'accès aux soins et aux thérapies innovantes ; elle donne l'alerte depuis plusieurs années sur la multiplication des pénuries de médicaments et ses conséquences sur la santé des patients. Vous aviez d'ailleurs été auditionnée en juillet 2018 par la mission d'information du Sénat sur la pénurie de médicaments et de vaccins.
Madame Juliana Veras, vous êtes la coordinatrice de Médecins du monde, ONG bien connue qui milite notamment pour la remise en cause des brevets et, plus généralement, du modèle économique des grands laboratoires. Ceux-ci ont tendance, expliquez-vous, à délaisser les molécules anciennes, c'est-à-dire les médicaments matures, moins rentables, quoiqu'indispensables, au profit d'innovations qui n'en sont pas toujours et qu'elles font payer au prix fort, tout en se désengageant de la recherche. Vous avez notamment obtenu, à l'automne dernier, un affaiblissement définitif du brevet protégeant le Sofosbuvir, la molécule de Gilead indiquée contre l'hépatite C, l'Office européen des brevets (OEB) ayant confirmé son jugement de première instance.
Dr Julie Allemand-Sourrieu, vous représentez le Collectif Santé en danger, créé par le médecin Arnaud Chiche en juillet 2020 en réaction aux conclusions du Ségur de la santé. Votre association, qui compte près de 6 000 adhérents et 250 000 abonnés sur les réseaux sociaux, dresse le constat d'un « effondrement » du système de santé. Vous relayez la parole et les demandes des professionnels de santé, du privé comme du public, et revendiquez en la matière un rôle d'alerte et de vigie.
Sur le sujet des pénuries de médicaments, le collectif a notamment publié, le 30 décembre 2022, un communiqué de presse intitulé « La France, pays en voie de régression ? » : vous nous direz s'il s'agissait d'une question rhétorique.
Dr Franck Prouhet, médecin généraliste, vous animez le collectif « Brevets sur les vaccins, Stop. Réquisition ! », qui faisait partie de la coordination européenne sur l'initiative citoyenne européenne Pas de profit sur la pandémie. Dans ce cadre, vous militez pour la levée des brevets sur les vaccins et traitements anti-covid et, plus récemment, pour la réquisition des moyens de production de médicaments d'intérêt majeur frappés par les pénuries. Vous nous direz dans quelle mesure les enseignements que l'on peut tirer de la période covid peuvent être transposés à l'organisation de la production des médicaments en général.
Enfin, Monsieur Christophe Duguet, vous représentez l'Association française contre les myopathies (AFM)-Téléthon, acteur associatif majeur de la lutte contre les maladies rares. Vous êtes donc bien placé pour évoquer notamment les questions de prix et d'accès à l'innovation thérapeutique. L'AFM-Téléthon a créé avec BpiFrance, en 2016, la plateforme industrielle YposKesi, consacrée à la production sur le sol français de médicaments de thérapie génique et cellulaire, qui est passée en mars 2021 sous pavillon sud-coréen - c'est hélas le destin de bien des initiatives industrielles, qui, souvent, quittent notre pays. À cet égard, votre témoignage peut nous éclairer sur les enjeux de souveraineté sanitaire et sur la faisabilité de la création d'une filière industrielle nationale des thérapies innovantes.
Les sujets sont nombreux et beaucoup de questions restent pendantes. Merci de vous être mobilisés pour cette audition.
Je céderai à chacun la parole pour un propos introductif d'environ cinq minutes.
Puis Mme Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions.
Nous vous adresserons à l'issue de l'audition un questionnaire complet auquel nous vous demanderons de répondre par écrit avant le 15 avril.
Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu publié.
Avant de vous donner la parole, je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal.
Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant : « Je le jure. »
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Catherine Simonin, Mme Juliana Veras, Mme Julie Allemand-Sourrieu, M. Frank Prouhet et M. Christophe Duguet prêtent serment.
Pas moins de 37 % des Français ont été confrontés à une pénurie de médicaments en 2023, contre 25 % en 2018. Ils sont 45 % à avoir dû reporter, modifier voire renoncer à leur traitement, selon les conclusions d'une enquête de 2020 de la Ligue nationale contre le cancer ; en outre, 68 % des oncologues médicaux considèrent que ces pénuries auront un impact sur la survie des personnes malades à cinq ans.
France Assos Santé se mobilise pour un accès équitable aux innovations, véritable défi pour notre système solidaire d'assurance maladie. Les malades font face à un chantage industriel. Devons-nous accepter les demandes d'augmentation de prix des médicaments anciens, qui ne sont plus sous brevet ? Des remises se négocient au sein du Comité économique des produits de santé (CEPS), mais ne sont pas publiées. Nous ne connaissons donc pas le prix réel du médicament, mais uniquement son prix facial.
Devons-nous octroyer davantage d'aides publiques aux industriels afin de faciliter les relocalisations ? Peut-être, mais ces aides doivent être assorties d'obligations, notamment celle d'une production du médicament sur le long terme. Et toutes les aides publiques doivent être publiées.
Les prix demandés par les industriels tiennent compte du positionnement tarifaire aux États-Unis, où se concentrent les innovations, mais aussi de la solvabilité de notre système de santé, qui, contrairement au système étatsunien, repose sur la solidarité. Faut-il en conclure que la France paie mal ses médicaments ? Selon le rapport du CEPS sur l'exercice 2021, le montant global de dépenses au titre des médicaments remboursables s'est élevé à 30,4 milliards d'euros en 2021, contre 27,9 milliards d'euros en 2019. Il s'agit non des prix réels, mais des prix affichés. Or le même rapport constate que les remises sur les médicaments s'élevaient à 4,5 milliards d'euros en 2021, contre 3,2 milliards d'euros en 2020, soit une augmentation de plus d'un milliard d'euros : cette situation interroge.
Le prix tient compte du volume de prescription et de dépenses. Récemment, les médicaments contenant de l'amoxicilline et du paracétamol étaient en rupture, or la France est le premier pays consommateur de ces molécules en Europe. Nous nous interrogeons sur la pertinence de prescriptions aussi nombreuses.
Nous proposons d'appliquer la législation en cours : en cas de rupture, le plan de gestion des pénuries (PGP) doit être établi par les industriels et transmis à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). La loi prévoit un stock de deux mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) et d'un mois pour les autres. Mais les sanctions contre les industriels sont rares. L'ANSM est-elle en mesure de contrôler ? Il est indispensable de prévenir les pénuries, dont la durée moyenne est de 14 semaines. Cela suppose de disposer d'un stock de quatre mois pour tous les MITM.
Nous suggérons également de poursuivre la production et la commercialisation de médicaments anciens, plus touchés par la pénurie. C'était l'objet de l'article 30 du projet de loi de financement pour la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023, hélas absent de la loi promulguée. Pourquoi ne pas réintroduire cette disposition dans le PLFSS pour 2024 ?
Nous plaidons pour plus de transparence : les informations relatives à la pénurie et aux traitements de substitution doivent être communiquées au patient. Cela ne pose pas de problème dans les pharmacies, mais la situation est plus complexe à l'hôpital, d'où des pertes de chances : une étude portant sur 402 personnes soignées pour un cancer de la vessie entre 2011 et 2016 à l'hôpital Édouard-Herrriot de Lyon a montré une augmentation des récidives durant une pénurie, qui conduit à une augmentation de la mortalité à cinq ans. Il faut informer le patient en cas de substitution de traitement, car les effets secondaires, différents de ceux de son traitement habituel, peuvent parfois être graves.
Plutôt que de courir derrière les industriels, envisageons une production des molécules délaissées par une structure à but non lucratif ou disposant d'un partenariat public-privé (PPP) sur toute la chaîne du médicament. Durant la crise sanitaire, les hôpitaux, face à la pénurie, ont façonné eux-mêmes des médicaments d'anesthésie, notamment aux Hospices civils de Lyon. Cela a sauvé des vies quand les médicaments faisaient défaut !
La France doit aussi être à l'offensive dans la révision de la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne en vue d'aboutir, à tout le moins, à une harmonisation et à une constitution de stocks de produits semi-finis, que les industriels pourraient utiliser en cas de pénurie de l'un des composants d'un médicament.
En résumé, nous regrettons l'opacité du système : les prix ne prennent pas en compte les volumes de prescription et les réductions accordées aux industriels. Il en va de même pour la fixation du montant des aides publiques.
Médecins du monde défend un système de santé inclusif, solidaire et pérenne. À ce titre, nous nous mobilisons depuis des années sur les enjeux du prix et de l'accès aux médicaments, sur l'innovation thérapeutique, mais aussi sur la question des traitements anciens, nécessaires et efficaces. Le problème est apparu dans les pays riches en 2014, avec l'arrivée des antiviraux à action directe contre l'hépatite C : la firme Gilead a alors introduit le Sofosbuvir au prix de 41 000 euros la cure, alors que près de 230 000 personnes vivaient avec ce virus. Pour la première fois, l'État a rationné l'accès au traitement en raison de son prix et limité la prise en charge du Sofosbuvir aux patients souffrant des stades les plus avancés de fibrose hépatique. Il gérait l'urgence, aux dépens d'une politique ambitieuse susceptible de mettre fin à l'épidémie.
Depuis, nous ne cessons de dénoncer les abus commis par de nombreuses firmes lors de la fixation du prix de nouvelles thérapies. Ces stratégies ont été documentées par le Sénat américain et par la Cour des comptes, entre autres. Le rapport technique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne que les prix des médicaments anticancéreux visent à maximiser le profit, dans une industrie où les marges sont très élevées.
Ce modèle de prix inflationniste est motivé par un paradigme fondé sur la valeur : cela revient à donner un prix à la vie. En France, c'est surtout l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) par les nouveaux traitements qui détermine la stratégie des firmes dans la négociation des prix avec l'État. Mais cette logique ne prend pas en compte l'équilibre des systèmes de santé. La fixation du prix répond à des critères opaques en raison d'une acceptation disproportionnée par les États du secret des affaires. Ainsi, les données des essais cliniques, les financements, les résultats et les échecs ne sont pas transparents, non plus que le cadre des négociations et les déterminants réels des prix. Les prix élevés sont au coeur du modèle économique des multinationales auxquelles les brevets assurent un monopole d'exploitation.
La propriété intellectuelle est le fondement juridique qui permet de contrôler l'offre et la disponibilité dans des systèmes de santé à ressources limitées, créant une situation de rareté artificielle et de pression sur les budgets de la santé. Certaines entreprises pharmaceutiques n'investissent plus les marchés européens, considérant que les prix qui y sont pratiqués sont trop faibles. C'est le cas de Bluebird Bio, dont la thérapie génique Zynteglo contre la bêta-thalassémie coûte trois millions de dollars par patient.
Ce modèle crée d'importants déséquilibres : d'une part, un soutien important des pouvoirs publics pour mettre rapidement sur le marché de nouveaux médicaments grâce à la recherche publique et aux subventions aux entreprises, en échange de prix élevés supportés par l'assurance maladie ; d'autre part, une stratégie lacunaire pour la mise à disposition d'anciens médicaments essentiels, considérés comme insuffisamment rentables par les entreprises, ce qui contribue aux situations de pénurie actuelles.
Or la pérennité et l'accès abordable devraient figurer au coeur des solutions. Face à ces constats, nous défendons des propositions très concrètes ; nous vous renvoyons également aux recommandations du rapport de la Cour des comptes de 2017.
Premièrement, l'État doit négocier le prix des innovations thérapeutiques en assurant la transparence des coûts réels de traitement, les déterminants de ces prix et les conditions de ces négociations. Le CEPS devrait prendre en compte l'apport des financements publics dans la recherche et développement des médicaments lors de la négociation des prix.
Deuxièmement, le ministre de la santé doit pouvoir déclencher la licence d'office lorsqu'un brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique, notamment en pratiquant des prix anormalement élevés en période de crise. La licence d'office a été créée sous le général de Gaulle, or les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas su ou voulu se saisir de cet outil. Ils n'ont même jamais créé les conditions réglementaires de sa mise en oeuvre, ce qui, de fait, vide cet outil de négociation de sa puissance. L'article R. 613-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit une commission chargée d'apprécier les cas concrets de licence d'office - elle n'a jamais été installée. D'où l'importance de donner un corps légal et réglementaire à cet outil prévu dans notre droit, mais aussi dans le droit international.
Troisièmement, nous demandons que la France s'implique davantage dans la gouvernance des pratiques de l'Office européen des brevets (OEB). Médecins du Monde a montré, par des oppositions au brevet et des observations de tiers devant cet organisme, que les revendications relatives aux brevets déposés par les firmes étaient abusives. Nous vous suggérons d'auditionner les membres de l'Office européen des brevets, mais aussi les représentants de la France qui y siègent. Les pratiques en matière de propriété intellectuelle des produits de santé ne doivent pas créer des barrières supplémentaires ou des retards dans l'accès aux médicaments génériques et biosimilaires.
Quatrièmement, il faut réformer et repenser les modèles de recherche et développement pour intégrer l'accès en amont, notamment lors du transfert des technologies de la recherche fondamentale - majoritairement financée par des fonds publics - vers les industriels. Il convient d'exiger des contreparties claires lors de cette étape : transparence des coûts réels de recherche et développement, partage de la propriété intellectuelle et prix abordable des médicaments.
Dr Julie Allemand-Sourrieu, représentante du collectif Santé en danger. -Notre collectif, qui regroupe des soignants de terrain, représente l'ensemble des professions de santé, joue un rôle de sentinelle et formule des propositions concrètes, notamment après le Ségur de la santé. Nous considérons que la démocratie sanitaire est en danger, avec la fermeture de maternités et de services d'urgences, entre autres. Les métiers de la santé perdent leur attractivité, alors que six millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Nous défendons le principe d'un accès à des soins de qualité pour tous.
En 2017, nous constations des tensions sur 500 médicaments, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année 2016, malgré le rapport alarmant publié par le Sénat en 2018. Aujourd'hui, 372 médicaments font l'objet de difficultés d'approvisionnement, dont plus de 50 % sont des MITM, pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique.
On aimerait se rassurer sur l'excellence de notre système de santé. La France est historiquement une puissance industrielle dans la production de médicaments. Certes, nous disposons encore de 271 usines sur le territoire, avec 35 000 salariés, mais notre pays, naguère leader, occupe désormais la quatrième place européenne. Toutefois, le commerce du médicament reste florissant, avec 3,2 milliards de boîtes vendues par an.
Le financement public soutient de manière non négligeable l'innovation industrielle. Dès lors, comment expliquer qu'un tiers des Français déclarent avoir subi une pénurie de médicaments ces dernières années ? Il ne s'agit pas d'un effet de la crise sanitaire : en 2023, le rythme des nouvelles ruptures de stock est supérieur à celui des remises à disposition - douze à quatorze MITM et vaccins sont concernés pour les mois de janvier et de février 2023. Il ne s'agit pas de médicaments de niche mais plutôt de médicaments anciens et matures. Cette situation met en danger la vie des patients et nuit au bon fonctionnement de notre système de santé.
Ces pénuries ont un coût, car elles mettent en difficulté les pharmaciens, sur fond de crise économique et géopolitique. Si rien n'est fait, le phénomène s'aggravera. Notre souveraineté sanitaire est menacée : la fabrication des principes actifs des médicaments essentiels est largement délocalisée - 80 % des substances actives consommées en France sont produites en Chine et en Inde, contre 20 % il y a trente ans. La production, notamment le conditionnement, est complexe. La loi de l'offre et de la demande s'impose, et les prix sont négociés au plus bas.
En cas de pénurie conjoncturelle mondiale, la France et l'Union européenne ne seront plus prioritaires pour les livraisons, faute de fournisseurs. A-t-on déjà oublié les difficultés à obtenir des masques lors de la crise sanitaire ?
Sur le terrain, les traitements de remplacement posent des problèmes d'effets indésirables ou d'erreur médicamenteuse. On prescrit antibiotiques et médicaments à visée cardiovasculaire par défaut ; souvent, seuls deux médicaments peuvent être fournis, quand la prescription en compte cinq. Les patients sont moins bien soignés, et les pertes de chances réelles. Les généralistes ont le sentiment de subir ces pénuries : aucune information ne leur est fournie et aucune cartographie des lieux de délivrance n'est disponible, ce qui contraint les prescripteurs ou les patients à contacter les pharmacies une à une.
La coopération européenne est difficile, notamment au niveau des prix ou de l'étiquetage. Pourtant, il est nécessaire de relocaliser notre industrie à l'échelle française et à l'échelle européenne. Nous déplorons un manque de coordination et d'efficacité.
Dr Franck Prouhet, représentant du collectif Notre santé en danger. - J'ai lancé puis animé le collectif « Brevets sur les vaccins, stop. Réquisition ! » Lors des discussions sur la levée des brevets, nous avions dressé un constat de faillite de l'idée du médicament-marchandise, dont la gestion a été déléguée non pas à l'OMS, mais à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les brevets permettent à la fois d'organiser la pénurie et de favoriser l'explosion des prix : ce sont les deux faces de la même médaille.
En 1918, en pleine pandémie de grippe, la société chimique des usines du Rhône souhaitait vendre son aspirine à un prix exorbitant. Le gouvernement de l'époque avait menacé de réquisitionner les stocks pour faire baisser les prix.
Lors de la crise sanitaire, le code génétique du covid-19 a été rendu public immédiatement. De plus, les deux brevets ayant permis la fabrication de vaccins à ARN messager avaient bénéficié de fonds publics. Or des milliards d'euros d'argent public ont été déversés sur l'industrie pharmaceutique pour produire des vaccins - 17 milliards d'euros grâce à la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) ou encore deux milliards d'euros débloqués par l'Union européenne. La France est un pays riche et a eu accès au vaccin, mais le reste du monde en a été privé : c'est non seulement scandaleux d'un point de vue moral, mais cela contribue aussi à la multiplication des variants. La presse scientifique s'en est d'ailleurs émue. Dans le British Medical Journal, Fatima Hassan a qualifié le refus de l'OMC de lever les brevets de crime contre l'humanité.
La répartition des 6,5 milliards de premières doses de vaccins a profité à 61 % des Européens et à 67 % des Américains, mais seulement à 4,5 % des habitants des pays pauvres. L'opacité règne : impossible de connaître la somme prise en charge par la Commission européenne. Chaque dose de Remdesivir aurait été facturée 2 100 euros, alors que l'étude Solidarity l'avait déjà jugé non seulement inefficace, mais dangereux pour les reins. Pendant ce temps, l'Ukraine achetait le même produit auprès d'un fabricant pakistanais de médicaments génériques pour 20,45 euros. Nos systèmes de sécurité sociale ont donc payé très cher des médicaments ou des vaccins qui avaient déjà été financés par la recherche publique.
Les sénateurs soucieux de la dépense publique feront le rapprochement avec les difficultés de l'hôpital public. Des négociations plus poussées auraient sans doute permis de faire baisser les prix.

Je vous rappelle que notre commission d'enquête porte sur la pénurie de médicaments.
Dr Franck Prouhet. - Il me semble que mon propos correspond au thème de la commission.

Qu'en est-il des problématiques actuelles relatives à la pénurie de médicaments en France ?
Dr Franck Prouhet. - La crise du covid-19 a montré qu'il existait d'autres solutions que les brevets. Moderna n'avait jamais produit un seul vaccin à ARN messager : elle a dû faire appel à l'industriel suisse Lonza. Or une étude d'une association américaine, Public Citizen, a montré qu'avec 9,5 milliards d'euros, on pouvait fabriquer environ 9 milliards de doses sur cinq sites décentralisés, ce qui aurait permis de vacciner largement.
Le système des brevets a failli, de même que l'OMC. Seuls des brevets publics et l'OMS peuvent réduire les pénuries et la pression financière pesant sur la sécurité sociale : les 2,5 milliards d'euros versés à Pfizer et Moderna auraient permis d'embaucher 59 000 infirmiers et infirmières. Ce manque de transparence a suscité la défiance de la population. L'affirmation d'une démocratie sanitaire passera par la rupture des liens incestueux entre l'industrie pharmaceutique et le système des brevets. Les vaccins et les médicaments ne doivent plus être considérés comme une marchandise.

Tous les intervenants ont dépassé leur temps de parole. En outre, je rappelle que les travaux de notre commission d'enquête portent sur les pénuries de médicaments.
J'évoquerai le problème à travers le prisme de personnes souffrant de maladies rares, voire très rares - celles qui touchent moins de 2 000 personnes. Environ 7 000 maladies rares ont été identifiées ; 85 % d'entre elles concernent moins d'une personne sur un million. Néanmoins, compte tenu du nombre important de maladies rares, un Français sur vingt est concerné, soit trois millions de personnes.
Or 95 % des personnes souffrant d'une maladie rare ne disposent d'aucun traitement spécifique pour se soigner et changer significativement le cours de leur pathologie. Depuis quelques années, les traitements fondés notamment sur la génothérapie se multiplient, mais soigner 7 000 maladies rares reste un immense défi. Et si les avancées scientifiques sont enthousiasmantes, les perspectives commerciales le sont beaucoup moins. Non seulement les prix de ces nouveaux traitements sont très élevés, mais l'absence de modèle économique ne permet pas toujours leur développement.
Les évolutions récentes sont inquiétantes. Nous observons un retournement des marchés financiers pour les maladies « ultra-rares » : les industriels cessent d'investir dans des traitements adaptés à ces pathologies, qui leur permettaient par ailleurs de maîtriser des technologies utiles pour soigner des maladies plus fréquentes, assurant la rentabilité des sommes engagées. De plus, certains laboratoires ont retiré leurs traitements du marché européen pour se recentrer sur le marché américain, alors qu'ils avaient obtenu les autorisations de mise sur le marché (AMM) nécessaires pour traiter des maladies graves excessivement rares. On peut citer un autre médicament de Bluebird Bio, le Skysona, destiné aux enfants atteints d'adrénoleucodystrophie. C'est d'autant plus choquant que ces deux produits étaient issus de la recherche académique française. Il est primordial d'inventer un nouveau modèle permettant un accès non pas aux marchés, mais aux patients souffrant de ces maladies « ultra-rares ».
Non pas une logique d'exception, mais un modèle adapté à l'ultra-rareté de maladies touchant de très nombreuses personnes, pour lesquelles la logique classique d'essais puis de généralisation via une AMM ne fonctionne pas. Nous plaidons en faveur d'un fonds public d'innovation dans ces situations difficiles.
Par ailleurs, de vieux médicaments sont souvent utilisés hors AMM pour traiter ces maladies rares. Or c'est souvent lors d'une rupture ou d'un arrêt de la production qu'on découvre cette utilisation. Malgré les efforts consentis à l'occasion du troisième plan national Maladies rares - en espérant un quatrième plan ! -, nous sommes loin d'avoir trouvé le modèle économique permettant de pérenniser la production de ces traitements. Par exemple, l'Agence européenne des médicaments (AEM) a retiré en 2013 l'AMM du Salbutamol sous forme de comprimés ou de sirop, considérant que d'autres médicaments étaient plus efficaces. Or 200 à 300 personnes atteintes de syndromes myasthéniques congénitaux obtenaient, grâce à ce traitement bon marché, des résultats spectaculaires - au point de pouvoir marcher de nouveau ! Après le retrait de l'AMM, il a fallu l'importer de pays qui en avaient conservé quelques boîtes. L'ANSM peine aujourd'hui à en acquérir et aucun laboratoire ne veut investir dans une molécule qui ne rapporte rien et qui ne sera utile qu'à 200 personnes. L'exemple est parlant.
Les personnes atteintes de maladies rares sont aussi touchées par toutes les autres maladies. Leur vie quotidienne est déjà difficile. Mais elles vivent dans l'angoisse lorsqu'elles font face à une pénurie d'amoxicilline, de corticoïdes ou de paracétamol. Souvent, elles doivent faire plusieurs pharmacies pour assurer la continuité de leur traitement : au fardeau de la vie quotidienne avec une maladie rare s'ajoute un fardeau psychologique.

Merci à tous pour votre participation. Vous avez déjà répondu à plusieurs de mes questions.
Madame Simonin, vous avez évoqué la révision de la législation pharmaceutique de l'Union européenne, dont la présentation aurait dû avoir lieu fin mars. Avec Sonia de La Provôté, nous nous sommes rendues à Bruxelles la semaine dernière : nous avons demandé à nos interlocuteurs les motifs du blocage - sans obtenir de réponses. Une députée européenne s'inquiétait de ce report, qui pourrait atteindre un an. Avez-vous des informations à ce sujet ? Il semblerait que des lobbys puissants empêchent l'adoption de cette réglementation.

Il ne s'agit pas uniquement de lobbys défendant la position des laboratoires.

J'ai simplement parlé de lobbys, je n'ai pas accusé les laboratoires, contrairement à l'étiquette que l'on veut souvent m'accoler.
Madame Veras, comment analysez-vous la jurisprudence de l'OEB sur la notion d'activité inventive ? Quelles que soient nos sensibilités politiques, nous sommes tous frappés que l'industrie privilégie l'innovation et rétropédale pour les produits matures. Les conséquences risquent d'être préjudiciables. L'innovation rime-t-elle nécessairement avec progrès thérapeutiques ?
Le prix exorbitant de certains médicaments dits innovants ne conduit-il pas à en rationner l'accès ? Je suis inquiète : seuls les patients pouvant être remboursés seraient éligibles à certains traitements. Un choix serait donc opéré.
Monsieur Duguet, le statut particulier d'YposKesi, entité industrielle placée sous la double tutelle d'une association et de l'État, était intéressant. Elle est désormais dans le giron d'un groupe sud-coréen. Faut-il y voir le symptôme d'une impuissance des pouvoirs publics ?
Quels sont les effets des ruptures sur les soignants ? Lors de précédentes auditions, certains ont évoqué la possibilité d'étendre les dates de péremption de médicaments. Est-ce une solution ?
Je pense également que la recherche sur les maladies rares pourrait bénéficier à des personnes souffrant d'autres pathologies.
Nous déplorons le blocage de la révision de la législation pharmaceutique européenne. Nous regrettons également que des stocks de médicaments essentiels ne soient pas constitués au niveau européen et qu'aucune sanction ne soit prévue contre les laboratoires pharmaceutiques.
Les accès précoces ne sont parfois pas confirmés par l'évaluation, faute de données en nombre suffisant pour vérifier l'amélioration du SMR. Certaines AMM sont délivrées malgré un degré d'incertitude important, surtout pour des patients ne disposant pas d'alternative thérapeutique. Mais ces médicaments innovants, chers, ne sont pas éligibles à la liste en sus : le retrait des laboratoires du marché français ou le refus des prix proposés menacent l'égal accès sur le territoire, en raison des différences de situation financière entre les établissements de santé.
Nous avons déposé deux oppositions à des brevets pour le Sofosbuvir et le Kymriah et formulé deux observations de tiers sur les vaccins contre le covid-19.
Les industriels multiplient les demandes autour d'un même produit : ils souhaitent breveter toute la chaîne de production. L'activité inventive, la nouveauté et l'application industrielle sont des critères de brevetabilité. Mais c'est une fiction juridique, qui peut être interprétée de façon large ou restrictive. Un rapport de 2019 sur la concurrence dans le marché pharmaceutique européen a influencé la démarche Raising the Bar adoptée par l'OEB, visant à rendre plus rigoureuse l'adoption des critères de brevetabilité. Mais ce projet semble avoir été abandonné. De plus, des combinaisons de molécules existant déjà dans l'état de l'art ne devraient pas faire l'objet de brevets ; je pense notamment aux polymorphes.
Nous disposons d'une connaissance concrète de l'impact des prix sur les rationnements. Nous travaillons avec des consommateurs de drogue, très touchés par l'hépatite C : ils ont besoin du Sofosbuvir. Nous nous sommes également intéressés aux conséquences sur le système de santé lui-même, qui n'est pas décorrélé du prix des médicaments.
La licence d'office est un outil pour la mise en place de génériques ; elle a été utilisée par plusieurs pays et a permis de nombreuses économies. Elle pourrait être utilisée pour le Sofosbuvir, dont le prix demeure élevé du fait d'une situation de monopole. Nombre d'acteurs, notamment le Sénat, ont souligné les abus de ce modèle économique.
Dr Julie Allemand-Sourrieu. - Il est nécessaire d'harmoniser les prix au sein de l'Union européenne, afin que les États membres ne se concurrencent pas entre eux. Il convient également de fluidifier le marché du médicament pour que les pays de l'Union puissent s'aider mutuellement, via une harmonisation des étiquetages et des marchés nationaux.
L'extension des dates de péremption est une piste intéressante. Cela suppose toutefois de mener des études de stabilité sur les principes actifs, qui pourraient s'appuyer sur les travaux des Observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et d'innovation thérapeutique (Omedit).
Le portail DP-Ruptures, utilisé par les pharmaciens, devrait également être accessible aux prescripteurs : la coordination et les outils de communication sont essentiels sur le terrain.
Il me semble que l'innovation est largement financée par les deniers publics, avec, en contrepartie, un prix trop bas pour les médicaments essentiels et matures. Un nouvel équilibre devra être trouvé à l'avenir.
Dr Franck Prouhet. - Je me concentrerai sur l'impuissance des pouvoirs publics. En mars 2020, Paul Hudson, PDG de Sanofi, avait annoncé que les Américains disposeraient du vaccin contre le covid-19 avant les Français, compte tenu de son prix plus élevé aux États-Unis. Il est vrai que Sanofi avait alors reçu 280 millions d'euros du gouvernement américain ; l'action du groupe avait monté de 10 %. Dans ce bras de fer, les pouvoirs publics refusent d'utiliser les instruments qui sont à leur disposition. En une dizaine d'années, Sanofi a reçu près de sept milliards d'euros au titre du crédit d'impôt recherche, alors que l'entreprise licenciait 5 000 chercheurs et délocalisait ses activités de recherche aux États-Unis.
Le gouvernement s'est toujours refusé à utiliser l'article L. 3131-15 du code de la santé publique autorisant les réquisitions de certains produits. Le cas du Sovaldi est emblématique : la France payait entre 24 000 et 75 000 euros pour un traitement de trois mois, quand l'Égypte payait 300 euros, car ce pays refusait la brevetabilité de ce médicament. Lors de la crise sanitaire, le gouvernement aurait pu demander à ses représentants à l'OMC de lever les brevets sur les vaccins.
En France, l'impuissance est organisée, car il existe depuis des décennies de fortes connivences entre les pouvoirs publics et les laboratoires, devenus des mastodontes au plan international : l'exemple de Servier le prouve. Nous devrons tôt ou tard aborder ce sujet.
Le rationnement des médicaments innovants, prescrits essentiellement à l'hôpital, est une réalité : en raison de la faillite de l'hôpital, les équipes médicales ne peuvent octroyer les rendez-vous nécessaires à la prescription de ces traitements dans des délais raisonnables. Les dispositifs d'accès compassionnel et d'accès précoce ont été améliorés depuis deux ans sur le plan législatif et réglementaire. Mais la situation est bloquée, car les moyens nécessaires à la délivrance de ces médicaments n'ont pas été prévus. Il faut en outre prévoir un système de collecte des données pour le suivi des médicaments innovants.
À l'automne 2019, l'AFM-Téléthon a organisé un colloque intitulé « Thérapie génique et indépendance sanitaire de la France ». À l'époque, ce sujet n'avait pas suscité un grand intérêt et beaucoup ne croyaient pas à la révolution médicale que constituent ces thérapies géniques, susceptibles de guérir de nombreuses maladies. Nous appelions la France à jouer un rôle de premier plan, à ne pas rater l'industrialisation de ces produits - au risque de voir ces médicaments être inventés en France mais produits aux États-Unis. Mais nous n'avons pas été suffisamment écoutés.
Il est urgent d'investir massivement en faveur d'une filière française des génothérapies. La production de ces médicaments très complexes suppose de réunir une multitude d'acteurs sur un même territoire pour coordonner les efforts et, partant, diviser par cent les coûts de production - puisque tel est le principal frein actuellement.
Lors de sa création, la plateforme YposKesi était la plus grosse au monde. Mais le monde évolue vite et les investissements dans les usines de production s'élèvent vite à 500 millions d'euros, voire un milliard d'euros. Il n'a pas été possible de trouver en France ou en Europe les fonds nécessaires au développement d'YposKesi. Cela dit, une nouvelle usine ouvrira prochainement à Évry pour assurer la production en France de ces thérapies.
Le Gouvernement a lancé un appel d'offres visant au développement de bioclusters de niveau international en France. Nous souhaitons que l'un d'eux soit consacré aux génothérapies.
Longtemps, la recherche sur les maladies rares a permis de trouver des solutions thérapeutiques pour des maladies plus fréquentes. Mais le modèle tend à disparaître et les maladies rares sont abandonnées. C'est pourquoi nous plaidons pour la création d'un fonds public d'innovation en faveur du traitement des maladies rares.

Nous vous ferons parvenir par écrit les questions de collègues qui n'ont pas pu intervenir durant cette audition - vous avez été prolixes ! Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.