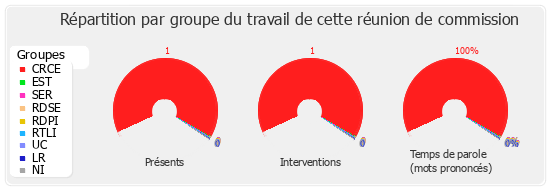Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 14 mars 2006 : 1ère réunion
Sommaire
- Familles monoparentales et familles recomposées
- Audition dans le cadre d'une table ronde de m. stéphane clerget pédopsychiatre de mme françoise dekeuwer-défossez doyen de la faculté de droit de l'université de lille ii membre du haut conseil de la population et de la famille de mme annie guilberteau directrice générale du centre national d'information sur les droits des femmes et des familles cnidff de m. didier le gall professeur de sociologie à l'université de caen et de mme jacqueline phelip présidente de l'association « l'enfant d'abord » (voir le dossier)
La réunion
Familles monoparentales et familles recomposées
Audition dans le cadre d'une table ronde de M. Stéphane Clerget pédopsychiatre de Mme Françoise deKeuwer-défossez doyen de la faculté de droit de l'université de lille ii membre du haut conseil de la population et de la famille de Mme Annie Guilberteau directrice générale du centre national d'information sur les droits des femmes et des familles cnidff de M. Didier Le gall professeur de sociologie à l'université de caen et de Mme Jacqueline Phelip présidente de l'association « l'enfant d'abord »
La délégation a procédé à l'audition, dans le cadre d'une table ronde, de M. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, de Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, doyen de la faculté de droit de l'université de Lille II, membre du Haut conseil de la population et de la famille, de Mme Annie Guilberteau, directrice générale du Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles, de M. Didier Le Gall, professeur de sociologie à l'université de Caen, et de Mme Jacqueline Phelip, présidente de l'association « L'enfant d'abord ».

a introduit les débats en indiquant que cette table ronde était destinée à enrichir les travaux de la délégation sur le thème des familles monoparentales et recomposées. Justifiant brièvement le choix de ce sujet de réflexion, elle a fait observer que la physionomie des familles françaises avait profondément évolué au cours des dernières décennies.
Elle a rappelé deux séries de chiffres particulièrement éloquents à ce titre :
- d'une part, de 1990 à 1999, le nombre de familles monoparentales est passé de 1,40 à 1,64 million et le nombre d'enfants vivant dans ces familles de 2,248 à 2,747 millions ;
- d'autre part, au cours de la même période, le nombre de familles recomposées a fortement augmenté, passant de 646 000 en 1990 à 708 000 en 1999, le nombre d'enfants vivant dans ce type de famille ayant également progressé, passant de 1,43 à 1,59 million.
a tout d'abord décrit l'activité de son association et manifesté d'emblée son inquiétude particulière à l'égard des enfants soumis par les juges à des résidences alternées qui bouleversent leurs conditions de vie. Puis elle a indiqué que la majorité des appels adressés à son association concernait des enfants de 0 à 9 ans. Analysant les causes des situations difficiles portées à la connaissance de l'association, elle a précisé qu'il s'agissait, dans 50 à 60 % des cas, de séparations provoquées par des violences physiques ou psychologiques et, dans 20 % des cas environ, de séparations dues à un désintérêt du père à l'égard de sa famille.
Elle a ensuite rappelé que la loi du 4 mars 2002 permettait au juge d'imposer la résidence alternée dans un contexte sociologique où des séparations ont lieu de plus en plus tôt, y compris, dans certains cas, pendant que la femme est encore enceinte.
a ensuite constaté un certain nombre de dérives résultant de l'application de cette loi, à partir d'exemples tels que celui d'un enfant d'un mois et demi soumis à une résidence alternée entre Paris et Bastia ou celui d'un enfant de 24 mois subissant une résidence alternée entre la France et les Etats-Unis. Abordant ensuite l'influence néfaste du conflit parental sur l'équilibre des enfants, elle a déploré qu'en cas de résidence alternée, les enfants puissent être placés dans des milieux familiaux parfois hermétiques, et notamment fréquenter alternativement deux crèches différentes. Elle a ajouté que certains enfants étaient suivis par deux médecins différents, au risque d'une éventuelle double médication, ou bien scolarisés dans deux écoles différentes. Elle a ensuite déploré que des résidences alternées soient trop souvent encore imposées par les juges dans un contexte de violences physiques entre les ex-époux, la loi ne comportant aucun « garde-fou » à ce sujet.
Puis Mme Jacqueline Phelip a décrit les symptômes des enfants subissant les dérives de la résidence alternée qui expriment leur malaise notamment par la détresse, l'insomnie, l'agressivité à l'égard de la mère lorsqu'ils la rejoignent, puis le refus de la quitter, et qui somatisent leur angoisse. Elle a précisé qu'on pouvait même constater, de la part d'un certain nombre d'enfants, dès l'âge de 7 à 9 ans, des menaces de fugue et de suicide. Rappelant que les juges avaient à leur disposition des outils d'évaluation, comme l'enquête sociale ou l'expertise psychologique, elle a déploré leur peu de fiabilité. Puis elle a souligné que, bien souvent surchargés de dossiers, les juges aux affaires familiales n'avaient pas de formation suffisante en matière de développement psychoaffectif de l'enfant. Tout en reconnaissant que la majorité des juges faisaient preuve de prudence, elle a estimé que se manifestaient, ici ou là, des prises de décisions idéologiques. Elle a également indiqué que trop peu d'enfants ayant atteint « l'âge de discernement » étaient entendus comme le permet la loi.
S'agissant des conséquences néfastes des séparations, Mme Jacqueline Phelip a tout d'abord évoqué le cas des mères qui avaient préalablement abandonné leur carrière pour suivre leur mari en cas de mutation professionnelle. Puis elle a rappelé que la résidence alternée exonérait fréquemment le mari du versement de la pension alimentaire, tandis qu'un certain nombre de mères isolées devaient faire face au chômage ou, à l'inverse, craignaient qu'une reprise d'emploi les contraignant à s'éloigner du domicile du père ne risque de leur faire perdre la garde de leurs enfants. Elle a également souligné, en cas de garde alternée, la prise en charge d'un certain nombre de frais, médicaux notamment, exclusivement par la mère, en observant, par ailleurs, que certaines « gardes alternées » se déroulaient, dans la réalité, entre la mère, d'une part, et les grands-parents paternels ou la nouvelle compagne du père de l'enfant, d'autre part. Elle a rappelé que les séparations paupérisaient souvent les ex-conjoints et évoqué la situation de nombreux parents en grande difficulté financière. Soulignant l'importance du maintien des liens entre les enfants et leur père, elle a regretté que les juges s'orientent de plus en plus vers la solution de la résidence alternée, en dépit de l'intensité de certains conflits parentaux qui s'exacerbent au fil du temps. Elle a souligné l'échec patent de cette orientation, dont les enfants font les frais. Insistant sur les phénomènes de pathologie que provoquent ces résidences alternées prescrites sans précautions, elle a dénoncé le non-sens qui consiste à « partager » l'enfant au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes ou du principe de parité entre les mères et les pères.
En conclusion de son intervention, Mme Jacqueline Phelip a fait référence à des études conduites aux Etats-Unis qui, avec un recul de vingt ans, ont analysé les inconvénients de certaines gardes alternées imposées et conduit à remettre en cause la systématisation de ce mode de garde préconisé dans les années 1980. Puis elle a évoqué des travaux reposant sur l'idée d'un calendrier de progressivité des visites chez le père, pour mettre en harmonie la garde alternée avec le développement de l'enfant. Elle a enfin mentionné des études conduites au Québec sur les troubles du comportement d'enfants qui apparaissent comme de véritables « cobayes » de la garde alternée. Elle a en effet considéré que, malgré l'arrivée des « nouveaux pères », il incombait encore très majoritairement aux mères de s'occuper des jeunes enfants.

a remercié l'intervenante et insisté sur la nécessité de rechercher des solutions adaptées en la matière.
Après avoir rappelé le sujet de deux de ses ouvrages intitulés « Comment survivre à la séparation de ses parents » et « Séparons-nous... mais protégeons nos enfants », M. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, a tout d'abord évoqué le nombre croissant de femmes qui « font des enfants toutes seules », en faisant observer que, dans de telles situations, l'enfant était amené à se poser des questions sur l'existence de son père et se retrouvait dans la situation d'un enfant né sous X. Il a cependant précisé que les familles monoparentales étaient le plus souvent issues de séparations ou de divorces, soulignant que si deux fois sur trois la femme demandait la séparation, les hommes se remettaient en couple plus fréquemment que leurs ex-épouses. Il a fait observer, à ce sujet, que la charge des enfants, supportée dans la plupart des cas par la mère, rendait celle-ci moins disponible pour de nouvelles rencontres.
Il a ensuite évoqué l'augmentation du nombre de consultations de psychologues ou psychiatres préalables à la séparation, qui donnent aux conjoints les moyens de mieux gérer cette situation et les conduisent, parfois, à la réconciliation. Il a souligné que les séparations conflictuelles, et tout particulièrement les attaques personnelles entre les parents, étaient extrêmement difficiles à vivre pour les enfants, qui intériorisent celles-ci comme si elles leur étaient directement adressées.
Rappelant que la garde était encore le plus souvent accordée à la mère à l'issue des séparations, il a insisté sur le principal inconvénient de cette décision, qui donne le sentiment à l'enfant que l'un des parents est plus important que l'autre, le rôle du père apparaissant alors comme nié par la justice et la société.
Il a ensuite décrit le processus de rupture des liens entre les enfants et leur père susceptible de survenir notamment lorsque ce dernier se remarie et fonde une nouvelle famille. Il a estimé que la loi autorisant la résidence alternée allait dans le sens d'un rééquilibrage et constituait, dans bien des cas, un moindre mal pour prévenir le délitement des liens entre l'enfant et son père. Il a cependant insisté sur la nécessité de prévoir une certaine souplesse dans sa mise en oeuvre, un parent pouvant s'avérer ne pas être apte à s'occuper de son enfant pour une raison ou une autre.
En ce qui concerne les recompositions familiales, M. Stéphane Clerget a tout d'abord indiqué que certaines femmes sacrifiaient leurs possibilités de vivre une nouvelle aventure, en préférant se consacrer à leurs enfants. Analysant la place des enfants dans la configuration familiale monoparentale ou recomposée, il a estimé plutôt sain pour l'enfant de constater que ses parents pouvaient s'inscrire à nouveau dans une histoire d'amour épanouissante. Il a précisé que les psychologues pouvaient délivrer des conseils utiles aux femmes pour qu'elles s'autorisent une nouvelle vie de couple, en soulignant l'importance d'aménager une installation progressive du nouveau conjoint.
Il a ensuite indiqué que les beaux-parents ne savaient pas toujours comment se positionner par rapport à l'enfant sans provoquer de conflit de loyauté chez celui-ci, entre son père et son beau-père par exemple. Insistant sur les bienfaits d'une démarche progressive en la matière, il a également souligné l'utilité d'expliquer à l'enfant qu'il ne devait à son beau-père le respect et l'obéissance, par exemple, que par délégation de l'autorité de sa mère biologique, ce qui permet de lui faire comprendre que l'autorité du beau-père ne se substitue pas à celle du père biologique. Sur la base d'exemples concrets, il a insisté sur la vertu apaisante à l'égard des beaux-enfants de cette explication, d'ailleurs en harmonie avec la logique juridique.
Il a ensuite fait observer que, dans une famille recomposée, la situation se compliquait fréquemment lors de l'arrivée d'un nouvel enfant. Evoquant le risque que le beau-parent ne s'investisse dans des liens avec son nouvel enfant, aux dépens des autres enfants, il a cependant considéré comme dynamisant et porteur d'harmonie l'arrivée d'un nouveau descendant dans une famille recomposée, tout en montrant que l'accompagnement d'un enfant de parents divorcés nécessitait un tact particulier.
En conclusion de son propos, M. Stéphane Clerget a estimé que, globalement, la recomposition familiale était positive pour l'enfant, car elle lui procure, notamment, une multiplication des possibilités d'identification à des adultes, qui lui sont largement bénéfiques.

a remercié l'intervenant de ses propos, tout en indiquant que 84 % des enfants étaient encore confiés à leur mère.
a tout d'abord rappelé que les centres d'information sur les droits des femmes, nés en 1972, s'étaient fortement développés dans les années 1980 et, qu'aujourd'hui, le réseau rassemblait 115 associations et 980 points d'information implantés sur l'ensemble du territoire. Elle a précisé que ce réseau avait développé son activité dans le champ des services de l'accès des femmes au droit, de l'aide aux victimes de violences, du soutien à la parentalité et de l'accès à la formation professionnelle. En 2005, le réseau a accueilli 338 000 personnes et traité 661 000 demandes d'information, une attention particulière ayant été portée aux familles monoparentales qui représentent 23 % des personnes informées.
Centrant son intervention sur trois aspects, la paupérisation des mères isolées, les difficultés relationnelles consécutives à la séparation et la persistance des violences après la séparation, Mme Annie Guilberteau a tout d'abord insisté sur la solitude extrême des femmes en situation de monoparentalité qui s'adressent au réseau. Evoquant les témoignages recueillis sur le terrain, elle a indiqué que, selon les représentations dominantes, l'homme élevant seul ses enfants avait droit à la considération de son entourage, tandis que la femme, dans la même situation, souffrait d'une certaine stigmatisation. Elle a ajouté que les revenus des mères isolées étaient largement constitués de minima sociaux, cette tendance s'étant aggravée au cours des dix dernières années. Elle a rappelé que la rupture d'un couple engendrait la plupart du temps un appauvrissement de ses deux membres et estimé que ce phénomène était insuffisamment pris en compte au moment de la séparation.
Elle a fait observer que les femmes en situation de monoparentalité qui sollicitaient le réseau des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) disposaient toutes de revenus insuffisants et devaient repenser leur temps de travail : souvent désireuses de l'augmenter lorsqu'elles travaillaient auparavant à temps partiel, ces femmes sont souvent confrontées à des situations qui reflètent les inégalités persistantes entre hommes et femmes dans les structures professionnelles, leur volonté en effet d'investir ou réinvestir une vie professionnelle nécessaire à la sécurité financière de la famille étant confrontée au risque de laisser les enfants livrés à eux-mêmes.
a insisté sur le fait que des freins d'ordre psychologique sont à prendre en considération dans les démarches d'accompagnement vers l'emploi : la peur de laisser les enfants seuls et d'être tenue pour responsable face au père et à la société si un problème ou un accident arrivait, reste un obstacle majeur à la réinsertion professionnelle de nombreuses femmes qui ont intégré, pour des raisons culturelles et sur un mode identitaire, l'idée qu'un statut de « bonne mère » passait inévitablement par un investissement permanent auprès des enfants.
Elle a précisé que les CIDFF conduisaient de nombreuses actions pour favoriser l'exercice de la coparentalité et qu'un travail important était à faire pour faire prendre conscience que les compétences parentales ne relèvent pas de la différence biologique des sexes.
a également souligné que les séparations, notamment pour les jeunes couples, étaient souvent concomitantes au déroulement ou à la fin d'un congé parental et qu'il était difficile pour les femmes de reprendre une activité à l'issue de ce congé, en dépit de la législation en vigueur.
Puis elle a évoqué les difficultés des mères en termes d'accès aux modes de garde, en particulier pour les femmes occupant un emploi précaire ou travaillant dans des secteurs à horaires atypiques (grande distribution, hôtellerie, restauration, milieu hospitalier...). Elle a souligné le désarroi des femmes recherchant un emploi qui, confrontées à la complexité de la législation, sont parfois conduites à abandonner leur démarche de recherche d'emploi compte tenu du risque de perte des minima sociaux que peut provoquer une reprise d'emploi à temps très partiel. Elle a souhaité qu'il puisse être remédié à cette difficulté et a fait observer que l'allocation de parent isolé (API) n'était pas assortie d'une obligation d'insertion, et ne pouvait pas remplacer une autonomie économique propre. Ajoutant que le réseau des CIDFF encourageait les femmes à la reprise d'activité, elle a néanmoins souligné que l'accès aux crèches était impossible pour les femmes allocataires poursuivant, dans cet objectif, un cursus de formation.
a par ailleurs signalé qu'une grande partie des demandes reçues par les CIDFF étaient liées aux difficultés de recouvrement des pensions alimentaires non versées ou versées irrégulièrement. Précisant que ce problème était fréquemment évoqué, elle a reconnu que l'impossibilité de payer invoquée par le père pouvait parfois justifier une telle situation, mais souligné qu'il s'agissait en réalité souvent de la persistance d'une forme de domination ultime de l'époux sur son ex-femme par le biais du versement irrégulier de la pension. Relevant que, dans un grand nombre de cas, le montant de la pension alimentaire avait été fixé à un niveau inférieur à celui de l'allocation de soutien familial (ASF) qui s'élève à 80,90 € par enfant et par mois, elle a considéré que le montant de la pension alimentaire devrait être au moins égal à celui de l'ASF.
De manière plus générale, elle s'est dite convaincue que notre société vivait un « choc de cultures », dans lequel certains couples se séparaient dans un contexte égalitaire certes tendu, mais gérable, et que d'autres rompaient après avoir vécu dans une configuration traditionnelle. Elle a insisté sur le traumatisme que constitue la rupture pour certaines femmes non préparées à assumer une autonomie financière et une identité propre en dehors de leur vie familiale. Elle a estimé qu'une évolution de la famille vers une configuration plus égalitaire était de nature à limiter les traumatismes en cas de séparation.
a enfin souligné que le réseau des CIDFF était régulièrement confronté à des situations catastrophiques dans lesquelles des résidences alternées sont décidées lors de la rupture de couples, alors même que des faits de violences conjugales sont avérés et perdurent après la séparation. Elle a estimé que le choix de la résidence alternée n'était pas adapté lorsque les causes de la rupture sont relatives à des violences conjugales, insistant sur le fait qu'insulter, frapper, déconsidérer la mère de ses enfants remet fondamentalement en cause la compétence d'un auteur de violence à être un bon parent.
Elle a par ailleurs manifesté son désaccord à l'égard du discours sur le thème des accusations mensongères de violence qui ne seraient destinées qu'à exclure le conjoint de l'autorité parentale en cas de séparation. En effet, elle a fait observer qu'il était plus facile de révéler les violences ou les faits d'inceste à partir du moment où une certaine distance s'était instaurée entre les victimes et l'auteur de violences conjugales ou incestueuses. Insistant sur la nécessité de jeter un regard dépassionné sur ces questions, elle a témoigné du fait que bon nombre de femmes ayant conservé le silence sur des faits graves pendant une longue période sont en mesure de les révéler après la séparation, parce que la pression exercée par l'auteur des faits est moindre.
Après avoir remercié l'intervenante pour son propos, Mme Gisèle Gautier, présidente, a rappelé la récente adoption d'une proposition de loi sanctionnant les violences conjugales et a souligné l'afflux de courriers reçus sur cette question depuis le début du débat sur ce texte au Parlement.
a rappelé que l'expression « famille monoparentale », qui désigne un ménage constitué d'une personne vivant seule et ayant un ou plusieurs enfants à charge, avait été importée, au milieu des années 1970, des pays anglo-saxons, où existaient déjà de nombreux travaux sur les conséquences économiques et psychologiques du divorce, par des sociologues féministes qui souhaitaient, à l'époque, éviter la stigmatisation des foyers dont le chef est une femme et qui avaient pour objectif de faire passer les situations monoparentales du registre de la « déviance » à celui de la simple « variance » et de souligner l'appauvrissement relatif que connaissaient les foyers monoparentaux féminins, ce dont les pouvoirs publics commençaient à prendre conscience. Il a précisé, qu'au même moment, était apparue, dans la législation sociale et familiale, la catégorie de « parent isolé », qui traduit la prise en compte par l'Etat du risque de pauvreté encouru par ces familles : si hier l'on devenait parent seul à la suite du décès du conjoint, c'est désormais, aujourd'hui, principalement en raison de la séparation conjugale.
Il a fait observer que les trois-quarts des familles monoparentales se constituaient en effet à la suite d'une séparation après un mariage ou une union libre, celles fondées suite à une naissance par des femmes qui ne vivaient pas en couple, ou consécutives à un veuvage ne représentant respectivement que 15 % et 11 % de l'ensemble de ces familles. Il a précisé qu'entre les recensements de 1990 et de 1999, l'augmentation des familles monoparentales comprenant au moins un enfant de moins de 25 ans, en France métropolitaine, s'était poursuivie à un rythme relativement élevé, passant de 1,175 million de familles à 1,495 million. Alors que ces familles représentaient 10,2 % de l'ensemble des familles ayant au moins un enfant en 1982 et 13,2 % en 1990, cette proportion, a-t-il ajouté, s'établit désormais à 16,7 %. Il a ainsi noté que la monoparentalité concernait aujourd'hui plus d'une famille avec enfants sur six et qu'un enfant sur sept était élevé dans une famille monoparentale, le plus souvent par sa mère, les foyers monoparentaux masculins ne représentant que 14 % des foyers monoparentaux.
a indiqué que, la séparation constituant désormais très majoritairement le fait générateur de l'entrée en situation monoparentale, les parents seuls étaient aujourd'hui un peu plus jeunes et, plus souvent encore que par le passé, des femmes. Il a précisé que ces foyers monoparentaux féminins résultant d'une séparation ou d'un divorce étaient susceptibles de connaître une certaine vulnérabilité économique, en particulier quand les mères n'avaient aucune qualification professionnelle ou qu'elles se retrouvaient déqualifiées pour s'être trop longtemps tenues à l'écart du marché de l'emploi, du fait notamment de leur implication dans le mariage. Il a fait état de comparaisons effectuées entre foyers monoparentaux et foyers biparentaux ayant au moins un enfant à charge qui avaient effectivement montré que le niveau et les conditions de vie des premiers étaient, dans l'ensemble, moins élevés, et que l'entrée en situation monoparentale se traduisait presque toujours par une baisse, parfois brutale, du niveau de vie. Il a constaté que, dans une société entièrement structurée sur le modèle biparental, l'entrée en situation monoparentale engendrait inéluctablement des difficultés, tout particulièrement quand le parent seul est une femme.
a souligné le facteur de modification du tissu relationnel que constitue la dissolution conjugale, près de la moitié des enfants ne voyant plus ou très peu leur père par la suite. Il a fait observer que l'autorité parentale conjointe était pourtant entrée dans la loi en 1987, puis devenue la norme en 1993, faisant ainsi disparaître la notion de garde qui pouvait laisser entendre que l'appropriation exclusive par l'un des parents était possible. Il s'est interrogé sur le caractère réaliste du principe de coparentalité systématisé par la loi de mars 2002, en dépit de l'intention louable consistant à protéger les relations entre parents et enfants par delà la dissociation conjugale. Il a estimé que, si la coparentalité relevait d'une représentation moderne de la famille et venait satisfaire les militants de la cause paternelle, elle reposait sur l'idée que le couple parental pouvait survivre au couple conjugal et imposait aux parents de négocier, alors qu'ils se sont séparés. Il s'est interrogé sur la promotion d'un modèle unique d'exercice de la parentalité dans un contexte où l'on prend acte de la diversité des familles et de leur culture et a évoqué le risque de faire violence aux parents et de se détourner un peu plus de ce que l'on souhaite pourtant préserver, l'intérêt de l'enfant.
a également expliqué que, en même temps que le conjoint et sa famille, les relations amicales du parent seul s'estompaient aussi parfois, voire disparaissaient, et que le degré d'insertion sociale au sein d'un réseau d'entraide s'affaiblissait et n'était plus, de ce fait, toujours en mesure de compenser la vulnérabilité économique. Or, il a fait observer que le soutien relationnel dont bénéficient les parents gardiens au moment de la rupture, ou par la suite, variait en fonction du milieu social, les mieux positionnés socialement étant aussi ceux qui ont le plus de chances de maintenir leur réseau relationnel et d'obtenir de l'aide de leur entourage.
Il a estimé que, si la dissociation familiale ne précipitait pas tous les parents seuls dans la vulnérabilité économique et relationnelle, la désunion apparaissait néanmoins, notamment pour les moins bien dotés, comme un des nouveaux risques familiaux, d'autant plus qu'il n'était pas certain que, même dans les milieux les mieux pourvus, la séparation parentale n'ait aucune incidence. Il a ainsi cité des travaux qui montrent que, quel que soit le milieu social, la rupture du couple parental est associée à une réussite scolaire plus faible chez l'enfant.
Abordant la question des familles recomposées, M. Didier Le Gall a rappelé les problèmes juridiques, psychologiques ou encore pratiques que connaissent ces familles issues d'une ou de deux unions fécondes défaites, au niveau de leur fonctionnement quotidien. Il a indiqué qu'entre 1990 et 1999, le nombre des familles recomposées s'était accru de près de 10 %, passant de 646 000 en 1990 à 708 000 en 1999, soit 8 % des familles ayant au moins un enfant de moins de 25 ans. Il a ainsi précisé qu'aujourd'hui 1,1 million d'enfants de moins de 25 ans vivaient avec l'un de leurs parents et un beau-parent - 63 % avec leur mère et son nouveau compagnon, et 37 % avec leur père et sa nouvelle compagne - alors que 513 000 vivaient avec leurs deux parents et des demi-frères ou soeurs et que 1,6 million d'enfants de moins de 25 ans étaient ainsi concernés par la recomposition familiale.
Il a rappelé que, si vivre avec un beau-parent n'était pas nouveau, dans le passé ces situations étaient issues du veuvage, alors qu'elles résultaient aujourd'hui de la séparation conjugale : or, à la différence du veuvage où le beau-parent vient, d'une certaine manière, occuper une place « vacante », la désunion fait de celui-ci un acteur supplémentaire du contexte familial. Il a ainsi expliqué que le rôle du beau-parent ne pouvait, dès lors, se jouer exclusivement sur le mode de la substitution. Il a fait observer que la recomposition de la famille à la suite d'une désunion, avec enfant(s) de la précédente union, nécessitait de revoir l'organisation familiale selon des modèles inédits de comportement, notamment en ce qui concerne les devoirs et obligations des acteurs, et que, dans une société où le modèle nucléaire reste la référence, ces familles ne disposaient pas de modèles de conduite préétablis pour gérer leur spécificité, y compris dans le cadre du remariage.
Il a mis en évidence le relatif silence du code civil au sujet des familles recomposées, tout particulièrement pour ce qui concerne la prise en compte des liens entre beau-parent et beaux-enfants. Il a également constaté qu'au niveau du langage courant, ces acteurs ne disposaient pas de vocables adéquats pour s'interpeller, les termes « parâtre » et « marâtre », étymologiquement appropriés pour le nouveau conjoint du parent gardien, étant tombés en désuétude en raison des représentations négatives liées aux remariages après veuvage. Reprenant à son compte les analyses d'Irène Théry, il a noté que la marâtre était représentée comme ne pouvant posséder l'instinct maternel, mais que le parâtre était, en revanche, un peu moins stigmatisé car sa venue contribuait souvent à re-stabiliser économiquement le foyer de la mère seule.
Par ailleurs, M. Didier Le Gall a fait observer que, à la suite du divorce, c'étaient majoritairement les femmes qui vivaient avec des enfants, mais que celles-ci reformaient moins fréquemment un couple, un homme ayant 23 % de chances de plus qu'une femme de revivre en couple, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il en a déduit que l'enfant du divorce avait, de ce fait, plus de chances d'être confronté à une recomposition familiale du côté de son père que de sa mère et a indiqué que les enfants de « premier lit » ont plus fréquemment une « belle-mère par intermittence » qu'un « beau-père au quotidien ». Or, il a constaté que ces foyers comprenant une « belle-mère par intermittence », bien que statistiquement plus nombreux, étaient moins « visibles » que les autres familles recomposées.
Il a indiqué que s'était posée avec acuité la question de savoir s'il fallait ou non offrir aux familles recomposées un cadre juridique adapté à leur situation, le principal point portant, à partir du début des années 1990, sur la reconnaissance éventuelle d'un « statut de beau-parent ». Il a considéré que le problème du partage de l'autorité parentale entre parents et beaux-parents paraissait délicat à trancher, les parents séparés assumant conjointement l'exercice de l'autorité parentale, d'autant plus que l'hétérogénéité des secondes unions rendait vaine toute recherche a priori d'un cadre juridique adapté, la majorité des recompositions familiales après divorce ayant d'ailleurs pour cadre une cohabitation, et non un remariage.
a fait observer que, du fait de l'augmentation du nombre des familles recomposées, le rôle de beau-parent avait gagné en visibilité et que, en dehors de tout encadrement juridique, il tendait aujourd'hui à s'instituer sous la forme d'un lien électif pouvant s'apparenter à un « amical parrainage », c'est-à-dire un lien social, certes inédit, mais qui semble s'ériger comme référence dès lors que le beau-parent a un rôle éducatif qui ne concurrence pas les fonctions dévolues à la parenté en ce domaine. Il a néanmoins constaté que ce rôle « quasi parental » n'advenait et ne s'imposait en tant que tel qu'au terme d'une co-résidence prolongée.
Il a estimé qu'aujourd'hui, la question de la reconnaissance du beau-parent s'inscrivait dans un cadre plus large, celui de la pluriparentalité, car les familles recomposées n'étaient pas les seules à ajouter des « parents sociaux » aux « parents par le sang », et a constaté que des relations parentales avec des enfants dont les parents ne sont pas les géniteurs étaient à l'oeuvre dans un nombre croissant de familles.
a fait observer que, si l'élection affective avait de plus en plus droit de cité dans la parenté aujourd'hui, notre système de filiation n'était guère enclin à reconnaître ces coparentalités, en raison de la prégnance de la norme de l'exclusivité de la filiation. Il s'est dès lors interrogé sur le rôle des parents « en plus », surtout lorsque ceux-ci jouent à l'évidence un rôle actif auprès des enfants. Il a cité le récent rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits de l'enfant qui suggère que les parents aient « la possibilité de donner à un tiers (dont le beau-parent) une « délégation de responsabilité parentale » pour les actes usuels de la vie de l'enfant, soit par acte authentique devant notaire et directement exécutoire, soit par acte sous seing privé homologué par le juge ». Il a estimé que cette proposition permettrait certes de faciliter au quotidien la vie de ces familles et constituerait une petite ouverture allant dans le sens d'une reconnaissance du rôle de beau-parent et, au-delà, de la pluriparentalité, mais a fait observer que l'accord des deux parents serait requis et a craint que ceux qui pourraient en avoir le plus besoin ne puissent s'entendre pour en bénéficier et que ceux qui auto-régulent déjà leurs rapports n'en voient pas l'intérêt.
a estimé qu'en matière de droit de la famille, il était parfois préférable de s'en tenir au statu quo plutôt que d'engager des réformes irréfléchies, faisant observer que les attentes exprimées dans ce domaine l'étaient parfois par des groupes minoritaires, ou sur le mode du non-dit. Elle a ainsi pris l'exemple de la reconnaissance éventuelle d'un « statut du beau-parent » et a considéré que les problèmes pratiques qu'une telle reconnaissance permettrait de résoudre étaient en fait réduits et qu'il convenait de s'interroger sur l'opportunité de confier au beau-parent l'exercice de l'autorité parentale, car les raisons de son manque d'autorité à l'égard de l'enfant de son nouveau conjoint sont en partie objectives. Elle a estimé que l'autorité du beau-père n'était jamais qu'une délégation de celle de la mère et qu'investir le beau-père de l'autorité parentale nécessiterait l'accord des deux parents biologiques, alors que ceux-ci sont précisément dans une situation de désaccord tel qu'il a bien souvent été la cause de la séparation. Elle a noté que l'autorité parentale s'exerçant à deux, les propositions visant à instituer un statut du beau-parent n'ont pour l'instant pas eu de succès, par exemple le parrainage, en 1998, ou la délégation de l'autorité parentale, en 1999.
Elle a expliqué ces échecs successifs par l'existence d'une ambiguïté sur les objectifs poursuivis, l'institution du statut du beau-parent nécessitant, selon elle, l'existence d'un lien de droit au sein du couple, tel que le mariage. Or, elle a fait remarquer que le beau-parent qui vient habiter au domicile du parent devait être accepté par l'enfant, alors qu'en fait celui-ci le considère souvent comme un intrus, parfois pendant très longtemps. Elle a d'ailleurs indiqué que les enfants vivant au sein d'une famille recomposée quittaient le foyer familial plus tôt que les autres.
S'agissant de la proposition parfois formulée d'un mandat donné au beau-parent lorsque le parent doit s'absenter et lui laisser la garde de son enfant, elle a estimé qu'il nécessiterait un document institutionnalisé, par exemple un acte souscrit devant notaire, ou devant les services de l'état-civil. Elle a ajouté que l'éventualité de la délégation par un parent de son autorité parentale au profit d'un beau-parent nécessitait une décision de justice.
a fait observer que le juge était souvent obligé de décider en fonction de stéréotypes, alors qu'il était appelé à se prononcer, sans avoir reçu de formation appropriée, sur « l'intérêt de l'enfant », qui n'est pas une question de droit, mais de fait. Rappelant que le père avait très longtemps exercé la puissance paternelle alors que la mère assurait en fait la garde de l'enfant, elle a indiqué les grandes étapes du droit du divorce et du régime de garde des enfants : réforme du divorce en 1975, premier arrêt de la Cour de cassation sur la garde alternée en 1983, reconnaissance de la coparentalité en 1993, loi de mars 2002 autorisant la résidence alternée. Estimant que celle-ci était une « fausse bonne idée » et qu'elle ne pouvait constituer une solution généralisable, elle a rappelé que, lors des débats parlementaires, il avait même été envisagé de rendre obligatoire la résidence alternée, cette proposition ayant notamment pour origine, d'après elle, l'influence du lobby des pères.
Elle a considéré que la résidence alternée illustrait le paradigme, selon elle erroné, de la possibilité d'une séparation des parents qui n'aurait pas de conséquences défavorables pour les enfants, alors qu'il s'agit toujours d'une situation très délicate à gérer. De ce point de vue, elle a souhaité une plus grande lucidité et estimé qu'il fallait avoir le courage de dire qu'il est parfois plus satisfaisant pour un enfant de rester avec un seul parent.
a également dénoncé un autre paradigme consistant à supposer que la séparation d'un couple permettrait à chacun de reprendre son autonomie, alors qu'il existe des femmes qui sont économiquement dépendantes de leur conjoint et pour lesquelles le divorce est lourd de conséquences. Elle a estimé que la société contribuait à entretenir ces situations sous différentes formes, citant le congé parental, qui peut devenir, selon elle, une mesure dangereuse dès lors que la séparation du couple est juridiquement aisée, ainsi que le projet, parfois évoqué, de congé filial qui permettrait à des personnes, en fait essentiellement à des femmes, de s'occuper de leur(s) parent(s) âgé(s). Elle s'est dès lors interrogée sur la portée effective de l'autonomie des femmes. Elle a conclu en appelant de ses voeux une démarche faisant davantage de place au réalisme et moins à l'idéologie.
Un débat général s'est ensuite instauré.
a fait observer que de grandes difficultés pour les enfants pouvaient également apparaître à l'occasion d'une garde exercée par un seul parent, et non seulement au cours d'une résidence alternée. Estimant qu'un mauvais mari pouvait quand même être un bon père, il a insisté sur le droit de ce dernier à voir ses enfants vivant avec leur mère, dans l'intérêt même de ceux-ci.
En réponse à une interrogation portant sur le rôle social de la mère, M. Didier Le Gall a estimé qu'il existait une sorte de consensus social, manifestant la domination masculine, selon lequel une mère de famille devait avant tout demeurer une mère, plutôt que de continuer à exister en tant que femme.
a ajouté que la manière dont les enfants voient vivre leur mère influe sur la façon dont les futures femmes vont vivre leur vie adulte.

a dit partager les différents points de vue exprimés sur la résidence alternée, qui constitue une solution intéressante mais qui ne peut être généralisée et demande une appréciation par le juge au cas par cas. Elle a fait observer que la paupérisation des femmes se retrouvant seules était accentuée par les inégalités professionnelles existant sur le marché du travail. Considérant que l'intérêt de l'enfant devait toujours être privilégié, elle a jugé que l'enfant ne devait en principe pas être séparé de son père, même s'il convenait naturellement de prendre en considération un contexte de violences au sein du couple. Enfin, elle a appelé de ses voeux une évolution de la société qui prenne mieux en compte la progression du nombre de familles monoparentales et recomposées, les femmes élevant seules leurs enfants étant encore trop souvent stigmatisées.
a considéré qu'un homme violent démontrait son incompétence à exercer son autorité de père et qu'un enfant ne pouvait être confié qu'à un parent compétent pour s'en occuper.
a réaffirmé qu'il n'était pas question d'exclure le père de l'éducation de son enfant. Elle a approuvé l'autorisation de la résidence alternée par la loi de mars 2002, mais elle a fait remarquer que les enfants pouvaient mal supporter une résidence alternée, même bien organisée. Elle a par ailleurs estimé que les mères dont les enfants ne vont pas bien ne cherchaient pas à refaire leur vie, dans la mesure où elles ne se sentaient pas disponibles pour le faire.

a estimé que le développement de la précarité constituait un obstacle à l'épanouissement des couples. Elle a déclaré avoir apprécié les propos tenus sur la résidence alternée, et a noté que le juge ne devrait jamais prendre parti pour le père ou la mère, d'autant plus que la plupart des enfants n'acceptaient jamais la séparation de leurs parents. Elle a constaté la difficulté pour le juge de se prononcer sur le bien-fondé d'une résidence alternée et s'est demandé si une telle décision ne devrait pas être prise par deux juges. Enfin, elle a considéré que les femmes qui prennent des responsabilités le faisaient généralement pour leurs enfants.

après avoir salué la qualité de l'ensemble des interventions, a estimé préférable de parler de complémentarité, plutôt que de stricte égalité, entre homme et femme. Elle a considéré qu'un couple était une relation contractuelle engageant l'honneur de ses membres, et non la réunion de deux égoïsmes. Elle a conclu sur la responsabilité des parents, que les procédés de contrôle des naissances rendent encore plus grande aujourd'hui.