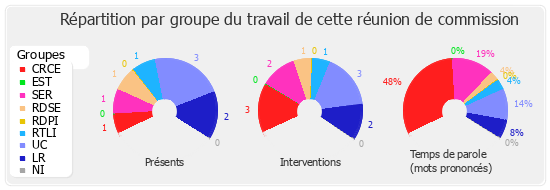Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Réunion du 8 février 2012 : 2ème réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission procède à la nomination d'un rapporteur sur le projet de loi relatif à la majoration des droits à construire.
Thierry Repentin est désigné rapporteur.
Puis la commission entend Mme Isabelle de Kerviler, membre du Conseil économique, social et environnemental, sur son rapport : « La compétitivité : enjeu d'un nouveau modèle de développement ».

Nous sommes réunis ce matin pour entendre Mme Isabelle de Kerviler, rapporteure pour le Conseil économique, social et environnemental d'un avis intitulé « La compétitivité : enjeu d'un nouveau modèle de développement ». Cette audition illustre tout l'intérêt que nous avons à renforcer nos liens avec le CESE.
Ce rapport résulte d'une saisine du Premier ministre, qui vous a demandé d'expliquer la perte de compétitivité de notre économie, en particulier par rapport à l'Allemagne, et de proposer des pistes de « rattrapage ».
Pour lui répondre, vous avez commencé par définir la compétitivité, ce qui n'est pas rien. Un mot sur cette définition : vous avouerez que nous sommes loin d'une vision comptable, ou réduite au simple coût horaire du travail - qui passe trop souvent pour l'alpha et l'omega de toute politique de compétitivité.
Dans la partie constat de votre rapport, après avoir identifié les nombreux facteurs de la compétitivité d'une économie, vous soulignez des chiffres chocs, de ceux qui sont faits, pour faire prendre conscience de l'ampleur du problème à traiter. Je vous invite à nous exposer succinctement ce constat, à la suite duquel nous pourrons laisser place à l'échange avant que vous nous exposiez les priorités de votre partie « propositions ».
Je vous remercie tout d'abord pour votre invitation ; je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, l'avis que je viens vous présenter résulte d'une saisine du Premier ministre du 30 mars 2011 qui nous a demandé d'identifier les principaux facteurs à l'origine de l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne - mais pas seulement avec ce pays.
Cet avis a été adopté à l'unanimité des partenaires sociaux : c'était très loin d'être gagné d'avance, je tiens à le souligner, ayant été moi-même surprise du résultat auquel nous sommes parvenus.
Nous avons consacré trois séances de travail initiales à la définition même de la compétitivité. Nous avons repris celle qu'en donne l'Union européenne : « la capacité d'une nation à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale dans un environnement de qualité ». La compétitivité n'est donc pas une fin mais plutôt un moyen. Le coût du travail n'en n'est pas le facteur déterminant, mais un facteur parmi d'autres. On distingue en effet les facteurs « coût » - les facteurs de production et le taux de change - et les facteurs dits « hors prix », c'est-à-dire la qualité des produits, les savoir-faire professionnels, la force de vente et le service après-vente, l'effort de recherche et d'innovation, l'organisation du travail et le dialogue social, la formation continue, les financements à des taux acceptables et, enfin, les politiques publiques favorables, en matière d'infrastructures et de services publics principalement. On voit bien combien la compétitivité résulte de nombreux facteurs, où le coût du travail n'occupe pas même la place déterminante.
Nous avons ensuite comparé le poids de la France et de l'Allemagne dans le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro : l'Allemagne en représente 27 % et la France 21 %, soit, à elles deux, quasiment la moitié. La France est devenue le troisième fournisseur de l'Allemagne, derrière la Chine - en 2005 - et les Pays-Bas - en 2009 -, et son premier client ; quant à l'Allemagne, elle est le premier fournisseur et le premier client de la France.
Nous avons travaillé sur la zone euro pour annuler l'incidence des taux de change. Entre 1999 et 2009, la France a perdu 4 points de parts de marché à l'export dans la zone euro, en passant de 17,7 % à 13,5 % ; l'Allemagne, elle, a gagné 2,6 points, pour atteindre 32,2 %.
Le poids respectif de l'industrie dans ces deux pays explique en bonne partie ce hiatus, sachant que l'industrie représente 80 % des exportations et 85 % de la recherche et développement privée. Or, en 2008, l'industrie représentait 26 % de la valeur ajoutée en Allemagne, contre 14 % en France.
« La France n'aime pas son industrie », a dit Georges Pompidou : cette désaffection n'est donc pas nouvelle. Lors de nos auditions, cette anecdote nous a été citée : en Allemagne, les parents conduisent leurs enfants à la foire de Hanovre pendant les vacances, pour y admirer les réussites industrielles du pays ; en France, on les emmène à la foire de Paris, pour ses jeux et victuailles.
La France a perdu son avantage compétitif sur le coût horaire du travail : en 2000, il était d'environ 10 % sur l'Allemagne ; les courbes se sont croisées en 2008 et les coûts sont aujourd'hui très proches de part et d'autre du Rhin. En Allemagne, les salariés de l'industrie sont mieux rémunérés que ceux du secteur de la finance : c'est ce qui explique que les ingénieurs restent dans le secteur de l'industrie ! Dans les comparaisons avec l'Allemagne, il faut cependant prendre en compte la productivité par personne occupée, où nous sommes en tête : en 2010, elle est 20 % plus élevée en France que dans la moyenne de l'Union européenne, mais seulement 5 % plus élevée en Allemagne.
J'en viens maintenant aux forces et aux faiblesses de l'économie française. La première force de la France est sa position géographique centrale. Le deuxième atout important, ce sont les perspectives démographiques. L'Allemagne est le pays le plus peuplé, avec 82 millions d'habitants en 2010 contre 65 millions en France. Mais le taux de fécondité est chez nous de 1,98 contre 1,36 en Allemagne. En 2050, en prolongeant les courbes, la France compterait 71 millions d'habitants et l'Allemagne 74 millions, puis la France passerait devant l'Allemagne à compter de 2055, avec une population plus jeune.
Autre point important, si le taux de prélèvements obligatoires est important en France, c'est aussi en raison du niveau élevé de la protection sociale. L'OCDE évalue les prélèvements sociaux à 43 % du PIB en France, contre 36 % en Allemagne ; cependant, la Cour des comptes a ajouté trois points de prélèvement pour l'Allemagne, en y incluant les cotisations des employeurs qui relèvent du système privé. Dès lors, ce que les spécialistes nomment le « coin socio-fiscal » est très proche de part et d'autre du Rhin : un célibataire au salaire moyen et sans enfant se voit prélever 49,2 % de son revenu brut en France et 50,9 % en Allemagne.
Parmi les faiblesses de l'économie française, notre avis souligne le faible nombre d'entreprises de taille intermédiaire (ETI), c'est-à-dire occupant entre 250 et 5 000 salariés : la France en compte 4 500 contre 10 000 en Allemagne. Pourquoi est-ce une faiblesse ? Parce que ces entreprises sont très fortes à l'exportation et en matière d'innovation. Je salue le rapport que M. Bruno Retailleau a réalisé l'an passé sur ce sujet : ce travail est tout à fait remarquable. Autre indicateur : la France compte quasiment quatre fois moins d'entreprises exportatrices que l'Allemagne : 92 000, contre 364 000.
De même, l'Allemagne est passée devant nous pour l'effort en matière de recherche et développement, public et privé confondus : en 1995, la France était légèrement au-dessus de l'Allemagne, en y consacrant 2,3 % du PIB ; les courbes se sont croisées en 1997 ; aujourd'hui, l'Allemagne y consacre 2,65 % et la France, 2,10 %. Ensuite, alors qu'en France, cet effort est réparti pour moitié entre la recherche publique et la recherche privée, en Allemagne la recherche privée représente 68 % des dépenses, ce qui est une source plus abondante pour le dépôt de brevets : et chaque année trois fois plus de brevets sont déposés en Allemagne qu'en France. Or, lorsque la main d'oeuvre coûte cher, c'est bien par l'innovation qu'on peut monter en gamme et gagner en exportations.
Enfin, le taux de marge des entreprises françaises est stable depuis 1985, alors qu'en Allemagne le poids des salaires dans la valeur ajoutée a baissé de cinq points depuis 2003, avec la réforme, par les lois Hartz, de l'indemnisation du chômage et des procédures d'embauche.
Tous ces chiffres font de l'Allemagne une référence en matière d'industrie et d'exportation, ce qui ne signifie pas qu'elle doive être notre modèle. Notre histoire diffère de celle de nos voisins, nous n'avons pas suivi la même voie - c'est évident pour la formation de l'État et en matière de décentralisation. Dans ces conditions, la comparaison est utile, dans le sens du benchmarking, mais il faut être prudent et il ne s'agit en aucun cas de copier un modèle qui ne serait de toute façon pas transposable.
J'ai également souligné dans mon rapport que les entreprises, en France, distribuent davantage de dividendes que la moyenne européenne : l'excédent brut d'exploitation, d'environ 38 %, se répartit entre 25 % de dividendes et 13 % de réserve. Nous y avons vu matière à proposition, pour inciter les entreprises à mettre davantage de leur excédent en réserve, j'y reviendrai. Cependant, il faut creuser la question du rapport entre les intérêts et les dividendes.
Pour résumer, le poids de l'industrie en France et en Allemagne varie du simple au double, ce qui explique une plus forte différence à l'export, avec quatre fois plus d'entreprises exportatrices en Allemagne. Ensuite, la recherche privée est moins importante en France qu'en Allemagne. Je suis cependant optimiste en considérant les atouts de la France : sa position géographique centrale, sa démographie et sa main d'oeuvre de qualité.

Vous indiquez que la productivité du Luxembourg serait deux fois supérieure à celle de l'Allemagne : comment l'expliquez-vous ? Je m'interroge ensuite sur les projections relatives au taux de fécondité en 2050 : comment raisonner avec de tels chiffres, qui impliquent le maintien de comportements actuels ?
Les démographes raisonnent souvent à horizon de 20 ou 30 ans. Les chiffres que j'ai cités sont des projections de la Commission européenne et de l'ONU : ils montrent que la France rattrapera l'Allemagne en termes de population entre 2055 et 2060.

Je comprends bien qu'il s'agit de projections. Pour autant, je m'interroge sur la prise en compte de l'évolution potentielle du comportement des Français et des Allemands.
S'agissant du comportement, il existe une contradiction entre le pessimisme des Français et leur comportement dans la vie courante, marqué par un taux de fécondité élevé, qui traduit une certaine confiance en l'avenir.

Il me semble que ces projections reposent sur le maintien des éléments actuels : la France a une politique nataliste alors que l'Allemagne n'en a pas - et il est probable que nos résultats démographiques deviendraient moins bons si par malheur nous renoncions à notre politique familiale.
L'Allemagne commence à s'inspirer de notre politique nataliste. Cependant, il est encore mal vu pour une femme outre-Rhin d'avoir des enfants et de continuer à travailler à temps plein...

Votre rapport met les pendules à l'heure sur la question de la compétitivité et vous appelez avec raison à un ensemble cohérent de mesures. Vous n'éludez pas la problématique du coût du travail, mais vous la mettez à sa juste place. Vous évoquez des questions essentielles, comme celle des ETI : il me semble que les mauvaises relations entre les entreprises industrielles et leurs sous-traitants expliquent le manque d'ETI dans notre pays. Sur la recherche et développement, je signale que si nous y consacrons globalement 2 % de notre PIB, la Corée est à 5 % et veut passer à 8 %... Il est essentiel de se doter d'une politique globale cohérente en matière de compétitivité.

Vous avez cité le Président Pompidou qui disait que « la France n'aime pas son industrie ». Cette désaffection, difficilement mesurable, a un impact majeur sur la situation de notre industrie : il y a, à mes yeux, beaucoup à faire en matière d'éducation.

Nos exportations chutent, avez-vous examiné la situation par filière ? Il y a bien sûr des explications générales, mais compte également une forme de réticence à s'engager sur certains créneaux - les Allemands, eux, savent parfaitement faire et nous vendre des casseroles -, et cette réticence a partie liée avec une forme d'élitisme consistant à trouver que telle industrie vaut mieux qu'une autre. N'y a-t-il pas des positions que nous pourrions reconquérir ?
La recherche publique a un poids important en France, c'est une tradition qui remonte à Philippe-le-Bel. Vous soulignez un certain recul de la recherche en France, par comparaison avec nos voisins allemands : n'est-ce pas la conséquence de ce qu'on a retiré des moyens à la recherche publique en escomptant un relais de la recherche privée que celle-ci n'a pas pris ? Enfin, le rôle des entreprises publiques est à considérer : je serais curieuse de connaître les conséquences des privatisations sur la compétitivité de notre économie...

Quelle est la contribution de l'Allemagne à notre déficit commercial ? Avez-vous étudié les évolutions en matière agricole où le potentiel français est important même en matière de pêche ? Aujourd'hui l'Allemagne nous fournit du lait et de la viande porcine, à l'inverse de ce qui se passait il y a une vingtaine d'années !

Je crois, comme Daniel Dubois, que l'éducation et la formation sont primordiales pour changer l'idée que les Français ont de l'industrie et des métiers techniques. Ensuite, je partage vos propos sur l'importance de la transversalité en matière de recherche et de développement. Notre vision, nos actions doivent aller au-delà des cloisonnements par filière : quel est, de ce point de vue, l'apport des pôles de compétitivité ? Qu'en est-il également des pôles d'excellence rurale ? Enfin, si l'Allemagne est souvent prise comme modèle, je vous rappelle que les Allemands continuent à dire, quand ils visitent notre pays : « Heureux comme Dieu en France » !

En Allemagne, l'ensemble des acteurs ont l'habitude de travailler ensemble. Ce n'est pas le cas en France où les grandes entreprises n'entraînent pas les plus petites à l'exportation. Est-ce, à vos yeux, inéluctable ?

Vous nous dites que 85 % des exportations sont industrielles. Ce pourcentage vous paraît-il devoir rester stable ? Ou peut-on imaginer que cette proportion diminue au profit des biens immatériels - évolution qu'il nous faudrait alors anticiper ?

Il existe une autre différence entre l'Allemagne et la France : l'alternance, que le système éducatif allemand valorise beaucoup plus que le nôtre...

Les entreprises industrielles de ma région, dans beaucoup de secteurs, ne trouvent pas les salariés formés dont elles ont besoin. Il n'y a pas de vision transversale mais plutôt un fonctionnement en « tuyaux d'orgue ». Les ETI allemandes sont capables de travailler à l'export et d'innover. Est-ce que les pôles de compétitivité et les clusters pourraient structurer nos réseaux de PME pour atteindre la masse critique ?
Quelques réponses rapides. Sur les filières, nous constatons un recul généralisé de nos positions, y compris dans les secteurs où nous étions traditionnellement forts, comme l'automobile. Notre balance commerciale est devenue déficitaire en 2005 ; celle de l'Allemagne n'a pas connu de déficit depuis 1952. Sur la richesse de la mer, oui, je crois que nous avons là d'un formidable atout et il ne tient qu'à nous de nous en servir. La France dispose de la deuxième zone maritime exclusive du monde, derrière les Etats-Unis : nous devons transformer cet atout en avantage comparatif, mettre en valeur notre domaine maritime, comme l'ont fait les Pays-Bas !
Je crois, comme vous, en la transversalité, parce que l'innovation se produit toujours aux frontières des disciplines. Or, l'enseignement, en France, est encore bien trop cloisonné ! Des expériences très intéressantes sont menées, cependant : à Nancy, des équipes de designers et d'ingénieurs ont travaillé dans un même ensemble, ils y ont tous trouvé des avantages. Je crois, également, que les grandes entreprises, avec leurs sous-traitants, doivent passer à des relations de co-traitance : les grandes entreprises ont une responsabilité sociétale en la matière, elles sont les locomotives et c'est à elles qu'il revient de partager l'activité avec les PME et les ETI.
Quelle place l'industrie prendra-t-elle demain dans les exportations ? C'est une très bonne question, sur laquelle nous devons travailler davantage, car, effectivement, rien ne dit que la part constatée aujourd'hui sera stable dans le temps.
Quant aux pôles de compétitivité, ils sont déjà transversaux, mais cela n'est pas incompatible avec les politiques de filières puisque nous avons des champions dans toutes les filières d'avenir : c'est vrai dans les transports, dans l'agroalimentaire, dans l'aérien. Nous devons apprendre à mieux travailler ensemble, un peu comme les Italiens, qui sont allés très loin dans le développement de clusters.

L'innovation trouve effectivement sa source dans la transversalité, les technopôles ont un rôle important à jouer. Les découvertes, cependant, sont d'une autre nature, qui a davantage trait à la transgression.
La transgression, c'est un point fort des Français... J'en viens à la partie « propositions », dont je signale d'emblée qu'elles ont été considérablement enrichies par le travail de la section de l'Environnement du Conseil économique, social et environnemental, pour une meilleure prise en compte de l'environnement.
Premier ensemble de propositions : définir des objectifs de long terme.
La croissance, d'abord, ne saurait être durable sans intégrer les enjeux environnementaux, c'est-à-dire sans économiser les ressources naturelles. Nous devons changer nos comportements, valoriser ce que les spécialistes appellent l'éco-fonctionnalité, c'est-à-dire la primauté de l'usage sur la propriété - par exemple la location automobile : il faut savoir qu'à Paris, une voiture est utilisée à peine 5 % de son temps disponible - et nous devons également valoriser l'éco-conception, c'est-à-dire la prise en compte du recyclage dès la conception du produit - on pourrait économiser jusqu'à 40 % de ressources naturelles, c'est considérable.
Nous proposons, ensuite, de conforter l'État-stratège et la réindustrialisation de notre territoire. La France, c'est sa tradition, confère un rôle important à l'État dans le développement de son économie ; nous souhaitons que l'État continue à jouer un rôle important, en déterminant et en protégeant des secteurs stratégiques. M. Jean-Louis Levet a eu cette formule que je vous propose de retenir : plutôt qu'une politique en faveur de l'industrie, mieux vaut un développement économique par l'industrie, ce qui implique des choix de stratégie, donc accepter qu'il y ait des gagnants, mais aussi des perdants. L'État-stratège peut jouer un rôle essentiel, également, dans la coordination des initiatives. J'ajoute que la dimension locale doit être pleinement prise en compte : les contrats de projets État-régions mobilisent 37 milliards d'euros, c'est davantage que le grand emprunt.
Une politique industrielle ambitieuse, enfin, doit être définie à l'échelon européen : la politique de concurrence ne doit pas être un dogme ! Lors de son audition, M. Denis Ranque a souligné qu'avec les règles que nous connaissons aujourd'hui, il serait probablement impossible de créer EADS : cela donne à réfléchir... Or, nos grands concurrents que sont les États-Unis et le Japon - sans parler de la Chine - n'hésitent pas, eux, à protéger leurs secteurs stratégiques, en particulier le numérique, les biosciences, les industries de la santé, du transport des matériaux, ou encore les nouvelles technologies « propres ». L'Union européenne doit, elle aussi, protéger ces secteurs stratégiques !
Deuxième ensemble de propositions : améliorer l'environnement des entreprises.
Nous proposons, d'abord, de réformer le financement des entreprises, en renforçant Oséo, en lançant un grand emprunt pour financer l'industrie, et en modulant le taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de la redistribution du résultat. J'insiste sur ce dernier point : le résultat qui est mis en réserve au lieu d'être distribué en dividendes entretient la trésorerie et, en augmentant les fonds propres, augmente la capacité d'emprunt des entreprises. La modulation du taux de l'impôt est donc un puissant levier de financement de nos entreprises.
Nous proposons, ensuite, d'investir dans nos infrastructures, en liaison avec les territoires : la position géographique de la France est un atout, à condition que nos territoires soient accessibles : il nous appartient de valoriser cet atout, ou bien il perdra sa valeur.
Nous suggérons, enfin, de faire évoluer le financement de notre protection sociale, à laquelle nous sommes très attachés. Nous sommes allés assez loin dans la recherche de nouvelles pistes de financement, en évoquant en particulier la CSG, une « TVA sociale », une cotisation sur la valeur ajoutée ou encore une taxation des échanges financiers.
Troisième série de propositions : valoriser le potentiel humain.
Il faut renforcer l'attractivité des métiers scientifiques et techniques, moteurs de l'innovation. Cela passe par un décloisonnement des métiers, des formations et des carrières, autant que par un effort de rémunération : en Allemagne, les carrières industrielles sont mieux rémunérées que les carrières financières, aux différents échelons. Je suis également favorable à des mesures plus symboliques mais qui ont toutes leur importance, comme l'accueil par les entreprises de classes scolaires dès le collège.
Nous soulignons également le rôle essentiel de l'apprentissage et de la formation continue. En France, les métiers techniques sont trop souvent choisis par défaut, même si la crise a peut-être un peu changé la donne : les élèves se disent davantage qu'avec un IUT et un BTS, ils trouveront plus facilement du travail qu'avec une formation générale. La formation continue est encore un facteur essentiel : elle doit être vivante, pour toutes les catégories de salariés.
Nous posons encore des jalons du côté de la gouvernance des entreprises, ce qui n'est pas allé sans grincements. A l'évidence, l'organisation allemande, où les salariés participent plus directement à la gouvernance des entreprises, a des avantages pour la production elle-même, pour l'adaptation des produits au marché. En France, nous avons beaucoup à faire pour intégrer le bottom-up, mieux associer les salariés aux décisions de l'entreprise - nous préparons un avis du CESE sur la question.
Enfin, nous nous sommes interrogés - le point d'interrogation était la condition de l'unanimité - sur un nouveau partage de la valeur ajoutée, qui est stable depuis vingt-cinq ans.
Quatrième série de propositions : dynamiser l'appareil de production. Il s'agit de consolider le tissu économique, en soutenant les ETI et en incitant les grandes entreprises à entretenir des relations de co-traitance avec les PME. Il s'agit encore de soutenir de nouvelles spécialisations - les technologies de l'information, la filière « verte », les services à la personne, la santé, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables maritimes, les exportations de services. Enfin, nous proposons de renforcer la recherche et développement, en encourageant les mécanismes d'interface comme les instituts Carnot, mais aussi les pôles de compétitivité à vocation mondiale. A propos du crédit d'impôt recherche, M. Denis Ranque a attiré notre attention sur un risque de recentrage de cet impôt sur les PME : attention à ce que des grandes entreprises ne délocalisent pas leurs centres de recherche ! Enfin, j'ajoute que la promotion de la recherche passe par de meilleures rémunérations des chercheurs !
Pour conclure, je dirai que la compétitivité, c'est l'affaire de tous. J'ai proposé l'organisation d'un Grenelle de la compétitivité, je n'ai pas été suivie, hélas, mais je vous en confie l'idée. Dans ce rapport, nous avons souligné que la compétitivité ne relevait pas d'une mesure miracle, mais d'un ensemble de réformes, cohérentes à long terme, qui visent en particulier à réindustrialiser nos territoires : le rapport que j'ai eu l'honneur de vous présenter n'est que le début d'une longue démarche pour la réindustrialisation de nos territoires !

Il me semble que votre avis n'aborde pas suffisamment la question de la coopération entre les différents acteurs à l'échelon du territoire - comme cela se fait en Italie avec les districts, ou encore en Allemagne, où ce sont les Länder qui ont la main. Il faut encourager la « clusturisation » des territoires !

J'espère que cet avis du Conseil sera suivi d'effets. La désaffection de notre pays pour son industrie est ancienne et elle a été entretenue par un discours officiel où l'on n'a cessé de parer le tertiaire de toutes les vertus ! Je le sais bien, pour avoir été élève à l'ENS filière enseignement technique et je discute avec les élèves d'aujourd'hui : ils pensent tous que l'industrie en France, c'est bientôt fini ! Le premier message à faire passer, c'est donc bien que l'industrie a un avenir dans notre pays !
Avec les chercheurs, ensuite, je crois que nous avons une carte à jouer : de grandes universités américaines ne financent plus des postes de recherche fondamentale, de grands chercheurs se trouvent sans emplois aux États-Unis mêmes - et ils peuvent être d'autant plus intéressés par des postes au CNRS ou au CEA, que l'emploi y est stable.
Je crois, ensuite, que nous devons prendre en compte la structure du capital, sa propriété : le capital public a joué un rôle considérable dans le développement de notre économie, dans celui de la recherche ; il diminue partout, nous avons privatisé, mais sans disposer pour autant de capitaux privés ou locaux, comme nos voisins allemands. En Italie, les grandes PME sont coopératives, c'est bien la preuve que ce mode de partage fonctionne. Il y a un vide à combler et, à cet égard, le fonds stratégique d'investissement est une bonne idée.

L'organisation territoriale me semble être un facteur très important, où des pistes doivent être explorées ; nous pourrions, par exemple, autoriser les régions à entrer dans le capital des entreprises, cela se fait en Allemagne. Sur la sous-traitance, ensuite, il faut convaincre les donneurs d'ordre qu'ils n'ont eux-mêmes pas intérêt à ce que les sous-traitants dépendent d'eux seuls, et qu'il vaut mieux que ceux-ci diversifient leurs partenaires. Je suis convaincu, encore, que nous devons définir une politique industrielle à l'échelon européen. Cela passe, effectivement, par une adaptation de l'application des règles de concurrence - je signale que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est moins sévère que la Commission européenne : nous perdons des points en nous appliquant plus rigoureusement les règles de concurrence ! Enfin, cela paraîtra anecdotique mais il me semble que le tourisme industriel peut jouer un rôle non négligeable pour relancer l'attractivité des métiers industriels auprès des populations locales.
Je vous rejoins, les uns et les autres, sur l'importance de l'organisation territoriale. J'ai du reste proposé que le CESE délivre chaque année un « Prix de la compétitivité » à des entreprises sélectionnées d'abord à l'échelon régional : les 22 régions françaises choisiraient trois entreprises, nominées pour le prix du CESE. Ce serait une façon de faire vivre cet avis sur les territoires. Enfin, je vous signale que le CESE travaille sur la question de l'économie sociale et solidaire.

Merci, chère Madame, cette première rencontre a été tout à fait réussie.
Puis la commission procède à l'audition de M. Alexandre de Juniac, président-directeur général d'Air France, accompagné de M. Jean-Claude Cros, directeur général chargé des ressources humaines.
L'évolution du secteur du transport aérien connaît trois tendances lourdes. La concurrence des compagnies à bas coût est un phénomène mondial, qui touche notamment le réseau court et moyen courrier. Le secteur du long courrier est lui-même affecté par la concurrence des compagnies du Golfe, qui travaillent dans des conditions économiques différentes, mais qui sont également très compétentes et très agressives sur le plan commercial. Enfin, la zone euro connaît depuis 2008 une croissance faible qui pèse sur le trafic aérien et le coût du baril de pétrole, qui était de 116 euros baril ce matin, atteint un niveau en euros historiquement élevé en raison de l'évolution des taux de change.
La situation d'Air France est difficile. Pour la troisième année consécutive, le résultat d'exploitation sera négatif. Nous avons maintenu pendant cette période les investissements à un niveau très élevé, sans avoir les moyens de les financer. Ainsi, la dette du groupe Air France-KLM est passée de 2,7 en 2008 à 6,5 milliards d'euros en septembre 2011. La contrainte financière est extrêmement forte et la rentabilité insuffisante. Cela explique la chute du cours de Bourse, qui rend plus difficile la conclusion d'accords avec échanges d'actions.
C'est pourquoi nous avons engagé un plan de transformation d'Air France afin d'améliorer structurellement sa compétitivité. Des mesures temporaires ne suffiraient pas. La situation d'Air France est différente de celle de KLM, mais le niveau d'effort demandé sera comparable dans les deux entreprises.
Le plan porte sur le rétablissement de deux milliards d'euros de la trésorerie pour Air France et de 900 millions d'euros pour KLM, d'où une réduction de la dette de deux milliards d'ici 2014, compte tenu des provisions pour aléas. Par ailleurs, nous allons restructurer le réseau court et moyen courrier où Air France connaît l'essentiel de ses pertes.
Le plan comportera deux phases sur une durée de trois années. Dans un premier temps, trois séries de mesures seront engagées. Les investissements seront réduits ou retardés, pour un montant de 300 millions d'euros : la flotte sera maintenue à un niveau constant. Les salaires seront gelés de manière temporaire. Enfin nous réaliserons des économies de carburant, celui-ci représentant un tiers de nos coûts.
La seconde phase du plan sera annoncée bientôt et concernera la transformation structurelle de notre réseau court et moyen courrier ainsi que l'adaptation de notre réseau long courrier, de notre système d'ingénierie et de maintenance et de notre activité cargo. Trois autres chantiers porteront sur la productivité et l'efficacité de notre méthode de production, sur le renouveau de nos méthodes de management et d'organisation, enfin sur les investissements à destination des clients.
Ce plan de retour à la compétitivité n'est pas un objectif en soi, mais un moyen de retrouver la croissance et de favoriser le développement de la compagnie. Nous avons pour but de retrouver en 2016 l'une des premières places, voire la première au monde, aussi bien pour le nombre de passagers transportés que pour la qualité de service.
Nous devons pour cela retrouver notre capacité financière en 2014, sans abandonner les investissements dans deux domaines : la sécurité des vols et au travail, ainsi que la qualité des services aux clients.
L'alliance Air France-KLM réunit les compagnies française Air France et néerlandaise KLM, ainsi que leurs filiales régionales, Brit Air, Air Liner et City Jet pour la première, et City Open pour la seconde. Elle affrète un peu moins de 600 avions courts, moyens et longs courriers, ce qui représente le réseau international le plus dense au monde. Si les deux compagnies se ressemblent, l'offre de courts et moyens courriers d'Air France est cependant plus développée, du fait d'un plus grand territoire national à desservir. Elles ont une politique de hub, ou plate-forme de correspondance, centrée sur Roissy-Charles de Gaulle pour Air France, et Schiphol pour KLM.
Air France-KLM s'inscrit dans l'un des trois grands réseaux d'alliances mondiaux, baptisé Skyteam, qui regroupe principalement Delta Airlines, Alitalia, Aeroflot, China Eastern et China Southern Airlines, et Kenya Airways. Ses partenaires gèrent de façon commune données, passagers, vols, points de fidélités ou encore prestations d'aéroports. Les deux autres réseaux d'alliances mondiaux sont Star Alliance, qui regroupe Lufthansa, United et Continental Airlines, et One World, qui rassemble British Airways et American Airlines. La Chine, dès lors que ses habitants voyageront davantage, est par ailleurs appelée à avoir de grandes compagnies.
Le groupe Air France-KLM réalise 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont les deux tiers par Air France. Il assure plusieurs métiers différents : le transport de passagers, d'une part en courts et moyens courriers, en Europe, et d'autre part en longs courriers, de marque Airbus et Boeing, à l'international ; le fret de marchandises, surtout pour sa composante néerlandaise, avec une quinzaine d'avions cargos au total ; et la maintenance des moteurs et équipements, qui fournit aux deux tiers Air France-KLM elle-même, et pour l'autre tiers les compagnies étrangères, et se développe rapidement.

La filiale régionale d'Air France Regional Airlines se trouve dans une situation difficile, avec un réseau en constante diminution, car ses lignes les plus rentables seraient récupérées par la maison-mère, et un projet dit « base province » dont aurait été exclu le personnel de la compagnie. Qu'en est-il de son avenir ?

Merci, monsieur le président directeur général, d'avoir été aussi clair dans votre présentation. Comment, toutefois, comptez-vous organiser le dialogue social pour obtenir et mettre en place des mesures douloureuses à court terme ? Quelle en sera l'acceptabilité ? Comment, à plus long terme, affronter la concurrence en matière d'ingénierie et de maintenance ? Enfin, où en est le dossier Alitatlia ?

Dans la situation financière tendue que nous connaissons, de quel ordre seront vos investissements, et quelle est la marge nette escomptée ? Le nombre de passagers triplerait d'ici 2030, nous dit-on ; comment vous y préparez-vous ? La concurrence des compagnies à bas coût sur les courts et moyens courriers, et des compagnies du Golfe sur les longs courriers, pourrait entraîner la perte de 11 000 emplois en Europe ; ne faut-il pas accorder une attention particulière à l'ouverture de nouveaux droits de trafic à ces compagnies ? N'y a t-il pas de distorsions de concurrence ?

Je rends hommage à la qualité du transport d'Air France, mais il se trouve altéré par les grèves actuelles ; pourquoi les retards et annulations ne sont-ils pas annoncés à l'avance aux passagers ? Est-il envisageable de renforcer les alliances à l'échelle européenne, notamment avec Lufthansa ?

Il est en effet très désagréable d'être prévenu au dernier moment de la perturbation d'un vol. En vue de lutter contre les nuisances aéroportuaires, la descente continue constitue une solution sur laquelle l'État ne nous a pas clairement donné son avis ; quelle est votre position ?
Regional Airlines opère sur de petits avions, dont le coût d'exploitation au siège est deux fois supérieur à celui des gros avions. Ceci implique le maintien d'une politique tarifaire élevée, ainsi que la réduction du nombre de lignes ouvertes pour pouvoir faire émerger une demande. Il n'y a pas, en tout cas, de « prédation » de Regional Airlines par Air France. Le recours à des avions à hélices permettrait de réduire le coût d'exploitation au siège, mais ce type d'avion n'est guère prisé des passagers. Plus globalement, le réseau court et moyen courrier, dont font partie les compagnies régionales, devra faire l'objet d'une restructuration permettant de l'optimiser.
Les « bases provinces » sont venues substituer des lignes opérées par Air France à des lignes auparavant opérées par les compagnies régionales. L'accord passé avec Regional est de remplacer nombre pour nombre par des lignes qu'il n'opérait pas auparavant. Cette compagnie bénéficie de tout l'apport sur Roissy, son activité évoluant de façon positive, au même rythme que celle des longs courriers. Quand des problèmes sociaux se sont posés, comme à la base de Marseille, nous avons eu un accord permettant au personnel de Regional d'intégrer Air France ; il en ira de la même façon dans les autres bases.
Le dialogue social chez Air France est organisé autour de la conclusion, avec les organisations professionnelles, d'accords-cadres. Une dizaine d'accords de ce type ont été signés à ce jour. La mise au point, actuellement, d'un nouveau modèle économique implique de définir un nouveau cadre contractuel en matière social, qui prenne en compte les exigences de productivité, de flexibilité... Le 10 février prochain, sera proposé un projet de dénonciation des conventions existantes, en vue de rénover le cadre contractuel existant. Le temps de la renégociation sera nécessairement limité, du fait de la conjoncture particulièrement difficile. Tout ceci se fera de façon parfaitement transparente. Nous avons d'ailleurs imposé une clause d'austérité salariale à tous les niveaux de la société.
Air France vient de signer plusieurs accords notamment sur le handicap, la formation, les risques professionnels, l'égalité entre hommes et femmes ... La politique contractuelle n'est donc pas mise à mal par les mesures de redressement, qui ne remettent d'ailleurs pas en cause les éléments substantiels des contrats de travail. En réalité, la stratégie de redressement porte sur deux problématiques : celle du rythme d'augmentation des rémunérations et celle du temps de travail.
Concernant la maintenance, il faut distinguer trois segments : la maintenance du fuselage, celle du moteur et celle des équipements. Ces deux dernières activités sont à haute valeur ajoutée et Air France dispose sur ce plan d'un outil industriel de haut niveau. L'activité de maintenance du fuselage est en revanche soumise à une forte concurrence des pays à bas salaires. Air France doit donc travailler avec des partenaires pour définir les lieux d'implantation de ses activités de maintenance.
Concernant Alitalia, Air France détient 25 % du capital. Il y a peu, Alitalia était en quasi-faillite, puis est rapidement revenue à une meilleure situation. L'accord entre les partenaires du tour de table pour sauver Alitalia viendra à échéance en 2013, redonnant à chacun la liberté de se désengager. L'encadrement d'Alitalia souhaite une fusion avec Air France mais aucune décision n'est prise à cet égard. La question de la capacité financière d'Air France à mener une telle fusion reste posée.
Concernant les investissements, ils s'établissent à un peu moins de 2 milliards d'euros par an. L'ancienneté de la flotte est de seulement 9 ans. La stratégie d'Air France consiste à réduire ses investissements pour restaurer ses capacités financières, mais avec deux limites : le maintien de la qualité de l'outil de production d'une part et la sauvegarde de secteurs essentiels d'autre part, comme la sécurité ou les services au client. La réduction des investissements ne sera pas préjudiciable à Air France et passera par un plus grand étalement dans le temps des investissements programmés et une réduction des investissements au sol.
Concernant la marge nette pour 2011, elle n'est pas encore connue, compte tenu des délais de bouclage de la comptabilité du groupe, mais elle sera négative.
Le triplement du trafic aérien à l'horizon 2030 est une perspective probable, mais se fera plutôt en Asie et en Afrique qu'en Europe. Il est donc nécessaire de développer des partenariats locaux, voire des implantations dans les zones en croissance, dans un contexte où les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) protègent encore fortement les compagnies nationales. Si Air France retrouve la croissance en 2014, elle pourra investir sur ces zones en développement.
Le modèle économique de « croissance rentable » d'Air France a bien fonctionné jusqu'à la fin des années 2000. Il s'agissait de croître en absorbant les hausses de coûts de production. Or, avec l'arrivée de nouveaux concurrents, il est nécessaire de générer des gains de productivité pour retrouver la croissance.
La concurrence des compagnies aériennes du Golfe est très forte et a des effets négatifs sur l'emploi en Europe : même si ces compagnies achètent des Airbus, les pertes d'emploi dans le transport aérien excédent les gains dans la construction aéronautique. Le Royaume-Uni a conclu des accords de ciel ouvert avec ces compagnies et British Airways subit une concurrence très forte : il existe ainsi une liaison directe Manchester - Dubai.
Concernant les annulations de vols en cas de mouvements sociaux, Air France a développé l'information en amont des passagers, par SMS et mails. Par ailleurs, Air France pratique les annulations de vols à l'avance, appelées abattements de programme, et réoriente ses passagers vers des compagnies partenaires, ce qui coûte plusieurs millions d'euros par jour. Malgré ses efforts, la compagnie doit encore procéder à des annulations à chaud, lorsque le personnel prévu ne se présente pas et que le personnel de réserve n'est plus disponible. La proposition de loi actuellement en discussion au Parlement vise à mettre fin à cette difficulté.
Le paysage de l'aérien en Europe est marqué par l'existence de trois compagnies majeures : Air France-KLM, Lufthansa et le groupe issu de la fusion entre British Airways et Iberia. Il est trop tôt pour dire si d'autres rapprochements sont encore possibles. Aux États-Unis, il y a également trois compagnies majeures. La faillite d'American Airlines va conduire à passer de trois opérateurs majeurs à deux, ce qui posera des problèmes de concurrence.
Enfin, concernant la descente continue, Air France y est favorable, notamment parce qu'elle permet d'économiser du carburant, mais la direction générale de l'aviation civile (DGAC) resterait réticente.

Je connais l'attachement des personnels d'Air France à leur compagnie. Or, les mesures de redressement proposées par la direction d'Air France constituent une rupture dans la pratique du dialogue social de la compagnie. En effet, il est dit qu'il n'y a plus de temps pour négocier, compte tenu de la situation financière d'Air France et en particulier de sa dette. Cette question m'apparaît centrale. J'aimerais également savoir quelles sont les intentions de votre compagnie en matière d'investissements informatiques. Enfin, quelle est la volonté d'Air France vis-à-vis d'Amadeus : s'agit-il de renforcer l'investissement dans cette société ou de se désengager ?

Le maintien du dialogue social est essentiel. Par ailleurs, vous avez évoqué les difficultés que vous rencontrez face aux compagnies à bas coût. Pourquoi ne parvenez-vous pas à vous mettre au même niveau qu'elles, par exemple via une filiale ?

Si les négociations avec les partenaires sociaux sont menées trop rapidement, les risques de conflit pourraient en être accrus... Pouvez-vous d'ailleurs nous indiquer s'il y a un risque de délocalisation de certaines activités d'Air France ? Par ailleurs, comment comptez-vous gérer le niveau élevé du prix du carburant ? Enfin, la restructuration du réseau court et moyen courrier entrainera-t-elle une diminution du trafic sur certaines lignes, voire leur suppression ?

Quel est l'avenir de l'activité cargo et quelle sera votre stratégie, compte tenu notamment de la concurrence du secteur maritime ? Je pense par ailleurs qu'il faut combattre au maximum les risques de transfert à l'étranger de nos activités industrielles. Quelle est votre stratégie de baisse des investissements selon les secteurs ? Dans l'informatique, qui évolue très vite, cela entrainerait une baisse immédiate d'efficacité et de compétitivité au niveau de la politique commerciale. Sur le plan géographique, avez-vous des projets de modification de vos sites, notamment à Orly ou, pour l'informatique, à Toulouse et Valbonne ? Les hubs régionaux pourront-ils être utilisés par les compagnies du Golfe pour mieux pénétrer sur le territoire ? Enfin, quel est le montant des dividendes versé sur les dix dernières années aux actionnaires privées ? Dans le transport aérien, le capital a une rentabilité cyclique, ce qui à mon sens plaide pour un renforcement de la part de l'État : avez-vous une stratégie concernant l'évolution de la répartition du capital ? Je m'associe également à la question de Marc Daunis concernant Amadeus.

Des mesures sont nécessaires, mais pourquoi travailler en deux temps ? S'agit-il de présenter l'essentiel du plan après les élections ? Par ailleurs, faut-il à tout prix viser les premières places mondiales ou rechercher plutôt l'attractivité de la compagnie et la qualité de service ? Enfin, les efforts seront-ils partagés par tous, notamment s'agissant des plus hauts salaires ? Il faut montrer l'exemple.

Il était prévu de fusionner Air France et KLM. Ce projet est-il renvoyé à plus tard ?
L'informatique, dont dépend la relation client, est un élément clé de l'exploitation : 30 % des ventes ont lieu par internet. Elle n'échappera toutefois pas au programme d'économies, sans que cela remette en cause la compétitivité : nous gérions trop de projets en même temps.
Le personnel lui-même demandait un ralentissement du nombre de projets car les changements étaient trop importants.
Je ne peux malheureusement pas répondre aux questions concernant Amadeus, de crainte d'influencer le cours de l'action dans un sens ou dans un autre... Je dirai simplement que le plan de transformation nous permet de rétablir notre capacité financière sans avoir à faire de désinvestissement.
Nos difficultés face aux compagnies à bas coût résultent d'une différence de modèle économique, fondé chez elle sur des prix bas, sur l'absence de services et sur des dessertes point à point. Notre réseau court et moyen terme est soumis à la contrainte d'alimenter les hubs de Roissy - Charles-de-Gaulle et d'Amsterdam - Schiphol. D'ailleurs, si l'on calcule tous les frais payés, suppléments compris, sur un vol d'une compagnie à bas coût, surtout lors d'un jour de pointe, les prix ne sont pas si différents. De plus, ces compagnies opèrent dans des conditions économiques et sociales beaucoup moins coûteuses.
Face à cette concurrence, nous mettons en place des bases de province : celle de Marseille rencontre un grand succès auprès du personnel local. Peut-être exploiterons-nous par ailleurs certaines lignes à partir d'une filiale sur le modèle des compagnies à bas coût. Il faut en effet distinguer deux segments de marché, selon que le prix à payer est, ou n'est pas, le paramètre essentiel pour les clients. Cela dépend des destinations.
Nous cherchons à conduire les négociations sociales dans les meilleures conditions possibles, tout en réduisant les délais par rapport aux habitudes : la situation de l'entreprise nous y oblige.
Nous prêtons, comme notre personnel, une grande attention aux risques de délocalisation. Nous confions des activités en priorité aux ateliers industriels situés en France, qui sont de grande qualité.
Le cargo est une activité importante pour Air France-KLM, qui exploite quinze avions dans ce secteur. La situation est difficile pour cette activité, qui est très sensible à la conjoncture économique. Nous avons défini un plan de restauration de la capacité. Nous faisons face à la concurrence du transport maritime, mais aussi à la mise en place d'activités cargo en Asie.
S'agissant des secteurs géographiques, nous n'allons pas modifier nos implantations à Toulouse, Valbonne et Orly. Orly sera d'ailleurs le centre de notre réseau point à point.
Nous n'avons versé aucun dividende au cours des cinq dernières années, ce qui rend d'ailleurs difficile la recherche de nouveaux actionnaires. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur l'avenir de la répartition du capital, mais je crois que c'est une bonne idée de l'utiliser pour conclure des partenariats, comme cela a été fait avec KLM. Je suis aussi très favorable au développement de l'actionnariat salarié.
La première phase du plan en constitue en fait la partie la plus substantielle puisqu'il concerne un montant 1,2 milliards d'euros sur deux au total. Nous travaillons sur le modèle économique, à partir duquel seront conduites les négociations sociales.
Nous cherchons à rejoindre les premiers mondiaux parce que le transport aérien est une activité très capitalistique qui permet d'importantes économies d'échelle. Il ne s'agirait d'ailleurs que de retrouver la position qui était encore la nôtre il y a trois ans. Le déploiement international est la force d'Air France-KLM.
Je vous confirme que l'effort sera partagé par tous. Nous avons par exemple réduit l'enveloppe de part variable revenant à la direction générale et nous avons supprimé certains avantages.
Sur les cinq dernières années, les salaires ont été bloqués et sont même en baisse cette année pour la direction. Le reste du personnel a connu une hausse de salaire moyenne de 3 à 3,5 % par an sur cette période.
L'intégration entre Air France et KLM est complète pour le réseau international et l'informatique. Elle est en cours concernant la finance. L'intégration totale est difficile, les personnels étant localisés dans chacun des deux hubs avec des statuts différents qu'il n'apparaît pas nécessaire d'aligner. L'intégration se poursuit pour d'autres fonctions, mais sur un rythme ralenti.