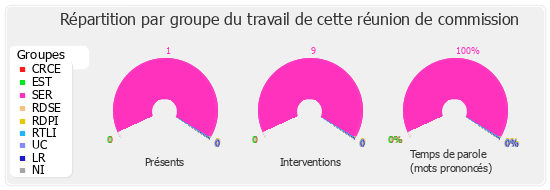Commission d'enquête sur la lutte contre le dopage
Réunion du 16 mai 2013 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Je signale au public que le silence est nécessaire.
Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Paclet. Je vous informe en outre qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Jean-Pierre Paclet prête serment.
Depuis trente ans que j'exerce dans le sport, auprès d'athlètes de haut niveau, j'ai toujours été viscéralement opposé au dopage. D'un point de vue éthique, c'est une tricherie. Quel exemple pour les enfants ! Si les miens avaient pu devenir sportifs de haut niveau, j'aurais été très ennuyé qu'ils prennent des substances dangereuses. J'ai été formé à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière, où ce n'était pas une préoccupation pour nos enseignants : je n'y ai reçu aucune formation sur ce sujet. La médecine du sport marche sur deux jambes : il y a les médecins qui réparent, et ceux qui préparent. Je suis de ceux-là. Ceux-ci étudient la physiologie et cherchent à améliorer le fonctionnement normal de l'homme, parfois en franchissant les limites.
Selon le type d'activité sportive, l'exposition au dopage varie. Un premier type regroupe les sports dans lesquels la performance est avant tout physique : athlétisme, cyclisme, natation, haltérophilie, ski de fond... Les athlètes y sont les plus susceptibles d'accepter la pilule blanche, ou la piqûre verte, si cela peut améliorer leur performance de 5 %, 10 %, voire 20 %. Ainsi dans le sprint, passer en-dessous de 10 secondes, c'est passer du niveau régional au niveau international ; passer en-dessous de 9,5 secondes, c'est devenir une star mondiale ! D'autres sports, à l'inverse, dépendent peu de la performance physique : il n'est que de voir, par exemple, la silhouette des champions de golf. Les sportifs y sont peu intéressés par le dopage. Un troisième groupe, enfin, comprend les sports dans lesquels la performance physique entre en ligne de compte, parmi d'autres facteurs : performance technique, dynamique collective, état psychologique...
On a beaucoup dit que le dopage était lié à des considérations financières. Mais en haltérophilie - le culturisme est la discipline qui a le plus utilisé les anabolisants - beaucoup de sportifs se dopent sans ce type de motivation, puisqu'ils demeurent anonymes. Dans ce cas, les fédérations sont impuissantes, seule la police peut intervenir.
Le profil culturel du sportif est déterminant. A-t-il réfléchi à sa pratique ? Un joueur de l'équipe de France de football m'a appelé et m'a recommandé de ne pas fléchir : preuve que certains sont fermement opposés au dopage et se réjouissent de la multiplication des contrôles. D'autres évitent le dopage par peur des contrôles, et non pour des motifs plus raisonnés. Je tiens à souligner à ce propos l'importance de l'éducation des jeunes.
Longtemps, la lutte contre le dopage a été confiée aux organisations sportives : fédérations, comité international olympique, FIFA... Les résultats ont toujours été faibles, et les contrôles en retard par rapport aux pratiques. Les affaires qui ont éclaté (Agricola en Italie, Fuentes en Espagne, Hamilton aux États-Unis) sont le fruit de l'action de services de l'État (police, douanes...), non des organisations sportives. Ce sont eux qui sont véritablement efficaces dans la lutte contre le dopage : les liens qui se tissent au sein des organisations sportives affaiblissent l'énergie des contrôles, de même que la perspective du passage devant le tribunal arbitral du sport et des complications juridiques subséquentes.

Notre but est d'améliorer l'efficacité de la lutte contre le dopage par la formulation de propositions à l'adresse de l'État et du mouvement sportif. N'hésitez pas à en faire ! Ne pensez-vous pas que les sportifs puissent être associés au moins à certains aspects de la lutte contre le dopage - la prévention, par exemple ?
Oui, la prévention est l'un des rôles des fédérations, qui sont en contact avec les sportifs. Il faut les encourager dans ce sens. Mais le plus efficace, c'est le contrôle a posteriori : c'est ce qui a fait tomber M. Armstrong, qui avait déjoué les contrôles médicaux pendant dix ans.
Avec la complicité de l'Union cycliste internationale (UCI), qui n'allait pas tuer la poule aux oeufs d'or, ni abîmer son image... C'est ce que j'ai lu dans la presse.
M. Armstrong était entouré de spécialistes de physiologie de haut niveau, qui connaissaient bien leur affaire.
Oui, mais peut-on vraiment leur conserver le titre de médecins ?

Ces explications suffisent-elles ? Qui a le rôle le plus important, le médecin de l'équipe ou le médecin personnel ?
Le médecin personnel, M. Ferrari. C'est lui qui fait la proposition - pour des raisons financières, car la dose d'EPO coûte cher ! C'est lui qui sait comment échapper à 95 % des contrôles, par l'usage de micro-doses, le choix des heures de prises... Et pour les 5 % restants, on s'arrange...
L'UCI enterrait l'affaire. La responsabilité est donc partagée.

Vous dites qu'on ne vous a jamais parlé de dopage dans votre formation médicale ?
C'était moins à la mode, sans doute. À présent, on en parle.
Oui, c'est un scandale. Je ne les considère d'ailleurs pas comme des collègues. Cela dit, il y a peu de médecins français impliqués : à part le docteur Bellocq - qui ne se cachait pas pour exposer ses idées, fausses mais plus tolérables - et le médecin de l'équipe « Crédit agricole », ce sont des médecins d'autres nationalités - Italiens, Américains, Belges, Espagnols... - qui sont concernés.

Vous parlez d'une formation d'une heure en tout, dans le cursus de médecine du sport, sur le dopage. Or ce problème concerne aussi les pratiquants occasionnels : sportifs du dimanche, membre d'équipes amateur... La formation des médecins sur ce sujet est donc laissée pour compte.
Beaucoup de matières sont insuffisamment enseignées : je dois faire mon cours sur la pathologie de l'épaule en trois heures, il m'en faudrait au moins dix fois plus ! La formation médicale en médecine du sport laisse à désirer.
Comme sur d'autres ! Il faut dire quels sont les risques, ce qu'il faut ne pas faire, comment exercer une surveillance...

Vous avez été médecin de l'équipe de France de 2004 à 2008, et donc lors de la finale de 2006. Après votre départ vous avez publié un ouvrage, « L'implosion », dans lequel vous affirmez que « certains cadres de l'équipe de France qui évoluaient en Italie présentaient un taux d'hématocrite anormal » en 1998. Pouvez-vous préciser ?
C'est curieux comme on retient trois lignes d'un ouvrage de 150 pages ! Ce n'était pourtant pas une révélation : les actes du procès du docteur Agricola à Turin avaient été publiés dans la presse à l'époque. Deschamps et Zidane jouaient alors à la Juve. Ils présentaient une variation anormale du taux d'hématocrite, dont un spécialiste italien avait affirmé qu'il ne pouvait résulter que d'une prise de produits dopants. Cela se savait, avant que je publie mon livre en 2010. Mais en 2002, il n'était pas question de toucher aux icônes, la presse française avait donc rendu compte de cela avec discrétion.
L'EPO, qui à l'époque était la substance reine : elle n'était pas détectable. J'en ai entendu parler pour la première fois dans les années 1990 : un journaliste de mes amis m'a indiqué que les Italiens avaient trouvé quelque chose. Il le savait - tout le monde savait - car les sprinteurs caracolaient dans les côtes, les équipes roulaient à 50 km/h de moyenne... Cela se conservait dans des glacières, et c'était indétectable : pas vu, pas pris ! Cela montre bien les limites du contrôle pour les fédérations : c'est la police, ou la douane, qui doivent opérer, fouiller les voitures...
Non, ou alors dans les phases de préparation physique en début de saison, ou peut-être pour faciliter la récupération... Il faudrait poser la question à des pharmacologues. Le docteur Agricola n'a jamais publié les résultats de ses tests dans une revue scientifique !
Ces gens fonctionnent de manière très expérimentale : si le coureur respire mieux et roule plus vite, pourquoi pas ? Leur démarche est empirique.

Dans le dossier médical révélé lors du procès de la Juventus, on apprend qu'une de nos icônes avait 51,8 % d'hématocrite...
J'avais retenu le chiffre de 51,9 %.
A l'époque, le doute était possible mais on ne pouvait rien prouver. La norme de 50 % avait été fixée au jugé par les directeurs sportifs, qui constataient qu'au-delà le sang des coureurs atteignait un tel degré de viscosité qu'ils se réveillaient la nuit avec des crampes, et devaient remonter sur un vélo pour relancer la pompe !

L'UCI aurait ainsi légalisé, en quelque sorte, l'utilisation de l'EPO dans le peloton ?
Paradoxalement, oui. Tant qu'on restait en-dessous d'un taux de 50 %, c'était accepté. Puis on a découvert que l'injection d'un litre de sérum faisait baisser le taux d'hématocrite ; et actuellement, l'utilisation de micro-prises donne un résultat équivalent sans faire augmenter ce taux !

Y a-t-il des substances qui peuvent servir de substitut à l'EPO, et qui ne seraient pas encore détectables ?
On parle depuis deux ou trois ans de l'hémoglobine recombinante. C'est une vraie course entre les fabricants de médicaments et les organismes de lutte contre le dopage. Un chercheur américain a découvert une molécule, le GR 1516, qui permet à un rat de courir 40 % plus longtemps qu'un rat entraîné. Mais il la destine à l'amélioration des conditions de vie des obèses et en a donné la formule à l'Agence mondiale antidopage (AMA). De nouvelles molécules sont régulièrement inventées. Toutefois, les contrôleurs sont toujours en retard sur les entourages des sportifs de haut niveau. Ce qu'il faudrait, c'est fouiller les voitures du Tour de France, faire des descentes à Clairefontaine, et analyser mêmes les produits ordinaires. Cela ferait peur.
Ce n'est pas le seul facteur.

Quand vous étiez médecin des Bleus, discutiez-vous de ces sujets avec les joueurs ?
Oui, parfois. En 1992, lorsque je travaillais avec les Espoirs, je les convoquais une ou deux fois par an pour leur parler du dopage, leur dire que c'était une tricherie et les alerter sur les dangers pour la santé que cela représentait - et sur les risques juridiques. Certains étaient sensibles à mon discours, d'autres non : une équipe est aussi diverse qu'une promotion au service militaire...
En quinze ans de collaboration avec M. Domenech, nous avons toujours été d'accord : il ne m'a jamais adressé de demande sur ce point. Une fois, nous allions jouer un match de qualification à Metz, les organisateurs nous avaient indiqué qu'il n'y aurait pas de contrôle le lendemain. J'ai alors prétendu que j'allais faire des achats au Luxembourg, où les médicaments sont en vente libre. Le lendemain, nous avons gagné, et lorsque j'ai confirmé à M. Domenech que je n'avais rien fait de tel, il m'a dit qu'il s'en réjouissait car il n'aurait pas été fier sinon.

Et avec d'autres que M. Domenech ? L'entourage partage-t-il cet état d'esprit ?
Ce n'est pas le facteur capital. Nous fournissions de la vitamine C, et c'est tout.
Oui. Sauf, naturellement, si j'ai été trompé - mais je regardais toujours ce qu'il y avait sur la table de nuit des joueurs - je puis affirmer que nous avons été en finale en 2006 uniquement avec du Vitascorbol et du Berocca.
En effet. Pas forcément en ce qui concerne les pratiques du personnel de l'équipe de France mais plutôt à propos des pratiques des équipes où les joueurs jouaient.
La Juventus, et d'autres équipes italiennes. C'est une question de culture : les joueurs anglais sont laissés libres de boire et manger ce qu'ils veulent avant un match, par exemple. L'Italie a été le noyau du dopage dans toutes les disciplines.

Mme Buffet a déclaré que lorsqu'elle était ministre des sports, en 1998, elle avait subi « des pressions de toutes sortes » à la suite d'un contrôle antidopage inopiné à Tignes. Avez-vous eu affaire à ce genre de pressions ?
Les contrôles inopinés sont à la base de l'action antidopage. Y renoncer reviendrait à arrêter les contrôles. Mais ils sont trop souvent mal expliqués, et donc mal vécus. Les prélèvements sont faits au plus mauvais moment : pendant la sieste, qui est une phase de récupération primordiale. Ceux qui ont été effectués à Tignes furent les premiers. Nous n'avons pas su adopter le bon discours : il faut expliquer que les contrôles ne sont pas l'indice d'un soupçon mais ont pour objectif de préserver le sport, et les sportifs, du dopage. La loi Buffet a été très mal expliquée : il ne faut pas être manichéen.

Que pensez-vous de l'existence de deux listes de produits interdits, l'une pour les périodes de compétition, l'autre pour le reste de l'année ? Est-ce scientifiquement justifié ?
Oui : en dehors des périodes de compétition, il faut pouvoir avoir recours à des médicaments usuels pour se soigner ! Il y a des justifications d'ordre thérapeutique : en cas de laryngite aigüe, ou pour se faire arracher une dent, mieux vaut utiliser des corticoïdes. Le problème vient plutôt des produits interdits : le cannabis, par exemple, qui est à l'origine de 80 % des condamnations pour dopage en France ! Si l'on veut que le sport serve à l'éducation des cités, il faut changer cela, et différencier les produits festifs des autres, ou dans certaines zones, nous n'aurons plus de joueurs !

Que pensez-vous de l'action des instances fédérales en termes de prévention et d'information ? Font-elles correctement leur travail ? La fédération a mis en place un conseil de l'éthique, qu'en pensez-vous ?
Les instances de formation ne se soucient guère de former des hommes : elles veulent avant tout de bons footballeurs. J'ai écrit mon livre car j'étais furieux lorsqu'Anelka a été critiqué pour avoir insulté M. Domenech. « C'est la France des racailles », écrivait le lendemain M. Finkielkraut. Or Anelka a été élevé dès l'âge de douze ans à Clairefontaine, où il était en pension, puis dès quinze ans au centre de formation du PSG, où il était interne. Ses parents sont instituteur et employée à la mairie des Ulis. Mais son éducation a été faite par le football français ! Les valeurs éthiques et civiques y sont trop négligées : un ancien directeur du centre de formation de Clairefontaine me parlait d'un élève de douze ans qui était un voyou, qu'il aurait fallu renvoyer, mais qu'il a conservé car il jouait bien au football.
Une prise de conscience commence. Mais il faut aller contre l'éducation de ces joueurs : ce sont des enfants confrontés à des problèmes sociaux, dont les parents voient la carrière de footballeur comme la promesse de la poule aux oeufs d'or...
Oui. Il faudrait réfléchir à la portée des sanctions personnelles. Dans les sports collectifs, les sanctions devraient être collectives. Cela inciterait l'ensemble les dirigeants, les entraineurs, les accompagnateurs à s'engager davantage. J'ai expliqué à un responsable de la FIFA qu'avec les sanctions existantes il était possible d'amener en finale une équipe intégralement dopée. Cela l'a paniqué...Si l'on dit « un joueur positif, toute l'équipe sera sanctionnée », il y aura des ruptures de contrat - il n'y en a pas actuellement - et la situation changera.

Merci. N'hésitez pas à nous adresser des communications écrites si besoin.

Madame, Messieurs, soyez les bienvenus. Cette table ronde sur la lutte contre le dopage et les libertés publiques vise à stimuler notre réflexion en confrontant les différents points de vue. Nous recueillerons celui des sportifs : M. Serge Simon s'exprimera pour les joueurs de rugby et M. Kastendeuch, pour l'ensemble des professionnels, leurs propos étant complétés par ceux de M. Eric Boyer, ancien champion cycliste. Sur un tel sujet, il nous fallait également inviter des juristes : des universitaires qui pensent le droit comme Mme Prune Rocipon jusqu'à ceux qui l'appliquent au quotidien tel M. Olivier Niggli, conseiller juridique de l'AMA (agence mondiale antidopage), en passant par les avocats qui le font vivre, d'où la présence de M. Jean-Christophe Lapouble.
Nos débats devraient aborder quelques sujets clés : les obligations de géolocalisation des sportifs, le passeport sanguin ou la nature des sanctions. Je signale au public présent que le silence est nécessaire.
Bien que le format retenu soit celui d'une table ronde, vous vous exprimez devant une commission d'enquête qui fait l'objet d'un encadrement juridique strict, tout faux témoignage étant passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, MM. Jean-Christophe Lapouble, Serge Simon, Sylvain Kastendeuch, Olivier Niggli, Éric Boyer et Mme Prune Rocipon prêtent successivement serment.
En 1993, lorsque j'ai fait ma thèse sur la loi de 1989 relative au dopage, on me disait que le problème n'existait pas et que dans tous les cas, il devait se régler en interne. Malheureusement, on en est toujours là.
J'ai été inspecteur de la jeunesse et des sports jusqu'en 2000 et suis actuellement maître de conférences à Sciences-Po Bordeaux, ainsi qu'avocat au cabinet Veber à Lyon. Dans ce cadre, j'ai eu à connaître l'affaire Christophe Bassons, véritable cas de contrôle antidopage inversé. Pour le reste, j'écris un certain nombre d'articles et j'ai en tant qu'expert près le Conseil de l'Europe et son assemblée parlementaire, rédigé un rapport sur la France qui a conduit à la loi de 2006. J'ai aussi participé à plusieurs missions d'observateurs de l'Agence mondiale antidopage (AMA).
Avec le recul de quelques années, j'estime que les choses ont un peu bougé et je me félicite de la création de votre commission, qui est une première. J'espère que le projet de loi qui en sortira apportera de nouvelles améliorations car jusqu'à maintenant, on s'est plutôt contenté, au niveau français comme international, de poser des couches successives, sans vision d'ensemble.
Je vous remercie de m'accueillir devant cette commission dont je souhaitais depuis longtemps la mise en place. J'ai créé et dirigé le centre d'accompagnement et de prévention pour les sportifs (CAPS) au CHU de Bordeaux, qui héberge l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD). Je préside le syndicat des joueurs de rugby professionnels et suis secrétaire général de la fédération nationale des associations et des syndicats de sportifs (FNASS). Médecin et ancien sportif de haut niveau, j'estime bien entendu que la lutte contre le dopage est nécessaire, mais pas pour les raisons qui sont habituellement invoquées. Se concentrer sur les raisons sanitaires, c'est faire fausse route, car l'enjeu de santé publique est souvent dissocié du risque objectif. En France, le tabac cause 60 000 morts par an ; l'alcool tue plus de 50 000 personnes par an et voit sa consommation tolérée, voire valorisée alors que la consommation de cannabis, indirectement responsable de 230 décès, est réprimée dans la mesure où elle pose problème à la société. Je ne pose pas de jugement de valeur, j'observe simplement que l'identification d'un problème de santé publique tient à d'autres facteurs que le seul risque objectif, d'ordre structurel ou culturel. Autre exemple : le paludisme concerne 500 millions de personnes et tue un million de personnes par an, sans déclencher de mobilisation comparable à celle qui a suivi la pandémie de H1N1, qui a tué 18 500 personnes en 2009.
Pour le dopage, le risque objectif est très difficile, voire impossible à évaluer, les études de mortalité et de morbidité étant inexistantes. Quant au périmètre de la consommation de produits dopants, il n'est même pas défini. Les seuls chiffres disponibles sont ceux des contrôles de l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) : sur 10 000 prélèvements, seuls 200 ont donné des résultats anormaux dont 30 % du fait du cannabis. Pourtant, la réaction de la société au dopage est très vive car il affecte un idéal sportif fait de passion et d'exemplarité. Là réside le véritable moteur de la lutte antidopage, d'où une politique qui tient davantage de la course à la répression qu'à l'efficacité. Il faut apporter une vision réaliste, lucide, pragmatique à la lutte contre le dopage, pour sortir du diktat de l'émotion, du cercle vicieux fondé sur l'idée que le sport est profondément touché, que les sportifs sont tous dopés, mettre à distance l'injonction d'agir, pour prendre le temps de la réflexion, d'études factuelles. La course à la répression vise à démontrer la détermination. L'argument de santé publique n'est qu'un habillage. La lutte contre le dopage doit être plus raisonnée, se libérer de la pression médiatique, du marketing de l'idéal sportif, pour s'occuper des réalités des sportifs.
Je suis très heureux que les sportifs puissent se faire entendre. Je préside la FNASS qui représente environ 4 000 sportifs professionnels et j'assure la coprésidence du l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), ayant moi-même été footballeur professionnel pendant 19 ans. J'ai aussi été adjoint au maire de Metz chargé des sports et de la jeunesse. La FNASS regroupe actuellement cinq disciplines : le rugby, le handball, le basket, le cyclisme et le football.
Nous sommes évidemment favorables à une lutte intensive contre le fléau du dopage. Elle doit être renforcée de façon plus intelligente par moins de localisation individuelle dans les sports collectifs et par plus de contrôles sur les lieux d'entraînement et de compétition. Avec 10 130 contrôles en 2009, 10 500 en 2010 et 9 500 en 2011, la lutte bat son plein et les sports collectifs en ont largement pris leur part. Mais combien de cas de dopages avérés ont-ils été mis en évidence par tous ces contrôles ?
Nous souhaitions revenir sur certains propos tenus lors de vos auditions précédentes. Tout d'abord, pour rappeler qu'une infraction à la législation antidopage ou des résultats d'analyses anormaux ne sont pas synonymes de cas de dopage avérés. Ensuite, lorsque le sénateur Alain Néri laisse entendre que les athlètes des sports collectifs ne souhaitent pas être soumis à des contrôles inopinés, c'est en fait tout le contraire. Nous sommes complètement en faveur de ces contrôles, tout en souhaitant qu'ils soient réalisés sur le lieu de travail - nous passons huit à dix heures par jour dans nos clubs - et non au domicile. Il n'est pas tolérable non plus pour des sportifs d'entendre le directeur des contrôles de l'AFLD, M. Jean-Pierre Verdy, affirmer qu'il aimerait procéder à davantage de contrôles sur les animaux car « eux, au moins, ne peuvent pas dire non ». Pour M. Verdy, un sportif devrait donc tout accepter, y compris de ne pas pouvoir s'opposer à une réglementation ; il n'aurait d'autre choix que de donner son consentement.
Nous ne pouvons pas non plus accepter les contrôles pour ciblage décrits par M. Genevois ; leur légalité n'est pas établie dans la mesure où le décret qui doit les mettre en oeuvre n'a toujours pas été adopté et où le groupe de travail peine à communiquer sur ses travaux.
Nous contestons aussi la proposition du président de la fédération de l'athlétisme qui, comme solution à la triche dans le sport, n'envisage rien de moins que la levée du secret médical ! Les sportifs ne sont pas des citoyens de seconde zone et ils ne veulent pas le devenir du fait de mesures qui n'accorderaient aucun respect à leur vie privée. Enfin, à l'inverse du président de l'International Rugby Board (IRB) qui invoque la spécificité du sport au sein du Traité de Lisbonne, nous estimons que le calendrier des compétitions, ainsi que l'ensemble des questions sportives doivent être réglés par les partenaires sociaux au sein de chaque discipline. Cela commence à se faire mais c'est encore insuffisant.
Nous sommes contre le système actuel de localisation des sportifs dans les disciplines collectives. En 2011, en effet, l'AFLD a développé un nouveau mode de contrôle : 2 568 prélèvements pour le profilage ont été réalisés sur un total de 1 648 sportifs. 75 profils anormaux ont pu être mis en évidence et aucune sanction n'ayant été prise, on s'est contenté d'informer du médecin de la fédération.
Quant au passeport biologique, qui sera mis en place en 1er juillet 2013, les données qu'il contient feront l'objet d'un traitement statistique sur lequel la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) n'a pas encore rendu d'avis. Le principe de localisation, tel que pratiqué par l'AFLD, n'a rien apporté à la lutte contre le dopage. Le système des groupes cibles est anormalement intrusif, puisqu'il commande aux sportifs concernés, qui n'ont pas donné leur accord, de communiquer à l'AFLD des informations sur leurs lieux de résidence, d'entraînement, et de compétition, de façon à pouvoir être localisables et éventuellement soumis sur-le-champ aux divers contrôles ordonnés discrétionnairement par l'agence. Le principe d'égalité entre tous les sportifs n'existe plus et les athlètes désignés sont placés sous l'emprise d'un régime d'exception dans lequel le sportif est un suspect potentiel. Enfin, le sportif localisable se trouvera soumis à une surveillance permanente qui le prive d'une vie familiale normale.
Ces moyens de lutte sont-ils donc toujours pertinents ? Nous pensons que non. Les sportifs professionnels n'ont-ils pas droit à être traités avec éthique et équité ? Aucune autre catégorie professionnelle n'est soumise à des obligations aussi intrusives, que l'on songe même aux militaires, aux médecins, aux pilotes d'avions, aux capitaines d'industrie, aux opérateurs de marché, sans même parler des représentants du peuple français, appelés à décider du sort de leurs concitoyens.
Plusieurs actions contentieuses sont en cours : l'une devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), visant à contester le principe de localisation permanente posé par l'ordonnance du 14 avril 2010 ; l'autre devant la Cour de Cassation, accompagnée de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur les multiples violations des droits de la personne causées par le principe de localisation permanente.
Avocat et conseil juridique de l'AMA, j'ai participé à la rédaction du code mondial antidopage et travaillé sur sa révision de 2009 et sur celle qui est en cours.
La première version du texte avait adopté le principe de la localisation sans l'harmoniser entre les différentes fédérations, laissant à chacune d'entre elles le soin de gérer ce principe comme elle l'entend. Certains sports, comme le cyclisme, s'y sont habitués, avec des contraintes bien plus fortes que celles qui existent aujourd'hui, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sans que cela pose de problème majeur, une décision de la justice espagnole ayant même reconnu la nécessité et la proportionnalité du dispositif.
La nécessité d'une harmonisation entre les différents sports s'est fait sentir lors de la révision engagée en 2007. L'AMA est intervenue, a procédé à de larges consultations et adopté un standard minimum acceptable par tous, à savoir l'obligation pour les sportifs concernés - essentiellement des sportifs d'élite - de définir une heure par jour, entre 6 heures et 23 heures, au cours de laquelle ils peuvent être contrôlés. Liberté était laissée à chaque fédération pour aller plus loin. Certaines agences nationales ont été plus zélées que d'autres, mais doivent être visés les sujets présentant un risque. Une polémique a pu naître lorsque certains sports ont été confrontés à des questions inédites pour eux. Ce fut notamment le cas des sports collectifs. Au final, le système est toutefois largement accepté. Le Conseil d'État en a reconnu l'utilité ; quant au recours devant la CEDH, nous en verrons bien l'issue... Si l'on veut que les contrôles soient efficaces, il faut qu'ils aient aussi lieu hors compétitions, les tests en compétition étant très prévisibles.
Le système du passeport des athlètes, se fonde sur un profil sanguin ou à l'avenir, urinaire, suivi dans le temps, et nécessite de connaitre non seulement la localisation du sportif, mais aussi le calendrier de ses compétitions et des périodes de repos. Les experts doivent accéder à l'emploi du temps, aux activités de l'athlète, pour les mettre en rapport avec les éléments du profil sanguin. Ce système est aujourd'hui souhaité par beaucoup d'athlètes, qui veulent pratiquer leur sport dans un environnement assaini et relativement bien accepté.
Coureur cycliste entre 1985 et 1995, j'ai ensuite été consultant et organisateur de compétitions avant de diriger l'équipe Cofidis de 2005 à 2015. Cette dernière ayant connu des problèmes de dopage en 2004, ma mission première a été de redonner à chaque coureur la possibilité d'évoluer dans le peloton sans recourir à ces pratiques, quand bien même ce n'était pas le cas des équipes rivales. J'ai ainsi constaté l'échec total de l'Union cycliste internationale (UCI) patente dans l'affaire Armstrong, et sa complicité avec certains dirigeants d'équipes dans un sens qui n'était pas celui de la lutte antidopage. De même, j'ai observé que pour les médecins de certaines équipes, la protection de la santé des coureurs comptait moins que la recherche de la performance, à laquelle ils étaient financièrement intéressés. Tout cela est insupportable. La responsabilité des médecins des équipes est très engagée dans la lutte contre le dopage.
Les cyclistes ont été les premiers à pratiquer la géolocalisation. Ils ont accepté de se soumettre à ce dispositif très contraignant et complexe pour démontrer à quel point ils étaient prêts à participer à la lutte antidopage. Au-delà du passeport sanguin, qui est très intéressant mais n'a peut-être pas porté tous ses fruits, je pense qu'il faut instaurer un passeport physiologique permettant de contrôler, tout au long de sa carrière, la situation du sportif par rapport à ses propres limites. En effet, si un coureur passe de la 50e à la 5e place du Tour de France, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal.
juriste, responsable de la formation Mesgo (Master in european sport governance), au Centre de droit et d'économie du sport. - Juriste au Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges, je suis conseil juridique d'institutions sportives. J'ai abordé la question du dopage lorsque, travaillant au ministère de la jeunesse et des sports auprès de Sophie Chaillet, j'ai rédigé les décrets d'application de la loi de 2006 en particulier en matière disciplinaire. Je rédige des articles dans la revue du CDES et j'assure la présidence d'instances disciplinaires de la fédération française de gymnastique et de la fédération internationale de ski de montagne ainsi que des fonctions d'inspecteur disciplinaire auprès de l'Union of European football associations (UEFA). Le dopage est un fléau contre lequel il convient de lutter. C'est un phénomène structurel - plus qu'individuel - qui ne peut être abordé dans un cadre franco-français, mais dans celui de la réglementation européenne (Conseil de l'Europe) et internationale (AMA). Comme Serge Simon, je pense que l'enjeu de la lutte antidopage ne se limite pas à la santé publique ; il renvoie aux valeurs du sport, à son intégrité et à son exemplarité. Jusqu'à quel point peut-on porter atteinte aux libertés publiques au nom de cette lutte ? Quelle est l'efficacité réelle de cette dernière ? Force est de constater qu'elle n'est pas avérée. Que faire pour l'avenir ? Telles sont les principales questions soulevées par cette table ronde.

La lutte contre le dopage pose la question de la gouvernance des acteurs du monde sportif. En matière de dopage comme sur les autres sujets, le dialogue social au sein du sport français est-il suffisant ? Ne peut-on aller plus loin ? Sommes-nous en avance ou en retard par rapport à d'autres pays ?
Toutes les obligations de la lutte antidopage reposant sur les sportifs, les employeurs ne s'en occupent pas, ce qui est à mon avis un mauvais calcul de leur part. Le dialogue social n'existe pas. Du reste, la voix des joueurs n'est pas prise en compte dans les conseils d'administration de la ligue de football professionnel (LFP) et de la fédération. Les employeurs ne s'intéressent au sujet que lorsque l'un de leurs joueurs est contrôlé positif et que se déclenche l'agitation médiatique. S'ils nous encouragent officieusement à faire entendre notre voix, ils n'engagent eux-mêmes aucune démarche officielle.
Dans le système sportif français et international, le dialogue social est nul. Son organisation date d'un siècle. Un seul joueur siège au comité directeur de la fédération française de rugby ; et encore, coopté par les autres membres, il n'est en aucun cas le représentant des pratiquants. De même, sur les 13 membres du comité directeur on ne compte qu'un joueur. Nous ne pesons rien.
Nous sommes en retard sur les autres pays. Sans aller jusqu'aux États-Unis, où les employeurs et les sportifs professionnels négocient jusqu'au calendrier et au format des épreuves, il nous faut sortir du système dictatorial actuel, d'autant plus paradoxal que le sport est censé incarner la démocratie et les valeurs républicaines.
Il est d'autant plus difficile pour les pratiquants de s'exprimer que ce sont des présumés coupables ; leur parole est suspecte. M. Olivier Niggli se félicitait des chiffres de la géolocalisation. Mais sur les 13 738 contrôles en compétition, seules 222 infractions ont été constatées. Quant aux 17 166 contrôles effectués hors compétition, ils n'ont permis de caractériser que 28 infractions. On ne peut pas dire que la géolocalisation fasse preuve d'une efficacité torride...
M. Eric Boyer nous dit que les cyclistes avaient accepté de « se soumettre » à la géolocalisation. C'est révélateur. Il ne s'agit donc pas d'une question d'efficacité mais de l'acceptation d'une soumission par des sportifs, dont la parole est suspecte par nature.
En quoi les écrits de Coubertin portent-ils la marque d'un esprit démocratique ? Comme le sociologue marxiste Jean-Marie Brohm l'indique à juste titre, le sport est d'abord un univers de lois et de règles. Le problème en France est que nous avons confié aux fédérations des prérogatives de puissance publique sans toujours nous donner les moyens du contrôle.
Autre question : peut-on durablement traiter de la même façon les sportifs professionnels et amateurs ? Je pense que non. Même s'il y a des limites, le système américain qui distingue bien ces deux catégories - les amateurs relevant de la National Collegiate Athletic Association, les professionnels assurant le show - pourrait nous faire réfléchir. Peut-on leur par exemple leur imposer les mêmes règles en matière de géolocalisation ? J'ai signé un article intitulé « La géolocalisation, quand Big Brother s'invite chez les sportifs ». On ne peut pas l'envisager de la même manière dans l'une et l'autre catégorie.
Après avoir subi un certain ostracisme, après m'être heurté à l'absence de reconnaissance du dopage, je suis ravi que le problème soit aujourd'hui envisagé globalement. Mais j'ai un doute sur l'appréhension éthique du dopage. Le mouvement sportif est ambivalent et tend à considérer le dopage comme une affaire interne. L'éthique est un problème personnel. Si l'on considère le dopage uniquement comme une affaire éthique, on en laisse la responsabilité aux institutions sportives. Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un problème majeur de santé publique.
La disposition instaurée en 1999, sans que personne ne s'en émeuve, qui oblige un médecin à dénoncer un sportif qu'il suspecte de dopage est choquante. Vichy avait instauré une telle obligation pour les maladies sexuellement transmissibles. Toute une série de mesures sont ainsi inadaptées.
Une vision globale est nécessaire. Mais le sport amateur n'est pas le sport professionnel. Les sportifs amateurs sont représentés dans les fédérations, c'est bien, mais les résultats des élections sont aisément prédictibles. La démocratie a des progrès à faire.
A l'AMA, avons mené des discussions avec les syndicats de joueurs, notamment UNI Global. Le dialogue existe.
Beaucoup de sports ne sont pas représentés par des syndicats. Au sein du Comité olympique, les athlètes élisent leurs représentants au Comité des athlètes. Il ne s'agit donc pas simplement d'un dialogue social entre les athlètes et le monde sportif. Beaucoup d'athlètes ne se sentent pas représentés et s'expriment grâce à ces instances.
Tout le monde convient que les chiffres disponibles ne sont pas satisfaisants. De plus, il faut les manier avec précaution : attention à ne pas comparer des pommes avec des poires ! La liste des substances interdites est deux fois plus longue en compétition qu'hors compétition et les probabilités de résultats positifs sont donc très différentes. Nous devons à l'évidence disposer de meilleures données pour élaborer des statistiques plus fiables.
Les athlètes, qui pratiquent un sport professionnel et sont soumis à l'exigence de résultats, sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont personne vers qui se tourner en cas de problèmes. Ainsi, à l'UCI, le représentant des coureurs est nommé par le président de l'institution, qui détermine aussi son budget !
Aux États-Unis la réglementation est fondée sur le dialogue social et les collective agreements. Dans certains pays européens le dialogue social est balbutiant, la France est dans une situation médiane à cet égard.
Je partage l'avis de M. Lapouble : à l'heure actuelle, le mouvement sportif n'est pas capable de résoudre seul le problème du dopage. Il faudrait interroger des représentants des employeurs ou des ligues.

Estimez-vous que la lutte contre le dopage affecte excessivement les droits des sportifs ou que ces atteintes restent proportionnées au but recherché ?
Aux États-Unis, la lutte contre le dopage a pris le plus de retard dans les disciplines qui se sont dotées précocement d'une organisation professionnelle. Voyez le base-ball : il faut faire le show. Donc l'auto-organisation n'est pas nécessairement le gage de l'efficacité.

Des membres de notre commission se sont récemment rendus outre-Atlantique. Il y aurait beaucoup à dire.

La proportion de contrôles positifs dans les disciplines non olympiques aux Etats-Unis est de 1 % à 2 %, la même que dans les disciplines olympiques en France.
On ne peut exiger les mêmes contraintes des sportifs amateurs et des sportifs professionnels, dotés de moyens.
L'égalité des sportifs n'a jamais existé. C'est une fiction juridique, un pur concept. Les sportifs sont-ils des sous-citoyens ? Non. Mais comme tout système le sport a ses règles qu'il faut respecter, de même que doit l'être le règlement intérieur d'une entreprise par ses salariés. On prête au sport une vertu d'exemplarité et aux sportifs des qualités morales qu'ils n'ont peut-être pas. Les médias s'étonnent de leurs défauts mais ils sont des êtres humains comme les autres.
Il n'est pas anormal que les règles du système soient respectées. Je ne vois pas d'inconvénients à la géolocalisation, même si les modalités peuvent être adoptées. Selon Willy Voet, Christophe Bassons, pourtant meilleur au début de la saison, avait vu ses résultats baisser quand les autres ont commencé à prendre des produits dopants. Ainsi le passeport biologique et/ou physiologique serait un bon remède et permettrait d'alléger les contraintes de la géolocalisation.
Pour apprécier la proportionnalité des moyens, il nous faudrait un constat de départ, des chiffres permettant de dresser l'état des lieux, de fixer des objectifs et d'apprécier les résultats obtenus, d'évaluer les politiques mises en oeuvre. Or c'est impossible, les statistiques ne sont pas fiables, comme vient de le dire M. Niggli. Si demain, il faut implanter des puces électroniques aux sportifs, pourquoi pas, si un danger imminent est avéré ? Mais faute de données, de constat, de statistiques, le débat reste abstrait et entretient la suspicion : les sportifs sont suspectés de tricher dès lors qu'ils refusent de se soumettre à une nouvelle exigence. C'est l'Inquisition.
L'intérêt de cette commission d'enquête est d'aboutir à des données factuelles et de dépassionner le débat. Il s'agit de politiques publiques. Elles doivent être évaluées. Le paludisme n'intéresse pas les laboratoires pharmaceutiques car il concerne surtout le Sud : cet exemple montre que les acteurs d'un système en définissent les termes. Ici des organismes récoltent des fonds importants et doivent justifier de leur action. Soyons factuels !
Dans les sports collectifs, la géolocalisation cible un ou deux joueurs d'une équipe, faute de moyens selon l'AFLD. C'est injuste. De plus, ces joueurs ciblés ont conscience que le risque de contrôle est accru, ils ne se laisseront pas piéger. Fondamentalement, le remède est mal conçu. C'est pourquoi nous préférons les contrôles inopinés sur la base de tirages au sort. Cessons d'appliquer le modèle des sports individuels, où les athlètes déterminent eux-mêmes leur calendrier et leurs entraînements aux sports collectifs, où l'employeur décide de tout.
La proportionnalité est une préoccupation permanente. Il est difficile de tenir la balance entre le contrôle de tricheurs aux procédés sophistiqués, comme l'affaire Armstrong le révèle, et le droit des athlètes. L'AMA a mené de nombreuses consultations pour rédiger le Code. Elle demande l'opinion d'experts indépendants sur les questions délicates. L'ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme rendra un avis sur la révision en cours.
Il est toujours possible de s'appuyer sur l'absence de chiffres pour refuser d'agir. Mais les agences antidopage bénéficient de remontées d'informations importantes...
Lesquelles ?
L'affaire Armstrong est révélatrice ! Lisez les témoignages !
Cessez de généraliser ! Soyons concrets et répondons aux problèmes identifiés.
Ne nous focalisons pas uniquement sur les chiffres. Les statistiques futures seront meilleures puisque l'AMA, qui ne dispose pas de statistiques fiables des agences nationales, a demandé aux laboratoires de lui adresser directement des données. D'ici là, ne restons pas inactifs, au prétexte que nous n'aurions pas de statistiques.
Depuis l'affaire Festina, les procédés de la lutte antidopage sont à la limite de la légalité et du respect des droits des sportifs. Mais l'état des coureurs le justifiait.
Multiplier les contrôles ne sert à rien. Ils sont inefficaces. Armstrong en a subi de nombreux sans jamais être pris. Plus importants sont la qualité des contrôles et le choix du moment. La géolocalisation paraît efficace à cet égard. Il faut aussi donner les moyens aux scientifiques de détecter les nouvelles molécules mises au point par la médecine. Le sportif qui veut tricher est très vite informé, en effet, des nouvelles découvertes été capable de les utiliser tout aussitôt.
Le dispositif de lutte contre le dopage porte indéniablement atteinte aux libertés individuelles des sportifs ; mais, d'un point de vue juridique, il paraît proportionné au regard des objectifs, même si des progrès pourront être réalisés en concertation avec les sportifs.
Je suis ravi que M. Niggli reconnaisse que nous manquons d'un état des lieux chiffré. Comment apprécier dès lors la proportionnalité ? C'est la quadrature du cercle.
Monsieur Lapouble, chaque système a ses règles certes. Mais celles-ci doivent être conformes à la loi. Un salarié peut contester le règlement intérieur d'une entreprise qui y contreviendrait.
La lutte contre le dopage est-elle efficace ? Deux critères permettent d'apprécier l'efficacité d'un test : la sensibilité, soit la capacité de détecter une molécule, et la spécificité, la capacité à cibler la molécule recherchée. Or les contrôles urinaires ne sont ni sensibles, l'affaire Armstrong le démontre, ni spécifiques, car ils multiplient les faux positifs : un contrôle positif ne signifie pas que le sportif est dopé, mais révèle simplement une consommation de cannabis, d'un produit soumis à autorisation temporaire d'utilisation (AUT), ou d'une substance sans effet sur les performances.
Je n'ai pas l'ambition de réformer la lutte antidopage. Mon seul objectif est de gagner en lucidité, de mettre un terme à une escalade sans fondement qui s'auto-entretient : l'inefficacité des procédés à supprimer le fléau crée une surenchère. L'impérieux besoin d'agir ne répond pas à un souci d'efficacité mais sert à démontrer la détermination. Prenons un peu de recul ! Cessons de franchir les lignes et de faire des sportifs des sous-citoyens. Sur la réforme de la lutte antidopage, laissez-moi un peu de temps...

Le temps presse, à vous entendre, mais vous ne proposez guère de solution....

L'Union nationale des coureurs professionnels se disait favorable à la localisation dès 2002 et aux contrôles inopinés dès 2006. Dans les arbitrages à venir, l'accent doit être mis sur les contrôles inopinés.
Les garanties de confidentialité des données collectées par le système ADAMS (système d'administration et de gestion antidopage) sont-elles suffisantes ?
J'ai signé un article sur le sujet. J'ai émis les mêmes doutes sur le système ADAMS que pour tout système de transfert de données. Les données collectées par l'AFLD sur les sportifs français sont transmises à l'AMA à Montréal, sous l'autorité de la Commission d'accès à l'information du Québec, puis transmises à des pays tiers si le sportif voyage : le degré de protection y est alors variable, tributaire de failles informatiques, ou d'indiscrétions. Il faut être vigilant, surtout quand les données sont transférées dans des pays où il n'y a aucune sécurité technique ou juridique.
Quant à la reconnaissance du dopage, elle relève de la sociologie non de la science expérimentale. Il y a 25 ans déjà on niait l'existence du dopage, en pointant l'absence de constat. L'affaire Armstrong révèle aussi un système mafieux destiné à éviter les contrôles, et à masquer ou subtiliser les résultats des contrôles positifs.
Monsieur Simon, les faux positifs sont très rares, ce sont des accidents, ils ne sont pas générés par le système. Un résultat d'analyse de laboratoire ne devient un contrôle positif qu'en l'absence d'explications valables (autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, par exemple).
Les informations recueillies par le logiciel ADAMS sont stockées sur un serveur à Montréal. Nous attendons que l'Union européenne reconnaisse que la législation québécoise, très proche de la législation française, offre un degré de protection suffisant.
Surtout les données ne sont accessibles qu'aux acteurs autorisés : athlètes, fédérations internationales et agences nationales compétentes. Une agence nationale peut autoriser, de manière volontaire, une organisation étrangère, dans le pays où se rend le sportif, à prendre en charge des contrôles et à y avoir si elle estime que les garanties sont suffisantes. Ce ne peut être qu'un acte volontaire, qui peut être conclu par contrat. Il n'y a pas de partage immédiat et généralisé d'informations. Le système est cloisonné. Le système ADAMS offre le plus de protections aux sportifs. Sinon les informations circulent selon des voies non sécurisées : méls, fax, etc. Tout système informatique présente des risques, mais l'AMA investit et met tout en oeuvre pour augmenter sa sécurité.

La pénalisation de l'usage des produits est-elle nécessaire, notamment pour faciliter les enquêtes ? Certains parlent à ce propos de « double peine ». Que pensez-vous des sanctions collectives dans les sports collectifs ?
La punition collective, c'est le retour du droit colonial !
Autant la pénalisation de certaines infractions commises par les entourages des sportifs est indispensable, car le dopage est un système global, autant pour les athlètes eux-mêmes, la sanction sportive paraît suffisante.
Il faut réfléchir à la possibilité de sanctionner les clubs. Les sanctions actuellement pèsent sur les seuls athlètes. D'autres pistes peuvent être envisagées. L'UEFA a déjà prévu des sanctions progressives à l'égard des clubs.
La sanction sportive paraît suffisante. Il faut être prudent : des accidents existent, des coureurs peuvent recourir à certains produits avec d'autres fins que d'améliorer leurs performances. Le cycliste est le dernier maillon d'une chaîne. Le dopage réclame la complicité de médecins, des dirigeants. Les médecins en Italie sont à peine poursuivis. Les lois en Espagne n'étaient pas adaptées à la faute du docteur Fuentes dans l'affaire Puerto. Des sanctions pénales sont nécessaires dans ces cas.
Il est indispensable que l'entourage du sportif puisse être poursuivi pénalement. Est-il nécessaire de pénaliser le dopage pour déclencher des enquêtes ? La réponse dépend des systèmes juridiques. Elle sera diverse. L'Italie, où le dopage est un délit, n'a jamais mis un athlète en prison mais a pu diligenter des enquêtes grâce à ce cadre juridique, qui a permis à la police et aux douanes de travailler.
Ne sous-estimons pas le poids de la sanction sportive. Deux années de suspension représentent une sanction très dissuasive pour un sportif professionnel. Surtout pas de sanctions collectives, sauf à considérer que la lutte antidopage concerne tous les joueurs de la même équipe de la même façon, ce qui est loin d'être le cas.
Je suis opposé à la pénalisation de l'usage des produits dopants tant que la lutte antidopage ne s'appuiera pas sur des données et des méthodes solides.
La détention de produits est déjà pénalisée en droit français. Cette disposition permet d'ouvrir des enquêtes. Les peines collectives paraissent aberrantes. L'affaire Armstrong a été révélée, non par un procureur, qui a fait chou blanc, mais par une commission administrative qui a mené l'enquête. Si l'on s'en donne les moyens, on peut utiliser d'autres voies que la pénalisation pour traquer le dopage.
Mme Delmas-Marty, professeur au collège de France, écrivait que la sanction administrative ou disciplinaire est souvent plus sévère que la sanction pénale.

Il est temps de présenter vos conclusions, en évoquant le passeport biologique.
Un mot sur la définition du dopage. D'un point de vue juridique, le dopage est caractérisé par une infraction à la législation antidopage. Il convient de réfléchir à la définition de ces infractions, comme l'AMA le fait à l'occasion de la révision du Code.
Les atteintes aux libertés individuelles paraissent proportionnées et justifiées.
N'oublions pas non plus le contexte international, sans nous focaliser sur certaines disciplines médiatiques. Sans doute faudra-t-il refonder la lutte contre le dopage, sur la base d'études nouvelles, sans se dispenser d'agir pour autant. Il serait en effet souhaitable de disposer de chiffres sur les conséquences du dopage sur la santé des athlètes à long terme.
Enfin, le passeport biologique n'est pas encore entré en vigueur en France, même si son introduction dans la loi a été décidée. A priori, vu l'inefficacité des contrôles, il apparaît comme une mesure pertinente, au même titre que la géolocalisation.
Lorsqu'à vingt ans j'ai souhaité devenir coureur cycliste, je n'imaginais pas à quel point le dopage était répandu dans ce sport. Tous mes camarades l'ont rencontré un jour ou l'autre. Le dopage résulte d'une rencontre, non d'un plan prémédité. Il est aussi l'héritage de nos pères. Il m'est arrivé de rêver de démarrer ma carrière sans cet héritage. J'ai rencontré le dopage alors que je venais de fonder une famille et que mes résultats n'étaient pas à la hauteur. J'étais seul, sans personne à qui me confier. Les gamins qui se lancent aujourd'hui doivent pouvoir trouver une oreille attentive et des solutions face au dopage.
La géolocalisation est contraignante mais efficace : elle dissuade les coureurs de partir loin pour mettre en place un protocole de dopage.
Le passeport biologique ? Pourquoi pas ? Mais le passeport physiologique semble préférable, et permettra d'accompagner un athlète en difficulté à franchir des caps et non à prendre des décisions regrettables.
Difficile de mieux décrire la raison d'être de la lutte antidopage ! Ce témoignage rejoint celui de nombreux athlètes qui souhaitent un sport propre ; il est la meilleure réponse à ceux qui évoquent l'absence de statistiques.
La lutte antidopage est en mutation. Outre les contrôles, elle peut s'appuyer sur les collaborations avec l'industrie pharmaceutique, les investigations, etc. Tous les moyens au niveau national comme international doivent être mobilisés.
La géolocalisation est indispensable. Les nouvelles technologies, grâce notamment aux applications mobiles, facilitent le quotidien des sportifs.
Le passeport permettra de mieux cibler les contrôles, d'améliorer leur efficacité et de suivre les athlètes venant de pays où les contrôles sont défaillants.
Il ne faut pas baisser la garde. L'affaire Armstrong a montré la sophistication des tricheurs. Les athlètes nous demandent de protéger le sport.
J'ai commencé à jouer au foot à partir de 5-6 ans, j'ai été footballeur professionnel jusqu'à 38 ans. Le témoignage d'Eric Boyer m'a fait frissonner. J'ai eu beaucoup de chance, je n'ai jamais rencontré le dopage.
Je plains les footballeurs désignés au sein des équipes pour être géolocalisés. Ils sont contraints de penser quotidiennement au dopage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dopage dans le football.
Nous avons cinq propositions. Tout d'abord supprimons l'exigence de localisation individuelle dans les disciplines collectives. Il est significatif que seul le nom d'Armstrong ait été autant évoqué ce matin. Remplaçons-la par une localisation collective pendant la saison sportive sous la responsabilité de l'employeur, seul décideur en la matière, et maître de l'agenda sportif, à la différence des sports individuels.
Suivons également la préconisation de l'AMA - c'est l'un de mes rares points d'accord avec M. Niggli - soutenue par la FIFA, mais non appliquée en France, selon laquelle seuls doivent être choisis dans le groupe cible les sportifs désignés par le collège scientifique de l'AFLD après une évaluation des risques pertinents.
Renforçons les contrôles inopinés sur le lieu de travail et sur tout l'effectif, de manière aléatoire, autant de fois que nécessaire.
Les syndicats de sportifs doivent être soutenus dans la mise en place de programmes de sensibilisation ou de formation à destination notamment des centres de formation. Les syndicats de footballeurs à cet égard sont très représentatifs : 96 % des footballeurs professionnels adhèrent à l'Union nationale des footballeurs professionnels.
Enfin les fédérations doivent remplir les objectifs qui leur sont attribués par les conventions signées avec les ministères, notamment en matière de prévention et de lutte contre le dopage.
La lutte antidopage, comme toute politique publique, doit rendre des comptes de ses moyens, de ses méthodes, de ses objectifs.
Elle doit accepter les critiques. Ainsi de la géolocalisation. Nous ne souhaitons pas nous soustraire au contrôle. La simple lecture de la presse permet de savoir où les mille rugbymen professionnels se situent en permanence. Donc oui à la localisation, mais avec des procédés simples. Oui aussi aux contrôles inopinés. La géolocalisation est coûteuse et impossible à évaluer. Le rapport de l'AFLD ne mentionne aucun contrôle positif en résultant. Deux rugbymen seulement ont été suspendus pour « no show », Yohan Huget et Djibril Camara. Un an de suspension parce qu'on ne sait pas manipuler un logiciel : on marche sur la tête ! La lutte antidopage doit respecter les libertés individuelles et justifier les entorses éventuelles avec soin.
Armstrong était un invité de marque aujourd'hui ! Monsieur Niggli, cette affaire n'est pas l'étendard de la lutte antidopage mais constitue plutôt la preuve de son échec : c'est une enquête administrative qui a fait chuter Armstrong. Tout le monde savait. D'autres méthodes sont disponibles que la biologie pour collecter des preuves : des témoignages, des saisies de disques durs, etc. Cessons de nous focaliser sur une méthode unique dont l'échec nous pousse à la surenchère. Sortons du dogmatisme, appuyons-nous sur des faits et libérons la parole. L'extrême sensibilité médiatique de ce sujet rend impossible toute discussion. Armstrong est tombé car la parole s'est libérée, notamment grâce aux témoignages des athlètes. Ceux-ci sont des êtres responsables. Ils sont les premiers concernés ! Comment envisager de ne pas les associer ? Ecoutons-les ! Le sportif n'est pas d'abord un suspect.
Il convient de distinguer le sport professionnel du sport amateur qui ne doit pas supporter les mêmes contraintes.
Dans les commissions disciplinaires fédérales il est nécessaire que les professionnels soient représentés. Rendons les séances disciplinaires publiques, comme l'avait réclamé Christophe Bassons. Cela contribuera à libérer la parole et évitera les rumeurs.
En outre, il convient d'unifier le régime juridique des sanctions prise par les fédérations. Actuellement, si l'AFLD ne fait pas appel, le tribunal administratif du domicile du sportif est compétent ; en cas d'appel, le Conseil d'État sera compétent. L'AFLD doit être saisie de l'ensemble des appels, puis le Conseil d'État statuera éventuellement.
Les statuts et les règlements doivent être relus. Dans l'affaire Bassons, la fédération française de cyclisme s'est attribué à tort le pouvoir réglementaire, à la place du gouvernement. Pourtant le ministère avait contrôlé le règlement.
J'en terminerai par le rôle des fédérations internationales. Certaines fonctionnent à l'envers : la lutte contre le dopage n'est pas leur premier objectif. Bien plutôt, elles souhaitent éviter qu'on en parle. C'est le cas de l'UCI, mais pas uniquement - même si l'UCI est la seule à s'être fait prendre.
Merci pour votre invitation. Je suis impatient de lire les conclusions de votre commission d'enquête.

Merci à vous. Notre travail va continuer. Nous organiserons d'autres rencontres. Notre rôle : apporter un complément aux textes existants. Merci pour votre participation et votre franchise.