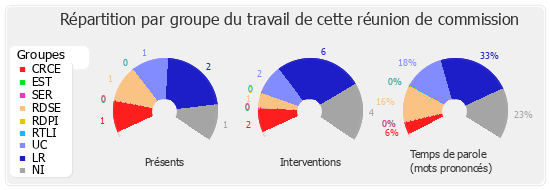Commission des affaires sociales
Réunion du 13 janvier 2011 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède à l'audition de M. Emmanuel Halais, philosophe, maître de conférences à l'Université de Picardie-Jules Verne.

Dans le cadre de nos travaux sur les propositions de loi relatives à l'aide active à mourir, nous accueillons Emmanuel Halais, maître de conférences en philosophie à l'université de Picardie-Jules Verne.

Après les auditions d'hier, essentiellement consacrées à des acteurs du monde associatif, il m'a semblé intéressant d'entendre Emmanuel Halais, philosophe, qui a eu la gentillesse de m'adresser son ouvrage intitulé L'euthanasie, à travers le cas de Vincent Humbert. Cet ouvrage, petit par sa taille mais non par son contenu, apporte un éclairage sur la détresse de certains de nos concitoyens et la gestion de la fin de vie.
Quelle est la valeur de la vie humaine et donc de la mort humaine ? Telle est la question que pose avec force le cas de Vincent Humbert. Ce dernier, parce qu'il a interprété sa situation en termes de droit, a provoqué une réflexion sur le thème de l'euthanasie et du traitement de la mort dans nos sociétés, qui a indéniablement entraîné une évolution des mentalités. Pour ma part, je voudrais m'interroger sur la question philosophique qui sous-tend ces débats : la vie humaine a-t-elle un sens ? Comment le définir ? Est-il acquis et peut-il donc être perdu, ou est-il inhérent à la vie ? Et, en définitive, qu'entend-on par vie humaine ? Cette interrogation, susceptible d'un traitement abstrait et pointu, n'est pas seulement une affaire de spécialistes, comme peuvent l'être des problèmes de physique ou de mathématiques, car la vie humaine est ce qui nous définit, à la fois collectivement et individuellement. La question de sa valeur est difficile. Non qu'elle soit technique, mais ce qui est le plus proche est parfois plus difficile à voir que ce qui est loin. Elle est redoutable parce qu'elle présuppose un aperçu du tout de sa propre vie, qui peut être effrayant ou nous renvoyer une image de nous-mêmes déplaisante.
L'être humain est ce qui nous définit en tant qu'espèce. La notion est directement morale, a montré la philosophe américaine Cora Diamond. De fait, elle recouvre le sens que nous donnons à la vie et à la mort à travers les rites, l'attribution des noms, la préservation de la mémoire des morts et l'idée d'une solidarité liée à notre destin commun de mortels dont la compassion tire sa source. Si j'ai parlé d'espèce, la notion d'être humain, telle qu'elle ressort des rites du baptême ou de l'enterrement, n'est pas réductible à la biologie, aux questions d'embryologie ou de mort des cellules. Autrement dit, la notion d'être humain est culturellement forgée ; elle est ce que nous en faisons dans les rites, la littérature et l'art. Nous ferions donc fausse route en cherchant à fonder nos jugements moraux sur des faits objectifs, croyant emprunter une démarche scientifique. Enfin, la notion dépend de la manière dont elle est, au fil des générations, investie d'un sens.
Cette démarche d'investissement de sens est également individuelle. Le sens qu'un individu donne à sa propre vie, s'il est rarement formulable, est lié à la possibilité globale d'un accomplissement : celle de ressentir une coïncidence entre ce que l'on fait et ce que l'on est dans sa relation à l'autre, dans la réalisation d'ambitions ou d'une vocation ou encore dans le regard porté sur le monde, le tout formant un entrelacs. La notion de vie individuelle, comme celle d'être humain, est donc subjective : elle dépend de la relation que l'individu entretient avec sa propre vie. Par conséquent, ce sens lui est, si l'on veut, immanent. L'individu est le seul à faire, au sens strict, l'épreuve de sa propre vie. Pour autant, le sens de la vie ne découle pas d'une décision individuelle. Il n'existe pas d'acte par lequel l'individu le détermine. Au reste, cette conception volontariste s'accorde fort peu avec le sentiment que l'on a parfois de ne pas être maître de sa vie, que l'on exprime en évoquant un destin.
Il existe donc deux manières de poser la question du sens de la vie. Si l'on retient une perspective collective, la réponse passe par le sentiment que la vie humaine est précieuse. Il apparaît, de manière évidente, lorsqu'une vie animale et une vie humaine sont dans la balance et qu'il faut faire un choix. Le caractère spécifique de la vie humaine peut aussi être un objet de contemplation et matière à élaboration artistique. Si l'on pose la question de manière individuelle, le sens de la vie n'est autre que le sentiment positif ou négatif accompagnant tout ce que l'on vit. Toute schématisation doit être évitée : personne ne dispose d'un appareil de mesure objectif. La qualité de la vie ne se mesure pas comme on pèse des livres de pommes chez l'épicier. Ensuite, nous ne ressentons pas ce sentiment en toute occasion ; il n'est pas consultable à loisir. Toutefois, notre vie nous renvoie un sentiment global, celui d'une qualité liée à l'adéquation plus ou moins grande entre ce que l'on fait et ce que l'on est. C'est le sentiment de l'allure que notre vie a, de sa couleur ou de sa forme globale. Celui-ci évolue, voire change du tout au tout en cas de rupture brutale dans le cours des événements. Peut-être est-il plus vivement ressenti lorsqu'il est négatif. Le récit de Vincent Humbert éclaire cette difficile question, nous oblige à l'envisager sous un angle qui ne soit pas seulement abstrait. Une rupture brutale dans le cours des événements définit un avant et un après, un sens des possibilités au plus haut qui lui est brutalement retiré. Etablir des critères objectifs afin de déterminer quelle vie vaut la peine d'être vécue aurait des conséquences pratiques terribles : tels individus mériteraient de vivre, d'autres non.
A cette manière froide de considérer les valeurs de la vie, on peut opposer le caractère précieux de la vie humaine en tant que tel. Les jugements que nous portons sur les autres et nous-mêmes dans la vie quotidienne - celui-ci a eu une vie bien remplie et heureuse, l'autre l'a gaspillée en pure perte - ont une portée limitée : nos conseils sont rarement suivis, réformer sa propre vie est un exercice difficile. Mais Vincent Humbert demandait à sa mère de partager le jugement qu'il portait sur sa propre vie, à savoir qu'elle était absurde, et d'en tirer les conséquences les plus sérieuses. Selon lui, les conditions mêmes du sens d'une vie individuelle n'étant pas remplies, mieux valait mourir. Toute la difficulté vient de ce que nous voudrions des faits objectifs, discriminants quant au sens ou à l'absurdité d'une existence. Après un terrible accident, Vincent Humbert a connu des blessures irréversibles. Mais cela n'explique pas la maturation aboutissant au verdict que son existence ne vaut pas la peine. Celui-ci relève de la subjectivité, du rapport exclusif de l'individu à sa propre vie. Dès lors, seuls l'empathie et un effort positif de l'imagination y donnent accès. Le même effort est nécessaire pour comprendre le courage et l'amour extraordinaires qu'il a fallu à Marie Humbert pour abréger les souffrances de son fils. Or nos capacités sont limitées car nous sommes rarement confrontés à des cas aussi extrêmes.
Le récit de Vincent Humbert nous force à nous demander ce que nous ferions, placés dans la situation du fils ou celle de la mère. S'il est impossible de répondre à cette question, nous pouvons comprendre la conséquence que Vincent Humbert avait tirée d'une vie qu'il considérait dénuée de sens et de son inquiétude quant au sort que la justice humaine réserverait à sa mère.

D'après vous, comment Vincent Humbert, après que le Président de la République a répondu négativement à sa demande, est-il parvenu à convaincre sa mère et le docteur Chaussoy de prendre tous les risques en abrégeant ses souffrances ? Par un processus de compassion ou de raisonnement rationnel ?

La situation de Vincent Humbert est très particulière tandis que nous sommes saisis de propositions de loi dont la portée est générale. N'est-il pas contradictoire de légiférer pour des cas particuliers ? Ceux qui, comme moi, sont opposés à ce texte, avancent la notion de dignité humaine, qui est pour nous un absolu. Qu'en pensez-vous ?
Monsieur Godefroy, la réponse à votre question se trouve dans le récit de Vincent Humbert que le journaliste Frédéric Veille a recueilli, avant d'écrire sa biographie. Bien que totalement paralysé, Vincent Humbert était animé par une volonté incroyable. Il a imposé à sa mère et à son médecin - et à travers eux, à l'opinion - une décision à laquelle ils étaient initialement opposés. Ont-ils cédé par compassion ? J'ai l'impression qu'ils se sont plutôt rendus à ses raisons.

Autrement dit, le raisonnement et la force de conviction de Vincent Humbert ont été plus déterminants que la compassion.
Certes, mais je ne suis pas certain qu'on puisse codifier ce processus d'adhésion...
Monsieur Lardeux, dans le texte que j'ai écrit, L'euthanasie, à travers le cas de Vincent Humbert, j'ai dit mon embarras devant la contradiction qui ressort du récit de Vincent Humbert : sa vie est dénuée de sens, dit-il, mais il veut la transformer en une question de droit, qu'il appelle le droit à mourir. La valeur de la vie, me semble-t-il, est essentiellement subjective. Et Vincent Humbert a peut-être eu tort de vouloir transformer son cas particulier en question de droit.
Quant à la proposition de loi, elle me semble justifiée, mais non pour les raisons que Vincent Humbert avance.
Les deux camps sont fondés à invoquer cette notion philosophique et religieuse...
D'un côté, la dignité humaine impose que l'on regarde toute vie comme précieuse, quelles qu'en soient les conditions ; de l'autre, elle justifie qu'on mette fin à une vie individuelle dégradée. Bref, elle ne permet pas de trancher.
Je peux essayer d'y répondre. La vie humaine est précieuse en tant que telle, mais elle peut être dégradée à tel point que l'on veuille y mettre un terme. La question doit être envisagée sous les deux angles : collectif et individuel.

N'ayant eu aucun contact avec M. Halais avant cette audition, sinon que j'ai lu son texte, j'aimerais savoir en quoi la proposition de loi lui semble justifiée.
Elle représente un progrès pour les libertés individuelles. La législation actuelle ne prend pas suffisamment en compte la situation des personnes en fin de vie.

Comment passer de la décision subjective de M. Humbert, que vous avez maintes fois soulignée, au cadre objectif de la loi ?

Monsieur Halais, puisqu'il s'agit de libertés individuelles, ne pensez-vous pas qu'il faut établir un parallèle entre les souhaits des vivants et les dernières volontés des défunts ? Certains veulent être incinérés ; d'autres souhaitent que personne n'assiste à leur enterrement. Nous faisons en sorte de respecter leurs testaments, qu'ils soient écrits ou oraux. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les vivants ? Adolescente, je me souviens de mon oncle à l'hôpital. Il m'avait implorée de le débrancher ; je ne l'ai pas fait mais je garde ce souvenir.

La valeur de la vie est affaire de subjectivité, avez-vous dit. Celle-ci peut être altérée par certains états psychiques. De nombreuses personnes pensent que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue, sans être atteintes par le délabrement physique. Sur quels critères les médecins fonderont-ils leur jugement ? Comment juger de la dégradation de l'état physique ?
En outre, Vincent Humbert n'était pas en fin de vie de même que de nombreuses personnes tétraplégiques. Faut-il les inclure dans le champ des textes sur l'aide active à mourir ou en rester à la grand-mère de quatre-vingt-dix ans, sans famille, grabataire depuis des années ? La loi peut-elle fixer la limite ou mieux vaut-il en rester à la situation actuelle où la décision est prise après discussion ?
Enfin, à quel âge est-on capable de porter un jugement sur sa propre vie ? Les textes excluent les mineurs. Qu'en est-il de la personne de dix-huit ans, quelles que soient ses conditions physiques ?
Monsieur Barbier, la différence est effectivement grande entre Vincent Humbert et les personnes en fin de vie. Dans son récit, il se plaint d'ailleurs ironiquement de ce corps physique qui lui a été restitué intact et lui permettrait de vivre très vieux. C'est une des raisons pour lesquelles il demande à sa mère de mettre fin à sa vie.
La question de l'altération du jugement me semble insoluble. Parler de subjectivité suppose effectivement que la personne soit consciente. Mais sur quels critères psychologiques l'évaluer ? D'où la difficulté à faire entrer cette question, qui relève de la subjectivité, dans un cadre juridique. Ce passage est très difficile.
La décision de mourir relève de l'intime. Hélas, on ne peut pas s'en tenir là : il faut protéger les proches et les médecins qui entourent la personne. Et donc trouver un cadre objectif...
J'en viens au parallèle entre les volontés des morts et des vivants...

Je vise seulement les personnes qui n'ont pas la capacité physique de mettre fin à leur vie ; les autres ont le choix.
Le parallèle existe, mais la démarche est différente : prévoir sa fin de vie suppose une réflexion sur soi et non sur ce que les autres feront après votre disparition. En revanche, je suis plutôt favorable à un document juridique établissant les volontés pour la fin de vie : ce serait un bon outil mis à la disposition des personnes.

Y a-t-il une définition objective de la dégradation ? Si tel est le cas, s'établit-elle sur des critères cliniques ? N'est-ce pas renvoyer la responsabilité aux médecins ? Quelle sera leur position lorsqu'ils entreront dans la chambre d'un patient en ignorant si l'on attend d'eux un traitement ou la mort ? A défaut de critères cliniques, comment établir une norme objective de la dégradation et de la souffrance pour aboutir à un cadre juridique ?
Les critères cliniques ne peuvent pas suffire. Si la personne est consciente, le rapport qu'elle a à son corps et à sa souffrance ne peut pas être objectivé. L'élément subjectif est irréductible.

Merci de votre exposé qui s'ajoute à une longue liste d'auditions que nous menons sur ce sujet depuis plusieurs années. Un élément me semble nouveau : le partage du jugement et la capacité à faire partager son jugement sur sa propre vie. Il est d'autant plus facile de comprendre la décision de mourir que l'on partage la vie quotidienne de celui qui la prend. Dans L'Ultime liberté ?, Axel Kahn s'évertue à tuer le titre de son essai pour le ressusciter à la fin : il s'accorde la liberté d'aider ses proches à mourir, après avoir montré pourquoi il ne reconnaissait pas le droit à mourir. En revanche, il dit vouloir être jugé pour son acte. Mieux vaut donc peut-être s'en tenir à un cadre légal de contrôle a posteriori afin de sanctionner les personnes agissant par intérêt et éviter la cour d'assises à Marie Humbert et au docteur Chaussoy, plutôt que de créer les conditions préalables de l'aide active à mourir. Qu'en pensez-vous ?
Je pencherais plutôt pour la deuxième option, même s'il serait préférable que ces questions restent du domaine de l'intime. Mais je ne suis pas juriste...

Le docteur Chaussoy a commencé par sauver Vincent Humbert - mais le procureur de la République avait été informé par un de ses collègues, demandait que l'on sépare la mère et le fils et avait d'ores et déjà annoncé qu'en cas de décès, il instruirait pour meurtre. La solution proposée par M. About n'empêche pas l'instruction.

La tierce personne pourrait, dès l'acte, faire appel à une instance qui mettrait fin à la procédure judiciaire et éviterait les poursuites. Ce n'est pas la même chose que ce que l'on connaît actuellement.

Le docteur Chaussoy est passé à l'acte car Vincent Humbert se serait trouvé privé de sa mère, qui lui était indispensable ! Cette problématique est au coeur de ma réflexion. Je doute que l'idée de M. About règle le problème.

Je me réjouis que l'on ait invité un philosophe ; cela nous conduit à réfléchir autrement. La notion d'être humain est culturellement forgée, et le sens de la qualité de la vie dépend de l'adéquation entre ce que l'on est et ce que l'on fait, dites-vous. Qu'en est-il alors de la notion d'ultime liberté, au regard de votre définition de la dignité humaine ? Y a-t-il un moment où la vie n'est plus digne, tant elle est dévastée ? Respecter la dignité humaine, n'est-ce pas surtout respecter l'ultime liberté ?
Mme Procaccia a soulevé l'apparent paradoxe entre respect de la volonté du défunt et de celle du vivant. Comment peut-on être à ce point réticent à respecter l'ultime volonté du vivant et à ce point attaché à la volonté du défunt ?

Il peut être par exemple difficile pour les proches d'accepter la volonté du défunt d'être incinéré. N'empêche que cette volonté est respectée. Il est paradoxal d'être moins respectueux de l'ultime liberté du vivant !
Ce n'est pas si paradoxal, dès lors que l'idée de vie humaine est culturellement forgée. Le respect de la volonté du défunt passe par un processus juridique, le testament, mais s'accompagne surtout de la notion, culturelle, de l'importance qu'il y a à respecter cette volonté.
La réflexion sur la fin de vie, en revanche, n'est pas encore culturellement forgée. Les choses évoluent, nous changeons, mais nous négligeons encore cette question car il y un aveuglement devant la place de la mort dans nos sociétés.

L'anticipation n'est pas la même selon que je suis bien portant ou que je souffre d'un cancer meurtrier, selon que je suis en début ou en fin de traitement. Puis-je dire aujourd'hui ce que je souhaite pour ma propre mort ? Notre problème est que nous légiférons sur la mort de l'autre !
On peut toujours anticiper sur les conditions de sa propre mort, qui fait l'objet d'un document écrit, document qui peut toujours être révoqué si l'on change d'avis.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Hier, M. Romero nous disait qu'une belle histoire d'amour pourrait le faire changer d'avis, même si son état était insupportable : une anticipation peut toujours être révoquée !
La commission procède enfin à l'audition de M. Régis Aubry, président de l'observatoire national de la fin de vie.
Vous m'interrogez sur la vision de l'observatoire sur les questions soulevées par vos trois propositions de loi.
A la suite du rapport de votre groupe de travail, l'observatoire, qui vient d'être créé, a dressé un état des lieux des connaissances fournies par la recherche sur l'euthanasie et le suicide assisté. Nous avons synthétisé les publications scientifiques et invité des chercheurs, l'objectif du séminaire étant de développer la recherche sur ces questions afin d'alimenter le débat. Cette réunion, fort intéressante, a souligné la faiblesse des connaissances scientifiques, en particulier dans notre pays, alors que la Hollande ou la Belgique ont mené des études. Nous sommes bien en peine de dire la réalité, quantitative et qualitative, des demandes d'euthanasie et de suicide assisté, faute d'études rigoureuses.
De tels travaux nécessitent des compétences en recherche qualitative, ce qui n'est guère une tradition française. Il faut croiser plusieurs types de travaux qualitatifs, sur la base d'une analyse des certificats de décès ; c'est ce que nous faisons avec l'institut national d'études démographiques (Ined), en nous appuyant sur la méthodologie suivie en Belgique. Nous devrions avoir des résultats intéressants d'ici le milieu de l'année.
Les travaux menés par le professeur Deliens en Belgique font état de la rareté des cas d'euthanasie : ceux-ci représentent moins de 1 % des décisions médicales de fin de vie. Combien de demandes d'euthanasie ? Qu'y a-t-il derrière ? Que deviennent-elles ? Il faut se donner les moyens pour pouvoir argumenter.
L'observatoire a été créé à la suite du rapport de la mission d'évaluation sur la loi Leonetti. Je suis par ailleurs chargé de la coordination du programme national de développement des soins palliatifs. Le progrès en matière de santé a pour conséquences l'augmentation du nombre de personnes qui vivront longtemps avec des maladies graves, et donc celui du nombre de personnes vulnérabilisées. La notion même de fin de vie évolue ; elle ne se réduit plus à la toute fin de la vie. Il faut mesurer la réalité de l'offre et du vécu.
Les questions soulevées par les propositions de loi sont complexes. Ainsi, on ne peut réduire les soins palliatifs à la fin de vie. Il faut distinguer la douleur physique, qui doit recevoir une réponse antalgique, et la souffrance morale, spirituelle, existentielle. Nombre des demandes d'euthanasie sont liées à une douleur non contrôlée : ce n'est pas normal ! En revanche, il faut prendre en compte l'expression d'une souffrance existentielle, qui touche au sens de la vie. De plus en plus de demandes d'euthanasie seraient liées au sentiment d'indignité, d'être une charge pour les proches, dans une vision « utilitariste » de la vie. L'euthanasie doit-elle permettre de supprimer la souffrance ? Nous sombrons dans une réflexion abyssale... Je ne saurais le dire... Vivre, c'est parfois souffrir et pour moi, la souffrance est consubstantielle à la vie. Il faut mieux évaluer l'impact des soins palliatifs et de l'accompagnement de la souffrance avant de conclure que pour supprimer la souffrance, il faudrait supprimer la vie.
Des personnes dont la vie est prolongée par la médecine peuvent être à ce point vulnérabilisées qu'elles ne peuvent exprimer leur souhait de poursuivre ou non leur traitement. Comment appréhender la volonté d'une personne qui ne peut l'exprimer ? C'est toute la question de la décision pour autrui.
La loi du 21 avril 2005 tente de donner les moyens de respecter la volonté exprimée, mais dans les faits, les cliniciens sont confrontés à la variabilité de la demande du patient au fur et à mesure que son mal progresse - le désir de mort alternant sans cesse avec l'envie de vivre. C'est pourquoi il faut nourrir le débat et produire les connaissances dont nous ne disposons pas aujourd'hui, préalable, me semble-t-il, à toute décision.

La notion de souffrance physique ou psychique vous paraît-elle fondée scientifiquement ?
Je préfère distinguer douleur et souffrance. La douleur est fondée scientifiquement ; la contrôler relève du respect dû à la personne. En revanche, la notion de souffrance existentielle, transitoire ou non, ne peut être fondée scientifiquement. Va-t-on se demander s'il faut étendre le droit à l'euthanasie aux dépressifs ? Il y a danger à réduire la souffrance à une question médicale.

C'est une distinction importante. La douleur doit être atténuée, mais vieillir dans la souffrance peut être une perspective intolérable...
Les souhaits des malades évoluent en dents de scie. J'ai vu ma fille supplier de pouvoir mourir, mais à d'autres moments, lumineux, s'accrocher à la vie. La vie humaine est précieuse, comme l'a rappelé M. Halais. Quelles limites doit-on mettre à la liberté individuelle ?
On entend souvent que la loi Leonetti est mal comprise, mal appliquée. Y aurait-il une volonté de ne pas l'appliquer ? Les médecins du centre de soins palliatifs de Zuydcoote me disent pourtant que c'est une bonne loi.
Je respecte ces propositions de loi, mais ne sont-elles pas prématurées ? Nous manquons d'éléments pour prendre de telles décisions, qui ouvriraient la porte à beaucoup de choses. Où situer l'exception ?

La souffrance psychique peut être liée à un état physique, un état végétatif par exemple, sans qu'il y ait de douleur... Quid des personnes qui ne sont pas en fin de vie mais qui n'ont aucun espoir de voir leur état physique s'améliorer ? Enfin, quelles seraient les améliorations à apporter à la loi Leonetti ?

Pouvez-vous nous éclairer sur la composition de l'observatoire, qui a été vivement critiquée par M. Romero lors de son audition ?
Mme Richard, présidente de la société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), qui dit avoir rencontré deux cas d'euthanasie en dix ans, a estimé que les sociétés savantes ne pouvaient juger en fonction de sondages, mais qu'un programme hospitalier de recherche clinique était en cours. Où en est-il ? Quand ses conclusions seront-elles connues ?

Vous dites qu'il n'y a pas d'études sérieuses menées en France. L'Observatoire se reporte-t-il aux expériences des autres pays, Hollande et Belgique ?

Y a-t-il vraiment, comme on l'entend dire, des personnes âgées qui quitteraient la Hollande pour l'Allemagne par crainte de l'euthanasie ?

Où s'arrête votre mission ? L'observatoire s'intéresse-t-il à la prise en charge des personnes très âgées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ? C'est un véritable problème de société. J'ai vu des structures d'accueil où des personnes très âgées, grabataires, vivaient dans des conditions absolument indignes...
Les conditions de vie des personnes très dépendantes, des personnes en état végétatif chronique, entrent bien dans le champ de l'observatoire. Son rapport annuel fera état des connaissances sur ces questions.
Celles-ci demeurent toutefois très complexes ; il n'y a pas de réponse unique, il faut creuser la réalité. La médecine sait prolonger la vie ; doit-elle le faire quel que soit le résultat, surtout si, in fine l'on supprime les vies que l'on a ainsi prolongées ?

On ne peut pourtant pas dire aux médecins de cesser de vouloir prolonger la vie !
Ne vous méprenez pas : mon propos n'est pas anti-progrès ! La loi prévoit déjà que l'on demande au patient de réfléchir avant d'engager un traitement qui peut entraîner une survie dans des conditions difficiles. Mais l'anticipation de l'action par une réflexion dynamique n'est pas une réalité aujourd'hui.
La loi Leonetti impose un changement de paradigme aux acteurs de la santé. On ne peut plus se dispenser de prendre en compte l'avis de l'intéressé. Les lois de 1999 et surtout de 2002 sur les droits des malades ont introduit un changement majeur, qui n'est pas encore totalement assimilé. La formation des médecins y est sans doute pour beaucoup : il n'y a ainsi aucun enseignement obligatoire en éthique clinique.
Il faut observer et analyser les situations et proposer des actions, notamment en matière d'organisation.
Personne ne veut vieillir dans un établissement tel que ceux que vous citez : les personnes dans un Ehpad « moyen » disent qu'elles préféreraient être mortes ! Demandent-elles pour autant à mourir ? Elles demandent surtout à ne pas vivre dans de telles conditions... Si on lui en donne les moyens, l'observatoire contribuera à enrichir la réflexion, pour poursuivre et approfondir ce débat.
Le programme hospitalier de recherche clinique, porté par le docteur Ferrand, vise à connaître la réalité quantitative de la demande d'euthanasie et à explorer qualitativement ces demandes. Les premiers résultats devraient être publiés dans un an. Nous en attendons beaucoup, car il faut des éléments factuels.
Je sais que M. Romero, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) critique la composition du comité de pilotage de l'observatoire.
Afin que les patients soient représentés, il a été demandé au collectif inter-associatif sur la santé (Ciss) de désigner deux personnes, parmi les associations qui composent le Ciss. J'ai été surpris que l'ADMD n'ait pas été choisie... Lors de notre séminaire sur l'euthanasie, nous nous sommes adressés directement à elle. Quant à la société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), elle n'est pas une association de malades, et n'est donc pas membre du Ciss.

Je vous propose de nous revoir lors de la publication du premier rapport de l'observatoire.

Je voulais indiquer que M. Aubry sera également présent au Sénat le lundi 24 janvier, avec notre collègue député Leonetti et d'autres, pour la projection du beau film Les Yeux ouverts, à laquelle les membres de la commission ont été conviés par mail.

Je regrette pour ma part d'avoir appris l'organisation de ce débat avec M. Leonetti par mail, d'autant qu'il se tient à la veille de notre débat en séance publique !

Notre commission a choisi de désigner comme rapporteur d'une proposition de loi son auteur ou l'un de ses auteurs. Ne serait-il pas plus opportun de confier le rapport à quelqu'un qui puisse apporter un éclairage extérieur ? Même sur des sujets moins sensibles que celui-ci, de droit du travail par exemple, la question mérite d'être soulevée. Mais sur un sujet aussi controversé que la fin de vie, elle se pose avec acuité. Que Jean-Pierre Godefroy soit le rapporteur des propositions de lois sur l'euthanasie, tout en étant le premier signataire de l'une d'entre elles, ne lui facilite pas la tâche et ne nous aide pas, pour notre part, à décider si nous devons le suivre ou non.

Je rappelle qu'un appel à candidature avait été lancé et que seul Jean-Pierre Godefroy s'était déclaré.

Je suis du même avis que Catherine Procaccia. J'avais moi-même envisagé d'être rapporteur de ces textes, mais vous aviez indiqué, madame la présidente, que le principe était plutôt que l'auteur d'une proposition de loi en est désigné rapporteur.

Qui irait mettre en cause la neutralité de Jean-Pierre Godefroy ? C'est un excellent rapporteur et nous avons soutenu sa désignation.

S'agissant du film Les Yeux ouverts, j'ai souhaité qu'il soit projeté la veille du débat en séance afin d'enrichir notre réflexion, et non pour faire pencher les sénateurs d'un côté ou de l'autre.

Ce sujet échappe aux clivages politiques et chacun se détermine librement en fonction de ce qu'il a vécu.

Dans un tel débat, le rapporteur ne pouvait être neutre. Marie-Thérèse Hermange y est-elle moins impliquée que Jean-Pierre Godefroy ?

Je rappelle qu'à la demande de Mme la présidente et de nos collègues, nous avons renoncé à inscrire notre proposition de loi dans notre « niche » parlementaire, afin qu'elle puisse être examinée en même temps que les deux autres. Mais il aurait été beaucoup plus confortable pour moi de l'examiner dans le cadre de l'ordre du jour réservé du groupe socialiste : j'aurais été plus libre de mes propos. Quoi qu'il en soit, je m'efforce de rédiger un rapport équilibré.
Quant à la projection du film Les Yeux ouverts, elle ne me gêne aucunement. Ce qui me trouble, c'est que M. Leonetti, auteur de la loi de 2005 et de l'évaluation qui en a été faite, soit présent lors de la table ronde. Cela permet-il de maintenir des rapports équilibrés entre l'Assemblée nationale et le Sénat ?

Ne pourrait-on demander à Gérard Dériot, qui a été le rapporteur pour le Sénat de la proposition de loi de M. Leonetti, d'assister à cette table ronde ?

Pour revenir à la question de la désignation de l'auteur d'une proposition de loi comme rapporteur, je souhaite qu'elle soit évoquée en Conférence des Présidents. Voyez les problèmes rencontrés lors de l'examen de la proposition de loi du député Olivier Jardé relative aux recherches sur la personne.

Il ne me paraît pas illégitime que l'auteur d'un texte en soit le rapporteur, car il connaît le sujet mieux que quiconque. Il est incongru que la question soit soulevée à l'occasion du rapport de Jean-Pierre Godefroy, dont chacun connaît la modération. Sur un sujet tel que l'euthanasie, personne ne pouvait être neutre.

J'ai moi-même suggéré à Marie-Thérèse Hermange qu'elle serait plus libre de ses propos si elle n'était pas rapporteur.

Ne faites pas à notre collègue Godefroy de procès d'intention. Peut-on considérer que M. Leonetti, qui sera présent lors de la table ronde, a une position neutre ?