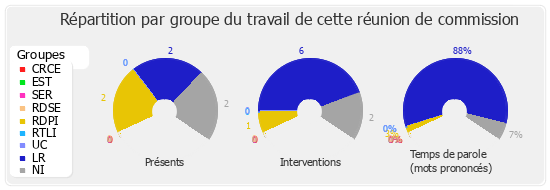Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 1er juillet 2014 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède tout d'abord à l'audition de M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'occasion de la remise du rapport annuel de l'AMF.

Nous accueillons Gérard Rameix, le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui vient honorer son rendez-vous annuel pour répondre à nos questions, après avoir remis son rapport au président de la République. Nous avons également le plaisir d'accueillir Corinne Bouchoux qui est avec moi co-rapporteur au nom de la commission chargée du contrôle de l'application des lois, pour l'évaluation des dispositions législatives relatives à l'exercice du pouvoir de sanction des régulateurs financiers. Lors de notre dernière rencontre il y a un mois, nous avions évoqué avec Gérard Rameix de l'influence de la conjoncture sur la stabilité financière. Nous souhaiterions aujourd'hui nous concentrer sur les activités de l'AMF : de quels moyens dispose-t-elle, quelles sont ses orientations stratégiques, comment apprécie-t-elle le marché de Paris et son devenir ?
Un décalage semble se dessiner entre l'évolution du marché et la situation économique de notre pays. La vitalité retrouvée du marché, le retour des introductions en bourse, la bonne tenue du CAC 40 et celle du marché des obligations contrastent avec la réalité sur le territoire : croissance quasi-nulle en 2013, balbutiante en 2014, inférieure au seuil à atteindre pour déclencher un mécanisme de création d'emplois marchands. S'agit-il selon vous d'un décalage dans le temps ? Ce serait l'interprétation la plus optimiste. Ou bien y a-t-il une déconnexion structurelle entre les marchés et l'économie réelle, une dissymétrie entre l'espace de développement des grandes entreprises et le territoire national ? Faut-il s'inquiéter de la gestion actuelle des liquidités ? Celle-ci doit converger avec la politique, non conventionnelle, mise en oeuvre par la Banque centrale européenne.
Le droit boursier à la française cumule la sanction pénale et la sanction administrative. Dans un arrêt datant du début de l'année, la Cour de cassation a retenu la compatibilité des deux. La Cour européenne des droits de l'homme, cependant, a pris une position contraire au cumul dans un arrêt du 4 mars 2014. Quel modèle privilégier, s'il faut choisir entre poursuites pénales et administratives ? Quelles conséquences ce choix pourrait-il avoir sur l'organisation judiciaire et le rôle joué par l'AMF ?
Le rapport annuel porte sur 2013 et je céderai volontiers à l'optimisme en constatant que la situation financière de notre pays est meilleure qu'en 2012. Le cours des actions a bien progressé et leur marché a redémarré après une atonie d'une durée sans précédent. Depuis l'automne dernier, on a pu constater beaucoup d'introductions en bourse, des levées de fonds, des opérations de restructuration parfois difficiles à réguler, mais qui montrent que les acteurs ont retrouvé dynamisme et confiance. Pourquoi l'amélioration n'est-elle pas aussi nette dans l'économie réelle ? L'articulation entre les deux est une question compliquée. Un premier écart vient de ce que les chiffres qui figurent dans le rapport concernent les marchés financiers français, alors que l'essentiel de nos capitalisations proviennent de chiffres d'affaires et de profits que les grands groupes réalisent à l'extérieur de nos frontières. À ce décalage spatial s'ajoute - on peut l'espérer - un décalage temporel dû au fait que la bourse anticipe toujours. Le redressement des cours et le dynamisme du marché annonceraient des perspectives économiques meilleures. Si cette amélioration est probable, elle ne s'appliquera pas forcément à l'économie française, car les groupes français se sont surtout appuyés sur la croissance d'autres économies. Les deux grands équipementiers automobiles français, par exemple, doivent beaucoup à la bonne santé des industries automobiles américaine ou allemande.
Nous avons axé notre travail sur la qualité de l'information comptable et financière accompagnant les introductions et les restructurations en cours. Une première difficulté a été de constater l'écart croissant entre le temps juridique et le temps des affaires. Lorsqu'un recours est déposé, il faut désormais un an pour que la Cour d'appel de Paris - qui est pourtant une juridiction spécialisée et compétente sur les sujets financiers - puisse rendre une décision sur nos dossiers. Le délai était de trois à quatre mois, il y a quelques années. Une autre difficulté est le décalage juridique qui perturbe certaines opérations. Alors que les offres d'achat doivent être faites sur 100 % du capital d'un groupe - pour protéger les minoritaires - certaines opérations visent désormais non plus les actions des groupes, mais leurs actifs. On peut ainsi acheter 30 % d'une société cotée sans faire d'offre publique d'achat sur les 70 % restant, ou bien acheter 70 % des actifs, sans demander leur avis aux actionnaires minoritaires, ce qui favorise un certain déséquilibre.

D'où ma proposition de loi tendant à rendre obligatoire le dépôt d'une OPA en cas d'acquisition de l'essentiel de l'activité d'une entreprise.
Elle trancherait le noeud, en transposant les règles de l'offre publique d'achat à ces opérations. L'AMF a mis en place un groupe de travail sur ce sujet qui demandera l'arbitrage des pouvoirs publics sur les différentes solutions envisagées. Nous comparons les solutions appliquées dans divers pays.
Les équipes de l'AMF, en collaboration avec Bercy, passent beaucoup de temps à élaborer les règles d'application, les standards ou les guidelines pour construire patiemment un système financier européen plus sûr. Je suis plus optimiste qu'il y a quelques mois. Même si nous sommes traditionnellement minoritaires face à nos amis anglais plus influents sur la question, nous avons marqué des points sur un certain nombre de sujets - la négociation des textes européens MIF II, EMIR, la régulation du trading haute fréquence. Nous veillerons à ce que les textes ne donnent pas lieu à des interprétations différentes en termes de pratiques, et cela afin de favoriser les conditions d'une concurrence loyale, selon le fameux principe du level playing field. Les événements nous ont donné raison sur la nécessité de réguler le trading haute fréquence.
Concernant la sécurité du système, il serait faux de penser que tous les efforts produits depuis la faillite de Lehman Brothers n'ont servi à rien. Le système est plus sûr (nous partions de loin) mais il ne le sera réellement que lorsque prendra fin l'exception actuelle : des taux d'intérêt extrêmement bas, intenables à terme, et des injections de liquidités massives aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe continentale. Entre le risque de déflation et celui d'une prochaine bulle, la voie est étroite, d'autant qu'il ne faut ni provoquer de krach obligataire, ni casser le début de croissance qui existe dans certains pays. La question dépasse le cadre strictement français.
À court terme, le secteur bancaire est dans un processus vertueux qui doit aboutir à l'unification, dans la zone euro, de la régulation prudentielle bancaire sous l'égide de la Banque centrale européenne. Néanmoins, l'étape indispensable de l'asset quality review, qui consiste à ausculter les actifs bancaires, inquiète les régulateurs du marché qui craignent les dérapages liés à ce type d'opération - effets de rumeur sur le niveau de provisionnement exigé par les experts, etc. Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, se veut rassurant, car notre système est solide.
Mon prédécesseur avait convaincu le Parlement et le Gouvernement de soutenir un projet ambitieux pour l'AMF en augmentant l'ancienneté des agents et leur nombre. Le financement accordé avait été sous-évalué à dessein, pour que nous résorbions notre fond de roulement et que nous fassions des économies. Le déficit persiste malgré nos économies, nous obligeant à couper dans nos moyens - des choix politiques seront à faire - ou à augmenter nos recettes. Lorsque j'ai pris la présidence de l'AMF, je pensais que la reprise des marchés réalimenterait notre budget. Nous avons 5 à 6 millions d'euros de déficit structurel pour un budget de moins de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que le développement de l'activité suffira à apporter les recettes suffisantes pour combler ce déficit. Par exemple, la nouvelle introduction en bourse d'Euronext - qui s'est faite à Paris et à Amsterdam - a été régulée principalement à Amsterdam, et procure donc peu de recettes à l'AMF. De façon générale, un déplacement plus nombreux des sièges sociaux en Suisse ou en Hollande accentuerait l'écart entre nos recettes et le total de notre budget. Une solution serait de nous aligner sur le système luxembourgeois pour augmenter nos recettes sur la gestion d'actifs. Nous pourrions également compenser nos coûts d'enquêtes par des frais de gestion de dossier appliqués à une partie des pénalités, comme cela se fait dans le système judiciaire.
S'agissant de la filière répressive, nous sommes attentifs à ce que tout dérapage soit sanctionné. Les relèvements du plafond des sanctions pécuniaires et les possibilités de recours du Président à l'encontre des décisions de la commission des sanctions sont efficaces : le montant moyen des sanctions a augmenté, même si le processus reste lent. Certains ont pu s'étonner du montant de l'amende infligée récemment à un grand groupe de luxe. Elle représentait en fait 80 % du plafond au moment des faits, ce qui est en pourcentage très élevé. Néanmoins mon plus gros souci - et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président - concerne l'articulation de la sanction administrative et de la sanction pénale. C'est un très vieux sujet. La sanction administrative date de la première affaire Péchiney, à la fin des années quatre-vingt. De nombreuses réformes juridiques ont façonné un système efficace où les tâches sont réparties. Le secrétaire général de l'AMF ouvre les enquêtes et les procédures de contrôle ; le collège de l'AMF engage les poursuites et notifie les griefs ; une commission indépendante composée pour un tiers de magistrats et pour deux tiers de professionnels de la place prononce les sanctions. Une partie des infractions examinées par cette commission coïncide avec les trois délits boursiers définis par le code monétaire et financier - utilisation d'une information privilégiée, manipulation de cours, diffusion de fausse information. Il y a très peu d'affaires pénales, en réalité, même si le courant de sanctions va en augmentant, avec environ trente affaires par an. La Cour européenne des droits de l'homme a mené une réflexion sur le cumul des deux sanctions, et sa jurisprudence s'y oppose. Le système mixte dans lequel nous évoluons n'est peut-être pas fait pour durer. L'essentiel est de maintenir une sécurité juridique et une répression efficace des infractions.

Je vous remercie pour la clarté de votre exposé, notamment sur la politique de contrôle. C'est une question à laquelle nous sommes sensibles.
Lors de la présentation de la cartographie annuelle des risques, en avril dernier, l'AMF a insisté sur plusieurs facteurs de risques, dont la politique monétaire américaine, le marché immobilier français, et la désintermédiation du financement des entreprises qui peut aboutir au report d'une partie du risque sur les épargnants et sur les émetteurs, avec une variabilité des prix et des volumes de financements disponibles. Comment accompagner cette dernière évolution ? Disposons-nous d'outils nouveaux pour atténuer ce risque ?
Euronext a été introduit en bourse, le 20 juin dernier, avec une valorisation autour de 1,4 milliard d'euros. Malgré la présence d'un noyau dur d'actionnaires - Euroclear, BNP, Société Générale, mais aussi la CDC et la BPI - certains ont parlé d'un manque d'enthousiasme, car l'action a été négociée dans le bas de la fourchette espérée initialement. Quel regard portez-vous sur cette opération ? L'indépendance retrouvée d'Euronext change-t-elle les compétences et la mission de l'AMF à son égard ? Quelle sera la collaboration de l'AMF avec les régulateurs des autres places concernées, Lisbonne, Bruxelles ou Amsterdam ?
Quant à la protection des épargnants, vous avez poursuivi en 2013 vos « campagnes mystère » qui consistent à vérifier les conseils donnés aux épargnants. Si ces conseils vous ont semblé adaptés dans leur ensemble, vous avez noté que le plan d'épargne en actions (PEA), développé pour orienter l'épargne vers le financement des entreprises, était très peu recommandé, même quand le profil de l'épargnant correspondait à la cible. Est-ce un défaut de pédagogie ou doit-on améliorer le produit ?
La mise en oeuvre progressive du règlement EMIR en 2013 et 2014 - avec l'obligation de déclaration des dérivés depuis février, l'obligation de compensation centrale à partir de la fin de 2014 - a donné un rôle croissant à certaines infrastructures dans le fonctionnement des marchés. Je pense notamment aux référentiels centraux et aux chambres de compensation. Ces infrastructures seront-elles suffisamment armées pour accompagner l'évolution de la règlementation ? Doit-on aller plus loin dans les restructurations industrielles ? Y a-t-il un champ de risque à circonscrire ?

Sur le financement des entreprises, pourriez-vous expliciter le paragraphe qui figure à la fin de la première page de votre lettre au président de la République ? Vous y écrivez que « l'État ne peut se désintéresser de l'évolution du capital et de la gouvernance des grands acteurs dont le siège social est en France ». Cette phrase est presque « montebourgeoise ». Vous poursuivez : « Cependant ces groupes sont et seront de moins en moins français par leur activité, leur zone de rentabilité ou même leur actionnariat, souvent déjà pour moitié international. On peut craindre que certains, à la faveur de regroupements, ne fixent leur siège social hors de France, tout en y conservant d'importantes équipes ». Où trouver sur le marché français les ressources longues dont auraient besoin nos grandes entreprises ?
Beaucoup d'observateurs ont noté que paradoxalement une crise venue des États-Unis obligeait les États européens et continentaux à changer leurs modèles de financement et à recourir davantage au marché et un peu moins aux banques. Selon nos économistes, le risque lié au financement à long terme serait alors reporté sur les épargnants alors qu'il reposait auparavant sur les banques. Les grandes entreprises n'ont pas forcément besoin des banques pour se financer à long terme. Ce n'est pas le cas pour les entreprises de taille intermédiaire auxquelles le marché ne s'ouvre que lentement. Leur financement est assuré par les actionnaires, par les banques pour des prêts de moyen terme, ou par le capital développement. Si les banques rechignent à assurer ce financement, une autre solution serait l'investissement des épargnants, sous réserve de les informer sur tous les risques auxquels ils s'exposent. Il faudrait également voir si les flux de financement diminués des prêts bancaires suffisent à développer l'entreprise ou bien freinent sa croissance. Je crois que souvent, la croissance des entreprises souffre davantage d'une trop faible demande d'investissement que d'un manque de financement. En revanche, si la croissance devenait plus forte, l'accès au financement deviendrait indispensable pour que les entreprises ne soient pas ralenties dans leur développement.
La BPI assure partiellement le financement des entreprises de taille moyenne. Les acteurs du capital développement sont également dynamiques en France, après une crise qui se résorbe. Enfin, d'autres acteurs financiers proposent des placements aux épargnants. Des gérants d'actifs nous ont demandé des agréments pour des fonds de prêt aux entreprises moyennes. Nous avons également vu des assureurs racheter des portefeuilles de prêts en laissant à la banque le soin de les gérer. Beaucoup de créativité est à l'oeuvre pour diversifier le financement des entreprises de taille intermédiaire. Le financement des grands groupes est très ouvert. Ce n'est pas pour des raisons financières que ces groupes s'éloignent du territoire français, mais pour des raisons économiques de compétitivité, de coûts, ou d'attractivité.
Quant à Euronext, les pouvoirs publics français se sont battus pour avoir un noyau dur d'actionnaires qui donne de la stabilité et une chance d'autonomie durable à une entreprise centrée sur quatre marchés. L'introduction en bourse est, de ce point de vue, une grande satisfaction. Le vendeur s'est montré très habile. En prenant le contrôle de NYSE Euronext, l'américain ICE a acheté trois grands marchés, celui du Liffe de Londres, le New York Stock Exchange, marché historique américain, et l'Euronext historique créé à partir de la bourse de Paris et de celle d'Amsterdam. Ils se sont aussitôt défaits de ce dernier marché au prétexte de ne connaître ni le fonctionnement des bourses européennes, ni celui des marchés d'actions. Ils ont bien vendu Euronext, et l'ont placé entre des mains sûres, puisque 30 % sont détenus par des acteurs financiers, tandis que des acteurs français non financiers dans la mouvance de Paris Europlace ont également acheté des titres. Le manque d'enthousiasme vient sans doute du prix un peu élevé qui a été payé. Pour que le cours de l'action évolue correctement, il faut que le nouvel ensemble s'inscrive dans une bonne stratégie. Il faudra stabiliser les parts de marché du marché des actions malgré la concurrence des autres places et des trading venues ou plateformes d'échange. Il faudra également se positionner sur d'autres segments, comme celui de la compensation ou celui des marchés dérivés. On pourra également étudier la possibilité de nouvelles alliances avec d'autres marchés qui ne sont pas dans la mouvance du London Stock Exchange, ni dans celle de la Deutsche Börse. J'imagine que Dominique Cerutti et son équipe ont réfléchi à ces questions. L'histoire n'est pas écrite. Elle peut se terminer par une énième restructuration ou évoluer de manière beaucoup plus positive. Avec Thierry Giami, nous avions écrit, il y a trois ans, un rapport sur le financement des entreprises intermédiaires et des PME par le marché financier, à destination de Christine Lagarde, alors ministre des finances. Le constat était celui d'un divorce entre les entreprises de marché et les entreprises non financières. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus proches.
Je suis un fervent défenseur du PEA, c'est un bon produit. Beaucoup de professionnels de la gestion se lamentent sur la surfiscalisation mise en place par le Gouvernement, qui effraierait leurs clients. Or, l'investissement en actions se fait à l'abri d'une enveloppe fiscale aux conditions très favorables jusqu'à 400 000 euros pour un couple, avec une détention pendant cinq ans en PEA et PEA-PME. Si le PEA est peu dynamique, c'est à cause de la méconnaissance, par les épargnants français, de l'évolution et du fonctionnement de la bourse, de la finance, et même de l'économie. Ils sont avers au risque et il est difficile de leur vendre du risque « action » même au travers d'un véhicule assorti d'une exonération d'impôt sur la plus-value et les dividendes.
Le marché des actions, très chahuté par la crise des subprimes, a crû de 12 % en 2012 et de 18 % en 2013. Or il n'y a pas eu en France le flux net d'investissement que l'on aurait pu attendre d'acteurs rationnels. Les Français ont plutôt désinvesti.
Certes, mais ils épargnent aussi près de 14 % de leur revenu, ce qui est considérable. C'est le résultat du traumatisme causé par l'éclatement de la bulle et la crise des subprimes. Il nous incombe de restaurer la confiance et de redonner du sens à la finance, car sans elle, il n'y a pas de croissance. Le PEA est un bon instrument et je suis satisfait que les pouvoirs publics l'aient maintenu, aient augmenté son plafond, et l'aient complété par le PEA-PME. Espérons simplement que les Français n'entreront pas sur le marché des actions lorsque les cours seront au plus haut.
EMIR est une réforme majeure. On a laissé se développer dans les années 2000 des instruments nouveaux - dérivés sur actions, sur taux... - à l'abri de toute régulation, sur les marchés over the counter (OTC). Or seules 15 % ou 20 % des opérations ont une finalité de couverture des risques. Le volume total a atteint 60 trillions de dollars au moment de la crise ! L'un des axes majeurs de notre action sera de soumettre progressivement cette masse à une régulation. Je n'ai pas de réponse définitive à votre question, mais je ne suis pas très optimiste : les référentiels centraux que nous avons agréés sont presque tous américains, ce qui est dommage. Des chambres de compensation existent en Europe, et développeront leur activité en compensant une partie de cette masse de dérivés, mais les Américains ont une longueur d'avance et fixent les règles les premiers. C'est l'un des terrains ouverts à Euronext, dont la faiblesse est toutefois de n'avoir plus de chambre de compensation propre. Dans ce jeu compliqué, il y a du business à faire, mais il n'est pas évident que ce soient des Français qui s'emparent de cette activité. Nous participons à des collèges de régulateurs qui examinent la façon dont LCH et Deutsche Börse vont se lancer dans ces métiers. C'est une gigantesque partie stratégique, dont je ne connais pas l'issue.
Il y a indéniablement un écart entre les grands groupes d'origine française et le territoire français. La logique des premiers consiste à se mondialiser, de sorte qu'ils peuvent bien se porter tandis que notre économie stagne. Efforçons-nous de ne pas donner l'image de nationalistes étroits : nous devons avant tout être compétitifs. La détermination de la politique économique n'est pas de ma compétence, ni la façon dont on présente ces choix aux milieux d'affaires et à l'opinion publique. Mais tout est question de dosage, car nos groupes font des acquisitions à l'extérieur ; il est normal que des groupes étrangers en fassent chez nous. Je suis plus inquiet de la tendance à déplacer les centres de décisions hors de France. Mais les facteurs à l'oeuvre ne sont pas strictement financiers, je l'ai dit.

Vous avez abordé la question du secteur non régulé, beaucoup plus important que le secteur régulé placé sous votre supervision. Des progrès incontestables ont été accomplis avec EMIR : quelles sont selon vous les conditions nécessaires à une avancée semblable dans le secteur non régulé ?
Entretenez-vous de bons rapports avec l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF » ou « ESMA ») ? Parvenez-vous à limiter l'influence de la City dans l'ensemble de la régulation ? La loi bancaire vous a donné des responsabilités supplémentaires. Où en est sa mise en oeuvre ? Disposez-vous d'effectifs suffisants ? Votre budget est tendu...

Vous nous avez fait part de vos inquiétudes sur le transfert des centres de décision : Alstom, Peugeot, SFR, Lafarge, LVMH, ... Vingt-neuf groupes ont adopté le statut de société européenne, préalable à la délocalisation de leur siège. Deux d'entre eux y ont effectivement procédé. D'autres, comme Airbus, l'envisagent... Le président de la République avait déclaré que le monde de la finance était dépourvu de morale, que la finance était l'adversaire. Cet état d'esprit persiste-t-il au sommet de l'État ? Cela pourrait expliquer la tendance à la délocalisation. Selon vous, celle-ci va-t-elle se poursuivre ?

Les transactions de gré à gré doivent désormais être déclarées. Quelle fraction d'entre elles l'est effectivement ? Quel est l'état d'esprit des opérateurs et quelle est l'efficacité que l'on peut mesurer aujourd'hui de cette obligation ?
On a par ailleurs du mal à imaginer toutes les conséquences qu'aura la condamnation de BNP-Paribas. Pourrait-elle affecter d'autres banques françaises et, indirectement, les marchés financiers où elles opèrent ?

Nos start-up ont beaucoup de succès, mais elles sont vite rachetées. Pourquoi n'obtiennent-elles pas les fonds nécessaires pour faire fructifier les recherches financées par le crédit d'impôt recherche et se développer en France ? Vous avez une responsabilité conjointe avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Coopérez-vous en bonne intelligence ? Enfin, vous semble-t-il probable que la prochaine bulle se produise dans le secteur des activités liées à Internet ?

Les marchés ont besoin de confiance, donc d'intégrité des opérateurs. Une amende plafonnée à 100 millions d'euros ou à dix fois les profits réalisés est-elle dissuasive, au regard notamment de celles prévues par le régulateur britannique ? Qu'en est-il de l'après-peine et du sens de la peine ? Nous connaissons le travail de Claude Nocquet sur le prononcé et l'exécution de la sanction, ainsi que sur le post-sentenciel. Il y a sur ce sujet deux pistes différentes, le droit à l'oubli et à la possibilité de réviser une décision de la commission - mais ne serait-ce pas là revenir sur la chose jugée ? Où en est cette réflexion ? Le rapport Nocquet que vous présentez n'est-il pas une sorte d'étude d'impact par anticipation de ces éventuels aménagements ?

La procédure de composition administrative est née de la loi de 2010. Le collège n'a soumis en 2013 que trois transactions à la commission des sanctions. Cela veut-il dire que la procédure n'a pas eu le succès escompté ? Puisqu'elle ne s'applique pas aux poursuites pour abus de marché, conviendrait-il d'introduire une procédure de « plaider coupable » semblable à celle qui existe en matière pénale ?
Les transactions du secteur non régulé représentent un enjeu colossal. Que la terminologie ne vous trompe pas : l'opposition n'est pas tranchée entre secteur régulé et non régulé. Il existe toute une palette de situations intermédiaires. Les fonds monétaires, par exemple, ne sont pas soumis au régulateur bancaire mais relèvent de notre supervision. La terminologie de shadow banking est une vue de banquier, qui consiste à penser que des acteurs font de la banque en dehors de la régulation bancaire. Nous préconisons pour notre part de proscrire les fonds à valeur constante, un peu trompeurs, au profit de ceux à valeur classique, autrement dit celle du patrimoine divisé par le nombre de parts. Nous participons à des ateliers internationaux sur ces sujets. Le plus lourd est celui des hedge funds et de leurs relations avec les banques. Il a été sérieusement travaillé par les régulateurs bancaires, et nous devrions parvenir à introduire un minimum de discipline dans ce secteur, d'autant qu'EMIR prévoit de faire passer une grande partie des transactions sur les dérivés, soit des centaines milliards de dollars, par les chambres de compensation, avec reporting et appels de marge.
Nous sommes l'un des États les plus favorables à l'ESMA tandis que les Allemands sont plus réservés, et que les Anglais se trouvent dans une situation déséquilibrée : notre autorité, qui est l'une des plus importantes, compte 450 agents, quand l'autorité anglaise en compte 4 000... Cela influe évidemment sur les rapports de force lorsque nous cherchons à établir une règle pour les Vingt-huit... L'ESMA n'en fait pas moins un bon travail, grâce à des équipes compétentes. Elle est financée à 60 % par les régulateurs, qui connaissent des difficultés budgétaires. Nous y tenons un rôle actif : je fais partie du management board et je préside le groupe corporate finance qui traite du droit des prospectus, des OPA et de toutes les questions d'émetteurs. Nous nous efforçons d'éviter le piège du juridisme et de faire des choix respectueux tant des intérêts des épargnants que de ceux des émetteurs.
Fabienne Keller m'interrogeait sur la déclaration des transactions de gré à gré. Toutes les transactions dérivées, y compris les OTC, sont désormais soumises à cette obligation, mais elle ne s'applique en France que depuis février. Nous sommes encore dans une phase de montée en puissance et de simple collecte des données. Nous ne serons en mesure de les exploiter que dans un an ou deux. Le risque est que nous dépensions beaucoup d'argent et d'énergie pour rassembler des données, mais sans disposer à terme des moyens colossaux - en informatique, en intelligence, en effectifs - nécessaires à leur traitement.
Quant au transfert des centres de décisions, je ne suis pas le plus compétent pour vous répondre. L'Europe est le marché naturel de beaucoup de nos interlocuteurs, il n'est donc pas choquant qu'ils choisissent le statut de société européenne. Que certains installent à Londres leur trésorerie ou leurs équipes suscite certaines inquiétudes, mais il ne faudrait pas surévaluer le phénomène. La France reste l'un des pays qui concentre le plus de sièges de grandes entreprises. Nous avions historiquement une base forte, car notre pays comptait beaucoup de grandes entreprises. Nous devons faire en sorte de conserver notre position...
Pour répondre à Philippe Dominati, voilà quinze ans que je travaille dans un monde « sans morale »... L'AMF s'intéresse surtout aux dérapages. Y en-a-t-il plus qu'avant ? Je n'en suis pas certain ; ils augmentent dans les périodes où les marchés sont volatiles.
Les risques de conformité, très importants, inspirent beaucoup de préoccupations à nos interlocuteurs, et la condamnation de la BNP, qui passait pour l'un des opérateurs les plus sérieux, ne fera que les aggraver. La réunion annuelle de toutes les équipes travaillant sur la conformité attire de plus en plus de monde. Certains de nos collaborateurs sont démarchés par des établissements en quête d'expertise sur ces questions. Les risques sont divers et complexes : j'ai été stupéfait, malgré mon expérience, de découvrir qu'on pouvait tricher sur le marché des changes et orienter le fixing, ou encore, manipuler le Libor. Le monde est plein de risques... Cependant, si nos interlocuteurs ne deviennent pas plus moraux, ils savent en tout cas que les mailles du filet se resserrent. Notre rôle n'est pas celui d'un régulateur bancaire : dans une affaire comme celle de la BNP, notre contrôle porte uniquement sur l'information publiée par la banque.
L'ACPR, dont Christian Noyer est président, et la Banque de France sont extrêmement proches : ce sont les mêmes équipes. Elles sont reliées par diverses passerelles. Robert Ophèle, numéro deux de la Banque de France, siège à l'AMF ; j'assiste à presque toutes les réunions de l'ACPR, y compris celles du collège de résolution. Je ne crois pas que les clients de la BNP aient lieu d'être très inquiets ; mais un tel accident ne peut qu'avoir des conséquences lourdes sur la stratégie de la banque et sur sa rentabilité.
Le financement des start-up n'est traditionnellement pas notre point fort. Un fonds doté de centaines de millions d'euros a été créé à cette fin dans la mouvance de la Caisse des dépôts. Il reste que ces entreprises ne trouvent pas en France de milieu aussi porté à prendre des risques que l'environnement californien. Si des progrès ont été accomplis, les start-up françaises continuent à avoir souvent davantage intérêt à se vendre qu'à chercher à atteindre une taille intermédiaire.
Quant aux amendes, les plafonds prévus suffisent amplement. Il nous faudra un certain temps pour utiliser l'éventail des sanctions : nous commençons tout juste à être saisis d'affaires pouvant donner lieu à 100 millions d'euros de sanction. Pour atteindre une telle somme, il faut de gros dysfonctionnements ! Le relèvement du plafond induira d'ici deux ou trois ans l'augmentation du montant moyen de l'amende.
Je suis favorable aux propositions techniques de Claude Nocquet. Si le Gouvernement et le Parlement parviennent à un consensus sur ce sujet, partiellement législatif, il suffira de trouver un véhicule pour le traiter.
La raison pour laquelle trois affaires seulement ont fait l'objet d'une procédure de composition administrative est que celle-ci a été définie avec beaucoup de prudence et que nous ne pouvons l'utiliser que pour des contrôles, en nous appuyant sur la jurisprudence déjà balisée.
Je suis favorable au « plaider-coupable » pour une solution para-pénale ; il importe surtout de saturer tout le champ non pénal : lorsque l'on trouve une information inexacte qui ne relève pas pour autant du délit de fausse information, on ne peut pas faire de transaction aujourd'hui, et nous sommes contraints de porter en commission des sanctions des infractions mineures, qui pourraient être traitées par des transactions. À vous, législateur, de nous en donner la possibilité.
Puis la commission entend une communication de M. Philippe Dominati, rapporteur spécial, sur la direction de l'information légale et administrative (DILA).

Monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, il me revient de vous présenter les conclusions de mon contrôle budgétaire de cette année, qui a porté sur la direction de l'information légale et administrative, la DILA.
Cette dernière, créée en 2010, résulte de la fusion de la direction des Journaux officiels (JO) et de la direction de la Documentation française. Ainsi, dès 2003, la Cour des comptes a souligné « l'étroite complémentarité » de certaines des activités des deux directions.
En outre, la même année, François Marc, alors rapporteur spécial du compte de commerce de la Documentation française, a mené un contrôle sur la Documentation française qui concluait à la nécessité « d'envisager de nouvelles coopérations entre la Documentation française et les Journaux officiels » et de « procéder à des économies d'échelle pour les opérations de renouvellement de l'outil de production ».
La prise en compte de ces observations par l'administration a conduit à la création, en 2007, du budget annexe « Publications officielles et informations administratives », regroupant les crédits des deux directions.
Il a encore fallu deux années, de 2008 à 2010, pour préparer leur fusion, avec en particulier la mise en commun des services de soutien.
Il faut noter que selon la DILA, cette période a permis de « négocier un aménagement des conditions d'emploi avec la direction du budget et la direction générale de l'administration et de la fonction publique pour rapprocher les niveaux de rémunérations des agents ».
Ainsi, les économies de masse salariale réalisées grâce à la fusion ont été en partie utilisées pour financer la convergence des rémunérations en trois ans. Entre 2009 et 2012, les effectifs de la DILA ont diminué de 91 équivalents temps plein travaillé (ETPT) permettant de réaliser une économie de l'ordre de 4,5 millions d'euros sur trois ans. La convergence des rémunérations, grâce à la mise en place d'une indemnité de modernisation des métiers, a bénéficié d'une enveloppe totale de 2,14 millions d'euros. Aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, la fusion peut être considérée comme une réussite.
Quelles sont les missions de la DILA ? Fruit de son histoire, elles sont diverses et fixées par un décret de 2010.
Tout d'abord, la DILA garantit l'accès au droit et offre aux citoyens des informations sur leurs droits et obligations et sur les démarches administratives qu'ils doivent effectuer. À ce titre, la DILA gère notamment les sites Internet « Legifrance », « Mon service public » ou « Vie publique ». Il s'agit des activités de service public effectuées à titre gratuit par la DILA.
Ensuite, la DILA exerce une mission - également de service public - mais qui lui procure des recettes : il s'agit de la publication des informations contribuant à la transparence de la vie associative, économique et financière.
Enfin, la DILA doit éditer et diffuser des publications de vulgarisation relatives aux politiques et au débat publics. Cette activité est également supposée lui apporter des recettes grâce à la vente des ouvrages.
Dans toutes ces activités, la DILA « s'appuie » sur la société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels (la SACIJO), qui compte 200 salariés, pour effectuer ses travaux d'impression. Je reviendrai plus tard sur le rôle de cette société.
Chaque année depuis sa création, le budget annexe dégage un excédent, qui est reversé au budget général. Ainsi, en 2013, cet excédent est de 26 millions d'euros, les recettes s'élevant à 201 millions d'euros et les dépenses à 175 millions d'euros.
La part des recettes relatives à la publication des annonces légales est prépondérante - elles représentent 94 % des recettes en 2013, soit 188 millions d'euros - et en progression de 5 points par rapport à 2010.
Or la plupart de ces recettes sont liées à des obligations légales de publicité des entreprises ou des collectivités : ainsi, les informations légales de certaines catégories de sociétés doivent être publiées au bulletin des annonces légales obligatoires (BALO). À partir de certains seuils, les appels à la concurrence en matière de marchés publics sont obligatoirement publiés au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ; enfin, certaines informations relatives à la vie des entreprises doivent être publiées au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Les autres recettes de la DILA sont atones, en particulier les ventes de publications et d'abonnement (7,5 millions d'euros) ou les prestations et travaux d'édition de la DILA (2,9 millions d'euros).
S'agissant des dépenses, elles sont relativement stables, à hauteur de 175 millions d'euros en 2013, soit une hausse de 1,3 % depuis 2007 à périmètre courant.
Elles sont également en « recomposition » depuis 2010 : en particulier, la baisse des dépenses relatives à l'activité d'édition et d'information administrative est compensée par la monté en puissance du pilotage et de la modernisation des activités numériques. Cette évolution montre que la DILA a entrepris sa modernisation.
Cependant, les dépenses totales de personnel, comprenant à la fois le personnel de la DILA et celui de la SACIJO s'avèrent particulièrement importantes, puisqu'elles représentent en 2013 plus de 60 % du budget de la DILA (soit 115 millions d'euros).
Comme vous le comprenez à l'issue de cette présentation, les métiers et les missions de la DILA doivent aujourd'hui évoluer très rapidement, afin de s'adapter à la révolution numérique.
Or, en 2010, afin que la DILA dispose d'un outil d'impression plus performant et polyvalent, il a été décidé d'investir dans l'achat d'une rotative, opérationnelle en 2013, pour un coût de 10 millions d'euros.
Aussi, à l'issue de ce contrôle, je souhaiterais vous faire part d'une observation et formuler plusieurs recommandations.
J'observe que le directeur de la DILA a quitté ses fonctions le 30 avril dernier. À ce jour, aucun successeur n'a été désigné. Or, cette désignation est capitale pour une institution devant prendre un virage au moins aussi stratégique que le projet, réussi, de la fusion.
Le choix d'un tel directeur est difficile et nécessairement long, mais il ne faudrait pas que cette absence dure trop longtemps et je souhaiterais qu'il soit nommé avant la fin du mois de juillet.
Par ailleurs, et c'est ma première proposition, dans la mesure où le JO papier n'a plus aujourd'hui que 3 129 abonnés, contre 64 726 abonnés au sommaire du JO électronique, il me semble indispensable de confirmer, par une déclaration officielle, l'intention d'arrêter l'impression du JO papier à la fin de l'année 2016. À ce stade, il ne s'agit que d'une perspective probable, mais non officiellement actée. Il appartiendra donc au nouveau directeur de prendre cette décision et d'en tirer toutes les conséquences.
En outre, la mission prioritaire du nouveau directeur sera d'accélérer le rythme du changement. Je recommande que soit rapidement prise une décision claire concernant l'avenir des activités d'édition et d'impression. Plus précisément, la question de l'utilisation de la rotative, amortie sur huit ans, soit en 2021, devra être réglée. Le cas échéant, le nouveau directeur devra déterminer les moyens de donner un second souffle aux activités d'impression et d'édition publique. Pour faciliter cette prise de décision, il est d'ailleurs urgent que la DILA se dote d'une comptabilité analytique fine, permettant de mesurer la compétitivité de ses différentes activités. En effet, plus rien ne justifie aujourd'hui que l'État dispose d'une imprimerie sans valeur ajoutée par rapport à un imprimeur privé. De plus, l'arrêt du JO papier et la réorientation des missions de la DILA vers le numérique justifient que les relations avec la SACIJO soient redéfinies.
En 2013, 43 millions d'euros ont été consacrés au financement des dépenses de personnel de la SACIJO, qui utilise le matériel mis à disposition par la DILA, son unique client. La SACIJO, régie par le statut de la presse parisienne, comprend aujourd'hui 200 salariés, occupés non seulement à des activités d'impression mais aussi de composition ou d'édition ; la moitié des effectifs, tout en gardant son statut, a été mise à disposition de la DILA. Les tâches aujourd'hui effectuées par les salariés de la SACIJO devraient être prises en charge par le personnel de la DILA.
Enfin, j'ai pu observer que l'équipe de direction - au sens large, y compris l'autorité de tutelle, composée d'un personnel de qualité et de haut niveau - est tout à fait consciente de la nécessité de réorienter les missions de la DILA vers le numérique, mais aussi des difficultés et des risques d'une telle opération.
Ainsi, tout en réduisant ses effectifs, la DILA met en avant sa gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) et les efforts de formation déployés pour accompagner le personnel dans cette transformation tout en continuant à garantir un bon niveau de service.
Il faut également saluer de belles réussites en matière de services numériques : c'est le cas notamment de Legifrance, exemple unique - et modèle envié - dans le monde ! De même, la fréquentation du site « Mon service public » a augmenté de 70 millions à 218 millions de visites par an entre 2010 et 2013.
Le projet stratégique qu'a défini la DILA pour les années 2014 à 2017 me paraît être le bon : il mise sur le numérique et le rôle résolument interministériel de la DILA, au service des administrations.
Fusionner les deux directions, en 2010, était risqué mais nécessaire. Aujourd'hui, de nouveau, la DILA doit prendre des risques : le choix du nouveau directeur s'avérera crucial puisqu'il devra conduire le changement à un rythme accéléré. Je vous remercie de votre attention.

Je remercie Philippe Dominati de nous avoir dressé le tableau de la situation présente de la DILA et de nous avoir rappelé qu'une belle rotative à 10 millions d'euros est faite pour tourner, comme l'indique d'ailleurs le signifiant du mot « rotative ». Je souhaite comme lui que l'on puisse trouver les débouchés nécessaires et une activité permettant d'amortir l'investissement en huit ans, avec l'efficacité espérée.
Je me réjouis également de constater à travers vos propos que la fusion a été un succès. À l'époque où j'étais rapporteur spécial, la fusion se préparait, mais des questions se posaient sur ses modalités et les économies que l'on pouvait en attendre. À l'heure où l'on parle tant en France de fusions et des économies en découlant, cette fusion de la Documentation française et des JO a-t-elle débouché sur des économies substantielles ? Peut-on identifier les gains issus de cette opération ?

Vous a-t-il été possible d'étudier dans quelles conditions la décision de commander cette rotative a été prise ? En effet, il semble bien qu'elle ait été actée sans une visibilité suffisante. Qui a été en mesure de porter un regard stratégique au moment où un investissement physique aussi substantiel, notamment par rapport au volume d'activité du service public, était décidé ?

Tout d'abord, en ce qui concerne la fusion, je crois que l'on peut dire que, globalement, cela a été une réussite. Les économies sont diverses et variées, notamment issues de l'outil principal qu'est la rotative. Par exemple, l'ancienne rotative nécessitait une dizaine de postes, contre six pour la nouvelle. En outre, la nouvelle rotative peut faire de la couleur, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne. Des économies d'échelles ont donc été effectivement réalisées.
Deuxièmement, la fusion a permis de faire cohabiter des mondes différents, à savoir la Documentation française, le JO et le statut de la presse parisienne. La SACIJO n'est en réalité que le réceptacle de l'action syndicale, et ce n'est que pour garantir la paix sociale qu'une relation, en réalité assez fictive, a été nouée entre la direction de la DILA et la SACIJO, se traduisant notamment par la réalisation d'économies d'échelles en termes de personnel.
Toutefois, le changement s'accélère et c'est pourquoi que je pense que nous sommes à l'aube d'un second virage. Actuellement, deux tiers des salariés employés le sont dans l'impression et l'édition. L'ancien directeur de la DILA s'est efforcé de trouver des débouchés avec l'aide des services du Premier ministre dont la DILA dépend. Une circulaire a ainsi été éditée pour essayer d'en faire l'éditeur public de référence et inciter les ministères à travailler avec elle, de façon à favoriser l'utilisation de la rotative. Toutefois, mon sentiment est que cette action s'est avérée limitée dans ses résultats.
La DILA rencontre des difficultés pour trouver un marché et asseoir sa compétitivité ; elle doit résolument basculer, comme toute cette profession, dans le numérique.
Je m'interroge également sur le fait de savoir si la DILA doit continuer à relever d'un budget annexe. En effet, ce dernier n'est motivé que par les recettes « garanties » provenant des annonces légales. Sans doute pourrait-on évoluer vers une autre forme de gestion budgétaire de l'organisme.
Pour répondre au Président, c'est le Secrétariat général du Gouvernement qui pilote depuis longtemps la nécessité pour l'État de disposer d'un outil performant d'impression. C'était sa préoccupation au moment de la fusion.
La DILA va devoir prendre ce virage et réussir cette mutation dans un délai beaucoup plus court que ce qui était prévu initialement au-delà de la durée des huit ans sur la rotative.

Je pense que le rapport est extrêmement utile pour bien prendre conscience de tous ces enjeux. Il conviendrait de demander au nouveau directeur de la DILA de proposer un plan de réduction de l'activité et de reconversion de l'outil, compte tenu de l'évolution du contexte technologique. C'est une mission assurément difficile.
Peut-être aussi pourrait-on s'interroger sur le paiement des annonces légales puisqu'en définitive près de 200 millions d'euros relèvent en réalité d'une taxe. En effet, nous n'avons pas le choix, nous sommes contraints d'avoir recours à ces moyens de diffusion légale.

J'ai le sentiment que ces annonces légales ne perdurent que pour assurer la survivance d'une activité qui risque de devenir obsolète dans peu de temps. Mais la mutation demande des reclassements, des formations, d'autres compétences, et c'est pour cela qu'elle est difficile.

Près de 200 millions d'euros pour les annonces légales, c'est tout de même un montant important...

On voit également que les recettes de l'ancienne Documentation française sont minimes. Les impressions couleur ne représentent d'ailleurs que 113 millions de pages contre 224 millions pour le noir et blanc
La commission donne acte de sa communication à M. Philippe Dominati, rapporteur spécial, et en autorise la publication sous la forme d'un rapport d'information.
La réunion est levée à 17 h 57