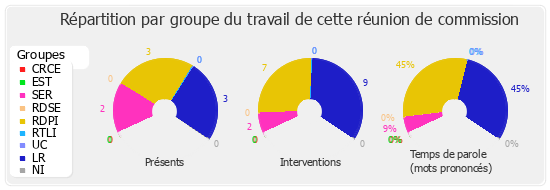Délégation sénatoriale à l'Outre-mer
Réunion du 26 mai 2016 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, nous poursuivons aujourd'hui nos investigations sur le thème des normes sanitaires et phytosanitaires applicables à l'ensemble des filières agricoles de nos outre-mer, végétales, animales et aquacoles.
Nous avons, au cours des auditions précédentes, notamment grâce aux visioconférences réalisées avec les producteurs et responsables des filières dans plusieurs territoires, rassemblé des informations nous permettant de mieux comprendre comment, et dans quelle mesure, les contraintes normatives s'exercent en matière sanitaire et phytosanitaire, creusant parfois les différentiels de compétitivité avec les productions similaires des États tiers.
Si nous comprenons que les logiques économiques, en particulier celles qui sont liées aux économies d'échelle, jouent en défaveur de nos petites économies insulaires et font obstacle à l'autorisation de certaines substances ou de certains procédés adaptés aux productions tropicales, nous militons pour que les spécificités de nos territoires puissent être davantage prises en considération, qu'il s'agisse des types de productions, des conditions climatiques ou encore de la nature des sols. Il y va parfois de la survie de certaines filières, et par conséquent des emplois de ces filières !
Nous voulons faire en sorte que les préoccupations de nos territoires ultramarins soient en permanence dans le champ de vision des autorités françaises et européennes... et ce n'est, semble-t-il, pas tout à fait le cas aujourd'hui.
Il importe que cette « veille ultramarine » soit présente dès l'amont, lors du processus de formation des normes : c'est pourquoi nos rapporteurs ont souhaité cet entretien avec les représentants de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui, depuis sa création en 2002, émet des avis scientifiques sur les risques relatifs à la sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, la nutrition, la santé et le bien-être des animaux, ainsi que la santé et la protection des plantes. Par ses avis, l'EFSA contribue activement à la définition de la réglementation sanitaire et phytosanitaire européenne.
Nous sommes donc en liaison avec Parme pour échanger avec plusieurs représentants de l'EFSA, que je remercie de s'être rendus disponibles pour notre visioconférence.
Messieurs, une trame vous a été adressée pour servir de fil conducteur à notre entretien et vous informer des nombreuses questions sur lesquelles nous souhaitons recueillir des éléments de réponse.
Je n'ai à mes côtés qu'un seul de nos trois rapporteurs, Mme Catherine Procaccia. MM. Éric Doligé et Jacques Gillot devraient nous rejoindre dans un instant.
À moins que Madame le rapporteur ne souhaite dire un mot d'introduction, je vous cède la parole sur la base de la trame qui vous a été transmise.
L'EFSA a été créée en 2002, à la suite d'un certain nombre de crises alimentaires, afin de séparer l'évaluation des risques de la gestion des risques. Elle rend donc des avis scientifiques, mais n'édicte pas de normes.
Nos travaux sont de deux ordres. Nous pouvons être saisis sur une question par un nombre limité d'acteurs : la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil et les autorités compétentes des pays membres. Nous procédons également à l'évaluation, sur dossier, de produits réglementés. Nous travaillons parfois sans dossier, par exemple sur les contaminants entrant dans l'alimentation.
Nos travaux se fondent sur les données scientifiques publiées ou les dossiers que nous recevons. Nous ne menons pas d'activité de recherche scientifique.
À cela s'ajoutent des actions de communication, portant, bien évidemment, sur nos avis sur les risques, et non sur les mesures de gestion.
Oui, nous avons été saisis sur la question de l'utilisation des néonicotinoïdes et de ses conséquences, conformément au cadre réglementaire qui autorise la Commission ou les États membres à le faire, qu'il s'agisse du règlement (CE) n° 1107/2009 sur les pesticides ou le règlement (CE) n° 396/2005 sur les limites maximales de résidus. Nous sommes compétents pour travailler sur ce sujet, mais, encore une fois, nos avis reposent sur les seules études et informations dont nous disposons, notamment fournis par les sociétés phytosanitaires ou des organismes nationaux ou internationaux car nous n'avons pas de laboratoire.
Nos évaluations des risques concernent la population européenne globale. Nous ne distinguons pas a priori un pays donné ou l'outre-mer. Toutefois, si nous identifions un sous-groupe de population potentiellement à risque, nous pouvons cibler notre évaluation sur celle-ci.
Nos missions ne sont pas des missions d'inspection ; elles ne portent ni sur le contrôle de qualité ni sur la traçabilité. J'insiste sur ce point, car nous souhaitons bien préciser le champ de nos responsabilités.
L'EFSA rend des avis scientifiques, mais ne prend aucune décision, les autorisations étant accordées par la Commission européenne et les États membres. Ces avis, qui se fondent sur la notion de sécurité du consommateur, sont généralement suivis, mais les gestionnaires de risques peuvent être amenés à prendre d'autres éléments en compte, notamment des intérêts économiques ou techniques.
Les mieux placés pour vous éclairer sur l'impact des avis scientifiques de l'EFSA sur l'évolution de la réglementation européenne sont probablement les représentants de la Commission européenne ou des États membres.

Nous avons déjà auditionné quelques directions de la Commission européenne. Grâce à un large panel d'auditions, nous cherchons à mesurer l'impact normatif sur la situation agricole de nos outre-mer.
Il faut également préciser que nous évaluons les risques liés aux substances actives présentes dans les pesticides, et non les produits en eux-mêmes, qui peuvent contenir des coformulants. Les autorisations de mise sur le marché sont délivrées par les États membres.
Effectivement, nous avons la compétence de l'évaluation sur les substances actives, les États membres celle de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits commerciaux contenant ces substances actives dès lors qu'elles auront été autorisées au niveau européen.
Nous travaillons selon des procédures fixées dans un corpus de textes réglementaires : le règlement n° 1107/2009 établit les procédures d'évaluation des pesticides ; le règlement n° 283/2013 dresse la liste de toutes les études techniques ou toxicologiques que l'appliquant, c'est-à-dire la société chimique qui possède la molécule active, doit fournir ; le règlement n° 284/2013, enfin, traite plus particulièrement des produits phytosanitaires, c'est-à-dire les produits commercialisés.
Nous travaillons, pour les pesticides, à partir des études fournies par l'appliquant. Celui-ci en a la propriété, mais ne les a pas forcément réalisées. Souvent, ces travaux sont sous-traités à des laboratoires privés soumis à des contraintes destinées à garantir la qualité des expertises.

Quand l'État français vous saisit d'une question, avez-vous connaissance de l'objectif précis et de la zone ciblée - outre-mer ou France continentale ?
Si la France saisit l'EFSA sur un sujet donné, un dialogue va s'instaurer pour cerner la problématique. Un point particulier propre à l'outre-mer pourra être signalé dans le cadre de ce processus de « formulation du problème », pour reprendre les termes que nous employons habituellement. Il sera alors pris en compte dans l'évaluation du risque.
Sauf à avoir des sous-groupes génétiques différents, le niveau de toxicité d'une substance active est le même pour tout le monde. En revanche, les niveaux d'expositions varient entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud et l'outre-mer. Ils sont pris en compte dans l'évaluation du risque.
Je précise à nouveau la spécificité de l'évaluation et de l'autorisation des pesticides. Première étape, une industrie souhaite voir autoriser une substance active. Deuxième étape, une première évaluation de cette substance est opérée par un État membre. Troisième étape, l'EFSA procède à une révision, par les pairs, de cette évaluation, dont les conclusions sont transmises à la Commission européenne. Quatrième étape, celle-ci, en accord avec les États membres, autorise l'emploi de la substance active avec les limites maximales de résidus notamment.

Pouvez-vous aussi préconiser une interdiction ? Êtes-vous uniquement saisis pour les nouveaux produits mis sur le marché ?
La règlementation européenne a été initiée en 1991 par la directive n° 91-414 et les évaluations ont commencé à être réalisées en 1993. En 1993, l'Union européenne nous a donné dix ans pour réévaluer les 725 substances actives qui étaient alors autorisées dans les États membres - ils étaient douze à l'époque. Cette opération a pris en réalité vingt ans et a conduit au retrait de près de 500 substances actives du marché européen. Des 70 types d'organophosphorés alors présents sur ce marché, il n'en reste plus qu'une dizaine, et d'autres familles de produits ont complètement disparu.
Contrairement à l'appréciation de certains organismes, les évaluations européennes n'ont donc pas été forcément favorables aux produits phytosanitaires. En revanche, l'harmonisation des lignes directrices en matière d'évaluation des pesticides a eu une conséquence : on a vu arriver sur le marché à partir des années 2000 de nouvelles molécules au profil toxicologique bien moins problématique, ce qui explique le faible nombre de refus sur les nouvelles substances actives. L'EFSA est saisie en moyenne par an d'une dizaine de dossiers pour de nouvelles substances actives.
Dans tous les domaines, l'EFSA peut être amenée à émettre des avis négatifs. Dans 99,9 % des cas, la Commission européenne suit ces avis et interdit la substance que l'EFSA considère comme présentant un risque pour le consommateur.
On peut aussi nous demander de formuler des recommandations en termes de gestion du risque, d'où l'importance de l'étape de formulation du problème.

Avez-vous eu la possibilité de travailler sur le chlordécone, dont l'interdiction est antérieure à 1993 ?
J'ai étudié cette question entre 2006 et 2008, une époque où je ne travaillais pas encore pour l'EFSA. J'avais collecté, en collaboration avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), les données issues d'enquêtes réalisées en Martinique et à la Guadeloupe, dans le cadre du règlement n° 396/2005 qui visait à harmoniser les limitations maximales de résidus de pesticides au niveau de l'Union européenne, limites précédemment fixées par les États par transposition d'une directive. Ce travail avait donc pour but de fixer les limites, au plan européen, pour le chlordécone.

Dans le cadre du travail que nous avons mené sur la question au sein du Parlement français, nous avons découvert que le chlordécone avait été utilisé en grande quantité en RFA ou en Pologne, mais nous n'avons jamais réussi à mettre la main sur de véritables études qui auraient été menées dans ces pays. Qu'en est-il de la surveillance une fois les limites fixées ?
Le règlement précédemment cité impose aux États membres de mettre en place des plans annuels de surveillance des résidus.
Deux types d'enquêtes existent. Les enquêtes dites « coordonnées » sont obligatoires ; elles concernent des substances actives et des cultures dont la liste est établie, de manière harmonisée, au niveau européen, le nombre d'échantillons à récolter étant proportionnel à la population et au minimum de 600 pour chaque groupe de cultures. S'y ajoutent toutes les enquêtes laissées à l'initiative des États membres, chacun pouvant décider des molécules à rechercher en fonction de ses propres problématiques. Chaque année, ce sont ainsi 80 000 échantillons, environ, qui sont collectés pour la recherche de 200 pesticides, soit 16 millions de données.
L'EFSA, toujours dans le cadre de ce règlement, a pour mission de collecter l'ensemble de ces données de surveillance et d'établir, sur ces bases, un rapport annuel dressant un bilan de la situation au regard des limites maximales de résidus et d'éventuels impacts sur la santé des consommateurs.
Plus d'un millier d'échantillons ont été analysés dans le cadre de la recherche spécifique du chlordécone.
Le bilan tiré des enquêtes réalisées aux niveaux européen et international, année après année, varie relativement peu : 50 % des échantillons ne présentent aucune trace de résidus, 47 % présentent des traces, sans dépassement des limites maximales et 3 % sont en dehors des normes, du fait soit d'un dépassement des limites, soit d'une non-conformité.
Les enquêtes coordonnées ont démarré dès 1997. Des progrès notables ont été réalisés dans ce domaine, avec une forte augmentation du nombre d'échantillons prélevés et de pesticides recherchés. On est passé pour ces derniers d'une centaine à 200 actuellement. L'apparition de la chromatographie en phase liquide, la HPLC MS-MS, a apporté un profond bouleversement dans les années 2000, en ouvrant les analyses à un nouveau type de pesticides.
Je l'ai dit, nos évaluations de pesticides sont réalisées en conformité avec une réglementation très stricte. Celle-ci exige qu'elles soient menées sur les usages dits « représentatifs ».
Pour le fipronil, les usages évalués à partir du dossier présenté dans les années 2004-2005 étaient le traitement de semences sur le tournesol et le maïs. Mais l'autorisation d'une substance active étant donnée pour dix à quinze ans, le dossier du fipronil devra être revu en 2017. L'évaluation ne concernait pas la fourmi-manioc.
La notion d'usages représentatifs n'est pas précisément définie : mais il s'agit d'usages s'appliquant à des cultures courantes au sein des États membres. Les sociétés peuvent donc être tentées de choisir des usages représentatifs en ce sens, comme par exemple les céréales, mais pas forcément au plan environnemental ou de la santé du consommateur.
La « représentativité » de l'usage pourrait donc parfois être contestée, mais il ne nous appartient pas de le faire.

La fourmi manioc est un véritable fléau pour les agricultures antillaise et guyanaise. Ce problème sera-t-il étudié en 2017 ? Est-ce un problème purement franco-français ?
J'insiste sur le fait que nous n'avons aucune marge de manoeuvre sur cette problématique des usages représentatifs. Tout dépend du choix ciblé par l'appliquant à l'origine de la saisine.
Effectivement, les conditions climatiques dans les outre-mer sont complètement différentes de celles de l'Europe continentale. Or, nos évaluations sur l'impact sur l'environnement ou le transfert dans les eaux de surface et les eaux souterraines s'appuient sur neuf sites représentatifs des cultures européennes - Châteaudun pour la France ou Piacenza pour l'Italie -, tous situés dans le périmètre européen. De ce fait, ces évaluations ne sont probablement pas représentatives de la situation en outre-mer.
L'EFSA n'est pas en mesure de demander à recueillir des données sur l'utilisation d'une substance active au niveau d'un territoire précis. En revanche, la France peut intervenir dans le cadre du comité chargé de délivrer l'autorisation pour la substance active en signalant que les pratiques agricoles sur lesquelles repose l'évaluation ne sont pas compatibles avec la situation en outre-mer. C'est à ce niveau qu'il faut agir.

La Réunion en est actuellement à la phase 2b d'un plan de lutte antivectorielle pour faire face à une crise d'arbovirose. Confrontées à une autre crise de nature similaire en 2005 et 2006, nos populations ont été ébranlées par l'utilisation de pesticides qui, selon elles, représentaient un grand danger pour la qualité de l'air et la santé animale ou végétale. Dix ans plus tard, l'EFSA s'est-elle penchée sur l'innocuité des produits larvicides et adulticides employés dans le cadre de cette lutte antivectorielle ?
Nous n'avons pas compétence à travailler sur les produits à usages non agricoles. L'impact des produits destinés à la destruction des moustiques que vous évoquez a dû être étudié au niveau de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) dont le siège est à Helsinki.

Peut-on considérer que vous ne travaillez jamais sur les préparations naturelles utilisées en outre-mer, dès lors qu'aucune société ne va diligenter d'études sur ces préparations ?
Le règlement n° 1107/2009 prévoit toute une procédure d'évaluation des substances dites naturelles. Nous disposons également d'une procédure simplifiée pour ce que nous appelons les produits basiques, c'est-à-dire des molécules dont la fonction principale ne correspond pas à un usage de pesticide, mais qui peuvent être utilisées comme tel.
Chaque année, nous recevons un nombre significatif de dossiers concernant des substances naturelles. Ils nous sont adressés par les États membres ; dans le cas de la France, beaucoup nous sont transmis par l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB). Il peut s'agir d'extraits de plantes ou des produits utilisés comme additifs alimentaires.

Existe-t-il un institut spécifique à l'outre-mer qui serait en mesure de saisir l'EFSA ?
L'autorité compétente avec laquelle nous travaillons en France est l'ANSES. Si des instituts voulaient développer le type de produits auxquels vous faites référence, ils devraient passer par elle pour que nous puissions nous emparer du dossier.

La signature, par l'Union européenne, d'accords de libre-échange avec des pays tiers entraîne l'entrée de substances sur le territoire européen. Celles-ci, j'imagine, sont évaluées. Vous arrive-t-il d'être saisis de ce type de dossiers ?
Nous le sommes, selon une procédure dite d'« import tolerance ». Si une molécule, interdite en Europe, est autorisée aux États-Unis ou dans un pays d'Amérique latine, un État membre peut introduire une demande d'import tolerance. L'évaluation est réalisée à notre niveau et pourra se traduire par la fixation d'une limite de résidus. Ainsi, si le Honduras utilise une molécule sur la banane qui n'est pas autorisée dans l'espace européen, il s'adresse à un État membre qui procède à une évaluation et transmet le rapport à l'EFSA qui fixera la limite maximale de résidu pour la molécule concernée.

Pensez-vous que, dans le cadre de l'action que la délégation sénatoriale à l'outre-mer entend mener au niveau du Parlement, nous pouvons directement intervenir auprès de vous. Le passage par l'État membre est-il incontournable ? Tiendrez-vous compte des problématiques spécifiques à l'outre-mer ?
Vous êtes tenus de passer par l'autorité compétente pour la France pour exposer une problématique propre à l'outre-mer. En revanche, s'il s'agit d'oeuvrer à la prise en compte, dans la réglementation européenne, de la spécificité des outre-mer, alors il faut travailler à une modification de cette réglementation. Nous ne sommes pas compétents dans ce domaine.
Si l'EFSA ou les experts auxquels nous avons recours sont informés d'un risque ou d'une utilisation non décrits dans le dossier d'évaluation, tous ont la liberté d'aller chercher des informations supplémentaires et de les faire remonter au niveau de la Commission européenne ou du gestionnaire de risque en les mentionnant dans les conclusions de l'évaluation. Nous ne pouvons pas aller au-delà, mais toutes les informations pertinentes sont évidemment bienvenues et nous avons le devoir de les prendre en considération.

Je vous remercie pour cette intervention, d'une grande clarté et d'une grande rigueur, qui nous permet d'apprécier le périmètre de vos missions.

Après l'Autorité européenne de sécurité sanitaire, nous recevons maintenant les représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire : Mmes Françoise Weber, directrice générale adjointe en charge des produits réglementés, et Alima Marie, directrice de l'information, de la communication et du dialogue avec la société, qui sont accompagnées de M. Jérôme Laville, coordinateur référent pour l'outre-mer.
Nous vous remercions d'être venus jusqu'à nous. Vous aurez compris le sens de nos préoccupations en prenant connaissance de la trame de questions qui vous a été adressée par le secrétariat de la délégation. Notre quête est celle d'une meilleure prise en compte des spécificités de nos productions ultramarines : vous pouvez y tenir un rôle majeur et il y a sans doute des progrès possibles. Nous voulons comprendre précisément les procédures actuelles et envisager avec vous les pistes d'amélioration.
À mes côtés se trouvent deux de nos rapporteurs, Catherine Procaccia et Jacques Gillot. À moins qu'ils ne souhaitent intervenir en préambule, je vous propose de prendre la parole en suivant la trame de questions qui servira de fil conducteur à nos échanges.

Je vous serais reconnaissante, par souci de continuité avec l'audition précédente, d'évoquer en priorité les saisines de l'EFSA par l'ANSES.
L'ANSES a une très vaste responsabilité, puisqu'elle est chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle exerce donc une expertise très transversale sur l'ensemble des risques auxquels la population et l'environnement sont exposés, risques liés aux aliments, aux modes de vie ou au travail.
Depuis le 1er juillet, elle a en outre la responsabilité de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
Par le passé, elle n'était responsable que de l'évaluation scientifique de ces produits, la décision finale revenant au ministère de l'agriculture. Désormais, elle prend aussi en charge la décision, laquelle tient compte d'éléments allant bien au-delà de la seule évaluation scientifique tels que des mesures de gestion ou de contrôle des risques, la praticabilité des conditions d'emploi ou l'intérêt agronomique des produits.
Elle accomplit ces missions dans le respect de ses principes fondateurs : rigueur et indépendance de l'expertise. La mise en place d'un dispositif de phytopharmacoviligance témoigne aussi de sa préoccupation d'une détection précoce des signaux relatifs aux effets nocifs de ces produits. L'agence a désormais les moyens de mener des études indépendantes dans ce domaine. Enfin, elle travaille dans un souci d'ouverture et de dialogue avec la société.
Dans ses travaux sur les produits utilisés outre-mer, elle a une exigence très haute de sécurité sanitaire et applique les critères européens qui sont parmi les plus stricts au monde. Cela explique, concernant la gamme de produits disponibles, les différences constatées avec les pays voisins extérieurs à l'Union européenne.
L'ANSES est néanmoins sensible aux besoins de l'outre-mer et très engagée dans la recherche de solutions spécifiques.
Ainsi, elle dispose sur l'île de La Réunion d'une unité spécifique dédiée à la recherche sur les agents pathogènes et particulièrement active en matière de protection des végétaux implantés. Il s'agit d'un laboratoire national de référence, en charge de la validation de méthodes de diagnostic très importantes et engagé dans de nombreuses collaborations avec le CIRAD, l'INRA et les acteurs locaux.
L'ANSES s'implique également dans la recherche de solutions au niveau ministériel, à travers le comité des usages outre-mer et orphelins. Cette structure, dans laquelle elle est très active, a pour mission de repérer les besoins prioritaires et de rechercher des solutions. Certaines ont déjà pu être trouvées, pour des usages mineurs.
Nous comptons maintenir cet engagement sur les sujets propres à l'outre-mer. En témoigne la présence de Jérôme Laville, agronome expérimenté à qui nous avons confié la responsabilité de porter les préoccupations outre-mer dans toutes nos activités relatives aux produits phytopharmaceutiques.
Nous avons également mis en place des procédures prioritaires, notamment pour les usages mineurs qui n'intéressent pas les firmes. Les dossiers sont allégés et traités dans un délai de six mois au lieu d'un an.
Malgré tous ces efforts, beaucoup reste à faire car les besoins phytopharmaceutiques en outre-mer ne trouvent souvent pas de solutions.
Pour les grandes cultures, comme la banane ou la canne à sucre, on en trouve, mais la couverture demeure fragile. Pour les usages mineurs, les besoins sont immenses et non couverts.
En outre, les conditions d'emploi prévues dans les dossiers par les firmes ne sont pas toujours adaptées à l'outre-mer. Malheureusement, la réglementation ne nous laisse pas beaucoup de capacité d'initiative dans ce domaine, puisque, si nous pouvons limiter les conditions d'emploi, nous ne pouvons pas en proposer de nouvelles.
Cela ne nous empêche pas d'intervenir auprès de toutes les parties prenantes, notamment dans le cadre du comité ministériel, pour essayer de trouver des solutions.
Selon nous, la lutte biologique, notamment les macroorganismes, suscite beaucoup d'espoir. Nous travaillons sur ces solutions, ainsi que sur la sécurité des agriculteurs et des consommateurs, avec, par exemple, des études portant sur les travailleurs dans les bananeraies ou les spécificités de la consommation outre-mer.
Un des problèmes que nous rencontrons est lié à la quasi-inexistence des modèles ultramarins dans les modèles scientifiques que nous utilisons, notamment prenant en compte les conditions climatiques spécifiques et la grande diversité des sols. De la même manière, nos modèles alimentaires se réduisent au périmètre européen.
La France étant l'un des principaux pays concernés par les régions ultrapériphériques, nous travaillons à développer des modèles spécifiques et à les porter au niveau européen afin qu'ils puissent être pris en compte dans les prochains documents guides servant de base à l'évaluation. Il s'agit de modèles d'exposition environnementale des sols et des eaux et d'un modèle de consommation caribéen.
L'ANSES est donc très engagée sur deux fronts. D'une part, elle cherche à assurer la délivrance des autorisations de mise sur le marché dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité agronomique ; d'autre part, elle développe une très grande expertise en matière de protection des végétaux et de recherche d'alternatives.

Les représentants de l'EFSA nous ont très clairement expliqué que leur autorité ne pouvait être saisie que par un État membre ou son agence nationale - l'ANSES en France. Elle ne pourrait répondre à des sollicitations des régions périphériques elles-mêmes. Si une problématique propre à l'outre-mer surgit, n'est-ce pas à l'ANSES de s'en saisir de manière très officielle et de se tourner vers l'EFSA ?

J'ai noté que vous étiez conscients des spécificités de l'outre-mer et développiez des modèles permettant de les prendre en compte. Il y a lieu de s'en réjouir. Cette prise en considération date-t-elle du mois de juillet dernier, quand vos compétences ont été étendues, ou le sujet était-il exploré auparavant ?
Cette démarche ne date pas de juillet dernier, même si la mise en place du référent outre-mer est récente. L'AFSSA y était déjà engagée et le laboratoire de la santé des végétaux est implanté à La Réunion depuis plusieurs années.

Dans ce cas, pourquoi la réglementation européenne ne tient-elle absolument pas compte des spécificités de l'outre-mer ?
Au-delà du règlement, datant de 2009, il a fallu mettre en place des documents guides pour l'évaluation, qui sont toujours en évolution. C'est un long travail, et il nous faut également du temps pour mener à bien nos études.
Les relations entre la France et l'Europe s'établissent à deux niveaux : un niveau ministériel faisant intervenir le gouvernement français et la Commission européenne pour l'autorisation des substances actives et le niveau des évaluateurs techniques, c'est-à-dire l'ANSES et l'EFSA.
Nous pouvons donc saisir l'EFSA sur des questions techniques, notamment sur l'intégration de modèles dans les documents guides, ou l'alerter sur certains sujets. J'ajoute que nous sommes responsables de la mise sur le marché des préparations, c'est-à-dire la substance active dans sa préparation et son emballage, alors que le niveau européen prend en charge l'évaluation et l'autorisation des seules substances actives.

Avez-vous des produits spécifiques à l'outre-mer sur lesquels l'ANSES a travaillé ?
Nous avons des produits adaptés à l'outre-mer, mais ils ne sont pas forcément spécifiques à ces régions. Actuellement, environ un tiers des besoins sont couverts pour les cultures tropicales. C'est largement insuffisant !

Vous arrive-t-il, contrairement à l'EFSA, de travailler sur un produit, même sans spécification d'un usage particulier en outre-mer par un fabricant ?
L'ANSES ne peut se saisir d'un usage de sa propre initiative - il faut un pétitionnaire, la demande pouvant émaner des filières. En effet, l'agence ne peut être directement le promoteur d'une solution et son évaluateur. Elle n'est en outre pas en mesure de produire des expérimentations. Cela explique notre participation en amont, au niveau ministériel, à la recherche de partenaires susceptibles de développer des solutions et de fournir des données à la fois sur l'efficacité du produit et son innocuité en termes de sécurité. On essaie de stimuler les acteurs potentiels.

Certains produits qui ne seraient pas employables dans l'Hexagone pourraient l'être en outre-mer, notamment du fait du climat tropical. Par ailleurs, dans certains de nos territoires, le développement agricole se trouve à l'arrêt du fait de la fourmi manioc. Pouvez-vous intervenir pour faire observer qu'un produit comme le fipronil pourrait être utilisé pour un usage spécifique en outre-mer ?
Le fipronil a posé de sérieux problèmes et le cas du chlordécone nous rappelle qu'il faut être prudent. Néanmoins, en toute hypothèse, certains produits pourraient être acceptables en outre-mer, et ne pas l'être ailleurs. C'est pourquoi nous développons des modèles spécifiques, notamment en matière de consommation.

Les dossiers de cette nature, qui, pour des raisons financières, n'intéressent pas les firmes, pourraient être pris en charge par l'État.
Le ministère de l'agriculture, à travers la cellule que j'ai évoquée à plusieurs reprises, a pris en charge un certain nombre d'essais et d'expérimentations ayant permis d'alimenter des dossiers d'autorisation de mise sur le marché.

Le fait qu'un produit, que l'on a jugé, sur des bases scientifiques, non utilisable dans un endroit donné pour des raisons de santé humaine puisse l'être ailleurs m'interpelle.
Par ailleurs, l'Europe autorise de plus en plus l'entrée sur son territoire de produits en provenance de pays tiers. Effectuez-vous un contrôle a posteriori, pour vérifier que ces produits ne contiennent pas de substances interdites ?
S'agissant de votre première remarque, je n'évoquais pas la possibilité d'une moindre exigence en matière de sécurité sanitaire. Mais les modes de consommation peuvent très largement varier entre l'Europe et l'outre-mer. Cela explique que l'on puisse envisager l'utilisation, en outre-mer, de produits interdits en métropole.
Nous ne sommes pas responsables des contrôles sur les produits de consommation, ce sont les services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DAAF) qui sont compétents ainsi que ceux de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF). L'ANSES ne contrôle que l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques et le respect de l'AMM pour ces produits. Des contrôles sont mis en place, mais on peut probablement considérer qu'ils sont insuffisants.

Voilà une dizaine d'années, l'île de La Réunion a connu une crise très grave, celle du chikungunya. À l'époque, les populations ont été très perturbées par une utilisation massive de pesticides. Dans le cadre de la lutte antivectorielle que nous menons actuellement, suis-je en mesure de rassurer la population quant aux larvicides et adulticides utilisés ?
Par ailleurs, nous sommes nombreux à avoir été troublés par les réponses qui sont tombées dans le dossier du glyphosate. L'OMS évoque un probable caractère cancérigène, l'Europe, au motif que ce caractère est probable, envisage une prolongation de l'autorisation tandis que la France décide d'interdire. Que pensez-vous de ces différentes réactions ?
Nous travaillons depuis longtemps sur la lutte antivectorielle et nous serons décisionnaires, au 1er juillet 2016, sur l'autorisation de mise sur le marché des biocides. Nous avons été mobilisés lors des graves crises en outre-mer et saisis à deux reprises par nos ministères de tutelle sur cette question. Celle-ci est complexe, et nous sommes loin de disposer du produit idéal. Nous menons donc actuellement une expertise sur des produits susceptibles d'être utilisés en toute sécurité, sachant que les phénomènes de résistance se développent. Nous travaillons également sur des conditions d'utilisation garantissant la sécurité et l'efficacité.
Le sujet du glyphosate nous occupe beaucoup. Deux avis scientifiques divergents ont été rendus : le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), dépendant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a considéré le produit comme un probable cancérigène, correspondant au niveau 1b dans notre classification actuelle ; l'EFSA, sur la base d'une étude allemande de l'Institut fédéral d'évaluation des risques (BFR), a estimé que seul un classement dans les cancérigènes de catégorie 2 pouvait être éventuellement envisagé. L'EFSA a également interrogé l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, sur la cancérogénicité du produit et sur un éventuel effet de perturbateur endocrinien. Le BFR et l'EFSA se sont donc prononcés en faveur d'une faible probabilité de cancérogénicité.
Interrogés sur cette divergence d'appréciation par nos ministères de tutelle, nous avons réuni un groupe d'experts pour trancher entre ces deux avis. Celui-ci a conclu que, s'il était peu probable que le glyphosate soit un cancérigène de catégorie 1b, on pouvait s'interroger sur son classement en catégorie 2. Donc il est légitime de se tourner vers l'ECHA qui étudie les dangers de la substance active. Le danger se différencie du risque qui prend en compte l'exposition.
Pendant ce temps, des débats ont été engagés au niveau de la Commission européenne sur le possible renouvellement de l'approbation de la substance au 30 juin prochain. Ces discussions sont toujours en cours.

Comment l'ANSES traite-t-elle les préparations naturelles utilisées de manière traditionnelle ?
Plusieurs dossiers de cette nature ont été portés à notre connaissance, et nous les accueillons avec bienveillance. Mais nous rencontrons régulièrement un obstacle dans ce domaine : pour pouvoir évaluer ces préparations, leur composition exacte doit être à peu près stabilisée et, surtout, portée à notre connaissance. Ce problème s'est présenté pour le lixiviado dans la culture de la banane.

Nous en revenons à la même question : que faire sans laboratoire ou société pour porter le dossier ? Nous avons des solutions naturelles pour lutter contre la fourmi manioc, mais nous ne pouvons pas les mettre à l'oeuvre faute d'homologation et de moyens financiers adéquats ! Pouvez-vous intervenir ?
Notre capacité d'intervention se limite à notre participation au comité des usages outre-mer et orphelins. Au-delà, il revient au ministère de l'agriculture d'agir. Nous pouvons également vous conseiller sur les données minimales qu'il faudrait fournir dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.
Nous entretenons un dialogue permanent avec les filières, et nous pouvons engager avec elles des discussions techniques sur le développement de certaines solutions.

Combien d'argent faudrait-il mettre sur la table pour financer les expertises dont il est ici question ?

Vous avez évoqué une implantation sur l'île de La Réunion. Comment l'ANSES intervient-elle concrètement en outre-mer ?
Je ne suis pas développeur, mais je pense que nous parlons de quelques dizaines de milliers d'euros par expérimentation pour évaluer l'efficacité d'un produit.

Je veux bien y consacrer une partie de ma réserve parlementaire. À dix, nous pourrions réunir la somme...
Par ailleurs, même si nous ne sommes pas sur place, nous travaillons en contact très étroit avec les territoires.
Les dossiers de demande d'homologation, particulièrement pour les cultures tropicales, nous sont connus plusieurs mois avant de nous être officiellement transmis. Nous identifions d'éventuels points de blocage pour l'homologation et entrons en contact avec les filières agricoles, notre point de passage privilégié étant l'Institut technique tropical pour éviter la multiplicité des interlocuteurs. Nous laissons donc l'évaluateur faire son travail scientifique, mais lors du processus de décision, nous pouvons introduire des informations supplémentaires à l'attention de la direction générale sur l'impact économique ou technique de la décision ou sur d'éventuelles mesures qui pourraient l'accompagner.
Dans ce processus de contextualisation, je m'appuie sur les compétences des personnes aux commandes et des instituts techniques. La décision étant nationale et s'imposant à tous les territoires, la prise en compte, en amont, des spécificités de chacun est essentielle.
Dans le cas du dossier Banol, l'évaluation a posé une difficulté du fait de la non-intégration, dans les modèles d'évaluation du risque environnemental, de certains insectes présents en outre-mer et pas dans l'Hexagone. Mais nous avons pu trouver un compromis entre la préservation de ce risque environnemental et les besoins des professionnels en termes de cadences d'application.
Ce qu'il faut retenir, dans cet exemple, c'est que les professionnels, à partir d'une demande de la société détentrice du produit, ont travaillé en amont pour faire évoluer les choses. Nous n'intervenons pas dans ce travail entre les professionnels, le pétitionnaire et l'institut technique, mais nous vérifions la cohérence des propositions et leur applicabilité sur l'ensemble des territoires français produisant de la banane.

Une démarche valable pour la filière de la banane, qui occupe une place importante aux Antilles, est peut-être plus difficile à mener sur les petites filières.
Nous procédons de la même manière, que la culture soit majeure ou mineure, même s'il y a davantage de données disponibles sur une grande culture comme la banane. On s'appuie également sur le groupe de travail animé par la direction générale de l'alimentation (DGAL) en concertation avec l'expert national du ministère de l'agriculture.

Avez-vous reçu des sollicitations concernant le département de Mayotte, qui dispose de certaines cultures propres ?
Une refonte du catalogue des usages a permis de regrouper, sous la terminologie globale de « cultures tropicales », un certain nombre de cultures orphelines qui n'y figuraient pas. Il faudrait vérifier que les cultures auxquelles vous pensez ont bien été incluses dans cette catégorie. En effet, les produits autorisés sur la culture principale sont de facto utilisables sur l'ensemble des cultures voisines.
Par ailleurs, nous ne pouvons prendre en considération un dossier d'homologation que s'il est déposé. Une éventuelle problématique sur ces cultures devrait être remontée à l'agence par le biais de l'Institut technique tropical. Il faudrait également alerter la Commission des usages orphelins et des cultures tropicales de la DGAL pour que les groupes de travail prennent en charge ces problématiques.

Suggérez-vous qu'un produit serait utilisable pour la culture principale, mais ne le serait pas pour d'autres cultures, que le danger n'existerait que pour certaines cultures ?
Le regroupement des cultures dans le catalogue a été effectué en se fondant sur une problématique « résidus ». On considère que le niveau de résidus acceptable pour une application à une dose déterminée d'un produit peut être extrapolé entre certaines cultures aux caractéristiques similaires, par exemple de la tomate vers l'aubergine ou du blé vers l'épeautre.
Les effets d'un produit sur le consommateur ou l'environnement dépendent du type de culture. Un produit peut être sans effet délétère pour une utilisation sur le sol avec des légumes racines, mais en avoir pour une autre utilisation, en arboriculture par exemple. Le progrès réside dans le fait qu'auparavant les données devaient être fournies culture par culture et que grâce au catalogue, il est désormais possible de procéder à des extrapolations. Cependant, selon la culture considérée, certains usages ou certaines conditions d'utilisation peuvent être déclarés non conformes.
Les organismes de contrôle sont nombreux, les contrôles pouvant porter sur les exploitations ou les denrées. Il faut également citer le dispositif de phytopharamacovigilance que nous sommes en train de mettre en place pour collecter les signaux relatifs aux effets nocifs.

L'Europe, qui ne tient jamais compte de la situation outre-mer, suit-elle systématiquement les avis que vous émettez ?
L'avis au niveau européen porte sur la substance active, et s'appuie sur les données relatives à cette substance et à une préparation de référence. Les pays ne peuvent autoriser un produit que si la substance active qu'il contient est autorisée par l'Europe. Celle-ci ne peut pas contester l'autorisation de mise sur le marché délivrée par un État membre dès lors qu'elle a autorisé la substance active.

Avez-vous des informations sur le rythme d'apparition ou de disparition de certains produits ? Pouvez-vous nous donner un nombre de produits existants ? Avez-vous la maîtrise de toutes les filières internationales de circulation des produits ? Existe-t-il un lieu d'échange international permettant de partager les expériences vécues, voire les analyses ?
Nous examinons environ 1 300 produits par an, dans le cadre soit d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, soit d'une hypothèse de retrait. Actuellement, nous avons une vingtaine d'autorisations en cours de réexamen pour la banane et un peu plus d'une dizaine pour la canne à sucre. C'est donc un ensemble très évolutif.
Il n'existe pas d'instance internationale d'échanges officielle, en dehors de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou de quelques autres instances des Nations unies. Mais, en dehors des colloques scientifiques, nous essayons de développer des contacts avec nos homologues européens, au travers de l'EFSA, ainsi qu'à l'international.

Donc, l'EFSA évalue la dangerosité de la substance active et vous analysez l'impact du produit sur la santé humaine...
Nous évaluons le risque, soit une combinaison de la dangerosité du produit et de l'exposition à ce produit. On trouve de l'eau de javel, un produit extrêmement dangereux, dans toutes les maisons. La question est bien de savoir quelle est votre exposition à ce produit et dans quelle mesure le risque est acceptable.

Dans le cas du chlordécone, si les travailleurs avaient été bien protégés, l'ANSES ou l'EFSA n'auraient strictement rien trouvé dans les bananes. Comment auriez-vous pu mesurer son incidence sur les légumes racines ?
Dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché, nous aurions obligatoirement examiné les questions de persistance dans les sols ou de présence dans l'eau. Aujourd'hui, le chlordécone ne serait autorisé ni au niveau européen pour la substance active ni à notre niveau pour les préparations.
Pour le glyphosate, nous nous intéressons à la préparation au niveau national et nous sommes surtout préoccupés par les coformulants qu'elle contient, notamment la tallowamine pour laquelle les garanties d'innocuité ne sont pas avérées. La décision peut différer selon les coformulants utilisés.

Pourriez-vous nous dire deux mots sur votre action en termes de communication ?
Notre préoccupation est double : être en contact avec l'ensemble des parties prenantes, ONG, citoyens ou élus, prendre en compte leurs avis et soumettre à leur regard nos réalisations, d'une part ; travailler dans la plus grande transparence en communiquant sur notre façon de travailler et sur nos avis, d'autre part. Nous tenons des comités d'orientation thématiques, par exemple très récemment sur la santé des végétaux. Nous organisons également des lieux d'échanges sur les sujets thématiques pour lesquels nous faisons le point à échéances régulières.
Nous distinguons la question des relations avec les parties prenantes, qui est fondamentale pour nous, de nos actions de communication. Nous cherchons effectivement à constituer de véritables lieux d'échanges pour recueillir leurs réactions et observations et expliquer en retour le processus de décision.
Nous sommes également très sollicités par les médias, qui, nous le notons, s'intéressent de plus en plus au fond. Nous nous en félicitons et nous rendons disponibles pour donner toutes les explications nécessaires.

Cet entretien nous conforte dans l'appréciation portée, au sein du Sénat, sur l'ANSES. Votre structure est perçue comme un organisme de référence, qu'il est important d'encourager, d'aider et de valoriser. Cet échange est porteur d'espoir pour nos outre-mer.