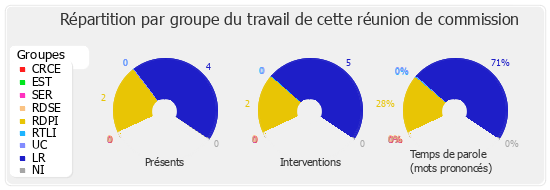Délégation sénatoriale à l'Outre-mer
Réunion du 7 juillet 2016 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Avant la présentation du rapport et des propositions afférentes, je vous propose de procéder à la nomination des rapporteurs pour la suite de nos travaux, c'est-à-dire :
- le troisième et dernier volet de l'étude triennale sur le foncier,
- un second volet de l'étude sur les normes.
En effet, le calendrier de la prochaine session sera très contraint par les échéances électorales et il nous faudra concentrer nos auditions sur la période d'octobre à février. Je vous rappelle que la désignation des rapporteurs doit combiner les critères de parité entre l'outre-mer et l'Hexagone et entre la majorité et l'opposition. Elle doit aussi privilégier la candidature de collègues qui n'ont jamais été rapporteur au nom de la délégation.
Concernant le foncier, en complément des deux premiers volets portant respectivement sur le domaine de l'État puis la sécurisation des droits fonciers, le dernier volet concernera la problématique des conflits d'usage et des outils de planification.
Pour ce rapport, j'ai reçu les candidatures de Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains et d'Antoine Karam pour le groupe socialiste et républicain.
La délégation désigne MM. Daniel Gremillet et Antoine Karam rapporteurs sur le dernier volet de l'étude relative au foncier dans les outre-mer.
Concernant l'étude sur les normes, alors que le premier volet, dont nous allons prendre connaissance dans quelques minutes, porte sur l'agriculture, le second pourrait traiter des normes en matière de construction, d'équipement et d'urbanisme, le BTP constituant un autre secteur économique clé dans les outre-mer.
Pour ce rapport, j'ai reçu les candidatures de Mmes Vivette Lopez pour le groupe Les Républicains et Karine Claireaux pour le groupe socialiste et républicain. Nous aurons ainsi un binôme féminin sur les normes applicables outre-mer en matière de construction, d'équipement et d'urbanisme.
La délégation désigne Mmes Karine Claireaux et Vivette Lopez rapporteures sur le second volet de l'étude sur les normes.

Nous parvenons aujourd'hui au terme du premier volet de notre étude sur les normes dans les outre-mer dont Éric Doligé est notre rapporteur coordonnateur.
Sans plus tarder, je cède la parole à nos rapporteurs. Éric Doligé présentera le panorama général sur l'importance du secteur agricole en outre-mer et ses problématiques, Catherine Procaccia traitera de la formation et de l'acclimatation des normes pour les outre-mer et Jacques Gillot interviendra sur le contrôle des échanges commerciaux avec les pays tiers et la politique de labellisation.

Les normes applicables à l'agriculture des régions ultrapériphériques (RUP) françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leur origine pour l'essentiel dans des règlements européens. L'enchaînement des interventions successives et parfois itératives des organes européens et nationaux dans le processus d'évaluation et de prise de décision est complexe, mais l'échelon national garde de fortes compétences, dévolues à l'Anses et au ministre de l'agriculture.
Le point essentiel est que les normes et les procédures sont les mêmes en Europe continentale et dans les RUP, sans que soient prévus de dispositifs spécifiques à leur intention. Il n'est pas tenu compte des caractéristiques de l'agriculture en contexte tropical et l'application uniforme de la réglementation conçue pour des latitudes tempérées sans forte pression de maladies et de ravageurs conduit à des impasses.
L'impasse phytosanitaire dont souffrent les filières agricoles ultramarines se traduit par la prégnance des usages orphelins, la fragilité de la couverture phytopharmaceutique, l'absence de réponse contre des ravageurs dévastateurs, un encadrement inadapté des conditions d'utilisation des produits, des dérogations difficiles à mettre en oeuvre et des interprétations françaises particulièrement rigoureuses des normes européennes.
Seuls 29 % des usages phytosanitaires sur cultures tropicales dans les DOM sont couverts, alors que la moyenne nationale est d'environ 80 %. La difficulté ne réside pas dans l'inexistence ou le faible développement de solutions phytopharmaceutiques pour des usages tropicaux. C'est l'indisponibilité de produits existants déjà dans des pays tiers concurrents qui fait problème, dès lors que les firmes ne souhaitent pas s'engager dans les procédures européennes et françaises pour des marchés ultramarins très étroits, et donc économiquement non rentables.
Le problème est exacerbé pour les cultures de diversification (ananas, mangue, turbercules) dont les filières sont particulièrement peu organisées et les surfaces cultivées très réduites. Certaines maladies ou ravageurs font de tels dégâts que le retrait ou le non-renouvellement de l'homologation d'un produit phytopharmaceutique efficace, par exemple contre la cercosporiose du bananier ou l'enherbement de la canne, risque d'entraîner l'effondrement de la filière.
La méconnaissance des caractéristiques de la production agricole dans les RUP nuit considérablement à la lutte contre les ravageurs inconnus en Europe continentale. La fourmi manioc est ainsi présente à la Guadeloupe et en Guyane. Cet insecte constitue un problème majeur. Les petits planteurs sont complètement démunis face à un ravageur qui peut défolier complètement une culture en l'espace de 24 heures : c'est le cas de la patate douce, de l'igname ou des agrumes, par exemple. Or, actuellement, aucun produit efficace contre la fourmi manioc ne peut être utilisé sur des cultures de plein champ. C'est une lacune dans la réglementation européenne et nationale qui n'a pas prévu d'usage agricole des moyens de lutte contre la fourmi manioc. Ne sont envisagés que des usages domestiques qui dépendent d'une réglementation sur les biocides de 2012 supervisée par l'Agence européenne des produits chimiques, alors que les pesticides répondent à un règlement de 2009 sous la responsabilité de l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA.
D'autres espèces de fourmis sont sources de dégâts indirects qui nécessiteraient aussi des autorisations d'usages agricoles qui manquent à l'heure actuelle.
De plus, les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques autorisés par l'Anses sont adaptées à un usage en climat tempéré. Dans les DOM, les conditions climatiques sont nettement différentes, ce qui joue sur la rémanence des matières actives. Elle est bien souvent inférieure à 8 ou 10 jours en raison d'une évaporation plus forte. Lorsque le nombre d'applications autorisées par saison, calculé dans les conditions « normales » de l'Hexagone est limité, les agriculteurs ultramarins se retrouvent dans des impasses techniques. Pourtant, une simple réduction des doses couplée avec une augmentation de la fréquence de traitement permettrait d'adapter les conditions d'utilisation aux périodes végétatives plus longues que connaissent les DOM.
De nombreuses restrictions d'utilisation très contraignantes se sont empilées ces dernières années, qu'il s'agisse de la réduction du nombre d'applications, de l'extension des zones non traitées (ZNT) ou de l'allongement des délais de traitement avant récolte. Ces restrictions sont en partie dues au manque de données disponibles pour évaluer correctement les risques en milieu tropical, tant au niveau de la France que de l'Union européenne.
Par ailleurs, les pays tiers bénéficient de différentiels de compétitivité considérables par rapport aux RUP, quelle que soit la filière agricole considérée, en raison d'un coût du travail très faible et d'une législation du travail souvent sommaire. Mais les cultures des pays tiers concurrents des productions des RUP françaises sont aussi favorisées par la conjonction d'une palette plus large de produits phytopharmaceutiques autorisés et d'une politique commerciale européenne favorable.
D'une part, les producteurs des RUP ne peuvent pas recourir à certains produits librement utilisés dans les pays concurrents voisins, mais pour lesquels aucune demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) n'a été déposée en France. D'autre part, des autorisations sont accordées dans les pays tiers pour des substances interdites dans l'Union européenne ou pour des produits non autorisés en France et les productions traitées sont ensuite exportées vers le marché européen, dès lors qu'elles respectent des limites maximales de résidus (LMR).
Prenons un exemple, celui de la cercosporiose : les producteurs de banane des Antilles ne peuvent utiliser que deux produits autorisés et ils procèdent à environ 7 traitements par an. Par comparaison, les concurrents africains et sud-américains peuvent utiliser au moins 50 produits. Le Costa Rica procède à 65 traitements par an et l'Équateur à 40 traitements par an.
Plusieurs produits phytosanitaires qui ont été retirés d'Europe ou qui sont très sévèrement contraints, continuent à être utilisés ailleurs. C'est le cas du diuron ou de l'atrazine sur la canne. Le Brésil, l'Australie et l'Afrique du Sud utilisent ces produits peu onéreux et à large spectre. Cela leur procure un net avantage dans la compétition internationale féroce sur le marché du sucre de canne, qui s'accroîtra encore en 2017 avec la fin des quotas sucriers de l'Union européenne.
Les filières ultramarines, notamment celles qui sont exportatrices et fortement structurées comme la canne et la banane, ne demandent pas le démantèlement de protections sanitaires française et européenne. Dès lors que la pérennité des cultures est assurée par la garantie d'une couverture phytosanitaire de base, elles sont prêtes à poursuivre les démarches environnementales qu'elles ont engagées. Depuis 2006, l'emploi des pesticides sur la banane a ainsi diminué de 50 %, grâce au développement de techniques alternatives. Ces filières désirent plutôt valoriser leurs efforts et leur mieux-disant environnemental auprès du consommateur.
Encore faut-il pour cela assurer les conditions d'une lutte à armes égales avec les pays tiers et une véritable information du consommateur. En matière de contrôle des importations, on pourrait croire que le système européen est solide et contraignant. Ce n'est pas le cas. La construction au niveau européen du système de contrôle des importations est faussée par plusieurs biais qui empêchent de rééquilibrer l'écart de compétitivité normative dont souffrent les RUP et qui créent les conditions d'une concurrence déloyale des pays tiers.
Tout l'édifice repose sur les limites maximales de résidus (LMR). Même si les LMR de pesticides applicables pour les produits alimentaires sont les mêmes pour les produits d'origine européenne et pour les produits importés des pays tiers, cela ne veut pas dire qu'il y ait une équivalence entre les normes de production sur le sol européen et celles qui prévalent dans les pays tiers. Les normes de production sur le sol européen sont beaucoup plus exigeantes que les normes de mise sur le marché qui s'appliquent aux produits en provenance des pays tiers. Cette évidence doit être rappelée contre la fiction parfois entretenue par certaines déclarations imprécises tant des services de la Commission européenne que des ministères français, selon lesquelles tous les produits destinés au marché de l'Union européenne doivent respecter les normes européennes.
Dans les faits, les denrées en provenance de pays tiers n'ont que les LMR à respecter, sans que soient prises en compte les conditions de production. Et même plus fort encore : les pays tiers bénéficient de tolérances à l'importation prévues spécifiquement pour permettre l'entrée de produits agricoles traités avec des substances tout bonnement interdites dans l'Union européenne.
En se bornant uniquement aux contrôles des résidus de pesticides, on constate que les denrées issues des pays tiers présentent un taux de non-conformité supérieure aux productions européennes. D'après la DGCCRF, en 2014, 3,3 % des échantillons de fruits et légumes en provenance de pays tiers contenaient des résidus de pesticides trop élevés, plus du double de la moyenne. Et les taux de non-conformité sont encore bien supérieurs dans les produits importés faisant l'objet de contrôles renforcés.
Les RUP ne subissent pas seulement cette concurrence des pays tiers à l'export sur le marché européen pour leurs produits phare que sont la banane, le sucre et le rhum. Ils la subissent aussi sur leurs marchés locaux pour les produits issus des filières de diversification végétale et animale.
La porosité des outre-mer aux importations illégales des pays tiers est avérée : la Guadeloupe vis-à-vis de la Dominique, notamment en exploitant les failles du contrôle à Marie-Galante, la Martinique face à Sainte-Lucie, la Guyane vis-à-vis du Suriname et du Brésil, Mayotte face aux Comores et La Réunion à l'égard de Madagascar.
Cette porosité contribue à enfermer les économies ultramarines dans un cercle vicieux. En effet, plus la concurrence sur le marché local est rude et plus les filières de diversification végètent et ne peuvent s'organiser pour résoudre le problème des usages orphelins, ni s'engager dans des démarches de labellisation ou d'agriculture bio. Les économies des outre-mer restent éminemment dépendantes des grandes cultures de la banane et de la canne. Or, celles-ci sont elles-mêmes fragilisées par le changement climatique (salinisation, sécheresse, épisodes violents) et surtout touchées de plein fouet par la multiplication des accords de libre-échange. L'Union européenne troque assez facilement les productions agricoles tropicales des RUP contre l'ouverture putative des marchés industriels et de services des pays tiers. La seule réponse de l'Union européenne est alors de prévoir des compensations financières via le POSEI, tant que le contexte budgétaire le permet. Cela ne fait que miner les capacités de développement endogène des RUP et accroître leur dépendance aux subventions.
Seuls des outre-mer disposant de la maîtrise normative, comme la Nouvelle-Calédonie, paraissent bénéficier d'un corpus normatif et de systèmes de contrôle adaptés à leurs besoins de développement des activités agricoles.
C'est pourquoi le ministère de l'agriculture et l'Anses doivent accélérer l'intégration des spécificités ultramarines et l'allègement des procédures. Ils doivent aussi porter cette préoccupation au niveau européen, auprès de l'EFSA et de la Commission. En parallèle, les autorités locales et les professionnels doivent se mobiliser pour définir des stratégies territoriales conquérantes misant sur la qualité et la promotion des performances environnementales. C'est au prix de ces efforts conjugués que les filières agricoles ultramarines pourront être sauvegardées et valorisées.
Avant de passer la parole à mes collègues rapporteurs, Catherine Procaccia et Jacques Gillot, qui vous présenteront en détail nos préconisations, permettez-moi encore un mot. Je veux vous dire que ce rapport nous a donné l'occasion de voyager, au moins en esprit, et de découvrir une autre facette de la richesse des outre-mer. Nous avons appris à connaître le papillon piqueur des agrumes et le citrus greening, la lucilie bouchère, dont le nom latin Cochliomyia hominivorax signifie « mouche mangeuse d'hommes » et les trypanosomes contre lesquels aucun vermifuge n'est opérant, le champignon phytophtora, la bactérie fastidiosa et la maladie moko. Nous avons aussi découvert avec intérêt les méthodes de synchronisation de la floraison des ananas par charbon enrichi à l'éthylène ou la technique de piégage de masse du charançon de la patate douce par confusion sexuelle. Tous ces noms évocateurs vous laissent imaginer l'étendue de notre champ d'investigation !

Éric Doligé a présenté très fidèlement les grandes lignes et les conclusions du rapport. L'organisation de nombreuses auditions et visioconférences a heureusement permis de compenser l'absence de déplacement car tous les rapporteurs avaient déjà une connaissance approfondie des outre-mer.
Pour simplifier et adapter le cadre normatif qui s'applique aux agricultures des outre-mer, les efforts doivent être menés à deux niveaux :
- d'abord, en France par le ministère de l'agriculture et l'Anses qui commencent à prendre conscience des spécificités ultramarines mais qui doivent aller plus loin, - ce qui est un pas positif si l'on considère le rapport que j'ai rendu, en 2009, sur le chlordécone ;
- puis également au niveau européen, où nous devons parvenir à faire évoluer les règlements communautaires qui laissent les outre-mer dans l'ombre.
Je vous présenterai d'abord les mesures qui pourraient être mises en place au plan national à brève échéance. L'extrême fragilité des filières ultramarines confrontées à de nombreux usages orphelins doit être beaucoup mieux prise en compte. Le ministre de l'agriculture a créé un comité des usages orphelins outre-mer et rénové le catalogue des usages agricoles pour faire officiellement toute leur place aux cultures tropicales. L'Anses s'est dotée d'un référent outre-mer qui dialogue avec les filières en amont de la procédure d'homologation. Ce sont des évolutions intéressantes mais qui sont, à elles seules, insuffisantes pour remplir l'objectif d'une couverture à hauteur de 49 % en 2017 des besoins phytosanitaires, objectif que les autorités françaises se sont elles-mêmes fixé.
Notre première recommandation est d'adapter aux spécificités des outre-mer les limites maximales de résidus (LMR) et les conditions d'utilisation qui encadrent les autorisations de mise sur le marché (AMM). Il est clair que les prescriptions associées à l'AMM doivent être différenciées selon le climat. Les conditions d'utilisation (dose, nombre d'applications, cadence, zones non traitées, délais avant récolte) ne peuvent plus être définies de façon uniforme, car ce sont toujours les producteurs des DOM qui en pâtissent.
Pour réduire les usages orphelins et accélérer le déploiement d'une couverture phytosanitaire adaptée, nous préconisons d'obliger les firmes pétitionnaires à joindre à tout dossier d'AMM d'un produit phytopharmaceutique des analyses portant sur son utilisation sur cultures tropicales. En contrepartie, la firme bénéficierait simultanément de l'AMM et de son extension pour l'usage tropical. Cela réduirait immanquablement les délais et les coûts au bénéfice des producteurs ultramarins. Actuellement, la plupart des produits phytopharmaceutiques utilisés pour des cultures tropicales ne sont pas homologués directement pour la banane, la canne, l'ananas ou l'igname. Ils sont d'abord homologués pour les grandes cultures de l'Hexagone comme le blé, le maïs, la tomate ou la pomme et suivent ensuite une deuxième procédure d'extension d'autorisation pour usage mineur qui permet leur utilisation sur culture tropicale. Notre proposition permet de fusionner les procédures, tout en forçant les firmes à fournir des données sur les cultures tropicales qui permettront à l'Anses de mieux calibrer les AMM et les conditions d'utilisation. Ce serait une petite révolution !
Il nous paraît également indispensable d'assurer un traitement spécifique des substances indispensables à la survie des cultures. La France doit rester vigilante sur de nombreux dossiers. En particulier, elle doit veiller au maintien d'une couverture en herbicide pour la culture de la canne et suivre à ce titre attentivement la procédure de renouvellement d'AMM de l'asulox. À titre général, il convient de faciliter les prolongations temporaires d'AMM sur des produits phytopharmaceutiques indispensables pour certaines cultures fragiles comme l'ananas et la mangue en cas de retrait d'autorisation ou de non-renouvellement, faute de dépôt de dossier par une firme.
Le ministre de l'agriculture devra aussi prendre garde à ajuster les autorisations de traitement en urgence pour s'assurer que les productions ultramarines puissent effectivement en bénéficier. On nous a donné l'exemple d'un fongicide autorisé en urgence pendant 120 jours pour protéger les plants de melon. Le seul problème est que la période d'autorisation d'urgence fixée par le ministre de l'agriculture tient compte de la récolte du melon des Charentes, mais pas de celle du melon de Guadeloupe, qui est décalée. Les maraîchers guadeloupéens ne peuvent donc pas en bénéficier. Cela fait partie des aberrations intolérables !
Par ailleurs, nous devrions revenir sur certaines interprétations françaises des normes européennes car elles sont maximalistes par rapport à celles d'autres États membres de l'Union. Par exemple, des préparations comme les biostimulants, qui sont à la frontière entre les fertilisants et les produits phytosanitaires, ne sont pas évaluées de la même manière partout en Europe. En France, si le biostimulant a un effet sur les mécanismes de défense de la plante contre un bioagresseur, il doit suivre la procédure d'AMM des pesticides. En revanche, l'Espagne et l'Allemagne les évaluent comme de simples fertilisants et les font bénéficier d'une procédure d'autorisation spécifique beaucoup plus souple.
Nous proposons donc de simplifier l'homologation des préparations biostimulantes en les traitant comme des fertilisants, même lorsqu'elles présentent des usages phytosanitaires complémentaires. Un décret du 27 avril 2016 est censé apporter une amélioration ; à vrai dire, il est très laconique et ambigu puisqu'il soumet les biostimulants à une évaluation préalable de l'Anses, sans plus de précisions. L'Anses confrontée à un biostimulant à usage phytosanitaire indirect le fera entrer dans la réglementation pesticides, donc il n'y aura aucun progrès.
D'ailleurs, une première liste de biostimulants naturels vient d'être fixée par le ministre de l'agriculture, mais cette liste ne reprend que les plantes médicinales déjà inscrites à la pharmacopée et énumérées dans le code de la santé publique. Ce n'est donc pas une avancée concrète. Il sera impératif de compléter la liste des biostimulants autorisés par la mention des essences employées traditionnellement outre-mer.
En matière d'aquaculture, l'adaptation des normes aux conditions d'activité en contexte tropical n'est pas encore une réalité. La réglementation française ne fait pas un sort particulier à l'aquaculture ultramarine et calque la limite des rejets sur celle applicable aux piscicultures intensives de truites. Les rejets de matières en suspension dans les sites d'élevage de crevette en outre-mer sont plus élevés que la norme à cause des conditions tropicales. Mais ces matières en suspension sont constituées essentiellement de phytoplancton vivant, très différent de la matière organique inerte observée en sortie de pisciculture de truite, qui, elle, est polluante une fois rejetée en mer. C'est pourquoi nous préconisons de différencier les normes de rejet de matières en suspension pour permettre l'essor de l'aquaculture ultramarine, dont le potentiel est aujourd'hui bridé.
Nous recommandons également de faciliter la réutilisation comme matières fertilisantes des déchets verts (broyats et compost), dès lors que ces méthodes sont validées par les instituts de recherche. Sur deux dossiers précis au niveau français, il paraît d'ores et déjà possible de débloquer la valorisation des déchets verts issus de la culture de la canne à La Réunion. Pour cela, le ministère de l'agriculture doit prendre les textes règlementaires nécessaires pour déroger aux teneurs limites en nickel et en chrome en tenant compte de la composition naturelle des sols volcaniques de La Réunion. 200 000 tonnes par an de déchets pourraient ainsi être valorisées à la place d'engrais chimiques !
Au niveau national, une prise de conscience générale et une mobilisation nouvelle commencent à porter quelques fruits, mais il demeure facile d'oublier les outre-mer. Par exemple, le Comité national des normes agricoles créé en mars 2016, à parité entre le ministère et les syndicats agricoles, doit impérativement travailler à un bilan des normes existantes en outre-mer pour proposer des adaptations rapides.
Force est néanmoins de constater que les principaux blocages qui pénalisent les agricultures ultramarines se situent à l'échelon européen. En effet, les RUP demeurent largement invisibles pour les autorités communautaires qui ne prennent pas en considération leurs contraintes particulières, ni dans l'élaboration des normes phytosanitaires, ni dans l'évaluation des risques.
En particulier, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, a clairement admis devant nous que les spécificités de l'agriculture des RUP n'étaient pas prises en compte dans ses travaux. En d'autres termes, les RUP restent délibérément hors du champ d'investigation de l'agence, qui n'est donc pas en mesure d'infléchir ses avis ou de proposer des adaptations en fonction du contexte tropical.
Ainsi, par exemple, le potentiel de contamination des eaux souterraines par une substance active est évalué par l'EFSA en considérant neuf lieux représentatifs des grandes zones de productions agricoles en Europe. Le site de Châteaudun dans la Beauce est retenu pour la France. Les conditions spécifiques de sols et de climat en milieu tropical ne sont donc pas considérées malgré d'énormes différences qui jouent sur la diffusion des polluants.
En outre, les évaluations d'exposition des consommateurs aux résidus de pesticides sont basées sur les régimes alimentaires inclus dans un modèle appelé PRIMo qui prend en considération 22 régimes alimentaires européens pour l'évaluation de l'ingestion chronique et 19 pour l'ingestion aiguë. Aucun régime alimentaire ultramarin n'en fait partie. Les spécificités alimentaires des populations caribéennes ou de l'océan Indien ne sont ainsi absolument pas prises en compte.
Il nous paraît donc amplement justifié de demander à l'EFSA de compléter les référentiels européens utilisés pour l'évaluation d'une substance active d'un pesticide pour inclure, parmi les terroirs européens représentatifs, un site implanté en outre-mer et, parmi les régimes alimentaires du modèle PRIMo, au moins un régime représentatif des habitudes de consommation des populations ultramarines.
C'est en matière d'encadrement des moyens de lutte biologique, appelée aussi biocontrôle, que les normes européennes apparaissent les plus pénalisantes. C'est d'autant plus surprenant que leur faible nocivité en fait une alternative de choix aux traitements chimiques. Nos instituts de recherche comme l'INRA et le Cirad y travaillent activement mais il semble que ce soit plus les pays tiers qui soient, une fois de plus, en mesure d'exploiter ces techniques.
La question des normes applicables aux phéromones est particulièrement importante. Certaines phéromones pourraient être utilisées pour compenser les usages orphelins sur les cultures fruitières et légumières des DOM. L'INRA a développé un moyen de biocontrôle contre le charançon de la patate douce à base de phéromones. Ce type de technique a déjà été élaboré, il y a 10 ans, pour lutter contre le charançon de la banane. Mais les phéromones sont considérées comme des substances actives au niveau européen. Elles sont soumises à la procédure du règlement « pesticides » de 2009 et doivent obtenir une AMM comme n'importe quel produit phytopharmaceutique. Malgré une efficacité certaine, la méthode de l'INRA ne peut légalement être utilisée par les producteurs en l'absence d'AMM. Pourtant, cette phéromone n'est pas en contact avec la culture et n'est pas dispersée dans l'environnement. Elle présente donc un risque très faible. Malheureusement, la longueur et le coût de la procédure d'homologation sont trop élevés pour intéresser une firme. Les instituts de recherche n'ont ni les moyens financiers, ni la vocation de s'y substituer, si bien que les résultats de la recherche restent lettre morte.
Il en va de même en matière de substances naturelles. Des produits de traitement à base d'extraits d'huiles essentielles, autorisés en Floride ou en Californie, ont été développés par l'INRA et le Cirad, notamment pour lutter contre le citrus greening qui décime les agrumes. Ces travaux valorisent des traditions locales, issues d'un savoir-faire ancien. Des décoctions à base d'arbre à pain, d'abricot « péi » ou de feuilles de manguier ont été testées avec succès.
Mais la réglementation est telle que l'EFSA évalue ces substances naturelles selon une procédure similaire à celle qui s'impose pour les produits chimiques. Alors que nous délibérons sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, nous mesurons combien cette façon d'aborder les substances naturelles est obsolète. Même l'agence européenne a admis, lors de son audition, que la règlementation européenne n'était pas adaptée en la matière.
Nous préconisons en réponse une mesure forte pour dynamiser la lutte biologique : il faut dispenser d'homologation tous les moyens de biocontrôle développés par les instituts de recherche nationaux comme l'INRA et le Cirad.
Pour cela, il faudra obtenir une révision du règlement européen de 2009 pour exclure de son champ les moyens de biocontrôle et dispenser d'AMM les phéromones et les extraits de plantes, dès lors qu'ils ont été testés et validés comme instrument de lutte biologique par les instituts agronomiques publics. Une réglementation spécifique est nécessaire pour encourager l'innovation.
En attendant l'aboutissement de la révision du règlement de 2009, nous proposons d'ouvrir un financement public État-régions pour soutenir directement les dossiers d'approbation au niveau européen des moyens de biocontrôle, développés par les instituts de recherche nationaux dans les outre-mer. Puis, au niveau national, l'Anses devrait adopter une procédure allégée : sur le fondement de la caution scientifique des instituts de recherche, on pourrait recourir à un simple enregistrement et à un dépôt de la substance qui vaudrait homologation. Ce sont des mesures simples qui constitueraient de très grandes avancées.
Je conclurai sur une dernière proposition forte qui vise à la fois à réduire les usages orphelins et à rétablir une concurrence saine et loyale entre les outre-mer et les pays tiers. Nous recommandons de faire établir par la Commission européenne, sur demande de la France, une liste positive de pays dont les procédures d'homologation de produits phytopharmaceutiques sont équivalentes aux procédures européennes. Ensuite, le ministre de l'agriculture, saisi par un groupe de producteurs, aurait le pouvoir d'autoriser un produit homologué dans un des pays de la liste pour la même culture et le même usage. Des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Australie, qui sont des concurrents importants, pourraient faire partie de la liste positive. Dans la mesure où l'Union européenne entame des négociations commerciales avec des pays tiers et ouvre son marché agricole, il serait juste qu'en contrepartie elle donne les armes adéquates aux producteurs ultramarins pour faire face à la concurrence.
Au moment où la Grande-Bretagne s'est prononcée pour le Brexit, le fonctionnement rigide de l'Union européenne doit évoluer. Notre rapport sort à point nommé. C'est le moment opportun pour nous d'insister et d'intervenir afin de diffuser largement ce rapport au-delà du Sénat, et même le porter au niveau européen.

Je suis fier de la qualité de notre travail. Nous devons envisager les moyens d'y donner suite et de le faire résonner dans les cénacles européens.

Je souscris à la proposition de Catherine Procaccia. Nous devrions solliciter la commission des affaires européennes pour engager une démarche conjointe auprès des instances communautaires.

C'est ainsi que nous avons procédé pour le sucre. Notre collègue Gisèle Jourda a oeuvré au niveau de la commission des affaires européennes et je suis intervenu au niveau de la commission des affaires économiques. Les résultats ont été immédiats et nous avons contribué à faire pression sur la Commission européenne pour qu'elle réduise de 20 000 tonnes à 400 tonnes le quota des sucres spéciaux accordés au Vietnam.

La politique de l'Union européenne en matière d'échanges commerciaux agricoles avec les pays tiers demande à être revue. Les RUP sont tenues d'accepter sur leurs marchés locaux toutes les productions des pays tiers, dès lors qu'elles respectent les limites maximales de résidus de pesticides. Les RUP doivent aussi tenter de résister sur leurs marchés à l'export traditionnels, l'Hexagone au premier rang, en endossant un handicap normatif dont l'Union européenne exempte les pays tiers.
Pour rétablir une concurrence saine et loyale, les normes de commercialisation dans l'Union européenne doivent intégrer des exigences sur les conditions de production au-delà du respect des limites maximales de résidus. C'est pourquoi nous demandons la suppression des tolérances à l'importation accordées par l'Union européenne pour des productions traitées par une substance active interdite au plan européen. Cette mesure contribuera à restreindre l'avantage comparatif indu dont bénéficient des pays tiers.
Il conviendrait à tout le moins dans l'intervalle de prévoir un étiquetage spécial pour les productions des pays tiers signalant au consommateur européen qu'elles ont été traitées avec une substance interdite dans l'Union européenne, même si aucun résidu n'est détectable.
Nous recommandons également de faire établir par la Commission européenne, sur demande de la France, une liste noire pour interdire les importations de produits de la pêche et de légumes-racines depuis les pays qui ont traité massivement par le passé leurs productions avec des substances fortement rémanentes dans les sols et l'eau. Ce dispositif ne ferait que reproduire les interdictions édictées dans les Antilles à la suite de la crise du chlordécone. Il permettrait en particulier de répondre à l'inquiétude face aux importations d'ignames en provenance du Costa Rica.
Face aux faiblesses et aux lacunes des contrôles aux importations, même dans le cadre des contrôles dits « renforcés », des mesures d'interdiction strictes seront plus simples à mettre en oeuvre et plus efficaces. Nos visioconférences avec Saint-Pierre-et-Miquelon et avec la Nouvelle-Calédonie nous ont permis de voir que le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande prenaient des mesures de contrôle des importations plus draconiennes que les nôtres. Je crois qu'il est temps pour l'Union européenne de s'en inspirer.
Pour améliorer l'efficacité des contrôles à l'importation dans les outre-mer, nous préconisons d'agir simultanément sur plusieurs leviers. Il conviendrait ainsi d'augmenter les effectifs généraux de la douane en outre-mer alors qu'ils ont diminué de 4,5 % en 5 ans et que nos territoires fragiles sont situés sur de grandes voies de trafic international. Il faut modifier leur répartition en donnant la priorité aux territoires présentant le plus de risques d'infiltrations illicites, notamment la Guyane et Mayotte. Un point de contrôle supplémentaire doit aussi être ouvert à Marie-Galante pour tenir compte de la nature archipélagique de la Guadeloupe et endiguer les flux illégaux depuis la Dominique.
Surtout, l'organisation des contrôles sur les importations de denrées alimentaires et la répartition des tâches entre le service d'inspection du ministère de l'agriculture, le SIVEP, et la DGCCRF nous paraît inadaptée. Nous proposons donc d'unifier les contrôles sanitaires à l'import sur les végétaux au profit du SIVEP du ministère de l'agriculture. Cette simplification permettra d'harmoniser et d'accélérer les contrôles en les confiant à une seule équipe d'inspecteurs installés sur le point d'entrée. Ce système, adopté notamment par les Pays-Bas, a fait ses preuves dans l'Union européenne et permet d'accroître la fréquence des contrôles.
Face à la concurrence des pays tiers dont la compétitivité coût est insurpassable, seule une montée en gamme permettra de préserver les parts de marché des producteurs ultramarins. Cette stratégie de la qualité est d'autant plus cruciale que certains pays tiers se lancent parallèlement dans des démarches similaires en bénéficiant de labels bio et commerce équitable sans pour autant respecter les normes européennes.
Les filières de la banane et du rhum sont les plus engagées dans le mouvement de labellisation car elles ont la force de frappe commerciale qui fait encore défaut aux filières de diversification. 90 % du rhum de Martinique est ainsi couvert par une AOC (appellation d'origine contrôlée). Les premiers retours du lancement du label « banane française » l'année dernière sont aussi extrêmement positifs.
Les signes de qualité et d'origine peuvent constituer un atout certain pour les productions ultramarines dont ils consolident l'image dans le public. Toutefois, ils n'ont rien d'une panacée. L'exemple des deux labels rouges qui protégeaient l'ananas et le litchi de La Réunion est instructif à cet égard. Depuis cinq ans, aucune production n'a eu lieu sous ces labels, si bien qu'ils sont officiellement tombés en désuétude. Ces labels n'ont pas empêché l'éviction de la production locale au profit de Maurice pour l'ananas et de Madagascar pour le litchi, alors même que ces produits commençaient à être spontanément reconnus et recherchés par le consommateur métropolitain. Quitte à me répéter, je pense que cet échec montre que, sans réforme des politiques phytosanitaires et commerciales de l'Union européenne, les filières ultramarines peineront à se développer, même en misant sur la qualité.
Ce bémol mis à part, force est d'admettre qu'une implication plus directe et plus constante de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) auprès des producteurs ultramarins serait bienvenue. L'Institut, qui gère les appellations d'origine contrôlée (AOC), les indications géographiques protégées (IGP) et les labels rouges, emploie 260 agents dont les deux tiers travaillent directement sur le terrain. Mais, c'est bien dommage, il n'a aucune implantation propre dans les outre-mer. Il agit dans les DOM par l'intermédiaire des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt qui, au regard de l'étendue de leurs missions, ne peuvent pas faire des labels la priorité de leur action. Il paraît donc nécessaire de renforcer la prise en compte des outre-mer par l'INAO et c'est pourquoi nous proposons d'installer une antenne permanente de cet institut en outre-mer. Étant donné à la fois le nombre d'indications géographiques protégées en suspens à La Réunion (Vanille Bourbon, Lentille de Cilaos, Vin de Cilaos, Ananas de La Réunion, café Bourbon Pointu) et la meilleure structuration des filières de diversification dans ce département, il pourrait être judicieux d'y installer cette première antenne ultramarine de l'INAO.
Parmi les labels les plus importants décernés par l'INAO, il faut mettre à part le bio qui constitue une voie d'avenir possible pour les agricultures ultramarines. Ces perspectives de développement sont bridées par une réglementation européenne défavorable et par la superposition des normes sur le bio et sur les phytosanitaires, qui avantagent à nouveau les pays tiers par rapport aux RUP.
Il faut déplorer que la réglementation européenne sur le bio n'ait jamais été élaborée en tenant compte des agricultures tropicales des RUP, alors que des concurrents comme la République dominicaine et le Brésil ont su définir des règles d'agriculture biologique adaptées au climat tropical. En outre, les RUP françaises ne peuvent recourir à certains produits phytosanitaires qui sont régulièrement autorisés en culture biologique dans des pays tiers. La République dominicaine peut utiliser 33 produits pour la banane bio contre 3 aux Antilles, et 14 de ces 33 produits ne bénéficient pas d'une autorisation en agriculture conventionnelle en France.
Paradoxalement, des productions biologiques des pays tiers moins exigeantes du point de vue environnemental et de la santé des producteurs que leurs homologues conventionnelles des RUP envahissent le marché européen en profitant d'un étiquetage bio. Le consommateur européen ne peut que s'y tromper. Rien ne lui permet de savoir que le label bio des pays tiers est moins exigeant, et qu'en particulier les bananes bio qu'il achète peuvent être traitées par des huiles minérales paraffiniques.
Nous préconisons donc de profiter de la refonte du règlement européen sur le bio de 2007. Il faut parvenir à prévoir un volet spécifique pour la culture biologique en milieu tropical dans le nouveau règlement européen sur le bio. Cela permettra d'assouplir le recours aux semences conventionnelles, d'autoriser la culture sur claies, de raccourcir le délai de conversion et de permettre le traitement post-récolte par des produits d'origine naturelle.
En outre, il serait judicieux de s'inspirer du modèle de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française pour autoriser la certification de l'agriculture biologique par un système participatif de garantie (SPG), en rendant facultatif le recours à un organisme certificateur. Interdit par la réglementation européenne, le SPG est pourtant utilisé non seulement au Brésil et en Inde mais aussi aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Le SPG permettrait de compenser l'absence des organismes certificateurs dans les outre-mer et de faire ainsi baisser le coût de la certification pour les producteurs domiens. C'est un système d'assurance-qualité ancré localement qui repose sur des groupements associatifs rassemblant des producteurs et des consommateurs.
Parallèlement, nous souhaitons que soit interdite l'importation sous l'étiquette bio des produits de pays tiers lorsqu'ils ne respectent pas la réglementation bio européenne. Il sera également essentiel de développer l'information du consommateur sur les conditions de production du bio dans les pays tiers et sur le différentiel de qualité environnementale avec les outre-mer pour valoriser nos productions.
Enfin, nous n'avons pas négligé le niveau de décision territorial. Le développement économique est de la compétence des régions. C'est pourquoi nous proposons que les régions accordent une aide financière, via des mesures agroenvironnementales territorialisées sur fonds européens, pour soutenir le revenu des agriculteurs pendant le délai de conversion vers le bio.
Plus largement, nous recommandons d'utiliser le modèle MOSAICA de l'unité ASTRO de l'INRA basée en Guadeloupe pour élaborer des stratégies territoriales agricoles. Ce modèle innovant permet de mesurer l'impact non seulement de changements techniques et environnementaux mais aussi de l'évolution des normes réglementaires sur les choix de cultures et de pratiques des agriculteurs au niveau de la parcelle, de l'exploitation et du territoire. Pourquoi ne pas étendre ce modèle conçu pour la Guadeloupe vers la Martinique, La Réunion et la Guyane et s'en servir comme aide à la décision au niveau régional ?
Voilà les principales propositions que nous souhaitions soumettre à votre approbation pour réussir cette « acclimatation normative » dont les agricultures de nos outre-mer ont tant besoin.

Nous devons impérativement arriver à sensibiliser les instances communautaires aux défis spécifiques que doivent affronter les RUP. Force est de constater que l'Union européenne recourt quasi exclusivement à l'anglais dans son fonctionnement quotidien. C'est pourquoi nous avons fait traduire en anglais notre résolution sur les sucres spéciaux et les accords de libre-échange. Je pense que ce rapport le mérite également et nous pourrions faire traduire en anglais la synthèse.
Par ailleurs, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui devrait bientôt être adoptée s'apprête à renforcer la part du bio dans les repas servis dans les cantines scolaires. Or, nos collectivités ultramarines n'abritent pas de production bio en quantités suffisantes, si bien que nous allons devoir importer des productions bio pour faire face à nos nouvelles obligations.
Encore un exemple du peu de prise en compte des contraintes des outre-mer !

Je suis très favorable à une traduction en anglais de la synthèse et des propositions du rapport. Il me semble qu'il serait très judicieux de les traduire également en espagnol et en portugais si nous voulons mobiliser l'ensemble des pays qui comprennent des RUP, et former un front commun avec eux.

Je félicite les rapporteurs pour leur excellent travail. Leurs préoccupations rejoignent certaines conclusions du rapport que nous avions préparé l'an dernier avec Jérôme Bignon sur les solutions territoriales ultramarines au changement climatique. Alors que la COP22 sera bientôt accueillie au Maroc, nous ne devons pas relâcher notre effort et donner toute la visibilité nécessaire aux problématiques mais aussi aux capacités d'innovation de nos territoires.
Vous avez très justement relevé la nature archipélagique de la Guadeloupe qui n'est pas prise en compte dans l'organisation du contrôle des importations. La suppression de la police aux frontières à Marie-Galante est très dommageable alors que notre île est située à quelques encablures de la Dominique.
Enfin, j'aimerais proposer à la délégation d'organiser une audition sur le thème de l'eau qui est une ressource capitale et très vulnérable dans les outre-mer.

Il est évidemment indispensable de porter les conclusions de notre délégation au niveau européen. À cette occasion, nous pourrions également faire le point avec les autorités communautaires sur le secteur de la pêche dans les RUP qui ne peut pas toujours bénéficier de l'ensemble des subventions auxquelles elles peuvent prétendre. Je pense aussi aux difficultés des pêcheurs guyanais qui ne sont pas en mesure de profiter de l'intégralité du quota de pêche qui leur est alloué en raison de l'inadaptation de la réglementation européenne.
La délégation sénatoriale à l'outre-mer a adopté le rapport à l'unanimité des présents.