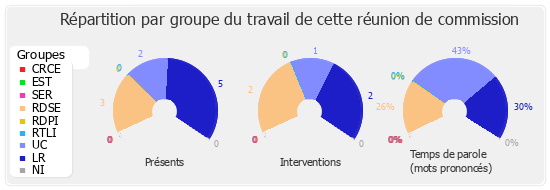Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 14 mai 2014 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission entend une communication de MM. Jean-Pierre Chevènement, Christian Cambon, Jean-Marie Bockel, Mme Michelle Demessine et M. Jacques Berthou sur la mission effectuée en République centrafricaine du 13 au 16 avril 2014.

Nous avons effectué, en République centrafricaine, une mission très intense par le nombre des rencontres et des informations qu'elle nous a procurées. Cette mission s'est déroulée sur deux jours, les 14 et 15 avril.
Après un arrêt à Libreville et une séquence d'information de notre ambassade et du colonel Rousselle, commandant adjoint des Forces françaises au Gabon, nous avons consacré deux jours pleins à Bangui où nous avons rencontré l'ensemble des intervenants : Sangaris avec le général Soriano et son état-major, la Présidente par intérim, Mme Samba-Panza, le Premier ministre, M. André Nzapayéké, le groupe des 4 : Union européenne, Union africaine, ONU et France. Seul « manque » à cette mission : nous n'avons pas pu avoir de contacts avec l'état-major de la MISCA.
Nous avons eu des entretiens avec les ministres de la défense, de la sécurité publique, de l'éducation et de la santé. Nous avons échangé avec le président du Conseil national de transition, M. Ferdinand Nguendet, avec les autorités religieuses (le président des églises protestantes, l'archevêque de Bangui et l'imam) et avec les principaux acteurs humanitaires (PAM, FAO, UNICEF, HCR, OCHA, ECHO, OIM et le CICR).
Ces rencontres officielles ont été ponctuées d'échanges très chaleureux avec les personnels de la force Sangaris auxquels nous avons dit toute l'admiration et l'estime de la représentation nationale pour le travail qu'ils accomplissent dans des conditions particulièrement difficiles.
Nous avons rencontré la presse à plusieurs reprises et nous nous sommes rendus au PK5 qui est le quartier musulman de Bangui, au sein du 3ème arrondissement, et qui demeure un lieu d'affrontement entre les communautés, ou plutôt de ce qu'il reste de la communauté musulmane (essentiellement commerçante) avec le reste de la population.
Pour mieux se rendre compte de l'action de la force Sangaris en RCA, je vous propose de visionner un très court film de 3 minutes réalisé par le service de communication de la force.
Je vous rappelle que notre intervention en Centrafrique à compter du 5 décembre 2013 avait pour objectif principal de rétablir une sécurité minimale et d'enrayer la spirale d'exactions et d'affrontements communautaires qui dégénéraient ou auraient pu dégénérer en massacres. Sa seconde mission consistait à favoriser la montée en puissance de la force africaine, la MISCA.
La force Sangaris compte environ 2 000 militaires. La stratégie poursuivie par notre pays suppose, dans le courant de l'année 2014, d'assurer la transition avec la mise en place successive de l'opération européenne EUFOR RCA, qui permettra un redéploiement de Sangaris, et, surtout, l'arrivée à compter du 15 septembre de l'opération de maintien de la paix et de la transformation de la MISCA en MINUSCA forte de 12 000 hommes. EUFOR RCA a commencé à se déployer quelques jours après notre mission et prend le relais de la force Sangaris pour la sécurité de l'aéroport de Bangui et de plusieurs quartiers de la capitale.
Comme je l'ai indiqué, nous n'avons pas pu rencontrer la MISCA. A travers cette force, l'Union africaine est un acteur incontournable et précieux de la résolution de la crise. Nous ne pouvons que constater malheureusement que le retrait du contingent tchadien ainsi que les difficultés structurelles de la force africaine réduisent sa capacité opérationnelle. C'est le cas, en particulier, en matière de commandement, en l'absence de certaines capacités clés et de moyens logistiques. Ces difficultés doivent être progressivement réduites avec l'aide de la France et de la communauté internationale. Le relais, après le 15 septembre, de la MISCA en MINUSCA, permettra de disposer de moyens plus importants avec le soutien logistique et financier de l'ONU.
S'agissant de la situation opérationnelle aujourd'hui, nous avons pu constater que le premier objectif de Sangaris a été atteint en rétablissant le calme dans la capitale Bangui. Les récents événements dans le nord du pays et la persistance des incidents graves en province tout comme dans certains quartiers de Bangui montrent à l'évidence que les forces en place font face à une situation d'insécurité diffuse permanente, qui souligne l'urgence de rétablir des forces de sécurité intérieure (police et gendarmerie) ainsi que l'ensemble de la chaîne pénale (justice et prison). L'une des principales difficultés de Sangaris est que, voulant sécuriser la population victime des exactions de la Seleka, elle peut donner aux pulsions revanchardes ou tout simplement criminelles des « antibalakas » l'occasion de s'exercer. La force Sangaris, qui n'a pas d'ennemi désigné, doit aussi faire face sur deux fronts aux exactions (pillages-meurtres) qui se font jour dans un pays qui n'a jamais connu l'Etat, mais seulement une succession de coups d'Etat.
L'une des difficultés principales est que la force militaire n'est que très partiellement adaptée à cette tâche d'interposition et de lutte contre des groupes armés qui sont très largement des groupes criminels composés de pillards issus pour beaucoup d'une jeunesse désoeuvrée.
Enfin, dernier point de cette longue introduction : la situation humanitaire qui est extrêmement problématique. Il suffit de rappeler que, selon les agences de l'ONU, la RCA compte près de 1,9 million d'habitants dans une situation de précarité alimentaire, 625 000 déplacés internes, dont 200 000 à Bangui, et plus de 300 000 réfugiés dans les pays voisins. La question des réfugiés et de leur retour sera l'un des éléments clés de la solution de la crise et du processus de réconciliation.

Avant d'en venir aux principaux enseignements de notre mission, je crois qu'il est utile de rappeler que la crise actuelle en RCA est un échec flagrant des dirigeants politiques centrafricains, mais aussi de la communauté internationale qui, depuis l'indépendance de ce pays, ne cesse de se pencher sur les drames qu'il a traversés, de coup d'Etat en coup d'Etat et d'aide internationale en aide internationale. L'incapacité totale de l'État (« il y a quatre armées », nous a dit un responsable ministériel : autant que de présidents qui ont recruté prioritairement dans leur région) et la crise humanitaire, politique et économique qui en résulte, montrent à l'évidence que les efforts déployés étaient insuffisants et qu'aucune alerte sur la gravité de la situation et la proximité de la crise n'a été donnée. La crise centrafricaine pose avec acuité la question de l'efficacité de la prévention des conflits inter ou intra étatiques.
C'est un débat récurrent, et que nous connaissons bien, entre le principe d'indépendance et de souveraineté des Etats et l'évidente faillite de leurs pseudo-élites, corrompues et incompétentes. Depuis quelques années, les Nations unies ont décidé d'intervenir, que ce soit au nom du devoir de protéger les populations civiles (résolution de l'AGNU de 2005) ou avec l'accord des gouvernements concernés. La frontière est néanmoins ténue entre ce devoir de protection et une ingérence pure et simple dans les affaires intérieures d'un pays. Toutefois, nous pouvons espérer qu'une dérive génocidaire telle que celle qu'a connue le Rwanda il y a 20 ans pourra être évitée.
Il importe, en effet, de rappeler les raisons de l'intervention des forces françaises en Centrafrique le 5 décembre 2013. Ce que nous avons pu constater, lors de notre mission, c'est que les affrontements politiques communautaires pouvaient dégénérer en heurts, ceux-ci enclenchant une logique prégénocidaire, qui n'a été que provisoirement endiguée et qui peut toujours ressurgir.
La responsabilité du Président Bozizé qui, pour se maintenir au pouvoir, a mis en oeuvre un processus de propagande qui opposait la communauté chrétienne à la communauté musulmane, est clairement engagée. Elle a conduit, avec la prise de pouvoir en mars 2013 par la coalition Séléka du Président Djotodia, à un premier nettoyage ethnique et à une haine intercommunautaire qui a assimilé à l'ensemble de la communauté musulmane les exactions des troupes de la Séléka. Cette haine a enclenché un désir de vengeance qui est à l'origine du développement des milices anti-balaka. Mais il serait tout à fait inexact de parler d'affrontements interreligieux ; la religion est instrumentée par des pillards qui ne sont ni chrétiens ni musulmans.
L'intervention de ces milices a conduit à un nouveau nettoyage en sens inverse, au détriment de la communauté musulmane forcée à l'exode, en particulier dans l'ouest du pays et à Bangui. A son tour, la communauté musulmane rend responsable l'ensemble de la communauté chrétienne des exactions commises par les « anti-balaka ». Il y a là indiscutablement un cycle extrêmement dangereux qui peut conduire à la généralisation des massacres d'une communauté contre l'autre et à la partition du pays.
L'un des éléments les plus inquiétants pour la poursuite de ce mouvement est que le « nettoyage ethnique », de fait mis en oeuvre par les « anti-balaka », rencontre la volonté de certains éléments de la Séléka et de la communauté musulmane d'aboutir à une partition du pays.
On pourrait penser qu'il y a loin du nettoyage ethnique au génocide. Je voudrais faire à cet égard trois remarques :
- la première est que la violence intercommunautaire n'a nullement été éradiquée par l'intervention française et celle de l'Union africaine. Elle est toujours présente même si l'action des forces internationales la contient. Cette violence revêt un caractère global puisqu'elle repose sur le fait que chaque communauté rend l'autre responsable de l'ensemble des exactions commises par les groupes armés, ou par de simples bandes de pillards.
- La seconde est que la principale violence est dans le désir, non pas d'extermination mais d'expulsion d'une minorité : les musulmans. Or certains pays voisins comme le Tchad ou le Soudan ne manqueraient pas d'intervenir en cas de dérapage de type génocidaire.
- La troisième remarque enfin est qu'il existe un risque important de voir des groupes terroristes du type Boko Aram recruter une jeunesse désespérée et délaissée par les pouvoirs publics. Cette activité terroriste, si elle n'est pas encore à l'oeuvre, ne peut être exclue en cas de pourrissement de la situation. Le risque de répercussions sur le Sahel doit être envisagé.
L'intervention française a sans doute freiné un engrenage très dangereux, mais elle a pu aussi susciter des espoirs irraisonnés et libérer des forces destructrices. D'où la complexité de la tâche de stabilisation qui doit être menée sur deux fronts. L'interposition de la communauté internationale masque l'ampleur de cette haine intercommunautaire qui est profondément présente et qui mettra de très longues années à disparaître. La logique d'extermination d'une communauté par l'autre, avec ses évidentes répercussions régionales, resurgirait immédiatement en l'absence des forces internationales.
Nous sommes donc dans une situation extrêmement fragile dans laquelle tout est à faire avec des moyens manifestement très insuffisants et une évidente incapacité des Centrafricains eux-mêmes à prendre en main leur destin. Cette constatation nous permet de tirer une première conclusion : la communauté internationale, à travers l'ONU, est en Centrafrique pour de nombreuses années. Elle est confrontée à une situation d'une extraordinaire complexité dans laquelle le travail de justice et de réconciliation nécessaire pour faire baisser les tensions doit se faire en parallèle à la construction d'un État qui, à dire vrai, n'a jamais existé mais dont l'embryon a été totalement détruit en un an d'affrontements intercommunautaires.
Il serait évidemment vain pour notre mission de deux jours en Centrafrique de prétendre à une analyse exhaustive et, a fortiori, à des préconisations. Mais, plus modestement, nous allons vous faire part de nos premières impressions.

La première impression est l'absence quasi totale d'Etat, d'autant plus frappante que nous ne nous sommes déplacés que dans la capitale. Il est vrai que dans les décennies passées la RCA n'a jamais eu un Etat digne de ce nom, en dehors de la capitale et des zones avoisinantes. Qui plus est, ce pays n'a pas de conscience nationale. Le fondateur de la RCA ne songeait-il pas à le rattacher au Tchad ?
Dans une interview récent au journal « Le Monde », la Présidente, Mme Samba Panza, répondait à la question : « de quoi la RCA est-elle malade ? » par la réponse suivante : « De sa division, du manque de nationalisme, du manque de vision commune pour parvenir à une sortie de crise ».
Les administrations n'existent plus. La plupart de leurs locaux ont été pillés et saccagés. Les fonctionnaires, non payés, ont fui. On observe un certain retour, très insuffisant, du fait que les salaires sont assurés depuis deux mois mais l'immensité de la tâche de reconstruction est hors de portée de la seule RCA. Elle ne dispose que de très peu d'encadrement (les préfets et sous-préfets sont à Bangui et non sur le terrain), elle n'a plus de moyens techniques, sa compétence en matière de gestion de l'Etat paraît extrêmement limitée.
Les principaux hommes politiques du pays, dont le comportement n'a évidemment pas été toujours exemplaire lorsqu'ils étaient au pouvoir, demeurent aujourd'hui invisibles et muets, se gardant soigneusement de prendre position dans la perspective des élections prévues en 2015.
Ce constat de l'absence d'Etat vaut pour tous les domaines et, plus particulièrement, pour les questions de sécurité.
L'armée centrafricaine a été balayée par la Seleka qui s'est emparée de tous les arsenaux, des poudrières, des matériels. Elle est totalement démunie. Une partie non négligeable s'est tournée vers le grand banditisme et les trafics en tous genres en s'octroyant, du reste, des grades à la hauteur de leurs ambitions. Une reconstruction de l'armée se heurte principalement aujourd'hui à deux obstacles : l'embargo, mais surtout leur incapacité totale à faire le tri du bon grain et de l'ivraie. Le ministre de la défense, le général Thomas Théophile Tchimangoua, s'en remet totalement à la France dont il souhaite qu'elle prenne tout en main. Mais dans le même temps il récuse toute idée de « chasse aux sorcières ».
Un rapport d'Amnesty International de février dernier indique que « lors de la reconstruction des forces de sécurité, le plus difficile sera de veiller à ce que ces forces démantèlent les nombreuses milices armées présentes dans le pays, et ne coopèrent pas avec elles ou adoptent leurs pratiques. » On n'en est manifestement pas loin et notre sentiment est que la reconstitution de forces armées républicaines sur une base nationale et non ethnique ou communautaire est à la fois indispensable et quasiment hors d'atteinte par la seule volonté des responsables centrafricains. Seule la Présidente évoque la nécessité de « reconstruire le pays sur la base de la justice ».
La police n'est pas mieux lotie et rencontre les mêmes problèmes. Le ministre de la sécurité publique, M. Denis Wangao Kizimalet, nous a dressé un tableau dramatique de l'état des forces de police démunies de tout. La remise sur pied de la police et de la gendarmerie, à laquelle la France prend une part active, qui doit être relayée par la force européenne, est une étape essentielle mais difficile de ce processus du fait de la faible détermination des intéressés. Il convient également de rappeler qu'au sein de la MISCA il y a un effectif de 650 policiers, soit un peu plus de 10% de l'effectif total.
Le rétablissement de la chaîne pénale, la poursuite des criminels, leur jugement et leur incarcération doivent être des priorités. La question de la justice est centrale. Le même rapport d'Amnesty International constate que « les précédents gouvernements du pays n'ont jamais rendu justice, de manière équitable et impartiale, aux victimes d'atteintes aux droits fondamentaux, même de crimes graves tels que les disparitions forcées les exécutions extrajudiciaires et la torture. Cette absence de justice perpétue le cycle de violence car nombre de Centrafricains sont convaincus que les actions d'autodéfense sont le seul moyen de punir les auteurs présumés de tels actes. Mettre fin au règne de l'impunité - par le biais d'enquêtes sérieuses, de véritables poursuites judiciaires et de sanctions contre les responsables de graves violations - contribuera fortement à apaiser les tensions intra-communautaires et à rétablir la confiance dans l'État de droit. »
Peut-être le domaine des finances fait-il l'objet d'un sort particulier puisque des experts occidentaux et les institutions internationales se penchent sur la question. Mais, là aussi, les recettes sont quasi inexistantes ou très largement surestimées. Pour dire les choses clairement, la RCA sera pour de longues années en perfusion financière internationale. Par ailleurs, l'aide financière internationale, aussi indispensable soit-elle, doit faire l'objet d'un suivi particulièrement rigoureux pour éviter qu'une fois de plus une partie importante ne soit détournée.
Un des points positifs que nous avons pu constater lors de notre mission est la volonté bilatérale ou multilatérale de relance de la coopération civile dans tous les domaines. La rencontre que nous avons eue avec les organisations internationales européennes ou onusiennes, tout comme l'investissement tout à fait remarquable de l'AFD en RCA, montrent qu'il y a une véritable prise de conscience de l'urgence, de l'immensité de la tâche et de la constatation de l'incapacité des autorités centrafricaines de coordonner et d'organiser la reconstruction civile.
La reconstruction ne peut être que globale puisque tout est à faire.
La Présidente de transition, Madame Samba Panza, nous a fait part d'un besoin d'audit général de l'Etat et, en particulier, pour ce qui concerne la chaîne financière et économique. Elle a demandé également un appui en matière de gestion des ressources humaines et une assistance technique dans pratiquement tous les domaines y compris, bien sûr, le domaine militaire.
La santé, l'éducation (seules certaines écoles privées ont repris timidement les cours). La rentrée scolaire 2014 ne connaît pas le commencement d'une réflexion. Les questions de formation sont fondamentales.
Et je ne cite pas le redémarrage d'une timide activité économique, le lancement de travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. Ceci est particulièrement fondamental pour donner des perspectives à une jeunesse désoeuvrée qui peut être tentée par le banditisme ou l'extrémisme armé.
Nous pourrions faire la même analyse pour tous les secteurs de la gestion d'un Etat. A sa tête, le gouvernement de transition ne paraît pas avoir non plus une grande expérience. Il s'agit souvent de fonctionnaires internationaux qui se voient confrontés à des tâches qui les dépassent.
Seuls peut-être la Présidente, Mme Samba Panza, et le Président musulman du CNT, M. Ferdinand Nguendet, nous ont paru avoir une certaine vision et surtout une certaine volonté. Mais comme le constate lui-même le Président du CNT : « l'Etat est en lambeaux, tout est à reconstruire. On n'a ni police, ni gendarmerie, ni justice, ni armée. L'histoire de la RCA est ponctuée de coups d'Etat et de conflits intérieurs qui ont entraîné une politique d'exclusion pour se protéger de l'adversaire. La jeunesse est laissée à elle-même, il y a une absence totale de vision, l'ensemble du pays est à l'abandon ».
Pourtant, selon lui, le gouvernement de transition est une chance pour la nation en raison de la manière dont il a été constitué, sans possibilité de se présenter aux élections. La présidente de transition et le premier ministre ne sont pas des hommes politiques. Ils n'ont pas d'adversaire politique et peuvent incarner les valeurs républicaines avec un seul but : celui de ramener l'ensemble des forces autour d'une table et de promouvoir la réconciliation. On peut néanmoins regretter que la répartition entre une présidente de transition chrétienne et un premier ministre musulman n'ait pas pu être obtenue conformément aux accords de N'Djamena.
Le Conseil national de transition, qui a pourtant gagné en crédibilité, peine encore à fonctionner, en particulier pour avancer dans la rédaction d'un avant-projet de Constitution qui demeure sa principale mission. Ses membres se considèrent comme une chambre d'enregistrement qui ne parvient pas à faire pression sur le gouvernement dont ils se plaignent de l'immobilisme.
La question des élections et de leur faisabilité en l'absence d'un recensement fiable des électeurs mérite d'être posée. Ce qui paraît évident c'est qu'il n'y a pas de légitimité démocratique et que celle-ci est indispensable pour rassembler et reconstruire. Nous avons constaté une nouvelle perte de confiance de la population dans le politique : la vision et les espoirs suscités ne sont pas concrètement au rendez-vous. Il y a là un danger très réel de pousser une population de plus en plus désespérée en l'absence de progrès concrets dans une logique communautaire et non pas nationale. La tenue d'élections pourrait permettre une identification de la population et de ses aspirations avec ses dirigeants. En disant cela nous ne méconnaissons nullement la validité des efforts réalisés par les responsables de la transition qui, ne pouvant se présenter aux élections, disposent, en théorie, de la liberté nécessaire à la mise en oeuvre d'actions concrètes et courageuses. Pourtant, le coordonnateur des Nations unies et un certain nombre de représentants d'organisations internationales nous ont fait part de leurs doutes quant à la faisabilité de l'organisation d'élections.
Enfin, à un moment où toutes les bonnes fées des institutions internationales se penchent sur la RCA, il faudra être particulièrement attentifs à la corruption des soi-disant « élites » ou plutôt de celles qui sont au pouvoir.

Notre seconde impression porte sur la façon dont la presse occidentale et notamment française décrit un conflit religieux.
Les autorités religieuses mais aussi politiques ont toutes souligné la tradition de coexistence sans problème des religions chrétienne et musulmane (Répartition approximative : catholiques 29%, protestants 52%, musulmans 15%) en RCA, depuis les origines.
Nous avons rencontré les trois représentants des églises catholique, protestante et musulmane : l'archevêque Dieudonné Nzapalainga, le pasteur Nicolas Guerekoyame-Gbangou et l'imam Kohone Layama. Ces trois représentants des autorités religieuses ont décidé dès le début de la crise de contribuer autant qu'ils le pourraient à apaiser les tensions et à se rendre ensemble sur le terrain, ce qui n'est pas le cas des autorités politiques. La cohésion qu'ils manifestent au nom des mêmes valeurs humaines peut contribuer à l'apaisement des tensions, mais force est de constater que cela ne suffit plus.
Selon nos interlocuteurs, la religion est instrumentalisée à des fins politiques et économiques. Il existe évidemment un phénomène de prédation des richesses de la population d'origine musulmane qui sont traditionnellement les commerçants de la RCA. Le pillage, le nettoyage ethnique puis l'appropriation sont les trois étapes de ce conflit entre les communautés dont l'aspect religieux n'est certainement pas le plus important.
L'épuration en cours est un drame humanitaire, politique et économique. En effet, avec la fuite des musulmans, c'est toute la structure commerciale qui disparaît, et ne s'improvise pas commerçant qui veut.
C'est la raison pour laquelle il faut, dans toute la mesure du possible - et si ces populations le souhaitent - maintenir ces communautés musulmanes à Bangui. Faute de quoi la marche vers la partition pourrait être irrésistible. Cette dimension est évidemment déterminante pour l'avenir du pays. Il est difficile de trouver un juste équilibre entre le fait de traiter les situations de détresse de ces populations dont la vie est menacée et la volonté des agences onusiennes de voir les forces internationales aider ces populations à rejoindre le Nord ou l'Est du pays, accroissant ainsi le risque de partition.
Mme Samba Panza dans l'interview donnée au Monde indique clairement le chemin à suivre pour éviter la partition : « d'abord, il faut restaurer l'autorité de l'Etat. Les brigades de gendarmerie doivent être rouvertes et les commissariats rééquipés. Il faut que l'administration revienne. Ensuite, un processus de réconciliation doit reprendre à la base. Il faut que les communautés réapprennent à se fréquenter. Il faut aussi un dialogue politique avec nos frères de l'est et leur apporter des projets alors qu'ils se sentent complétement abandonnés. »
Il n'empêche que nous ne pouvons qu'être frappés par le niveau de la haine et de la peur qui s'exprime et qui rendra long et difficile le processus de réconciliation. Nous avons pu constater cela lors du déplacement que nous avons fait, à la rencontre de la population musulmane, dans le quartier PK5 de Bangui.
Les autorités religieuses, tout comme les autorités politiques, sont dépassées par l'ampleur de la crise et l'effondrement de toutes les structures. Nous avons entendu un appel à la communauté internationale, et, comme un refrain, la sollicitation faite notamment à la France, qui « détient toutes les clés », de se substituer aux autorités défaillantes. Nous avons réaffirmé, là encore, que, si la communauté internationale détenait certaines des clés de la sortie de crise, rien ne pourrait se faire sans la participation active des Centrafricains eux-mêmes.
Enfin, les comptes rendus de la presse ont tendance à glisser de l'idéologie et du conflit religieux dans les deux groupements que sont la Seleka et les anti-balaka. En fait, ces groupements, très hétérogènes, sont, dans une très large partie, composés de bandits de grands chemins et de maffieux ou d'opportunistes qui prospèrent sur le conflit et le manipulent à leur profit.

La réconciliation : c'est l'un des principaux points d'inquiétude. La séquence idéale qui passe par quatre étapes : sécurisation, reconstruction de l'Etat, réconciliation, élections. Elle est très loin d'être assurée. Nous avons déjà parlé de la reconstruction de l'Etat pour laquelle des moyens considérables en hommes, en formation, en argent doivent être coordonnés par l'ONU.
Pour dire les choses crûment, nous n'avons pas eu l'impression d'une volonté de tout mettre en oeuvre pour lancer et, à fortiori, pour faire aboutir le processus de réconciliation. On nous dit que l'on tire les leçons du passé en commençant par la base des communautés villageoises pour aboutir in fine à une grande messe inclusive ; on nous dit que le processus est en marche, mais, objectivement, on ne le voit guère et, plus grave, la volonté semble faire défaut. Or la sécurisation, qui est le socle indispensable de tout le reste, ne se suffit pas à elle seule. L'apaisement des tensions ne peut se faire que s'il y a justice et réconciliation.
Le point central de ces hésitations tient à l'incapacité de mettre la justice en pointe, c'est-à-dire de rechercher et de juger ceux qui ont commis des crimes. Derrière ces hésitations, il y a en particulier le sort réservé aux deux anciens Présidents Bozizé et Djotodia qui conservent une influence certaine et qui n'ont pas renoncé au pouvoir.
La présidente par intérim a récemment déclaré : « Je suis contre l'impunité. La réconciliation nationale sans justice n'a pas de sens. Pour le moment seul M. Bozizé fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la justice centrafricaine, lancé avant que je n'arrive. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités des uns et des autres dans les exactions commises depuis 2012. »
Il n'y aura pas de réconciliation sans justice et l'absence de justice perpétue le cycle de la violence. Là encore, le sentiment d'impuissance des autorités, au-delà des mots et de la clairvoyance des analyses, est manifeste.
En conclusion, très provisoire, les populations comme les responsables, comptent beaucoup trop sur la France. On lui demande de tout faire et toute perspective de retrait partiel est dénoncée avec vigueur. Il y a indiscutablement une tentation de la déresponsabilisation que nous avons constatée chez l'ensemble de nos interlocuteurs.
Nous n'avons cessé de leur dire que la France ne peut tout faire. Elle dispose d'un certain nombre de clés, mais pas de toutes les clés. Elle assume ses responsabilités mais les autorités de RCA doivent assumer les leurs.
A ce stade, le principal risque pour notre pays, et au-delà pour la communauté internationale, est de voir la stratégie menée ne pas recouper la courbe de la montée en puissance des Centrafricains eux-mêmes qui doivent prendre leur destin en main sans recopier les schémas précédents qui ont conduit à cette implosion.
Notre stratégie c'est qu'à une opération militaire, Sangaris, décidée dans l'urgence pour éviter ce qui aurait pu dégénérer en logique génocidaire, se substitue progressivement une opération sécuritaire autour d'Eufor RCA et de l'opération de maintien de la paix de l'ONU (12 000 h), avec la mise en place d'une police, d'une gendarmerie, de prisons, d'une justice. C'est le rétablissement de la chaîne pénale. Nos forces armées ne sont en effet pas faites pour des opérations de police et d'interposition. En septembre, la force de l'ONU, par l'approche globale qu'elle est seule à permettre, devra aider à reconstruire l'Etat sur la base d'une situation de retour à la sécurité, condition du développement. Ce transfert s'accompagnant d'un allègement de notre dispositif.
Le pendant de cette stratégie logique c'est que les autorités centrafricaines prennent leur part du processus, et notamment de la réconciliation, de la justice et de la prise en compte de la jeunesse qui est un élément absolument fondamental. Cela suppose un certain sens de l'Etat et de l'intérêt général dont nous attendons qu'il se manifeste chez ceux à qui cette responsabilité incombe.

Je voudrais souligner l'intérêt de ces déplacements qui nous permettent de découvrir comment les choses se passent concrètement. C'est en particulier le cas pour les conditions matérielles de vie de nos militaires auxquelles nous sommes particulièrement attentifs. S'agissant de la RCA, nous avons pu voir la proximité du camp de réfugiés à M'Poko qui rend les conditions de sécurité difficiles. Les conditions de vie, le rationnement d'eau, l'absence de climatisation... tout cela pose problème alors même que nos soldats prennent tout cela avec une dignité admirable. Il faut mettre cela en regard des menaces qui planent actuellement sur le budget de la défense qui, si elles sont avérées, devront conduire l'exécutif à dire clairement que nos interventions en OPEX seront demain impossibles.

J'ai pu constater aussi les conditions souvent spartiates des cantonnements en OPEX en particulier en Afghanistan. Nous avions fait part de quelques remarques au ministre de la défense à notre retour qui se sont traduites par des améliorations au niveau des petits équipements. D'une manière générale, nos soldats ont une réputation de rusticité qui est regardée avec une certaine admiration surtout si on la compare aux autres armées européennes. S'agissant du respect de la LPM, nous avions voté en ayant conscience que les moyens étaient juste insuffisants. C'est la raison pour laquelle j'avais insisté pour que nous adoptions un amendement visant les 2% du PIB norme OTAN en cas de retour à bonne fortune. Je considère inenvisageable une réduction de ces crédits sauf à remettre en chantier un nouveau Livre blanc et une nouvelle LPM.

Il est évident qu'une ponction de quelques milliards d'euros ne procurerait qu'un avantage minime au regard des dégâts énormes qu'elle entrainerait. Revenant à la RCA, je voudrais faire une remarque sur la présidente par intérim, Mme Samba-Panza et du gouvernement en général. Le discours qui est tenu est souvent bien reçu et les analyses clairvoyantes, mais cela n'embraye sur rien et n'a que très peu d'effets concrets et ne se traduit pas par des engagements sur le terrain.

Je partage ce point de vue. Les personnalités qui sont au pouvoir de transition sont excellentes pour le dialogue avec les capitales occidentales et les bailleurs de fonds mais cela n'a pas d'efficacité sur le terrain.
La réunion est levée à 11 heures 47