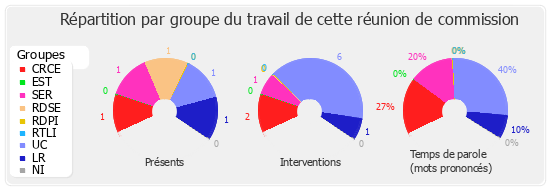Mission d'information Démocratie représentative, participative et paritaire
Réunion du 11 janvier 2017 à 17h00
Sommaire
- Audition de m. jean-françois pilliard professeur affilié et président de la chaire « dialogue social et compétitivité des entreprises » à l'escp europe membre de la section du travail et de l'emploi au conseil économique social et environnemental cese ancien délégué général de l'union des industries et métiers de la métallurgie iumm et ancien vice-président et président du pôle social du mouvement des entreprisse de france medef (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Jean-François Pilliard professeur affilié et président de la chaire « dialogue social et compétitivité des entreprises » à l'escp europe membre de la section du travail et de l'emploi au conseil économique social et environnemental cese ancien délégué général de l'union des industries et métiers de la métallurgie iumm et ancien vice-président et président du pôle social du mouvement des entreprisse de france medef
Audition de M. Jean-François Pilliard professeur affilié et président de la chaire « dialogue social et compétitivité des entreprises » à l'escp europe membre de la section du travail et de l'emploi au conseil économique social et environnemental cese ancien délégué général de l'union des industries et métiers de la métallurgie iumm et ancien vice-président et président du pôle social du mouvement des entreprisse de france medef

Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs voeux pour l'année 2017. Nous poursuivons les auditions de notre mission d'information, qui auront lieu désormais à un rythme plus régulier. Notre objectif est de remettre notre rapport d'ici à la mi-mai 2017.
Nous accueillons aujourd'hui M. Jean-François Pilliard. Ancien délégué général de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), ancien vice-président du Medef, où il était chargé du pôle social, M. Pilliard est, depuis 2015, membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Il est également professeur affilié et président de la chaire « dialogue social et compétitivité des entreprises » à l'ESCP Europe. Il est surtout l'un des spécialistes incontestés du dialogue social dans notre pays, un thème auquel il a consacré bien des enseignements et des publications. Il est ainsi particulièrement à même de nous éclairer sur la façon dont la démocratie paritaire peut, en France, enrichir la démocratie représentative pour mener à bien des réformes difficiles ou des projets structurels contestés.
Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion en direct sur le site Internet du Sénat. Elle est également ouverte au public et à la presse et fera l'objet d'un compte rendu écrit.
ancien délégué général de l'UIMM et vice-président du Medef, président de la chaire « dialogue social et compétitivité des entreprises » à l'ESCP et membre du Conseil économique, social et environnemental. - Ayant mis un terme à tous mes mandats professionnels il y a déjà un an, je suis un « semi-retraité », mais je continue à m'engager sur les sujets qui me passionnent, l'entreprise et le dialogue social. J'interviens sur ces questions au Cese, où je siège comme personnalité qualifiée. Je viens, par ailleurs, de créer une chaire qui est la première traduction d'une recommandation du « rapport Combrexelle » sur le dialogue social. J'exerce enfin des activités de conseil auprès d'entreprises. Mes propos n'engagent que moi, puisque je ne représente plus aucune organisation. Je parle à la lumière d'une expérience de trente-cinq ans en entreprise, puis de huit ans dans les organismes professionnels, UIMM, Medef, ou Comité européen de dialogue social de la métallurgie. Je me considère comme un généraliste d'entreprise, pas comme un « expert ».
Il est bon de préciser les termes « paritarisme », « dialogue social », de mieux définir leur contenu, car ils font l'objet de propos réducteurs. Le paritarisme de décision renvoie à la question : qui fait quoi dans l'établissement de la norme sociale ? Le paritarisme de gestion intervient une fois la norme fixée - l'enjeu essentiel étant alors d'analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de proposer des pistes d'amélioration. Chacun a tendance à défendre l'organisation à laquelle il appartient, alors que celle-ci n'a de raison d'être que si elle apporte aux usagers, à la Nation, des résultats.
Le paritarisme de décision a été largement abordé par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui visait à définir qui fait quoi dans la définition de la norme, et quel rôle joue chaque catégorie d'acteurs. Dans le champ du temps de travail, elle a ainsi clarifié les choses par rapport au passé : la norme s'élabore au plus près du terrain, la branche intervient pour apporter des réponses aux petites et moyennes entreprises (PME) et la loi fixe un socle de droits essentiels pour les salariés. D'autres champs pourraient être pareillement abordés. Un groupe de travail sur la refondation du code du travail a été annoncée, mais aucune décision effective n'a été prise à ma connaissance.
Jusqu'à cette loi, faute de choisir qui faisait quoi, les robinets coulaient à tous les étages, si vous m'autorisez cette métaphore ! Accords d'entreprise, accords de branche, accords interprofessionnels, lois, règlements, directives européennes, sans oublier la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation : du point de vue des entreprises - les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés et leurs représentants -, tout cela était synonyme de complexité, d'instabilité et d'insécurité.
Lorsque l'on est attaché au dialogue social, on souhaite que se dégagent des voies d'amélioration. Nous avons un modèle social de qualité, en apparence ; mais il est d'une telle complexité qu'un professionnel lui-même n'y comprend rien, sauf s'il est secondé par une armée de juristes. C'est le modèle « Canada Dry », qui donne l'illusion d'un contenu très dense... si dense et si complexe qu'il en devient impossible à appliquer. Sur l'hygiène et la sécurité, je défie quiconque de dire ce qu'est le contenu de la législation.
Je voudrais à cet égard signaler trois enjeux. L'enjeu économique, d'abord : quelles sont les performances de la France, par rapport à celles de pays comparables ? Deuxième enjeu : les décisions et les droits sont-ils appliqués ? Enfin, l'emploi. Un environnement complexe et instable contribue au fort taux de chômage, à la dégradation de la qualité de l'emploi, et à des formes de contrat de travail pénalisantes pour l'ensemble des parties.
Le paritarisme de gestion fonctionne plus ou moins bien selon les domaines. J'en citerai trois. La gestion de l'assurance-chômage est-elle satisfaisante ? Le système incite-t-il ou non au retour à l'emploi ? Quelle est sa pérennité après tous les déficits cumulés depuis 2008 ? J'ai été responsable, côté patronat, de la dernière négociation et j'ai présidé l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Quand j'entends certains réclamer que l'État reprenne la main, je ne peux m'empêcher de penser que celui-ci n'a pas montré un haut degré de performance dans la gestion de budget ! Évitons les slogans, et ne croyons pas qu'en passant le mistigri, tout va s'arranger. Le point essentiel, c'est que l'assurance-chômage a été créée à une époque de croissance économique élevée et que personne, alors, n'avait prévu la possibilité d'une croissance si faible, si durablement. C'est pourquoi, quand bien même l'État - ou les assureurs, autre possibilité clamée - reprenait la main, les choses n'iraient sans doute pas mieux.
La vraie question est : comment recréer un système adapté aux réalités nouvelles ? Ce que l'on appelait « crise » se révèle être plutôt une transformation permanente. Dans l'avenir, les taux de croissance resteront plus faibles qu'avant 2008. Et la structure de l'emploi change considérablement. Les nouveaux modèles économiques nous obligent à revoir l'assurance-chômage.
Les retraites complémentaires Agirc-Arrco font également l'objet d'une gestion paritaire. Celle-ci fonctionne plutôt bien, même si, sur le plan économique et financier comme sur le plan du service rendu, il y a des marges de progression. J'ai négocié et supervisé des négociations, j'identifie deux voies à suivre. D'abord, clarifier et simplifier le régime de gouvernance de la prévoyance et des retraites complémentaires, car les fusions intervenues entre systèmes différents ont débouché sur des gouvernances à plusieurs étages, exigeant de mobiliser de nombreux mandataires, qui n'ont pas toujours le professionnalisme nécessaire. Ensuite, améliorer les performances de gestion financière : j'avais proposé, lors d'une négociation, une réduction des frais de gestion de 10 % par an, qui correspond à un fonctionnement normal et qui fut acceptée après des débats très difficiles. Par ailleurs, les groupes de protection sociale ont un statut particulier et gèrent à la fois les retraites complémentaires et la prévoyance. Qui est responsable de quoi, en matière de retraite complémentaire et de prévoyance ? Je suis attaché à l'économie de marché, mais la santé n'est pas un produit comme un autre ; elle doit faire l'objet d'une régulation, et d'une gestion appropriée. Est-il sain de gérer à la fois la retraite complémentaire et la prévoyance ?
Troisième domaine où s'exerce la gestion paritaire : la formation professionnelle. Les intervenants y sont nombreux : entreprises, partenaires sociaux, branche, organismes interprofessionnels, État, régions. Faute d'une vraie réforme à la hauteur des enjeux, la situation entre 2009 et 2013 s'est peu améliorée. Tous les quatre ans, il faut y revenir. Or, procéder à des réformes à répétition contribue à l'inefficacité du système. En 2009, la négociation sur la formation professionnelle avait duré quatre mois. Nous avions créé le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Puis le Parlement a légiféré sur l'accord que tous les partenaires, fait rare, avaient signé. Or le texte a, durant un moment lors de la navette, divergé par rapport aux termes de l'accord ! Là encore, entre démocratie politique et démocratie sociale, il faudrait savoir qui fait quoi. En Allemagne, quand on signe un accord majoritaire, pas besoin de loi...
Quoi qu'il en soit, les décrets d'application ont ensuite été pris, les circulaires envoyées. Déjà un an de passé. Puis on a renégocié dans les branches. Encore six mois. Enfin, il a fallu informer les entreprises. Avant que les effets réels ne se produisent sur le terrain, trop de temps se passe, notamment dans la petite et moyenne entreprise ; en effet, on l'oublie trop souvent, la France est un pays dans lequel plus de 80 % des entreprises sont des PME, et non des grands groupes. Et, pour remédier à cette inertie, il faut clarifier. D'autant que la formation professionnelle donne lieu à une gestion pluripartite et non simplement paritaire. Au pays de Descartes, on aime les choix binaires : si le système fonctionne mal, il faut le mettre à bas, et le confier soit à l'État, soit au marché. La réponse n'est pas si simple... parce que la vie n'est pas si simple. Le paritarisme a tout son sens mais il est aujourd'hui aux limites de la rupture, probablement parce qu'il a insuffisamment anticipé les transformations permanentes de l'environnement économique. L'immobilisme - j'assume ma part de responsabilités - s'explique aussi par la tendance à privilégier les logiques d'appareil et d'organisation sur l'efficacité pour l'usager ou le citoyen.
Il importe donc de réfléchir à l'évolution du paritarisme, au bon équilibre entre démocratie sociale et démocratie politique. Une seule initiative a réellement été prise par votre président Gérard Larcher, alors ministre du travail, lorsque sa loi a posé l'obligation, avant tout dépôt de projet de loi sur un sujet social, de saisir les partenaires sociaux. Ceux-ci négocient s'ils le souhaitent. En sens inverse, un accord majoritaire ou unanime doit-il donner lieu à une loi ? Quelle en est la valeur ajoutée ? Les partenaires sociaux se demandent alors à quoi ils servent...
Je me souviens d'une négociation, Christine Lagarde étant alors ministre de l'économie et Laurent Wauquiez secrétaire d'État à l'emploi, où le groupe de travail qui s'était réuni avant la négociation a débouché sur des lettres d'orientation ministérielles portant sur les thèmes et les délais : il nous dictait presque le résultat des négociations !
Enfin, je le redis : il est temps d'intégrer le cadre économique actuel, qui change profondément.

L'intitulé de notre mission d'information peut être jugé complexe, ou trop intellectuel. La vocation de cette mission est pourtant tout à fait concrète. On a, en matière sociale, les pires difficultés à réformer, par voie législative ou paritaire, et notre pays peine à se doter des équipements structurants dont il a besoin. Comment en finir avec ces blocages ? La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels fut une catastrophe à cet égard, les manifestations se succédant interminablement ; et l'on peut craindre que, demain, si des ordonnances étaient prises, cela ne reproduise les mêmes effets. Nous voulons faire des propositions.
Pourquoi le paritarisme et le dialogue social suscitent-ils autant de difficultés ? Traditions historiques, postures, culture nationale ? Les Allemands, eux, pratiquent la cogestion depuis longtemps. Ou peut-être faut-il incriminer la complexité excessive des mécanismes ? Bref, où sont les blocages ?
Le dialogue social en lui-même n'a pas d'intérêt, mais il prend tout son sens dès lors que l'on s'interroge sur ses finalités. Les questions sociales sont en France essentiellement traitées sous l'angle juridique, et dans les entreprises, on se demande surtout si l'on a bien tenu toutes les réunions légales - autrement dit, a-t-on bien dit sa liturgie !
Pour moi, le dialogue social est tout autre chose, et l'avis que j'ai rapporté au Cese, avec Luc Bérille de l'Union nationale des syndicats autonomes (Unsa), recommandait d'améliorer la culture du dialogue social en France. Nous sommes repartis de la définition donnée par l'Organisation internationale du travail (OIT) : le dialogue social, ce n'est pas seulement un dialogue entre le chef d'entreprise et ses représentants et les institutions représentatives du personnel. Il faut être convaincu que la communauté de l'entreprise gagne en efficacité dès lors que ceux qui la composent, c'est-à-dire bien sûr majoritairement les salariés, sont en capacité de comprendre à quoi sert leur travail. Le dialogue social sert à donner de l'information, débattre sur celle-ci, discuter de la stratégie de l'entreprise, de la politique commerciale, économique, financière. Il permet aussi de faire évoluer les conditions de travail. L'approche éminemment juridique nous a beaucoup éloignés de ce que devrait être le dialogue social dans l'entreprise. En Allemagne ou dans le nord de l'Europe, les chefs d'entreprise partagent l'information sur tous les domaines avec leurs salariés, sans qu'il soit besoin de le leur imposer...
On a longtemps vécu dans une culture considérant que celui qui a l'information a le pouvoir, et cette croyance a la vie dure. Or ce concept est daté ! La structure des qualifications, l'éducation ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, un client d'une entreprise a accès à l'information en temps réel, et il apprend les événements au même moment que le chef d'entreprise lui-même...
La circulation de l'information est souvent vécue de façon défensive, alors que cette dernière devrait être considérée comme un élément de partage. Si l'on diffuse l'information dès le départ, les chances d'aboutir in fine à une solution, même s'il y a des divergences, sont bien plus élevées que si un seul acteur a toutes les informations et que l'autre n'en a pas. Si le débat est déséquilibré au départ, le résultat l'est nécessairement aussi.
Une seconde voie d'amélioration - il ne s'agit nullement d'un propos lié à une quelconque actualité, je me suis toujours senti totalement libre dans mes propos - concerne la représentativité et le financement des organisations, tant patronales que syndicales.
Tout à fait. Comment voulez-vous qu'une organisation, patronale ou salariale, ait de la légitimité si son financement provient principalement, non de ses cotisations, mais de subventions diverses ? On a dit que le financement de la formation professionnelle était opaque. La loi de modernisation du dialogue social a considérablement clarifié les choses ; cela dit, on n'a pas traité le fond du sujet : une organisation doit vivre majoritairement des cotisations. Comment être autonome vis-à-vis du pouvoir politique, quel qu'il soit, si l'on est dans une relation de dépendance ?
Ce débat sur la représentativité ne se résume pas à une question de pourcentage ; 5 % ou 6 % de taux de syndicalisation dans le privé, c'est effectivement très faible, mais, finalement, il n'en va pas tellement différemment dans le secteur politique - d'ailleurs, beaucoup de points de faiblesse existant dans le champ du dialogue social se retrouvent dans le champ politique. En réalité, le maire dans sa commune, comme le délégué syndical dans son entreprise, ont une légitimité, mais, plus on s'éloigne du terrain, moins la légitimité est forte. Cette question du financement est donc très importante.
En second lieu, se pose une question clef, qui est mal traitée : qu'est-ce qui fait, dans le champ syndical comme dans le champ politique, qu'un homme ou une femme qui a du talent et de l'énergie ait envie de s'engager dans un mandat ? Aujourd'hui, pour le dire de manière un peu provocatrice, pour exercer un mandat, il faut être soit très courageux, soit inconscient, soit incompétent. Dans une entreprise, quand un salarié assume un mandat dans un comité d'établissement - je pense à des cas concrets que j'ai vécus -, au mieux on ne tiendra pas compte des compétences nouvelles acquises au cours du mandat, au pire le salarié sera marginalisé.
Je pense donc que les mandats devraient être plus courts. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un cercle vicieux : on assume un mandat dans un comité d'établissement, on s'aperçoit que cela ne sera pas pris en compte, voire qu'on en pâtira, donc on se représente pour assumer un mandat supplémentaire. Ainsi, plus le temps passe, plus on s'éloigne du terrain et plus on perd en compétence. In fine, il devient tellement difficile de retrouver un emploi que l'on se retrouve en fédération, puis en confédération. C'est ainsi que l'on se retrouve en négociation avec des gens qui, y compris dans la délégation patronale, n'ont jamais vu une entreprise de près ou de loin, ou alors il y a tellement longtemps que cela n'avait plus aucun sens...
La véritable question à se poser est donc : combien de temps dure un mandat et comment l'organise-t-on ? Si un électricien devient secrétaire ou membre du comité d'établissement, il acquiert de nouvelles compétences - des connaissances dans le champ économique, une aptitude à dialoguer... -, qu'il faut pouvoir valoriser.
J'ai plutôt tendance à être opposé aux statuts... Il ne faut pas de caractère automatique - dans une entreprise que j'ai connue, la rémunération de la personne élue ne devait pas être inférieure à la moyenne de celles de ses collègues -, mais il faut que le titulaire du mandat puisse bénéficier, un an avant la fin de son mandat, d'une discussion avec son responsable managérial, pour identifier ses compétences et déterminer la manière dont elles peuvent être utilisées.
Je suis rétif à l'idée de statut parce que, en France, on a tendance à tout réglementer. Il s'agit davantage, selon moi, d'une question d'état d'esprit, même si un encadrement est nécessaire. L'objectif n'est pas d'avoir un statut, mais que le dialogue social améliore la performance de l'entreprise.
Enfin, j'évoquerai la professionnalisation du mandat - on retrouve en partie ce sujet en politique. Aujourd'hui, un organisme d'assurance-chômage ou de caisse de retraite est confronté à des enjeux économiques, stratégiques et sociaux considérables. Si le directeur général d'une caisse de retraite soumet, par exemple, à son comité d'établissement un projet de rachat d'une chaîne de cliniques privées, cela pose toutes sortes de questions : est-ce stratégique ? Est-ce le rôle de la caisse de retraite ? Ensuite, les conditions financières envisagées sont-elles bonnes ? Le rôle de la gouvernance est, en quelque sorte, d'établir un contrepoids, dans le bon sens du terme, avec le management interne de l'institution paritaire. Or, pour assurer convenablement ce rôle, on ne peut être un amateur. Le choix du mandataire est donc crucial et sa formation continue est un enjeu clef.
Par ailleurs, le mandataire doit rendre compte de ses mandats. Lorsque j'ai assumé la présidence du pôle social à l'échelon interprofessionnel, ma première décision a été de réunir les mandataires. Je me suis rendu compte qu'il y en a avait une quantité invraisemblable, qu'on ne les connaissait pas et que la plupart d'entre eux ne rendait jamais compte de leur mandat. Le plus souvent, dans une entreprise, quand vous êtes disponible, ce n'est pas bon signe ; les plus compétents ne sont pas toujours les plus disponibles.
Nous touchons là à un véritable problème, que l'on retrouve aussi dans le sport : les mandats sont bénévoles. Aussi, beaucoup de mandataires, du côté tant syndical que patronal, considèrent que donner de leur temps, faire un acte de générosité, les dispense d'être professionnels et de rendre des comptes.
Pourquoi le débat sur la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels s'est-il si mal passé ? Il s'agit, selon moi, d'un échec collectif lié à l'absence de pédagogie vis-à-vis des citoyens. J'avais encore des mandats à l'époque et je peux certifier qu'il y a eu une véritable concertation entre l'État et les organisations salariales et patronales. Je me souviens de l'organisation, avant le dépôt du projet de loi, d'un nombre important de réunions bilatérales avec les ministres et avec le Premier ministre. Il ne faut donc pas travestir la réalité, la concertation a été réelle et on a largement abordé la question du niveau et des modalités d'élaboration de la norme sociale.
Néanmoins, la loi a subi deux problèmes. Tout d'abord, alors que le débat initial portait uniquement sur la question de la norme, se sont ajoutées la question des indemnités prud'homales et celle du licenciement économique. Ces sujets sont légitimes et doivent, selon moi, être traités, mais ils ont été ajoutés a posteriori au texte. Ensuite, on a perdu la bataille de la communication avec les citoyens. Pas une personne sur dix, dans les cortèges qui ont défilé, n'avait lu la loi, car elle était illisible ! Elle comportait 165 articles, sans parler des décrets par la suite ! C'est pourtant le rôle des politiques et des partenaires sociaux que d'expliquer les enjeux d'une réforme en termes non juridiques, de détailler ce que le texte signifie du point de vue des risques et des opportunités.
Or, si je peux me permettre, mesdames, messieurs les sénateurs, on a une faiblesse endémique en ce domaine. On prétend qu'il s'agit d'un problème de communication, mais c'est plus grave. La communication, cela s'apprend, surtout quand on est à ce niveau de représentation. Pour moi, le problème repose sur le postulat que l'on s'adresse à des gens qui ne sont pas toujours en capacité de comprendre et qu'il n'est donc pas nécessaire de perdre du temps à leur expliquer les choses. Avec ce type de posture, on n'est pas près de s'en sortir...
Ensuite, on fait des choix, car, même si l'on a réuni toutes ces conditions, le positionnement des acteurs existe encore. Certaines organisations sont systématiquement dans la destruction.
Oui, mais l'opposition peut être saine. La confrontation des points de vue est source de progrès si elle est respectueuse et porte une volonté de construire. Si des organisations ne veulent pas discuter, dont acte, on ne discute pas, mais qu'elles ne se plaignent pas par la suite.
Prenons l'exemple de l'Allemagne et des réformes de Gerhard Schröder. Au-delà des cultures nationales très différentes, l'État allemand a pu agir face aux partenaires sociaux parce qu'il était fort. Si l'on n'a pas pu se mettre d'accord avec les organisations syndicales, l'État peut prendre les choses en main, cela peut être légitime. Or, si je puis me permettre, la légitimité des partenaires sociaux est remise en cause et l'État n'est plus en position de force depuis quelques années. Ainsi, chaque fois que l'on veut conduire une réforme, il manque le levier de la légitimité.

Vous avez parlé des problèmes liés aux textes de loi, je suis d'accord avec vous ; on n'écrit pas vraiment la loi, on renvoie en permanence à d'autres articles de codes ! C'est illisible et personne ne comprend rien. Pourtant, on se complaît dans ce rôle, on ne dit rien...
Par ailleurs, vous parliez du « brouillard » qui entoure ces questions, mais peut-être que cela arrange tout le monde finalement, car cela permet de passer sous silence ce qui est essentiel à mes yeux, à savoir le caractère éminemment conflictuel des sujets que vous évoquiez. Il s'agit en effet, disons-le, de la lutte des classes - je sais que c'est une horreur de dire cela, mais c'est un fait. Vous évoquiez le dialogue social au sens du Bureau international du travail (BIT) mais c'est une vieillerie, qui date d'une époque où l'on ne considérait pas l'entreprise comme une machine à faire de l'argent pour de malheureux investisseurs qui prennent des risques...
Ainsi, comme il y a une contradiction entre des personnes qui voient les choses de manière diamétralement opposée, on tourne autour des sujets de fond sans en parler. S'agit-il de « communautés d'entreprises » ou bien est-ce le marché qui règle tout pour que le meilleur gagne ? 80 % des entreprises françaises sont certes des PME, mais elles dépendent quasiment toutes des très grandes entreprises, dont elles sont sous-traitantes. Elles subissent donc indirectement les conditions que ces groupes imposent, et je ne pense pas que la notion de « communauté d'entreprises » soit leur problème principal.
Par ailleurs, lorsque j'ai participé au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales (CAF), j'ai été frappé par le pouvoir de la bureaucratie. Est-ce général selon vous ?

J'aurai une remarque et une question.
Tout d'abord, je rejoins ce que disait mon collègue Pierre-Yves Collombat. Il y a plusieurs domaines que, année après année, on souhaite réformer sans y parvenir. Je pense par exemple à la relation entre fournisseur et distributeur, qui a donné lieu à beaucoup de lois, mais qui n'a jamais connu de changement d'état d'esprit. Il demeure un rapport de force et une incompréhension entre les acteurs.
Ensuite, vous avez parlé d'assurance-chômage. Notre système a été conçu à une autre période. On ne traverse pas, vous l'avez dit, une crise, mais une modification du monde. Il faut donc adapter notre système. Quelle forme d'assurance-chômage pourriez-vous donc imaginer ?

Vous avez parlé des modes d'organisation et j'ai pour ma part des motifs de satisfaction. Il existe une vraie différence entre les grands groupes et les PME, pas seulement dans le champ numérique. Bien des start-ups associent les salariés à l'entreprise ; il y a même des entreprises qui n'ont ni directeur des ressources humaines (DRH) ni directeur administratif et financier (DAF), qui travaillent de manière transversale, en pôles. J'ai visité une telle entreprise à Rennes, la semaine dernière ; elle va se mettre en conformité avec la loi et les salariés vont désigner leur représentant, mais eux-mêmes ne pensent pas ainsi.
Le mode d'organisation constitue un vrai problème, car cela rejaillit sur la légitimité et la représentativité des organismes. Vous avez justement parlé de défiance, de crise de légitimité. Or l'information ne circule plus de la même façon, elle est plus fluide et, à cet égard, les réseaux sociaux jouent un rôle parfois un peu dangereux.
Mon autre question a trait aux exigences des citoyens. Entre la démocratie sociale et la démocratie politique de demain, que l'on doit encore inventer, n'y a-t-il pas un espace qui permettrait d'être plus proche des citoyens et de leur redonner confiance ? Avec l'idée de la consultation, par exemple ?

Je suis membre de la délégation aux entreprises du Sénat. Nous allons souvent visiter des entreprises, et lors de l'une de nos premières missions, nous avions découvert un outil efficace : lorsque nous avions visité une entreprise de production de chocolats, dans la Drôme, nous avions été accueillis par un encart sur lequel était écrit « Bienvenue à la délégation sénatoriale dans une entreprise où tout va bien ».
Le président nous avait expliqué le fonctionnement de son entreprise, et nous avons compris la raison de ce panneau. Cette société s'est engagée dans la responsabilité sociale des entreprises et dans la démocratie sociale ; elle fait donc participer les salariés à la stratégie. J'aimerais vous entendre à ce sujet.
Sur le premier point, je n'entamerai pas un long débat, il s'agit aussi de convictions personnelles. Vous l'aurez compris, j'ai passé toute ma vie professionnelle dans l'entreprise, et ma conviction est que, si celle-ci a des marges de progrès, elle demeure, qu'on le veuille ou non, la source de la croissance et de l'emploi. Certes, des débats existent sur l'« ultralibéralisme », mais nous savons aussi, par expérience, que les résultats de l'économie étatisée sont loin d'être performants.

Ce n'est pas le problème. Il s'agit de la mutation de l'entreprise, telle qu'initialement pensée, en « machine à faire du cash » !
Je pense qu'il faut éviter les schémas réducteurs.
Sans doute, mais ce n'est pas la majorité. Pour être performante dans la durée, une entreprise doit créer de la richesse pour quatre parties prenantes.
Premièrement, les actionnaires, car une entreprise sans capital ne fonctionne pas, que vous le veuillez ou non.
Deuxièmement, les clients, car sans client, l'entreprise n'existe pas. D'ailleurs, on ne parle jamais des clients, mais la pression la plus lourde qui pèse sur une entreprise provient d'eux. On peut tenir des discours théoriques, mais, quand nous sortons de cette pièce, nous devenons tous des clients et, si nous ne sommes pas satisfaits du service d'un fournisseur, nous en changeons dans les dix minutes. Avec l'économie du partage, le client, qui était extérieur, est entré dans l'entreprise.
Par ailleurs, peut-être y a-t-il eu des excès dans le champ financier, mais des études sérieuses ont montré que le partage de la valeur ajoutée est plutôt équilibré. Ainsi, entre 2008 et 2014, le salaire réel a augmenté plus vite que l'inflation et la productivité. Si les gouvernements successifs avaient apporté des réponses fiscales plus pertinentes pour encourager le citoyen à investir davantage dans les entreprises, les grands groupes n'auraient pas un capital majoritairement détenu par des fonds financiers...
La troisième partie prenante est le personnel de l'entreprise et la quatrième est la société civile, car on ne peut être performant dans la durée si ses pratiques ne coïncident pas avec les attentes de la société. Je suis donc, sans être excessif, de ceux qui considèrent que l'entreprise constitue une communauté.
J'ai été interrogé sur l'assurance-chômage. Il serait trop long d'y répondre dans le détail, mais, en effet, le système d'assurance-chômage n'est plus adapté à la croissance de notre pays, ni à la modification de la structure de ses emplois. Quelques mécanismes étrangers efficaces pourraient être adaptés à la France, comme les solutions modulables. En période de croissance, on fait des réserves et en période difficile, on les utilise. Il s'agit d'un mécanisme assurantiel, mais qui n'a jamais réellement été appliqué. Je rappelle tout de même que le système actuel est équilibré jusqu'à un taux de chômage de 9 %, ce qui est élevé.
Par ailleurs, la finalité d'un régime d'assurance-chômage est double : il doit permettre à celui qui a perdu un emploi d'avoir des conditions de vie décentes et de retrouver ainsi un emploi, mais, s'il y a des droits, il doit aussi y avoir des devoirs. Ainsi, s'il est naturel que l'assurance-chômage offre à ceux qui sont privés d'emploi des conditions décentes de vie, en contrepartie, celui à qui l'on offre un emploi en rapport avec ses compétences, éventuellement moyennant une formation, a le droit de refuser, mais alors le système peut en tirer les conclusions. En Allemagne, par exemple, si vous refusez un emploi adapté et situé à moins de 350 kilomètres, vos indemnités subissent un premier abattement ; si vous refusez une deuxième fois, elles connaissent un nouvel abattement et au troisième refus, vous touchez les minima sociaux. De tels mécanismes existent depuis longtemps en France, mais ils n'ont jamais été mis en application.
Il ne s'agit pas de se comporter de façon sauvage, mais on est dans une situation où 3,5 millions de personnes au total sont sans emploi et où, pourtant, des emplois ne sont, par ailleurs, pas pourvus. Il faut donc des droits et des devoirs, c'est logique.
Vous parliez, madame Robert, de démocratie participative ; le débat politique ou social doit-il se cantonner aux institutionnels ou est-il légitime de faire entrer dans le débat d'autres acteurs ? C'est compliqué. Examinons l'exemple de l'assurance-chômage. Ce domaine doit-il rester réservé aux partenaires sociaux ou doit-il y avoir des discussions avec les autres parties prenantes, notamment les associations de chômeurs ? Si l'on pense que c'est utile - personnellement, je pense que cela va dans le sens de la démocratie sociale -, il faut définir les modalités d'organisation. Faut-il parler avec toutes les organisations de chômeurs ? Il est déjà compliqué de négocier avec cinq organisations syndicales, sans compter que l'État reste toujours présent... Il est donc intéressant de réfléchir, en amont de la négociation, à une concertation avec les autres parties prenantes, mais il faut établir des règles qui ne complexifient pas les choses.
En ce qui concerne la question sur les grands groupes, les très petites entreprises (TPE) et les PME, je le répète, si, dans l'industrie, on n'avait pas les « champions français », il n'y aurait pas une seule PME en France. Néanmoins, la relation entre le donneur d'ordre et le sous-traitant doit être plus efficace.
La situation est contrastée, de ce point de vue. Il existe des fédérations de PME, des structures conçues comme des PME où le partage de l'information avec les salariés est important. Cela dit, il existe aussi des modèles paternalistes ; ce n'est pas parce que l'on dit « bonjour » le matin et « bonsoir » le soir que le modèle est idéal. De manière générale, cette question est insuffisamment traitée. Par ailleurs, en Allemagne, on ne parle pas de « donneurs d'ordre » et de « sous-traitants », terme très péjoratif, on parle de « partenaires ». Les mots ont leur importance...
Par ailleurs, la plupart des règles sociales ont été élaborées à partir du modèle des grandes entreprises ; or celles-ci évoluent aujourd'hui à l'échelle mondiale et elles fonctionnent avec leur propre modèle de négociation, qui est trop complexe pour être adapté aux petites entreprises.
Dans la métallurgie, on a décidé de rebâtir de zéro une nouvelle convention collective pour vingt ans, sans tenir compte de l'existant et en partant des besoins des « communautés d'entreprises ». Après une réflexion commune pendant deux ans, très intéressante d'un point de vue pédagogique, la négociation s'ouvre. C'est, me semble-t-il, un bon exemple.
Vous m'avez également posé la question des outils qui fonctionnent. Avant tout, ce qui manque aujourd'hui, selon moi, ce sont les bases de la relation humaine. Quand j'ai commencé ma carrière, en 1974, il n'y avait pas d'outil de ressources humaines, on ne travaillait que de manière empirique. L'enseignement de ma chaire sur le dialogue social ne consiste pas à apprendre le code social et les différentes institutions représentatives du personnel. C'est important, mais il s'agit avant tout d'une question de comportement. Sommes-nous ou non d'accord pour affirmer que la confrontation profite à l'entreprise ou au pays s'il est organisé, avec un diagnostic partagé et le respect d'autrui, surtout si l'on n'est pas a priori d'accord ?
L'actionnariat salarié ou l'épargne salariale peuvent être des outils très intéressants de pédagogie en direction des salariés. Il existe aussi des enquêtes de satisfaction triennales, destinées à mesurer l'appréciation des salariés, afin de conduire des plans d'actions et progresser. Dans certaines entreprises, on est tellement outillé pour assurer les processus que l'on n'administre plus la dimension humaine, mais des outils. Or il faut les deux.
En conclusion, je dirai deux choses : « peu d'outils » et « simple et stable ».

J'aurai moi aussi encore quelques questions : si le dialogue social bloque, est-ce principalement une question d'état d'esprit, de culture, d'histoire institutionnelle, ou est-ce lié à une série de dysfonctionnements techniques - vous mentionniez la hiérarchie des normes, les outils, les niveaux trop importants de dialogue social ?
Les deux vont de pair. Dans une culture de la confiance, on serait plus à même de traiter tous les sujets sous un angle technique. L'excès de loi et la judiciarisation de la vie résultent de la défiance. On ne peut dissocier les deux phénomènes.
Une fois cela posé, il faut être pragmatique ; comment restaurer la confiance perdue ? On dit que le dialogue social est bloqué, mais c'est plus compliqué que cela, car il revêt des formes très diverses. Il est bloqué à l'échelon interprofessionnel, très actif ou bloqué dans certaines branches, très actif ou bloqué dans certaines entreprises. De même, le dialogue politique est bloqué à l'échelon national, mais, plus on se rapproche du terrain, plus il est fluide.
Je crois que l'on devrait faire une pause dans la multiplication des textes et amener les politiques et les partenaires sociaux à réfléchir dans une perspective dynamique aux défis de l'entreprise et de la société moderne, pour définir un diagnostic partagé et envisager les leviers sur lesquels agir collectivement. Cela vaudrait la peine d'être tenté, on ne l'a jamais fait.

Vous avez plusieurs fois insisté sur la notion de diagnostic ou de constat partagé et vous avez indiqué que, dès lors que l'on peut techniciser, objectiver une question, on favorise le processus de décision. Cela dit, est-ce vraiment le cas dans la réalité, car on a l'impression contraire dans le domaine social ? L'exemple des retraites est éclairant ; on a publié beaucoup de livres blancs, on est d'accord sur le diagnostic, on aurait donc pu penser que les décisions seraient prises, mais cela n'a pas été le cas. Même remarque avec la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Le diagnostic partagé suffit-il donc ?
Si le diagnostic partagé est réservé aux institutionnels, c'est insuffisant. S'il donne lieu à un exercice de pédagogie, cela fonctionne.
Le problème des retraites est en réalité fort simple à comprendre. La démographie évolue, et il y a deux leviers : les cotisations et les prestations. Quand l'Allemagne a mené ses grandes réformes des retraites, on a envoyé des fonctionnaires dont la qualité première était la pédagogie dans les länder et dans les entreprises, pour y conduire des campagnes d'explication. En France, quelle que soit la majorité, le diagnostic et la pédagogie sont quasiment inexistants. Nous allons prendre en 2017 des décisions importantes pour le pays, mais au cours des débats télévisés, les candidats ont trois minutes pour s'exprimer sur des questions fondamentales...
Le diagnostic partagé est donc nécessaire, mais il n'est efficace que s'il devient un outil pédagogique donnant lieu à un débat. Là est la véritable démocratie participative.

Comment maîtrise-t-on les minorités de blocage ? Quelle que soit la démonstration pédagogique de l'utilité de telle ou telle nouvelle infrastructure envisagée, des personnes peuvent continuer de s'y opposer. Comment créer l'équilibre entre la pédagogie et la prise de décision ?
Dans un premier temps, ce ne sont pas les minorités qui comptent. La première cible, dans une démocratie, c'est l'opinion majoritaire qu'on doit convaincre ; je considère qu'il y a presque une forme d'insulte dans le traitement respectif de celui qui hurle et de celui qui ne s'exprime pas, comme s'il y avait une prime au nombre de décibels plutôt qu'au calme ou à la raison.
À l'ESCP Europe, nous essayons d'amener l'élève - futur salarié, citoyen, dirigeant - à comprendre que ses responsabilités comprennent aussi la façon dont il conduira le dialogue avec ses collaborateurs. Il y a un déficit français en la matière. Cela rejoint d'ailleurs une recommandation de Jean-Denis Combrexelle et du Conseil économique, social et environnemental (Cese).
La pédagogie, élément essentiel, est très peu travaillée. Dans les écoles d'ingénieurs ou les universités, le thème du dialogue en entreprise est uniquement traité sous l'angle du droit du travail et non du comportement.
Enfin - j'émets un avis très personnel -, je pense que, dans une démocratie, il faut un temps pour la concertation et un autre pour la décision. Je ne crois pas à la cogestion ni à la codécision. Le chef d'entreprise a la responsabilité de décider, tout en créant en amont les conditions de la décision et en expliquant en aval pourquoi il a pris cette décision. Il en va de même en politique : le chef de l'État doit trancher.

L'Assemblée nationale a rédigé un rapport sur le thème du paritarisme. Quelle est la mesure, parmi celles qui sont proposées, qui vous paraît la plus pertinente ?
Je ne saurais vous répondre à brûle-pourpoint, il faudrait que je reprenne le texte. Je me souviens que, lors de mon audition, j'avais initialement eu un mouvement d'humeur, car les débats reposaient sur des partis pris.

Vous réfléchissez depuis longtemps à ces sujets ; pourriez-vous nous suggérer le nom de quelques personnes qu'il serait pertinent d'auditionner pour nous aider à lever les blocages ?
En ce qui concerne les entreprises, je vous invite à écouter des personnes de terrain, par exemple le patron d'une PME. Il faut s'inscrire dans le cadre institutionnel, mais il faut aussi en sortir de temps en temps.
Ensuite, j'ai cité précédemment Jean-Denis Combrexelle, car c'est un homme qui présente deux caractéristiques. D'une part, il a une grande expérience, car il a beaucoup travaillé sur ces sujets. D'autre part, il fait partie des personnes qui ne sont pas que des techniciens.
En outre, on a tendance à inscrire nos réflexions dans un cadre purement hexagonal. À votre place, je m'adresserais à des interlocuteurs d'autres pays, y compris en allant voir sur place. Je m'intéresserais aussi à la globalisation des affaires économiques et financières, à la démographie, à la cohabitation de modèles économiques différents. Et j'interrogerais des entrepreneurs de l'économie du partage, qui va au-delà du seul numérique. Il me semble évident qu'un système ne remplacera pas l'autre, mais que plusieurs systèmes cohabiteront, avec un impact sur les relations sociales et la protection sociale, dans son financement et dans son contenu.

L'obligation de consultation des partenaires sur tout texte social est-elle réellement mise en oeuvre ?
Elle a bien fonctionné, y compris pour la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, où la concertation a été très large - mais les partenaires n'ont pas voulu négocier, l'état de leur santé n'y étant sans doute pas propice, et une partie des décisions relevant plutôt de l'État. La situation s'est dégradée lorsque la loi a été complétée par de nouveaux éléments. J'ajoute que la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, dite « loi Larcher », ne s'applique pas aux propositions de loi... J'y insiste, si l'on veut aller plus loin, il faudrait surtout se demander si une loi est nécessaire après un accord majoritaire interprofessionnel.
Le gouvernement Schröder a estimé que la profondeur des réformes était telle que la voie de la négociation n'était pas pertinente : l'État prenait donc la main, ce qui n'excluait ni la concertation ni les explications. Matteo Renzi a fait de même sur la réforme du licenciement.