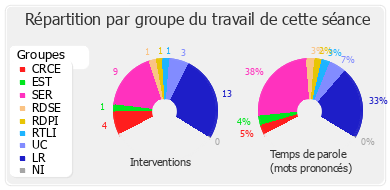Séance en hémicycle du 1er mars 2023 à 21h45
La séance
La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, sur la mixité sociale à l’école.
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je rappelle que l’auteur de la demande dispose d’un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, le groupe auteur de la demande dispose d’un droit de conclusion pour une durée de cinq minutes.
Dans le débat, la parole est à Mme Sylvie Robert, pour le groupe auteur de la demande.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les établissements scolaires français sont touchés par un phénomène puissant de ségrégation sociale, qualifié de « bombe à retardement pour la société française » par Nathalie Mons, ancienne présidente du Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco).
Ce constat, dressé en 2015, n’est malheureusement pas nouveau. Depuis près de vingt ans, les études successives soulignent que les indicateurs de mixité sociale à l’école ne s’améliorent pas. Pis, la dernière étude Pisa, à savoir celle de 2018, démontrait que, sous le poids des déterminismes sociaux, le système scolaire français devenait gravement inégalitaire.
Avec Israël et le Luxembourg, la France est le pays de l’OCDE où l’origine sociale des parents influence le plus le parcours scolaire. Or nous ne pouvons nous satisfaire d’une telle représentation, à moins d’estimer que le retour à une société de classes, figée, est un projet politique d’avenir.
La récente publication des indices de position sociale (IPS) des collèges et des lycées a jeté une lumière crue sur le déclin de la mixité sociale dans notre système scolaire. Ainsi, sur les 100 lycées de France présentant les IPS les plus élevés, 82 sont des établissements privés sous contrat.
Nous sommes face à une véritable saignée du secteur public, qui s’accompagne d’un double mouvement de fond.
Premièrement, l’on constate de terribles disparités au sein même du système scolaire, notamment entre, d’une part, la filière professionnelle et, de l’autre, les filières générales et technologiques ; la moyenne des IPS des lycées généraux et technologiques, public et privé confondus, s’élève à 114, 21, quand celle des lycées professionnels n’est que de 87, 5. L’écart atteint donc près de trente points.
Mes chers collègues, mesurons-nous bien ce que dévoilent ces chiffres ? Les sociologues de l’éducation ont une expression spécifique pour désigner cette dichotomie au sein du système scolaire : le « tri social ».
Deuxièmement, de très fortes inégalités territoriales sont à l’œuvre, certaines académies concentrant la plupart des établissements à faible ou fort IPS. Apparaît ainsi en filigrane l’importance des politiques de logement et d’aménagement du territoire – j’y reviendrai.
Désormais, la question qui nous est adressée en tant que décideurs politiques est la suivante : voulons-nous réellement renforcer la mixité sociale à l’école, facteur déterminant de réussite scolaire, singulièrement pour les élèves défavorisés ? Ou, à l’inverse, estimons-nous qu’il s’agit là d’un sujet mineur, voire d’une fatalité ?
Monsieur le ministre, si j’en crois vos propos, vous avez clairement opté pour la première hypothèse, et les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’en réjouissent.
En effet, nous sommes convaincus que l’absence de mixité sociale à l’école n’est ni acceptable ni soutenable. Elle n’est aucunement acceptable, car elle induit une conception séparatiste de notre société, ainsi qu’une indifférence généralisée aux inégalités qu’elle suscite. Elle n’est aucunement soutenable, car elle gangrène l’idéal cardinal d’égalité des chances, qui se trouve au fondement de notre pacte républicain.
Si l’école ne permet plus d’assurer la mobilité sociale, c’est l’ensemble de notre édifice sociétal et démocratique qui est en danger.
Pourtant, depuis l’adoption, en 2013, de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, la mixité sociale est un objectif du service public de l’éducation : ce dernier doit « veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements », tout en « contribuant à l’égalité des chances » et à la lutte « contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative ».
Dès lors, comment combler l’écart entre la théorie et la pratique ou, si vous préférez, entre la loi et la réalité constatée ?
Le gouvernement socialiste, en collaboration avec les collectivités territoriales volontaires, s’est attelé à apporter une première réponse. En 2016, à la suite du plan pour la mixité sociale dans les collèges lancé par la ministre de l’éducation nationale de l’époque, dix-sept départements ont mené des expérimentations pour lutter contre la ségrégation sociale dans le secondaire.
À cet égard, le plan mis en œuvre par le département de la Haute-Garonne présente des résultats remarquables. Une conclusion incontestable peut en être tirée : la mixité sociale permet aux élèves défavorisés de mieux réussir scolairement, sans pour autant faire baisser la réussite des élèves plus favorisés. En pratique, elle établit donc un système gagnant-gagnant.
Aussi, le plan haut-garonnais témoigne que plusieurs ingrédients sont indispensables pour garantir le succès de telles initiatives.
Tout d’abord, le temps de la concertation, cher à notre collègue Émilienne Poumirol, en particulier avec les parents, est fondamental.
Ensuite, la coconstruction avec la communauté éducative fait évoluer positivement le projet et assure son acceptabilité globale.
Par ailleurs, il est impératif de disposer de moyens budgétaires, lesquels peuvent être utilisés pour des politiques publiques connexes, telles que la mobilité – je pense aux bus scolaires, par exemple.
Enfin, l’appui, y compris financier, du ministère de l’éducation nationale est primordial.
Monsieur le ministre, allez-vous par conséquent soutenir de façon plus massive ces expérimentations territoriales, qui ont des effets éducatifs et sociaux évidents ? Êtes-vous prêt à dégager des moyens substantiels pour accompagner les collectivités territoriales volontaires ?
Cette question est d’autant plus légitime que nous savons que vos chantiers sont nombreux – rémunération des professeurs, généralisation de « l’école du futur », même si je n’entends plus beaucoup cette expression…
Concrètement, de quel budget disposez-vous pour accroître la mixité sociale à l’école ? J’y insiste, car ce point est essentiel : au-delà des adaptations organisationnelles que vous proposerez, il déterminera la portée réelle de votre action. Sans ressources budgétaires adéquates, il n’est point de plan ambitieux en matière de mixité sociale !
Il y a une autre problématique que je souhaite aborder en préambule de mon intervention : la participation de l’enseignement privé sous contrat à l’objectif de mixité sociale.
Au regard de l’ampleur du phénomène de ségrégation sociale qui affecte le système scolaire, est-il encore possible de fermer les yeux et de laisser faire ? Telle est la question que je vous pose, monsieur le ministre, et que je nous pose collectivement, mes chers collègues : la liberté de recrutement du privé est-elle négociable aujourd’hui ?
J’ajouterai que, en France, sauf erreur de ma part, nulle liberté n’est absolue, si bien que, comme toute liberté, celle de recrutement peut être encadrée, dans la mesure où elle constitue un enjeu décisif pour améliorer la mixité sociale à l’école et la réussite de tous les élèves.
Ce sont l’efficacité et la crédibilité de notre politique publique éducative qui sont en jeu. En finançant les établissements privés sous contrat à hauteur de 73 %, sans contrepartie en matière de mixité sociale, l’État ne participe-t-il pas à l’éviction du public vers le privé ? L’État ne fragilise-t-il pas ses propres écoles publiques ?
Monsieur le ministre, allez-vous moduler les dotations des établissements privés sous contrat en fonction de leur action, ou plutôt de leur inaction, en matière de mixité sociale ? Du reste, êtes-vous favorable à cette conditionnalité ?
Comme vous le constatez, cette proposition ne vise nullement à punir les écoles privées, mais bien à faire en sorte qu’elles concourent à l’objectif de mixité sociale et scolaire. Plus globalement, que comprendra le protocole d’accord que vous envisagez, monsieur le ministre ?
La mixité sociale des établissements scolaires dépend des politiques de logement et d’aménagement du territoire. Aussi, avez-vous entrepris un travail interministériel avec vos collègues des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en lien avec les collectivités territoriales ? Si la réponse est positive, à quelles conclusions un tel travail pourrait-il aboutir ?
Mes chers collègues, après le combat en faveur de l’égal accès aux études, qui fut schématiquement celui du XXe siècle, celui qui est mené en faveur de l’égalité des chances est entier et probablement plus intense que dans les années 1980. Si l’école ne peut pas tout, la promesse méritocratique qui lui est attachée doit impérativement être rehaussée, ce qui implique de s’assurer que les conditions de sa réalisation pour tous soient réunies.
Passer de la partialité des chances à une réelle égalité des chances oblige le Gouvernement à un volontarisme politique très fort et affirmé, afin de briser les ghettos sociaux et scolaires, sous peine de basculer vers une société purement endogame ou de tomber dans un gouffre démocratique.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST, ainsi que sur des travées du groupe RDPI.
Madame la sénatrice Robert, avec les membres de votre groupe, vous avez souhaité inscrire à l’ordre du jour du Sénat un débat sur la mixité sociale au sein des établissements scolaires. Je vous en remercie, puisque j’ai érigé ce sujet, dès mon arrivée au ministère, en priorité de mon action.
Ce sujet nécessite la mobilisation, l’engagement et la persévérance de tous, en particulier des collectivités locales que vous représentez au sein de cette assemblée. En effet, la mixité sociale et scolaire dans les écoles et les établissements est une des conditions de la réussite de chaque élève. La diversité des parcours familiaux, la multiplicité des origines sociales, leurs mélanges et leurs interactions sont une force et non une faiblesse pour l’école.
L’école doit porter – tel est son rôle – une vision émancipatrice de son action auprès des élèves ; elle doit lutter contre les déterminismes de naissance, d’origine ou de genre. Elle doit permettre à chaque enfant d’étendre ses ambitions au-delà de ce à quoi son environnement le restreint, voire le contraint.
Malgré les efforts engagés depuis plusieurs années, la France est l’un des pays de l’OCDE où les déterminismes sociaux pèsent le plus sur la réussite scolaire des élèves. Au-delà même de la réussite scolaire, les phénomènes ségrégatifs privent la société de talents, brident les ambitions, découragent les efforts et participent aux replis identitaires.
Venons-en brièvement aux constats : la situation sociale est en partie polarisée dans les établissements publics.
À la rentrée scolaire de 2021, la proportion d’élèves issus de milieux défavorisés était en moyenne de 37, 4 % au collège. Toutefois, si nous examinons la situation en détail, on retrouve ces élèves les plus défavorisés à hauteur de 61 % dans un dixième des collèges les plus défavorisés, alors que les établissements les plus favorisés n’en accueillent que 14, 6 %. En miroir, les 23, 9 % d’enfants issus de milieux très favorisés ne sont présents qu’à hauteur de 6, 6 % dans les collèges les plus défavorisés, alors qu’ils sont près de 45 % dans quelque 10 % des établissements les plus favorisés.
La différenciation sociale est encore plus marquée entre le public et le privé. La proportion moyenne des élèves de milieux défavorisés est de 42, 6 % dans le public, mais seulement de quelque 18 % dans le privé. Et les écarts se creusent depuis le début des années 2000. L’IPS, l’indice de position sociale moyen, est de 106 dans le public hors réseaux d’éducation prioritaire (REP), alors qu’il est de 121 dans le privé sous contrat.
Ces constats implacables s’observent particulièrement au collège et concernent à la fois l’enseignement privé sous contrat et l’enseignement public, dans un contexte où l’écart entre les deux n’a cessé de s’accroître depuis plusieurs décennies.
Afin de faire de l’égalité des chances et de la réussite de tous les élèves une priorité, j’ai entamé un cycle de concertations et de consultations avec l’ensemble des acteurs concernés par le champ de la mixité sociale et scolaire : les organisations syndicales représentatives de la communauté éducative de l’enseignement public et privé sous contrat, les collectivités locales, les élus et les ministères partenaires.
Jouant un rôle essentiel, les concertations avec les collectivités locales s’inscrivent dans le cadre de l’instance de dialogue entre le ministère et les collectivités locales que j’ai souhaité instaurer en septembre 2022. Je situe résolument ce cycle de consultations et de concertations dans une démarche collective.
Il nous faudra passer des bonnes intentions à des solutions pragmatiques, compréhensibles et acceptables par tous.
Pour cela, il n’existe pas, c’est évident, de « modèle clés en main ». Les expériences menées, même les plus réussies, n’ont pas vocation à être dupliquées sans adaptation, quels que soient le territoire, ses ressources ou ses particularités. Il est de mon rôle et de mon devoir de donner une impulsion et de proposer des leviers d’actions variés. Ils existent. Je ne doute pas que les acteurs sauront s’en emparer, voire en inventer d’autres.
Le plus évident de tous ces leviers est, bien évidemment, la détermination de la sectorisation au moyen de la carte scolaire.
Peut-être, d’ailleurs, faut-il s’interroger avant même cette étape sur le rôle joué par les politiques d’habitat et sur le choix géographique d’implantation des établissements scolaires. Le département de la Haute-Garonne – vous l’avez cité, madame la sénatrice –, qui a mené un travail résolu et réussi pour créer les conditions d’une mixité scolaire, n’a par exemple pas hésité à détruire des établissements enclavés et connotés de longue date pour les reconstruire ailleurs.
Si la prise en compte de l’objectif de mixité dans l’affectation des élèves avec des secteurs multicollèges est une solution qui porte ses fruits et qui, moyennant des explications aux familles et la prise en compte des temps de trajets ou des moyens de transport, produit assez vite des effets mesurables, la fusion d’établissements, voire la création de binômes de collèges peu éloignés géographiquement, avec des configurations variées ou des jumelages d’établissements, permet également d’améliorer l’hétérogénéité sociale des élèves – nous avons identifié quelque deux cents binômes potentiels.
L’implantation d’offres de formation attractives dans les établissements défavorisés reste aussi un outil extrêmement efficace. Concernant les sections internationales, par exemple, on assiste en une année scolaire à une hausse de trois à huit points de l’IPS moyen dans les établissements où elles sont créées. Quarante-trois sections internationales nouvelles ont donc été ouvertes dans des collèges d’éducation prioritaire en 2022 ; seize autres le seront en 2023.
L’absence de mixité existe aussi en milieu rural. Il faut trouver des moyens particuliers d’action. Je pense par exemple au rapprochement d’établissements isolés avec ceux des bourgs plus importants par des projets communs ou des échanges pédagogiques.
En parallèle, parce que l’argent public finance l’enseignement privé sous contrat, il est normal d’exiger de ce dernier qu’il favorise aussi la mixité des élèves en s’engageant dans une démarche volontaire et contractualisée.
C’est d’ailleurs ce que recommande le rapport du président Laurent Lafon et du sénateur Jean-Yves Roux, rendu en 2019, sur les nouveaux territoires d’éducation. J’ai donc entamé une discussion constructive avec l’enseignement catholique pour établir un protocole d’engagements, qui, je l’espère, sera signé dans quelques semaines. Je mène aussi ce travail auprès des autres confessions, ainsi qu’avec des établissements privés laïques.
Même si, bien sûr, il existe des a priori, des préjugés, des volontés d’entre-soi et des représentations négatives et stigmatisantes contre lesquels nous devons lutter, et même s’il faut dire et redire que la mixité sociale ne fait pas baisser le niveau des élèves, il faut aussi entendre le souhait des parents d’offrir le meilleur à leurs enfants. La seule réponse, c’est de renforcer l’attractivité des établissements publics, pour permettre aux parents un choix rassurant.
J’ai conscience des enjeux et je ne nie pas les raisons qui poussent certaines familles à choisir soit de contourner la sectorisation, soit de recourir à l’enseignement privé, parfois pour certains au prix de sacrifices importants.
Comme vous l’avez compris, faire de la mixité sociale une réalité, ce n’est pas remettre en cause la liberté scolaire. Ce n’est pas non plus faire gagner un camp contre un autre ou une catégorie contre une autre. C’est au contraire permettre l’enrichissement de tous, offrir un socle commun pour tous, assurer les conditions de l’altérité et continuer à faire de la France une nation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais pouvoir compter sur le soutien de tous ceux qui veulent faire vivre en actes la belle devise de notre République.
Applaudissements sur les travées des groupes RPDI, SER et GEST.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question et son éventuelle réplique.
Le Gouvernement dispose pour répondre d’une durée équivalente. Il aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de répondre à la réplique pendant une minute supplémentaire. L’auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute.
Dans le débat interactif, la parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.

Monsieur le ministre, chacune et chacun d’entre nous a conscience de l’importance de faire vivre la mixité dans nos écoles de France.
La mixité permet de se confronter à la différence, quelle que soit sa forme ; elle permet d’apprendre à comprendre l’autre et elle participe à la formation du citoyen.
Toutefois, le sujet de la mixité ne se pose pas avec la même intensité selon les territoires. Chacun a son expérience. La mienne est celle d’un ancien maire d’une commune rurale dans l’Aisne, et j’imagine que l’enjeu n’est pas le même quand on est le maire d’une ville-centre ou d’une ville de banlieue.
Des décrochages, des problèmes et des difficultés liés à la mixité, il y en a partout – il ne s’agit évidemment pas de les classer. Néanmoins, quand on est dans un territoire métropolitain, grâce aux offres de mobilité – le RER, le métro ou le bus –, on a accès à des lieux culturels. Pour dire les choses simplement, le monde est devant soi et on peut le voir.
En revanche, dans les territoires ruraux, soit on vit dans une famille qui a les moyens et l’organisation permettant de se rendre dans de tels lieux, soit on connaît des difficultés, et c’est alors la double peine. Il y a des familles où personne n’a le permis de conduire ou qui n’ont pas les moyens de partir quelques jours dans une grande ville pour s’ouvrir l’esprit.
Cet éloignement, ces difficultés et ce manque de mixité ne sont pas toujours pris en compte dans la mise en œuvre des politiques scolaires ; ils pourraient pourtant faire la différence dans certains cas. Il s’agit de donner les mêmes conditions, les mêmes chances et les mêmes possibilités à chacun. Telle est la vocation de l’école républicaine.
Aussi, monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions pour favoriser la mixité sociale dans les territoires ruraux et lutter contre les inégalités territoriales ?
Monsieur le sénateur Verzelen, vous avez raison, la question de la mixité sociale se pose non seulement dans les territoires urbains, mais également dans les régions rurales.
Cependant, les problématiques scolaires qui se posent dans les régions rurales sont quelque peu différentes de celles des territoires urbains.
Globalement, les résultats scolaires dans les régions rurales – il existe des variations, il faut le reconnaître – sont corrects, voire bons dans certains départements très ruraux. En Mayenne, par exemple, les résultats scolaires sont bons. Néanmoins nous constatons un manque d’ambition ou plutôt des difficultés à projeter ces résultats scolaires vers des études post-bac qui impliquent un éloignement géographique de la région d’origine.
La question de l’éloignement, comme le montre cet exemple, est absolument centrale pour les territoires ruraux. Voilà pourquoi j’ai mentionné dans mon intervention liminaire la possibilité d’organiser des rapprochements entre des établissements scolaires qui sont moyennement éloignés, c’est-à-dire dont la distance qui les sépare peut être couverte par des modes de transport appropriés.
Je pense également à l’importance et à l’intérêt des cordées de la réussite. Comme vous le savez, quelque 168 000 élèves sont aujourd’hui concernés – nous visons l’objectif de 200 000 élèves « encordés » dans le supérieur, au lycée et au collège. Ce dispositif donne de bons résultats, notamment en matière d’ambitions et de perspectives scolaires et universitaires.
Je mentionnerai enfin le sujet de la refonte de la carte de l’éducation prioritaire, à laquelle nous nous sommes attelés avec le ministre délégué à la ville et au logement. Cette question impliquera aussi les territoires ruraux. Nous prendrons notre temps pour aboutir à une réforme en septembre 2024.

Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues du groupe socialiste de l’inscription à notre ordre du jour de ce débat essentiel. Il y a beaucoup à dire sur la mixité sociale et, plus largement, sur les inégalités à l’école.
La France est l’un des pays de l’OCDE où l’origine sociale d’un élève pèse le plus sur son destin scolaire. Notre système éducatif est l’un de ceux qui reproduisent le plus les inégalités sociales, et cela depuis plus de dix ans. Le manque de mixité sociale à l’école est un facteur aggravant des inégalités ; sur ce point, la France est à la traîne.
On assiste au développement d’une école à deux vitesses. Les établissements privés sont devenus l’un des moteurs de la ségrégation scolaire en favorisant l’évitement de la carte scolaire pour les classes les plus favorisées. Selon une étude de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), à la rentrée scolaire de 2021, quelque 40, 1 % des collégiens du secteur privé sous contrat étaient issus de milieux sociaux très favorisés, contre 19, 5 % dans le public.
Monsieur le ministre, vous avez annoncé que la mixité sociale à l’école était l’une de vos priorités, et nous nous en réjouissons, tant votre prédécesseur avait ignoré cette problématique.
Dans ce cadre, vous avez déclaré souhaiter mettre en place un accord avec les établissements privés sous contrat, et vous venez de le réaffirmer. Il est vrai que le taux de boursiers dans l’enseignement privé sous contrat est actuellement inférieur à 10 %. Cela a été rappelé, l’État et les collectivités territoriales subventionnent pourtant l’enseignement privé sous contrat à hauteur de 73 %.
Les enjeux des modalités de cet accord suscitent notre interrogation. Quels en seront les termes ? Allez-vous enfin pondérer les subventions publiques versées au privé en fonction d’un ratio de mixité sociale acceptable ?
Allez-vous, en d’autres termes, conditionner les aides attribuées aux établissements privés sous contrat à des taux de boursiers largement plus importants, afin de cesser de financer par des deniers publics la ségrégation sociale ?
Applaudissements sur des travées du groupe SER.
Monsieur le sénateur Dossus, je vous remercie de votre question importante relative à l’enseignement privé sous contrat.
J’ai en effet indiqué que l’enseignement privé sous contrat sera impliqué dans l’effort en faveur de la mixité. Tous les chercheurs qui ont travaillé sur cette question ont abouti à la même conclusion : si l’enseignement privé sous contrat n’est pas impliqué, les politiques de mixité sociale à l’école seront sinon vouées à l’échec, du moins très limitées.
Vous avez également rappelé que l’État finance aux trois quarts les établissements privés sous contrat. Nous sommes en négociation avec la principale organisation regroupant l’essentiel des établissements privés sous contrat, le secrétariat général de l’enseignement catholique, dont je me réjouis de la bonne volonté, ainsi qu’avec d’autres fédérations ou associations que j’ai pu consulter ces dernières semaines.
Selon moi, deux écueils sont à éviter. Le premier consisterait à ne rien demander aux établissements privés sous contrat en échange du financement dont nous parlons et à laisser l’enseignement privé sous contrat libre d’agir comme il le souhaite.
À l’inverse, le second écueil serait de faire passer sous les fourches caudines de l’enseignement public le secteur privé sous contrat ; nous nous heurterions à de très nombreuses difficultés et à de très importantes résistances politiques. Entre ces deux pôles, si je puis dire, il y a un espace, celui de la négociation.
Du reste, nous avons des moyens d’agir, notamment en modulant non pas la part fixe, mais la part variable de notre subvention aux établissements privés sous contrat. Les collectivités locales peuvent également procéder à une telle modulation, j’y insiste, à l’instar de ce qu’ont récemment fait le département de la Haute-Garonne et la Ville de Paris.

Monsieur le ministre, si la mixité sociale à l’école est tellement importante, c’est parce qu’elle est un prérequis incontournable et incompressible du vivre ensemble. Or ce dernier ne se décrète pas : il s’apprend et il s’exerce.
En ce sens, l’école publique est évidemment le lieu privilégié de cet apprentissage. Dès le plus jeune âge, l’école, qui garantit l’émancipation par le savoir et la culture, bâtit également un projet démocratique fondé sur des principes communs partagés et respectés par tous.
Je fais partie de ceux qui pensent que l’école doit faire davantage pour la mixité sociale. À ce titre, l’expérimentation de secteurs multicollèges dans six établissements parisiens, dont les résultats sont positifs, va dans le bon sens.
Toutefois, la mixité sociale à l’école n’est pas le seul fait de l’école. Vous le savez, la carte scolaire des écoles maternelles et élémentaires est déterminée par les conseils municipaux et celle des collèges par les conseils départementaux.
Par ailleurs, nos écoles sont des réalités physiques et urbaines. Elles s’insèrent dans un environnement urbain, qui a des effets, lui aussi, sur la mixité sociale. Les politiques de l’urbanisme et de l’habitat ont donc également un rôle à jouer.
Monsieur le ministre, quel rôle les services de votre ministère pourraient-ils jouer dans la nécessaire coordination entre les différents acteurs qui, de près ou de loin, agissent sur la mixité sociale à l’école ?
Madame la sénatrice, vous faites référence à une question importante : le lien entre le travail de l’éducation nationale et celui des services d’autres ministères – je pense en particulier à celui de la ville et du logement.
Avec mon collègue Olivier Klein, je travaille dans la perspective que j’ai déjà indiquée, à savoir refondre ou, à tout le moins, retoucher la carte de l’éducation prioritaire, qui est établie sur des données remontant à 2011 – la carte elle-même est parue en 2015.
En effet, les changements sociologiques et urbains de la société française imposent certainement de repenser cette carte, en particulier pour les établissements de REP. Les environnements des établissements REP+ sont, d’une certaine façon, très immobiles, puisqu’ils sont situés dans des quartiers défavorisés qui, malheureusement, n’ont pas changé de façon importante depuis dix ans.
En revanche, les quartiers REP, un peu plus intermédiaires, ont connu des changements sociaux importants, sous l’effet, par exemple à Paris, de phénomènes de gentrification, qui ont profondément modifié ces quartiers. Par ailleurs, des régions ou des secteurs ont été quelque peu oubliés en 2015. En un mot, il faut repenser ce dispositif en lien avec les quartiers prioritaires de la ville, sur lesquels travaillent les services du ministère de la ville et du logement.
J’ajoute un point très important : en dépit des pesanteurs urbaines et sociales, nous pouvons prendre des initiatives pour aller au-delà des frontières sociales.
Je pense à ce qui a été fait à Toulouse, où les élèves des collèges du quartier du Mirail ont été déplacés et scolarisés dans des quartiers centraux.
Mme Émilienne Poumirol approuve.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le ministre, ainsi que plusieurs de mes collègues l’ont rappelé, dans notre pays, l’enseignement privé sous contrat est subventionné par l’État et les collectivités territoriales à hauteur de 73 %, soit près de 10 milliards d’euros qui, chaque année, sortent des caisses publiques pour financer le privé !
Alors que le public souffre d’un manque de moyens chronique, le privé continue de profiter de nouveaux effets d’aubaine, à la suite de la loi Carle de 2019 et de la loi Blanquer de 2019.

Or, cas unique au monde, ce financement public du privé se fait pratiquement sans aucune contrepartie. Ces établissements échappent à la carte scolaire et leur recrutement reste opaque : on ne sait pas quels critères sont retenus pour sélectionner les élèves !

Tout le monde finance le privé, mais tout le monde n’y a pas accès ! Car le privé pratique l’exclusion sociale de fait.
Monsieur le ministre, en juillet 2022, vos services ont souligné que l’écart entre la proportion d’élèves très favorisés dans le privé et dans le public s’était creusé de près de dix points en vingt ans.
La publication des IPS en janvier dernier a confirmé l’embourgeoisement de plus en plus marqué du privé. Deux chercheurs, MM. Julien Grenet et Youssef Souidi, ont montré que, à Paris, le privé ne compte que 3 % d’élèves défavorisés, contre 24 % dans le public. Voilà le véritable séparatisme contre lequel nous devons lutter avec acharnement !
Pis, une étude de 2014, menée par Loïc du Parquet, Thomas Brodaty et Pascale Petit au moyen d’une expérience contrôlée, inspirée de la méthode du testing, a montré qu’il existe à l’entrée des établissements scolaires privés une sélection ethnique.
Monsieur le ministre, en tant que chercheur, vous serez aussi sensible que moi à la pertinence de ces travaux. Vous partagez ce constat, je le sais. Nous connaissons vos convictions et nous sommes prêts à vous soutenir contre tous les conservatismes si vous prenez des mesures à la hauteur de l’urgence.
Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à introduire, à l’échelle nationale, un système de bonus-malus analogue à celui que le département de la Haute-Garonne a mis en place – vous n’avez pas été suffisamment précis sur ce point – pour moduler les crédits pédagogiques versés aux établissements, en fonction de leur niveau de mixité sociale ?

M. Yan Chantrel. Cela reviendrait à prendre l’argent des établissements privés qui ne jouent pas le jeu de la mixité sociale pour le donner à ceux du public.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le sénateur Chantrel, à la question du financement de l’enseignement privé sous contrat, que vous avez posée, je souhaite répondre par la concertation, afin d’aboutir à un protocole d’accord comportant des objectifs très précis.
À cet égard, je note la bonne disposition de nos interlocuteurs du privé sous contrat : les temps ont changé, la publication des IPS a joué son rôle, et nous disposons de quelques moyens de pression, si je puis dire.
J’ai indiqué que les collectivités locales pouvaient agir, comme l’ont fait, par exemple, le département de la Haute-Garonne et la ville de Paris. Nous le pouvons également, en jouant sur les moyens d’enseignement. Ainsi, les allocations de postes en réponse à des demandes exprimées peuvent être utilisées comme des moyens de pression sur les établissements, afin que ceux-ci s’engagent dans des politiques résolues de mixité sociale et scolaire.
J’évoque la mixité sociale et scolaire, parce qu’un objectif en termes de pourcentage de boursiers est certes intéressant, mais ne doit pas pour autant conduire les établissements privés sous contrat à chercher les meilleurs élèves boursiers dans les établissements publics, privant ces derniers de leurs têtes de classe.
Il nous faut veiller à favoriser une mixité scolaire qui combine une dimension purement sociale avec d’autres facteurs, concernant, par exemple, les élèves en situation de handicap, dont le taux est significativement plus bas dans l’enseignement privé sous contrat, ainsi que des élèves dont les résultats scolaires soient répartis sur l’ensemble du spectre.
Nous nous sommes attelés à ce travail, afin d’aboutir à un protocole aux alentours du 20 mars prochain.

L’école française est l’une des plus inégalitaires des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle a donc besoin de mesures structurelles, et pas seulement cosmétiques.
Prenons l’exemple du lycée Claude-Monet, au Havre. Depuis 2018, celui-ci a perdu l’équivalent de 8 postes, alors qu’il a accueilli 35 élèves en plus. L’indice de position sociale (IPS) de cet établissement a baissé d’année en année, atteignant 92, 9 aujourd’hui, alors que l’IPS du lycée privé Saint-Joseph, qui se trouve à 150 mètres, atteint presque 138.
Face à la dégradation de la situation sociale des élèves de l’établissement public, on ne saurait se contenter d’ouvrir des formations dites « attractives » ou d’inciter les parents d’élèves du lycée privé à y inscrire leurs enfants.
Monsieur le ministre, la communauté éducative vous demande non pas un énième artifice, mais bien l’attribution de moyens, pour pallier par un renforcement de l’action pédagogique et éducative les conséquences des inégalités socioéconomiques que subissent certains élèves.
Or ce souci ne semble pas guider les attributions de dotations horaires globales (DHG) dans le secondaire, qui sont actuellement examinées, non plus que les mesures de carte scolaire concernant le primaire. Les établissements en réseaux d’éducation prioritaire (REP), en REP+, ou dans le rural isolé – les difficultés sociales y sont également nombreuses – continuent ainsi à perdre des moyens d’enseignement.
Allez-vous mieux tenir compte de la réalité sociale dans l’allocation des postes, qui évoque encore trop souvent une gestion purement comptable ?
Applaudissements sur des travées du groupe SER.
Madame la sénatrice Brulin, je ne connais pas la situation spécifique du lycée Claude-Monet du Havre.
Je l’examinerai. Croyez bien que les réponses que vous attendez ne relèvent pas simplement de la mise en place de formations attractives. Nous disposons d’un éventail de moyens d’action, dont fait partie la sectorisation, que j’évoquais précédemment. Si celle-ci ne concerne pas l’établissement privé auquel vous faites allusion, elle peut s’appliquer à un autre établissement public du voisinage, voire de la ville du Havre.
Pour répondre à votre question, les moyens d’enseignement doivent être pris en compte, mais il convient également de donner aux établissements publics défavorisés la capacité de garder des élèves susceptibles d’aller ailleurs, en particulier dans l’enseignement privé sous contrat.
Il est donc utile de réfléchir à la meilleure manière de conserver ces élèves. Des expériences intéressantes ont été menées un peu partout en France, qui montrent que des formations d’excellence peuvent offrir de bons résultats à ce titre. Il peut s’agir d’une classe de préparation aux études supérieures, au travers d’un conventionnement avec un institut d’études politiques, par exemple, ou encore d’une section internationale.
Les moyens d’enseignement sont, quant à eux, directement dépendants des effectifs scolaires. S’ils baissent dans certaines régions, nous veillons alors à améliorer le taux d’encadrement ; ce sera le cas dans le département de la Seine-Maritime.

Monsieur le ministre, vous indiquez que l’allocation des moyens est presque exclusivement liée aux effectifs. Tel était bien le sens de ma question : j’entendais vous demander comment prendre en compte la situation sociale des établissements pour renforcer les moyens d’éducation.
Par ailleurs, dans la palette de propositions que vous avancez, il me semble que vous mettez beaucoup à contribution les collectivités pour garantir la mixité sociale. Nous connaissons pourtant tous, ici, la situation dans laquelle celles-ci se trouvent…
Enfin, je m’inquiète de vos propos qui semblent envisager des regroupements d’écoles dans les centres-bourgs, …

… alors que l’existence d’une école rurale, fruit d’un maillage très fin du territoire, est aussi un gage de réussite des élèves.
Madame la sénatrice Brulin, les moyens d’enseignement dépendent non pas seulement des effectifs, mais aussi de l’IPS et de l’éloignement. Les directions académiques font des calculs et mènent chaque année ce travail, en échangeant d’ailleurs avec les élus ; cela peut donc aboutir à des variations complètement indépendantes des effectifs stricto sensu.
Certes, le maillage a de l’intérêt. Mais, dans le secondaire tout au moins, les meilleurs résultats scolaires ne sont pas le fait des très petits établissements, et une taille réduite ne garantit pas des résultats scolaires convenables. Il nous faut réfléchir à une taille critique d’établissement en vue de la réussite de nos élèves.

J’entends que vous prenez en compte les IPS dans l’allocation de moyens. Nous nous préparons dès lors à avancer nos arguments quant à certaines situations, avec l’espoir d’obtenir l’attribution de postes et de DHG supplémentaires pour les établissements concernés.
Quant au maillage scolaire en milieu rural, j’y insiste, car il favorise la réussite des élèves : dans les communes rurales se forme un vivier social autour de l’école, où se nouent des relations et où se créent des associations. Tout cela contribue à la réussite et me semble très important.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que le postulat de départ est clair – l’article 1er du code de l’éducation rend la mixité obligatoire dans l’enseignement primaire et secondaire –, force est de constater, près de cinquante ans plus tard, que cet objectif est loin d’être atteint, malheureusement.
Le rapport de la Cour des comptes de décembre 2021 relève, d’ailleurs, que la possibilité pour chaque enfant, quelles que soient ses origines, de bénéficier des mêmes conditions de scolarisation n’est pas garantie : il s’agit d’un frein à l’efficacité générale de l’école, qui reste segmentée, dont l’impact est négatif en termes d’accès au savoir et à la culture, ainsi que d’appartenance à la Nation.
Aussi, monsieur le ministre, quel plan comptez-vous mettre en œuvre pour rendre concret l’objectif de mixité sociale fixé dans le code de l’éducation ?
Par ailleurs, concernant l’enseignement privé sous contrat, vous avez récemment évoqué les efforts à envisager afin que ce secteur « participe à une plus grande mixité sociale ». À quoi pensez-vous et de quels leviers disposez-vous dans cette perspective, sachant que la loi reconnaît à ces établissements un caractère propre ?
Enfin, quels bilans et enseignements tirez-vous des réformes mises en place pour rendre l’école plus juste, au travers de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, ou s’agissant de la sectorisation dans le secondaire, dont l’assouplissement, en 2007, n’a pas modifié in fine la composition sociale des collèges à l’échelle nationale ?
Évaluer l’efficacité d’une politique publique et en corriger le cas échéant les faiblesses en proposant des solutions de rechange, cela exige du courage politique. Il faut un message clair et fort, massivement compris et soutenu, dont l’impulsion ne peut venir que de l’État, de manière transversale.
Quels sont vos objectifs en la matière ? Comment comptez-vous amorcer le changement nécessaire pour permettre à l’enseignement obligatoire de jouer pleinement son rôle intégrateur ?
Monsieur le sénateur Kern, en matière de mixité scolaire, je le répète, il existe un ensemble de leviers, qui peuvent être utilisés différemment selon les territoires et les réalités locales.
Notre méthode consiste à proposer aux recteurs une palette d’actions que ceux-ci peuvent mettre en œuvre de manière souple en lien avec les collectivités. Ils ont également la possibilité d’inventer d’autres moyens, pour atteindre les objectifs que nous leur fixons, avec une progressivité annuelle.
Parmi ces leviers, j’ai mentionné la situation de l’enseignement privé sous contrat et j’ai indiqué que nous avions adopté une démarche de négociation pour aboutir à un protocole. Nous avons des moyens d’action : les postes, les bonus-malus que les collectivités peuvent appliquer, mais aussi, pour ce qui nous concerne, les allocations de fonds supplémentaires via le programme 139, au-delà des strictes exigences de la mission de service public qu’assure ce secteur.
La sectorisation a fait l’objet de nombre de travaux et de réflexions depuis plus de quinze ans. Je vous invite à examiner ce qui a été réalisé récemment à Paris dans le cadre d’Affelnet pour l’affectation des lycéens à l’entrée en seconde. Cet outil a donné des résultats tout à fait probants : des établissements, parfois très prestigieux, qui recevaient peu d’élèves boursiers en accueillent beaucoup plus ; à l’inverse, des établissements avec un très fort taux de boursiers retrouvent une population scolaire plus équilibrée.
Avec l’aide des chercheurs, grâce aux statistiques issues des travaux de la Depp, nous avons une connaissance bien plus fine de la carte scolaire qu’il y a une quinzaine d’années.

Monsieur le ministre, « la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. Et la réponse se trouve dans l’école, dans l’orientation ». Ces mots sont d’Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux Français pour 2023.
Le secteur privé compte 40 % d’élèves très aisés, contre 20 % dans le public. Quelque 42 % des élèves du public sont issus de milieux sociaux défavorisés, contre 18 % dans le privé. Ces écarts se creusent à un rythme accéléré depuis les années 2010.
Vous avez indiqué vouloir impliquer l’enseignement privé sous contrat dans la poursuite de l’objectif de mixité sociale, consubstantiel à celui d’égalité des chances. Le taux de boursiers dans les écoles privées sous contrat est actuellement inférieur à 10 %, « un chiffre trop faible au regard de la composition sociale de nos effectifs scolaires », selon vos propres mots.
L’intégration, depuis la rentrée de 2022, des lycées Louis-le-Grand et Henri-IV dans le système d’affectation Affelnet semble prometteuse. Les candidats parisiens y sont recrutés non plus sur dossier, mais en fonction de leur proximité géographique et de caractéristiques sociales, et des quotas d’élèves boursiers sont désormais appliqués. Parmi les classes de seconde, la part d’élèves de catégories moyenne et défavorisée est ainsi passée de 13 % à 29 % à Louis-le-Grand et de 12 % à 22 % à Henri-IV.
L’entrée de ces deux établissements dans Affelnet semble avoir produit un effet incitatif sur les élèves parisiens, qui sont plus nombreux à avoir candidaté – plus 29 % – par rapport à l’an dernier, et qui proviennent de collèges plus divers.
Devant la délégation sénatoriale à la prospective, Jacques Attali a recommandé la présence de 20 % à 30 % d’élèves issus de familles défavorisées dans tous les établissements. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à imposer ce niveau de mixité sociale dans le public et dans le privé sous contrat ? Si tel est le cas, comment comptez-vous y parvenir ?
Monsieur le sénateur Fialaire, vous avez souligné l’écart entre les taux de boursiers dans le privé sous contrat et dans le public : il est inférieur à 10 % dans le premier, alors qu’il avoisine 29 % dans le second, soit un rapport d’un à trois.
Il faut le réduire, et c’est le sens du protocole que j’espère signer dans quelques semaines, avec des engagements précis de la part des établissements privés sous contrat. Je vous confirme l’intérêt de leurs organisations représentatives pour cette question. Il reste un certain nombre de points à régler, concernant, notamment, la restauration scolaire, mais nous avançons, avec l’aide des collectivités.
Vous avez très justement mentionné le cas des lycées Louis-le-Grand et Henri-IV. Dans la situation issue de la réforme d’Affelnet, des lycéens de Louis-le-Grand, par exemple, peuvent venir de zones distantes du lycée, parce que le quartier dans lequel celui-ci est situé ne garantit pas une mixité sociale très intense.
Nous utilisons les moyens de transport très denses de Paris, en particulier la ligne du RER B, pour acheminer vers ce lycée des élèves qui en sont géographiquement éloignés. Ceux qui habitent dans le nord de Paris peuvent ainsi s’y rendre en une demi-heure environ. La proximité géographique compte moins que le temps de transport, ce qui offre beaucoup de possibilités dans une ville comme Paris.
Cette réforme a donné d’excellents résultats ; sa mise en œuvre nécessite un travail très fin, avec des calculs impliquant les modes de transport, et aboutit à une carte à l’allure parfois baroque. Mais c’est à cette condition que nous avons pu obtenir des résultats probants pour des lycées qui étaient en quelque sorte hors normes par leur recrutement, mais également par leurs résultats scolaires.

Monsieur le ministre, je veux le rappeler, la France enregistre de mauvais résultats en matière de réussite scolaire pour tous ses élèves. Certes, cela touche particulièrement ceux qui sont issus des milieux défavorisés, mais cela concerne aussi les autres.
Notre groupe soutient donc toute initiative visant à assurer la performance scolaire et l’égalité des chances. Il ressort de vos premières annonces que vous souhaitez principalement revoir la sectorisation et ouvrir davantage l’enseignement privé à la mixité sociale. Pourquoi pas ?
Pour autant, le risque sera grand de renforcer l’incompréhension des parents et la mise en place de stratégies d’évitement, sans apporter de réponse globale et durable à la question de la réussite de tous les élèves.
En réalité, nous ne visons pas le même objectif : vous parlez de mixité sociale, nous parlons d’égalité des chances et de réussite scolaire. Pour y parvenir, ne faudrait-il pas plutôt nommer dans les établissements à besoins éducatifs particuliers des enseignants expérimentés ?
L’affectation quasi exclusive de professeurs fraîchement issus des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (Inspé), voire des formations accélérées de quarante-huit heures proposées in extremis aux vacataires, n’est-elle pas l’un des points de faiblesse majeurs de ces établissements qui auraient tant besoin de stabilité et d’expérience ?
Ne pourrait-on pas leur donner davantage d’autonomie, afin de laisser aux acteurs de terrain les marges de manœuvre nécessaires et les moyens d’assurer l’égalité des chances ?
Ne faudrait-il pas, enfin, instaurer un véritable service public du soutien scolaire, épaulé par la création d’une réserve éducative ?

Telles sont les propositions que je souhaitais formuler et dont nous reparlerons. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre ?
Monsieur le sénateur Brisson, je ne vois pas de contradiction entre mixité sociale et réussite scolaire de tous les élèves.
Des études, comme les travaux de M. Grenet auxquels il a déjà été fait allusion, montrent que dans les établissements dans lesquels on crée de la mixité, comme à Paris ou à Toulouse, les résultats des élèves défavorisés s’améliorent, tandis que ceux des élèves favorisés ne baissent pas du tout. Si la progression des premiers n’est toutefois pas spectaculaire – il n’existe pas de baguette magique en la matière ! –, elle ne se fait pas au détriment des autres.
Deux autres points peuvent être relevés : d’une part, les élèves défavorisés voient leur ambition scolaire et post-bac décuplée, des perspectives s’ouvrent à eux et ils se projettent très différemment par rapport à leur situation précédente ; d’autre part, les réseaux d’amitié entre les élèves se reconfigurent. Autrement dit, les élèves se mélangent entre eux et ne forment pas des groupes séparés qui obéiraient aux logiques scolaires anciennes.
Ces évolutions sociales sont tout à fait intéressantes et invitent à penser la mixité comme un facteur de réussite, plutôt que comme un élément qui l’embarrasserait.
Je vous rejoins sur la question de la formation des enseignants, et nous aurons l’occasion d’en reparler : nous avons besoin d’enseignants mieux formés. En France, la formation académique est plus longue qu’ailleurs, alors que la formation au métier est courte. C’est paradoxal, alors que l’on attend des enseignants, dans leurs établissements, une compétence élevée dans leur métier.

Il ne me semble pas que ce soit en permettant à quelques élèves issus de milieux défavorisés de se retrouver à Pierre-de-Fermat ou à Louis-le-Grand que l’on réglera le problème de la mixité sociale et les difficultés des élèves issus de tels milieux…
Je le répète, ce n’est pas en tentant d’imposer la mixité sociale à tout prix, par la sectorisation rigide et les quotas, que nous ferons progresser le niveau scolaire des élèves les plus éloignés de la réussite. Nous le ferons par la différenciation de nos politiques éducatives sur le terrain, dans ces établissements, laquelle passe par une nouvelle approche contractualisée des ressources humaines et de l’affectation des moyens dans nos territoires.
Monsieur le sénateur Brisson, là encore, je ne vois pas de contradiction. Ce ne sont pas quelques élèves qui sont concernés et qui masqueraient le reste !
À Toulouse, par exemple, plusieurs centaines d’élèves du quartier du Mirail ont été envoyées dans sept collèges du centre-ville, mais aussi des bordures de la ville. Il s’agit non pas seulement des meilleurs élèves du Mirail, mais bien d’une cohorte dont la mixité scolaire est élevée. Cette expérience mérite d’être examinée de près.
Par ailleurs, j’insiste sur l’importance de valoriser des établissements défavorisés, problématiques ou délaissés, grâce à des filières d’excellence, ainsi qu’à des travaux menés sur le bâti scolaire.

Monsieur le ministre, je ne vous ennuierai pas davantage quant au caractère cosmétique de ce que vous évoquez.
En revanche, je vous pose de nouveau une question : quand cesserons-nous de nommer dans les établissements des quartiers les plus difficiles, où la population a des besoins éducatifs particuliers, les professeurs les plus jeunes et les moins expérimentés, sortant des Inspé, voire des vacataires n’ayant reçu que quelques heures de formation ?
Quand allons-nous réfléchir à une nouvelle politique de ressources humaines, conduisant à orienter vers ces établissements des professeurs chevronnés, expérimentés et capables de sortir le plus grand nombre de ces élèves des difficultés scolaires dans lesquelles ils se trouvent ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la question de la mixité scolaire se pose différemment dans les agglomérations et dans les territoires ruraux, où les établissements scolaires sont plus éloignés les uns des autres, limitant ainsi l’impact de la ségrégation résidentielle et les stratégies d’évitement des familles.
La mixité est une réalité bien plus tangible dans les écoles, les collèges et les lycées de nos communes rurales, où le vivre ensemble existe de fait. C’est une raison supplémentaire de leur accorder les moyens de fonctionner dans des conditions correctes et de maintenir leur ancrage territorial. Sur le terrain, on observe en effet une montée en puissance des écoles privées rurales, notamment hors contrat, qui pourrait remettre en cause ce fragile équilibre.
Nous payons aujourd’hui très cher les suppressions de postes actées lors du vote du budget pour 2023, en particulier dans le premier degré. Dans la Drôme, plus de 40 classes vont ainsi être fermées, essentiellement dans les communes rurales, victimes d’une logique comptable.
Monsieur le ministre, que prévoyez-vous pour maintenir des conditions d’enseignement à la hauteur des besoins dans ces territoires ?
La situation des lycées ruraux appelle également votre attention, car la réforme du lycée a mis à mal leur attractivité. Nous avions pointé ce problème dans le rapport Bilan des mesures éducatives du quinquennat, que j’ai signé avec mes collègues Annick Billon et Max Brisson : en raison de leur dotation globale horaire limitée, les lycées ruraux sont contraints d’opérer des choix entre les spécialités et les options proposées, ce qui incite des élèves à les quitter.
Le Gouvernement a-t-il prévu de renforcer les moyens qui leur sont consacrés, afin de garantir une offre éducative homogène et une égalité d’accès aux enseignements, qui sont des facteurs-clés de la mixité sociale ?
Madame la sénatrice Monier, selon les données dont nous disposons, la question du rural ne saurait être abordée en laissant entendre que les écoles rurales seraient sous-dotées par rapport aux écoles urbaines : c’est le contraire qui est vrai.
Le taux d’encadrement est souvent meilleur dans les écoles rurales : 18 % des élèves sont accueillis dans ces établissements, qui représentent 35 % des écoles. Il est vrai que les moyens d’enseignement diminuent pour la rentrée 2023, mais cela correspond malheureusement à une baisse des effectifs scolaires.
Pour autant, la diminution des moyens n’est pas proportionnelle à cette baisse, de sorte que le taux d’encadrement s’améliore. Par ailleurs, nous examinons au cas par cas les situations délicates et, d’ici au mois de juin prochain, nous allons procéder à certains ajustements dans les différentes académies.
S’agissant de la réforme des lycées, celle-ci n’a pas restreint le choix des élèves.
Actuellement, 93 % des établissements proposent au moins sept spécialités sur les douze possibles. Notre intention est d’accroître le nombre de spécialités proposées, en particulier les spécialisés « Numérique et sciences informatiques (NSI) » et « Sciences de l’ingénieur », puisque nous souhaitons augmenter le nombre d’élèves se dirigeant vers les voies technologiques.
Je tiens toutefois à souligner la variété des offres et à rappeler que la présence de ces sept spécialités au moins permet un choix très large comparé à la situation qui prévalait précédemment.

Nous avons pourtant bien le sentiment que les suppressions de postes sont proportionnelles au nombre des élèves…
La moyenne des élèves par classe en primaire est de 21, 9 enfants en France, contre 19, 4 dans l’Union européenne. Dans nos classes rurales, après fermeture, ce nombre monte souvent à 24, 25 ou 26. Cela rompt l’égalité et fragilise la mixité.
Vous avez indiqué que les directions académiques négociaient avec les élus, mais elles le font à partir de ce qui a été voté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, c’est-à-dire pas grand-chose ! À Grenoble, aucun poste n’est ainsi prévu ; la Drôme, quant à elle, a dû en rendre 11.
Je vous ai entendu évoquer la notion de trajet raisonnable et de regroupements, ce qui m’interpelle. Nous ne souhaitons pas un retour à l’article 6 quater de la loi pour une école de la confiance. Je vous rappelle que, dans les zones rurales, un trajet raisonnable se calcule en minutes, et non en kilomètres. Il importe d’y être attentif.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord remercier Sylvie Robert et son groupe, qui sont à l’initiative de ce débat sur l’école.
J’ai aussi à l’esprit, ce soir, la famille, les collègues et les élèves d’Agnès Lassalle, sauvagement assassinée dans son établissement scolaire.
Monsieur le ministre, 43 nouvelles sections internationales devaient être ouvertes à la rentrée de 2022 dans les collèges les plus défavorisés. Ce dispositif bilingue, qui propose d’accueillir des élèves français et étrangers dans une même section, est l’un des leviers à actionner pour améliorer la mixité sociale à l’école. Il permet aux élèves de bénéficier d’un total de 6 heures de cours supplémentaires par semaine – 2 heures d’histoire-géographie ou de mathématiques dans la langue de la section, ainsi que 4 heures de lettres étrangères.
Monsieur le ministre, mercredi dernier, vous avez affirmé votre volonté de multiplier les ouvertures de sections internationales dans les collèges et les lycées défavorisés. Pour assurer ces 6 heures de cours hebdomadaires, les professeurs en poste devront être mobilisés et de nouveaux professeurs embauchés dans certaines académies.
Or les enseignants n’ont jamais été aussi nombreux à quitter leurs fonctions. Les partants représentent ainsi près de 3, 5 % des effectifs actuellement, contre 0, 05 % en 2008.
S’y ajoutent les démissions qu’un certain nombre d’enseignants contractuels, recrutés à la rentrée de 2022 pour pallier les 4 000 vacances de poste de professeur titulaire, présentent après quelques semaines ou quelques mois d’exercice.
Monsieur le ministre, face aux difficultés de recrutement et à la crise d’attractivité du métier, comment entendez-vous garantir l’effectivité de ces sections internationales ?
Madame la sénatrice Billon, l’ouverture de sections internationales donne effectivement de bons résultats, puisque l’indice de positionnement social des établissements concernés progresse d’année en année, ce qui est bien sûr un très bon signe pour des établissements défavorisés.
Telle est la raison pour laquelle nous n’envisageons d’ouvrir de section internationale que dans des établissements défavorisés. Nous optimisons ainsi l’effet de ces ouvertures de sections tout en assurant une forme de rattrapage.
Ces ouvertures se font de manière progressive, la première année en classe de sixième, puis dans les classes de cinquième, quatrième et troisième. Le déploiement des moyens nécessaires est ainsi réparti sur quatre années, ce qui permet de l’envisager de manière graduelle, en prenant en compte les difficultés de recrutement que nous rencontrons dans le secondaire et que vous pointez à juste titre, madame la sénatrice.
Ces difficultés de recrutement sont inégales selon les disciplines. Si elles sont importantes pour le français et l’allemand, elles sont moins marquées pour les mathématiques, la physique-chimie ou la technologie.
En dépit de ces difficultés, nous avons décidé de consentir un effort particulier en faveur des établissements défavorisés. Dès la rentrée de 2023, nous ouvrirons donc 16 sections internationales supplémentaires. Je souhaiterais faire davantage, mais à ce stade nos calculs montrent que nous pourrons assurer ces ouvertures.
Le taux de démission des enseignants contractuels auquel vous faites allusion est effectivement préoccupant, madame la sénatrice. C’est pourquoi nous déployons un programme au long cours de formation des enseignants contractuels.
Je précise toutefois que 87 % des enseignants contractuels embauchés à la rentrée de 2022 avaient déjà enseigné l’année scolaire précédente. Dans leur grande majorité, ils n’ont donc pas été engagés à la dernière minute, et beaucoup avaient plusieurs années d’expérience.

Contrairement à vous, monsieur le ministre, je ne suis pas convaincue que le risque de précarisation soit faible.
Il sera intéressant d’évaluer l’efficacité des moyens que vous vous apprêtez à engager au regard des objectifs fixés. Pour ma part, je demeure sceptique à ce stade.

Monsieur le ministre, « il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs », écrivait Victor Hugo avant que Jules Ferry n’édifie l’école républicaine, comprenant que pour moissonner le bonheur public, il faut d’abord en semer les germes dans la jeunesse.
En rendant l’école laïque, gratuite et obligatoire pour tous, la IIIe République nourrissait l’ambition de façonner des citoyens libres, instruits et éclairés, unis par des valeurs partagées dans le grand creuset social scolaire.
Pendant des décennies, la République a fait de l’école sa pierre angulaire, y plaçant son essence, alors même que les divisions qui traversaient la France étaient peut-être plus vives qu’aujourd’hui.
L’école a donné une instruction solide à tous, distingué les plus méritants et offert à une République jeune et hésitante un corps social cohérent et soudé derrière elle. L’école, alors, cimentait la Nation. Aujourd’hui, cette dernière s’y lézarde.
Preuve de ce malaise, l’enseignement privé, dont on a beaucoup parlé, ne s’est jamais si bien porté, et certainement pas pour des raisons religieuses. Ce que recherchent les parents d’élèves dans le privé d’aujourd’hui, c’est l’école publique d’hier, où le travail, la discipline et l’autorité du maître étaient les points cardinaux.
Comment s’en étonner quand le niveau des élèves s’effondre, quant au temps des hussards noirs a succédé celui des contractuels recrutés en job dating, quand la carte de l’éducation prioritaire oublie les trois quarts du pays ?
L’enjeu de la mixité sociale à l’école est capital pour empêcher l’avènement d’une société-archipel, mosaïque de groupes antagonistes refusant de faire nation ensemble.
La non-mixité sociale couve les séparatismes de demain. La mixité, elle, forge le sentiment d’appartenance à une communauté de destin, liant de toute société.
Monsieur le ministre, la première pierre d’une vraie mixité sociale n’est-elle pas le retour à certains fondamentaux pédagogique : le travail, la discipline, le respect de l’enseignant ?
Monsieur le sénateur Paccaud, vous ne m’entendrez pas déprécier l’importance de l’effort, du travail et du mérite.
Telle est la raison pour laquelle, par exemple, j’ai choisi de réintroduire les mathématiques en classe de première, dans la filière générale, en dépit des efforts supplémentaires que cela demande aux élèves n’ayant pas d’appétence pour cette discipline ou en ayant peu. De même, nous nous sommes attelés à faire du cours moyen et de la sixième des moments essentiels.
Pour autant, en tant qu’historien, permettez-moi d’exprimer mon scepticisme quant à la nostalgie de l’école de jadis que vous semblez entretenir.
Si l’école de jadis peut avoir un charme particulier en 2023, n’oublions pas que, pour l’immense majorité des enfants, ceux qui étaient issus des couches populaires, elle s’arrêtait au certificat d’études, et que très peu nombreux étaient les élèves qui poursuivaient au lycée jusqu’au baccalauréat. Vers 1960, le pourcentage d’élèves reçus au bac était de 10 %. Je ne regrette pas particulièrement cette époque.
La trajectoire historique du XXe siècle fut celle de la massification de l’école – je suis certain que vous ne le regrettez pas, monsieur le sénateur –, c’est-à-dire de l’entrée au collège, au lycée et à l’université du plus grand nombre des élèves.
L’enjeu aujourd’hui est donc non plus la massification, mais la démocratisation, c’est-à-dire l’accès égal et méritocratique de tous les élèves à toutes les filières, en particulier aux filières d’excellence professionnelles, comme universitaires.
Nous ne réussirons à répondre à cette question centrale qu’en relevant le niveau général, ce qui suppose notamment d’insister sur les matières fondamentales, en particulier le français et les mathématiques, mais aussi en relevant le défi de la mixité sociale et scolaire.
Applaudissements sur des travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le constatons depuis plusieurs décennies, notre système scolaire demeure profondément ségrégué.
La corrélation entre le milieu socioéconomique et la performance scolaire dans notre pays est l’une des plus fortes de l’ensemble des pays de l’OCDE selon l’enquête Pisa, et elle s’aggrave chaque année sans que nous sachions remédier à cette difficulté.
Qu’elle soit spatiale, budgétaire, résidentielle ou culturelle, cette segmentation sociale renforce les inégalités d’éducation et d’apprentissage, nourrit un sentiment de fatalisme et freine l’interaction entre élèves de différents niveaux. Les effets produits, sévères et durables, participent de la fracturation de notre modèle républicain.
Le code de l’éducation dispose que « la scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité ».
Notre responsabilité, et celle de votre ministère en particulier, est de permettre la réussite de tous les élèves, objectif fixé par la loi, en améliorant partout les conditions de scolarisation, en premier lieu celles des plus fragiles.
Aussi, monsieur le ministre, par quels moyens envisagez-vous de lutter plus efficacement contre le séparatisme scolaire et de contrer les stratégies d’évitement des familles ? Comment développer une véritable culture de l’hétérogénéité dans les établissements ?
Sur des problématiques plus locales, qui affectent le fonctionnement de nos écoles et creusent encore davantage les inégalités scolaires, qu’entendez-vous opposer à la crise structurelle du non-remplacement des enseignants dans nos départements, qui dégrade les conditions d’apprentissage et qui est à l’origine de fermetures de classes uniques ou de sites isolés ?
Concrètement, vous fermez des classes pour créer des postes de remplaçants, par exemple en Creuse.
Dans un contexte national de suppressions de postes pour 2023 – moins 1 117 postes – comment envisagez-vous de garantir une présence enseignante au quotidien dans chaque classe ?
Par ailleurs, la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers vous paraît-elle satisfaisante ? Nous constatons sur le terrain de grandes difficultés dans la structuration de nos réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et la persistance de zones blanches.
Enfin, « l’école du futur » prônée par l’exécutif permettra-t-elle de réduire les inégalités territoriales, telles que nous les subissons dans l’hyperruralité ? Ce dispositif vous paraît-il adapté à nos réalités ?
Monsieur le sénateur Lozach, remédier aux difficultés relatives à l’évitement et au séparatisme scolaire que vous évoquez requiert, d’une part, de rendre plus attractifs les établissements publics qui le sont peu – nous avons déjà abordé ce point – et, d’autre part, d’accroître le nombre d’élèves défavorisés scolarisés dans les établissements attractifs et favorisés, qu’ils soient publics ou privés. Telles sont les propositions que j’ai formulées ce soir.
Par ailleurs, la perte d’attractivité du métier d’enseignant est un sujet grave. Le rendement des concours d’enseignant est relativement faible, puisqu’il s’établit aujourd’hui à 83 %, si bien que, pour 100 postes mis au concours, seuls 83 professeurs sont recrutés.
Le nombre de postes et la baisse des moyens doivent d’ailleurs s’apprécier à l’aune des difficultés à pourvoir les postes qui résultent de cette situation. Avant d’augmenter le nombre de postes, encore faut-il s’assurer que nous aurons suffisamment de professeurs.
À cet égard, la question de l’attractivité du métier est essentielle. Nos professeurs ne sont pas suffisamment rémunérés. Des négociations sont en cours avec les organisations syndicales, auxquelles nous avons proposé une part d’augmentation non conditionnelle de la rémunération de tous les enseignants, des néo-titulaires jusqu’à ceux qui sont proches de la retraite, et une part d’augmentation conditionnelle, liée à de nouvelles missions. L’ensemble permettrait des augmentations substantielles.
Je reconnais toutefois que la perte d’attractivité du métier ne tient pas seulement à la rémunération et que d’autres facteurs, tels que le déroulement des carrières, l’entrée dans le métier, les mutations ou les affectations doivent être pris en compte.
Nous y travaillons, et nous formulerons des propositions dans les mois à venir pour faire en sorte que les postes soient pourvus, y compris dans les zones rurales.

Monsieur le ministre, la mixité sociale est à l’école publique ce que les droits de l’homme sont à la France : une part de son être, le résultat d’une histoire et d’une politique de longue haleine.
La première égalité est celle de l’accès au savoir. C’est le droit fondamental et inaliénable à une instruction que notre école publique n’est malheureusement plus en mesure de fournir à tous les enfants de notre pays.
La crise de confiance est telle que de plus en en plus de parents se tournent vers le privé, moins par conviction que pour échapper aux failles de l’école publique.
Le constat et les chiffres sont, hélas, bien connus, de la dégradation du climat scolaire identifiée dans un rapport du Sénat pointant le phénomène du « pas de vague » à l’étiolement de l’autorité dû à une politique du laisser-faire. Ajoutez à cela l’absence de reconnaissance d’un statut qui perd en attractivité, et vous obtenez logiquement une crise des vocations dans l’enseignement.
Tel est le cocktail explosif qui empêche vraiment la mixité sociale.
Laisser l’école publique se dégrader conduit mécaniquement à un déport vers le privé. Pour assurer une mixité sociale dans l’école de la République, encore faut-il que le niveau général de l’instruction prodiguée aux élèves soit redressé partout, pour tous et dans la durée.
Vous proposez de colmater un bateau dont il faut redresser le gouvernail par des binômes d’établissements et un charcutage de la carte scolaire indignes des enjeux.
Ne nous trompons pas de débat, et encore moins de solutions, monsieur le ministre. Le sociologue Jean-Pierre Terrail rappelait en 2006 que les enfants de toutes les classes sociales peuvent mener une scolarité égale dès lors que le savoir transmis est le même partout.
La maîtrise des acquisitions élémentaires neutralise le poids de l’origine sociale dans les parcours scolaires. Telle est donc la clé si l’on veut vraiment et durablement gommer le poids des inégalités sociales.
Comme l’indiquait votre illustre prédécesseur Jules Ferry, « avec l’inégalité d’éducation, je vous défie d’avoir jamais l’égalité des droits ».
Monsieur le ministre, comment comptez-vous agir pour garantir à nouveau cette égalité et rétablir la mission essentielle et première de l’école publique ?
Madame la sénatrice Bourrat, loin de moi l’idée de mettre en accusation qui que ce soit.
En l’occurrence, nous avons engagé plusieurs chantiers importants, afin de favoriser la mixité sociale et scolaire.
Le premier – je vous rejoins sur ce point, madame la sénatrice – vise à redresser certains aspects de l’école publique.
Nous poursuivons ainsi les efforts engagés ces dernières années pour le dédoublement des classes de grande section, de CP et de CE1 en zone d’éducation prioritaire. Ce chantier est presque achevé pour les grandes sections des écoles maternelles.
Nous poursuivons également les plans Français et Mathématiques. À l’école primaire, la réforme du cours moyen a permis de mettre l’accent sur l’écriture, tandis qu’au collègue, nous avons dégagé une heure d’enseignement consacrée à l’approfondissement et au soutien en français et en mathématiques en classe de sixième. Ce sont là des points importants.
Nous allons par ailleurs créer un grand nombre de clubs des mathématiques dans les collèges et dans les lycées avec Hugo Duminil-Copin, notre médaille Fields.
Au lycée, nous avons réintroduit l’heure de mathématiques en classe de première et instauré des modules de renforcement en mathématiques en classe de seconde.
Ces différents éléments, auxquels s’ajoutent les programmes spécifiques et les filières d’excellence que nous avons évoqués, visent à renforcer l’école publique.
En revanche, madame la sénatrice, la sectorisation n’est pas une forme de charcutage. Elle se pratique depuis toujours, et il est normal qu’elle soit élaborée de manière à produire les meilleurs résultats possible, c’est-à-dire de bons résultats pour les enfants favorisés, mais aussi pour les enfants défavorisés. Or c’est au sein des établissements mixtes que ces derniers sont tirés en avant.
Nous travaillons donc à la fois sur le public, sur la sectorisation et sur la participation de l’enseignement privé sous contrat. Soyez assurée, madame la sénatrice, que nous faisons feu de tout bois pour améliorer les résultats scolaires de tous nos élèves.

Monsieur le ministre, l’un des objectifs de l’école est de transmettre et de faire partager les valeurs de la République. La mixité sociale, qui favorise l’équité et optimise les performances des élèves, doit y concourir.
Pour autant, toute la question tient aux conditions dans lesquelles nous mettrons en œuvre cet objectif. Le lien entre l’origine familiale et sociale et la composition sociale de l’établissement fréquenté est la source d’une tension majeure. L’objectif susvisé se heurte aux résistances de tous les acteurs.
Les indicateurs sont insuffisants et l’évaluation difficile, car il est illusoire de prétendre analyser l’effet d’une seule variable dans l’ensemble d’un processus complexe, les effets des inégalités étant toujours cumulatifs.
Le besoin exprimé est fort. Il participe de la démocratisation de l’enseignement public et de l’émancipation républicaine. L’État a le devoir d’assurer l’intégration réussie de toutes les composantes de la Nation.
La sectorisation scolaire et la ségrégation spatiale sont des outils essentiels, quitte à entrer en conflit avec l’intérêt des familles, auxquelles, en démocratie, l’on ne peut reprocher de s’efforcer d’obtenir les meilleures chances d’une scolarisation réussie pour leurs enfants.
Tout est question d’équilibre dans l’action de l’État.
La politique d’éducation prioritaire a eu le mérite de pointer du doigt les inégalités sociales et culturelles. Elle a reconnu le besoin d’homogénéiser les caractéristiques sociales des élèves de certains établissements. Il faudra néanmoins un courage quotidien pour défendre la laïcité.
Des objectifs et des actions sont annoncés, notamment avec les collectivités locales, pour agir sur les affectations scolaires, ainsi qu’avec l’enseignement privé sous contrat.
Pouvez-vous nous préciser les modalités de ces actions, monsieur le ministre ? Vous affirmez que chacun devra apporter sa contribution à l’effort de refonte de la carte de l’éducation prioritaire, mais à quelle forme d’effort pensez-vous ?
Monsieur le sénateur Grosperrin, je partage votre point de vue, lequel est confirmé par de nombreuses études, selon lequel les inégalités de naissance sont mal ou insuffisamment corrigées par l’école dans notre pays.
La situation de la France est à ce titre particulière : si dans nombre de domaines les familles défavorisées y sont mieux aidées que dans de très nombreux autres pays de l’OCDE, notre école est moins performante pour corriger les inégalités.
Les pays qui ont les meilleurs résultats et dont les sociétés sont moins inégalitaires que la nôtre, notamment en Europe du Nord ou bien au-delà de l’Europe, sont ceux où les résultats scolaires des élèves sont les plus homogènes. Il nous faut donc nous atteler à cette difficulté.
J’ai indiqué que notre méthode était celle de la concertation avec les collectivités, parce qu’il n’y a pas de recette unique à appliquer.
En revanche, nous nous fixons des objectifs, notamment chiffrés. Cela concerne aussi l’enseignement privé sous contrat. À cet égard, nos partenaires ne se borneront pas à prendre un vague engagement – je me réjouis qu’ils soient tout à fait disposés à s’engager sur des objectifs chiffrés.
Des progrès doivent également être réalisés, j’y insiste, par les établissements publics favorisés, sur lesquels nous avons davantage la main, en particulier grâce à la sectorisation.
Il ne s’agit pas de procéder de manière violente. Nous devons bien entendu agir en concertation avec les associations de parents d’élèves et avec les familles, mais il nous faut progresser à un rythme mesurable, de manière à obtenir des résultats significatifs dès la rentrée de 2024.

Vous évoquiez les comparaisons avec les autres pays, monsieur le ministre. Dans un rapport publié en 2007 sur les clés du succès des systèmes scolaires les plus performants, le cabinet McKinsey, qui s’est penché sur 25 pays de l’OCDE, montre que, indépendamment du contexte culturel dans lequel ils se déploient, les meilleurs systèmes scolaires remplissent trois critères – je n’en citerai que deux.
Premièrement, ils incitent les personnes les plus compétentes à devenir enseignants.
Deuxièmement, seule l’amélioration de l’enseignement dans les classes produit des résultats. Max Brisson évoquait tout à l’heure la question de la formation. Il faudrait s’interroger sur ce qui se passe véritablement en classe et avoir le courage de l’évaluer et de le rendre public.
Monsieur le sénateur Grosperrin, la question de la formation des enseignants est absolument décisive.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, la formation au métier est objectivement trop courte. C’est pourquoi j’ai proposé de recruter les professeurs des écoles non plus à bac+5, mais à bac+3, en assurant ensuite deux années de formation, qui seraient en quelque sorte deux années d’élève-professorat.
Cette proposition, qui doit être étudiée et évaluée dans toutes ses dimensions, s’inspire effectivement des écoles normales de jadis, qui formaient véritablement des praticiens.
Cela permettrait également de promouvoir le rôle d’ascenseur social du professorat des écoles, l’accès à bac+3 étant socialement plus juste que l’accès à bac+5.
Vous le constatez, monsieur le sénateur, je plaide pour une transformation assez profonde du recrutement des professeurs des écoles.
Sourires.

M. Jacques Grosperrin. De même que Max Brisson, qui vous a adressé ses encouragements – j’espère que vous y êtes sensible, monsieur le ministre
Sourires.

Permettez-moi de rebondir sur un autre point. Depuis de nombreuses années, tous les ministres qui se sont succédé n’ont ménagé ni leurs efforts ni les moyens consentis à l’amélioration des enseignements. Les différentes enquêtes – Pisa, Timss ou autres – montrent pourtant que nos mauvais élèves ont toujours du mal à progresser, tandis que les meilleurs sont toujours les meilleurs.
Nous avons là une véritable difficulté, et j’estime que, au-delà de la proposition dont vous venez de nous faire part et qui peut effectivement contribuer à une amélioration du niveau des élèves, il faudra s’interroger sur l’évaluation des enseignants.
La formation est certes fondamentale, mais, en tant que professeur agrégé, j’aurai le courage de dire que ce ne sont sans doute pas les professeurs agrégés qui travaillent le plus. Et en tant que politique, j’estime que c’est un point qu’il faudrait améliorer dans le cadre de la formation continue.
Il faut examiner ce qu’il se passe dans les classes et encourager ceux qui travaillent davantage que d’autres, monsieur le ministre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons, l’absence de mixité sociale à l’école est l’un des nombreux éléments préjudiciables à l’unité d’une nation.
Si la question semble simple, les réponses à apporter sont bien plus complexes, opposant souvent égalitarisme intransigeant et libertés individuelles.
Monsieur le ministre, je n’aborderai pas la question de la mixité sociale à l’école comme vous pourriez vous y attendre. En effet, ce sujet appelle nécessairement celui du mérite, qui se définit par ce qui rend une personne digne d’estime et de récompense.
L’histoire de l’école républicaine est celle d’une école qui permet à ses meilleurs éléments de s’élever dans la société à force de travail et d’abnégation. Or ces dernières années ont malheureusement été marquées par l’importation de débats venus d’outre-Atlantique : fini l’universalisme républicain, place à l’assignation perpétuelle dérivée du wokisme.
Le mérite n’existe plus, car le monde se divise désormais entre oppresseurs et opprimés, des catégories orchestrées en fonction du genre, de la couleur de peau, du statut social et de l’orientation sexuelle de chacun.
Aux yeux des théoriciens du wokisme, le seul mérite – nous ne partageons pas la même acception de ce terme – est d’être dans le camp des victimes de l’oppression.
Ma question est donc simple, monsieur le ministre : à quoi bon louer certaines formes de mixité quand, en même temps, on ferme les yeux sur l’apparition au sommet de l’éducation nationale de mouvements essentialistes et racialistes, qui, sous couvert de lutter contre toutes les formes de discrimination, enferment les individus dans des stéréotypes compromettant l’équilibre même de notre pacte républicain ?
Madame la sénatrice Imbert, si je souscris pleinement à la notion de mérite, j’ai précédemment indiqué mes réserves quant à l’idée que l’école de jadis aurait été celle du mérite pour tous.
L’école de Jules Ferry était en effet une école inégalitaire, puisqu’elle était pensée pour éduquer les enfants du peuple, ceux de la paysannerie comme du monde ouvrier, mais seulement jusqu’au certificat d’études, et cela quels que soient les mérites des enfants concernés.
Le pourcentage d’élèves qui avaient le bac au début du XXe siècle était de l’ordre de 1 % de la population. Dans ce monde inégalitaire, où les possibilités d’un élève étaient fortement liées aux positions sociales des familles, les lycées étaient réservés à une minorité bourgeoise.
Je rappelle à cet égard que les instituteurs du début du XXe siècle n’allaient pas au lycée et qu’ils n’obtenaient pas le baccalauréat. Les écoles normales étaient précisément conçues pour « élever » les enfants du peuple jusqu’au métier d’instituteur. Vous comprendrez donc que je n’aie pas de nostalgie particulière pour cette époque très inégalitaire.
Par ailleurs, vous semblez considérer que l’école d’aujourd’hui serait wokiste. Je ne suis pas certain de saisir ce que vous entendez par là. Je ne reconnais le tableau que vous dépeignez ni dans les programmes d’histoire, de géographie, de SVT ou de français ni dans les instructions pédagogiques données aux enseignants ni dans les enseignements eux-mêmes.

Il y a au moins une chose qui réunit, monsieur le ministre, c’est la notion de mérite, à laquelle vous avez indiqué que vous étiez attaché.
Si je ne regrette pas l’école d’autrefois, je ne comparerais pas le bac d’aujourd’hui et le certificat d’études de jadis. On peut n’avoir que son certificat d’études et être très intelligent – vous l’avez dit vous-même –, et on peut exercer le métier d’instituteur sans avoir le baccalauréat tout en étant bien éduqué, digne, capable de transmettre et très attaché à son métier.
Je tenais à introduire la question du wokisme, car même si celui-ci relève effectivement d’un autre débat, il participe également de la fracture sociale. Alors que nous débattons de la mixité scolaire, en laquelle je crois, car elle est source de plus d’égalité, je souhaitais également vous renvoyer à des déclarations où, dans d’autres domaines, vous prôniez des réunions non mixtes, monsieur le ministre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, toutes les enquêtes le montrent : la France est l’un des pays où le milieu social de l’élève conditionne le plus sa réussite scolaire. Cette situation n’évolue pas, malgré les réformes successives.
Pour assurer l’égalité des chances, monsieur le ministre, vous comptez agir sur la mixité sociale, principalement au collège et au lycée. Mais le sort de l’élève se joue bien avant !
Selon les données de l’Institut national d’études démographiques (Ined), en début de classe préparatoire (CP), seuls 42 % des élèves inscrits dans les écoles en REP+ ont une bonne compréhension de la langue à l’oral, contre 75 % des élèves des écoles situées de ces zones. De même, 46 % des premiers ont un niveau satisfaisant en résolution de problèmes mathématiques, contre 70 % des seconds.
L’Observatoire des inégalités signale que, déjà à la maternelle, les tout-petits ont une maîtrise inégale du vocabulaire. Les enfants issus de l’immigration, notamment, ne peuvent progresser au même rythme que ceux d’une famille aisée. Or c’est pendant les premières aimées de son existence que l’enfant dispose des meilleures capacités cognitives pour l’acquisition du langage et du raisonnement.
Ma question porte donc sur la nécessité d’intervenir le plus tôt possible dans l’éducation des jeunes élèves issus d’un milieu modeste.
Monsieur le ministre, vous avez annoncé un plan pour les maternelles, sans préciser quelles mesures concrètes seront prises ni décrire les moyens que vous y affecterez. Je rappelle que de nombreuses classes de maternelle sont en sureffectif et que le nombre de postes d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) est toujours insuffisant.
Pourriez-vous nous apporter des précisions sur vos projets pour cette période déterminante ?
Madame la sénatrice Gosselin, si la question de la mixité sociale se pose surtout au collège et au lycée, cela ne signifie pas, en effet, qu’il ne faut pas s’y intéresser dans le primaire ou au sein des écoles maternelles.
Nous avons effectué des efforts ces dernières années, avec le dédoublement, dans les zones d’éducation prioritaire, des classes de grandes sections, CP et CE1. Les premières cohortes ayant bénéficié de ces dédoublements sont désormais en sixième.
Or les évaluations montrent des progrès intéressants, surtout pour les enfants de REP+, même si la crise sanitaire a entravé le processus, avec le confinement, dont nous n’avons pas fini de payer les conséquences, sur la santé psychique et physique des enfants comme sur leur niveau scolaire. Nous poursuivons le dédoublement, qui sera bientôt achevé, puisque nous en sommes à 75 %. L’objectif est d’atteindre les 100 % à la rentrée de 2024.
Nous sommes favorables, dans les zones d’éducation prioritaire, à la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans de très petites sections. Cela donne de bons résultats, notamment dans l’acquisition du vocabulaire. J’ai visité de telles sections dans des écoles maternelles de quartiers prioritaires dans le Sud-Ouest.
Le plan maternelle a plusieurs volets. L’un d’eux concerne la formation des enseignants. Les professeurs des écoles, en effet, sont tous formés de la même manière, qu’ils doivent enseigner en petite section ou en CM2. La comparaison avec d’autres pays montre qu’il serait utile, sinon de spécialiser les enseignants des écoles maternelles, du moins de leur apporter des compléments de formation. Tel est l’objet du plan maternelle.

Certes, monsieur le ministre, la covid-19 a fait des dégâts. Mais quand on observe le nombre des classes qui sont fermées cette année, on peut s’inquiéter quant au devenir de nos établissements et de nos enfants : dans la Manche, l’an dernier, 9 ont fermé, pour 380 élèves en moins ; cette année, on en ferme 29, pour 550 élèves en moins !

En conclusion de ce débat, la parole est à Mme Sylvie Robert, pour groupe auteur de la demande.

Je veux tout d’abord remercier mes collègues, dont les interventions, reflétant des points de vue divers, ont toutes témoigné de leur intérêt pour la question de la mixité scolaire.
Je voudrais également remercier M. le ministre de ses réponses toujours étayées, mais aussi des quelques annonces qu’il a faites.
Je trouverais important, monsieur le ministre, que nous puissions suivre, au Sénat, ce qu’il adviendra de ces annonces dans les prochaines semaines, compte tenu bien sûr de la nécessaire négociation. En effet, la publication des IPS nous engage et nous incite à aller plus loin. C’est un enjeu démocratique.
Dans leurs interventions, au-delà de la question de la mixité scolaire, mes collègues, avec, en dernier lieu, Béatrice Gosselin, ont longuement évoqué la question des moyens. Mais les leviers sont multiples. Plusieurs ont été mentionnés : options, parrainages, sectorisation…
Il faut tenter de les actionner, à l’échelon interministériel, car ils engagent la politique de l’habitat, l’aménagement du territoire et la fabrique même de nos villes et de nos territoires, en milieu rural ou urbain, car la ruralité présente des spécificités qui ont été soulignées à juste titre. Le partenariat avec les collectivités territoriales est fondamental, tout comme la formation des enseignants. La palette, en somme, est extrêmement variée.
On a beaucoup parlé d’expérimentation en Haute-Garonne. Je vous encourage, mes chers collègues, à lire le rapport tiré de ces cinq ans d’expérimentation. Les résultats sont extrêmement positifs, et ce fut l’occasion d’actionner tous les leviers disponibles, ce qui a demandé des moyens. Diffuser ce rapport peut être l’occasion de travailler au plus près avec les collectivités territoriales sur leur volonté d’expérimenter d’autres projets de cette nature.
Vous nous avez parlé de la date du 20 mars prochain, monsieur le ministre. L’école privée sous contrat a été largement évoquée, elle est un élément de notre débat. Vous menez des négociations pour y améliorer la mixité scolaire et vous comptez aboutir à un protocole d’accord aux alentours du 20 mars. Nous sommes tout à fait impatients d’en découvrir la teneur, puisqu’il constituera une nouvelle étape dans le parcours de la mixité scolaire au XXIe siècle.
La mixité scolaire est un véritable enjeu démocratique et républicain. C’est une promesse que nous devons à tous les enfants de notre pays. Pour la tenir, il faut un puissant volontarisme politique. Nous comptons donc sur vous, monsieur le ministre !
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. le ministre acquiesce.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 2 mars 2023 :
À dix heures trente :
Vingt-trois questions orales.
À quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, dont le Sénat est saisi en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution (texte n° 368, 2022-2023) : discussion générale.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq.
La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l ’ État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : M. François-Noël Buffet, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Catherine Di Folco, MM. Loïc Hervé, Hussein Bourgi, Jean-Yves Leconte et Alain Richard ;
Suppléants : Mme Catherine Belrhiti, M. Christophe-André Frassa, Mme Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Mmes Maryse Carrère et Cécile Cukierman.
Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la commission des affaires européennes.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Valérie Boyer est proclamée membre de la commission des affaires européennes, en remplacement de M. Laurent Duplomb, démissionnaire.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, la liste des candidatures préalablement publiée est ratifiée.
M. Stéphane Artano, Mmes Annick Billon, Céline Boulay-Espéronnier, Toine Bourrat, Valérie Boyer, MM. Rémi Cardon, Thomas Dossus, André Gattolin, Daniel Gueret, Loïc Hervé, Mme Christine Lavarde, M. Claude Malhuret, Mmes Marie Mercier, Catherine Morin-Desailly, MM. Pierre Ouzoulias, Cédric Perrin, Mmes Sophie Primas, Laurence Rossignol et Mickaël Vallet.