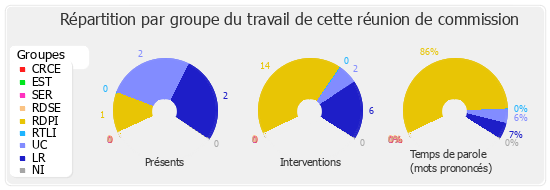Mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables
Réunion du 5 juin 2012 : 1ère réunion
La réunion

Très rapidement après sa constitution, le 21 février dernier, notre mission commune d'information a lancé un ambitieux programme de travail caractérisé par sa diversité : auditions, déplacements à l'étranger et visites d'entreprises. Nous avons également souhaité que nos travaux soient les plus ouverts possibles. Je pense que cet objectif est atteint et que nous avons recueilli tous les points de vue des personnes concernées par les sujets que nous avons traités.
Nous avons tenu trente deux heures d'auditions, dont six tables rondes. Au total, ce sont plus de cinquante organisations, associations, entreprises, journalistes, philosophes ou ethnologues qui nous ont fait part de leurs préoccupations et suggestions. A de rares exceptions près, toutes ces auditions ont été ouvertes au public et à la presse. Elles ont également fait l'objet d'une diffusion simultanée sur le site Internet du Sénat. Selon les premiers chiffres fournis par Public Sénat, les auditions ont été suivies, en moyenne, par plus de deux cents personnes chaque mois, ce qui est un bon résultat.
Deux visites d'usine ont permis de compléter sur le terrain les éléments recueillis au cours de ces auditions. Dans les établissements Sebbin, six d'entre nous ont suivi toutes les étapes du processus de fabrication de prothèses en silicone. Nous avons pu y observer les contrôles très précis de la phase industrielle mis en place par le fabricant. La semaine dernière, trois d'entre nous ont visité l'entreprise Eurofeedback qui fabrique, entre autres, des appareils laser ou à lumière pulsée pour l'épilation. Nous y avons eu une discussion intéressante avec le dirigeant sur la puissance de ces appareils, leur sécurité et l'utilisation qui peut en être faite par des professionnels non médicaux comme les esthéticiennes.
S'agissant des déplacements à l'étranger, je rappellerai qu'une délégation de la mission s'est rendue aux Etats-Unis, où elle a conduit treize entretiens et animé une conférence téléphonique. Le système américain semble a priori très séduisant, avec un mécanisme d'autorisation préalable à la mise sur le marché qui s'apparente à l'autorisation de mise sur le marché (AMM) qui existe pour le médicament. Il ne constitue pourtant pas la panacée : les producteurs disposent très souvent de moyens pour échapper au mécanisme d'autorisation de mise sur le marché grâce à des procédures simplifiées. Surtout, la réglementation des professions médicales relève des Etats. Il existe donc une très grande diversité de situations, surtout pour les activités esthétiques, entre le cas de New York, où elles ne sont quasiment pas réglementées, et celui du Maryland, où l'encadrement est très strict.
Le déplacement en Suède et au Danemark a également été riche en enseignements, en particulier en ce qui concerne le suivi des dispositifs médicaux implantables après leur mise sur le marché. La Suède est un pays qui a une tradition ancienne en matière de registres, qui remonte aux années 1970. Ils fonctionnent bien car leur mise en place est le résultat d'une initiative des professionnels de santé, qui assurent leur pilotage. Il n'y a là aucune logique de contrôle ou de tutelle administrative mais les compétences, notamment entre collectivités locales, sont réparties de manière très différente par rapport à la France. Le Danemark dispose d'une réglementation très précise et innovante en matière esthétique qui distingue les interventions non selon leur technique mais selon leur finalité. Un décret adopté dans ce pays en 2007 est très rigoureux dans ce domaine.
Nous avons également sollicité les ambassades de France au Brésil et en Corée, ainsi que l'ambassade d'Australie en France, afin d'obtenir des précisions sur la législation applicable dans ces trois pays. Brésil et Corée sont les symboles de l'engouement planétaire pour la chirurgie esthétique ; l'Australie est un pionnier pour les deux domaines d'investigation de notre mission. C'est d'ailleurs dans ce pays que la défaillance des prothèses de hanche DePuy a été détectée.
Afin que les travaux de notre mission reçoivent la publicité qu'ils méritent, la publication du rapport devrait avoir lieu durant la première moitié du mois de juillet. Nous avons également sollicité auprès du Président du Sénat l'organisation d'un débat en séance publique sur les conclusions du rapport lors de la reprise des travaux parlementaires.

La création de notre mission d'information répondait à l'émotion suscitée par le scandale des prothèses PIP. Cette affaire, qui est désormais entre les mains de la justice, est venue malheureusement confirmer les craintes que nous avions exprimées à l'automne, lors de l'examen de la loi sur la sécurité du médicament et des produits de santé : après le Mediator, nous touchons du doigt un domaine encore largement ignoré, celui des dispositifs médicaux, qui jouent pourtant un rôle de plus en plus important en matière de santé. Afin de maitriser tous les enjeux de cette politique publique, nous avons étendu le champ de nos investigations aux interventions à visée esthétique, qui connaissent un succès croissant.
Les auditions, visites sur le terrain et déplacements auxquels nous avons procédé ont confirmé le défaut d'organisation du contrôle de la filière des dispositifs médicaux et l'absence de véritable réglementation du secteur de l'esthétique, à l'exception notable de la chirurgie, qui ne semble pas poser de difficulté majeure. Dans ce domaine, la France fait plutôt figure d'exemple, même si des ratés existent.
Les dispositifs médicaux constituent un ensemble très varié de dizaines de milliers de produits, du pansement au pacemaker, de l'abaisse-langue à la prothèse de hanche. Ils sont fabriqués aussi bien par de grands groupes multinationaux que par des petites et moyennes entreprises (PME). Dans tous les cas, ces produits s'adressent à des personnes qui souffrent de problèmes de santé. La mesure du rapport entre le bénéfice attendu et le risque encouru est au coeur de l'analyse des produits.
C'est pourquoi nous nous sommes focalisés sur les dispositifs les plus risqués, des classes IIb et III, qui sont implantés dans le corps humain pour une durée supérieure à un mois. Lorsque la vie même du patient est en cause, on peut accepter un certain niveau de risque. Mais encore faut-il que ce risque soit correctement mesuré avant la commercialisation du produit et fasse l'objet d'un suivi précis après l'implantation. Malheureusement, nous en sommes loin. C'est d'autant plus préoccupant que les progrès de la science ouvrent de nouvelles perspectives, qui se traduiront par une plus grande individualisation des dispositifs et, donc, une plus grande difficulté à les suivre.
La problématique des interventions à visée esthétique est fondamentalement différente : le plus souvent, il ne s'agit pas de réparer une infirmité, de lutter contre la maladie ou de prolonger la vie des personnes. L'esthétique s'adresse à des personnes en bonne santé ; on ne peut donc admettre que la vie des gens qui y recourent soit mise en danger.
Je dirais même qu'il est logique que ces interventions ne présentent aucun danger. Une prise de conscience semble se dessiner, si j'en crois le recul sensible des techniques les plus invasives. En clair, la chirurgie esthétique n'a plus la cote. En revanche, de nouvelles techniques de médecine esthétique apparaissent sans cesse. Chacun veut sa part du marché, bien sûr, qu'il s'agisse des médecins, des dentistes, des professionnels de l'esthétique ou des industriels. L'imagination est sans limite et si elle n'est pas condamnable en soi, la volonté de nos contemporains de vivre en meilleure forme ne doit pas leur faire perdre de vue l'essentiel : ne pas nuire à leur santé. Evidemment, toutes ces interventions ont un coût ; en conséquence, un nouveau marché est né, celui du tourisme médical, et avec lui de nouveaux risques sanitaires.
En matière de dispositifs médicaux, les affaires récentes ont démontré les graves insuffisances des mécanismes de contrôle au niveau européen. La première directive ne date que de 1990, quinze ans après la création d'un mécanisme de certification aux Etats-Unis. Le marquage CE est né de la « nouvelle approche » destinée à assurer la libre circulation des marchandises. A cette époque, l'Europe a adopté une classification proche de celle des Etats-Unis. Les exigences de sécurité sont plus fortes pour les dispositifs les plus risqués mais d'une manière générale, la réglementation n'est pas plus exigeante pour un pacemaker que pour un grille-pain ou un aspirateur, même si les normes sont différentes.
Le contraste avec le médicament est flagrant : en matière de dispositif médical, pas d'autorisation de mise sur le marché, pas d'agence centrale. La certification est confiée à des sociétés privées, les organismes notifiés, payés par les fabricants. Il est ahurissant d'apprendre, comme on nous l'a affirmé, qu'un fabricant débouté par un organisme peut obtenir la délivrance du marquage CE par un autre organisme notifié. Cela montre toute la fragilité du système !
Comment les organismes notifiés travaillent-ils ? Selon quels critères évaluent-ils les produits qui leur sont présentés ? Quels sont les moyens qu'ils mettent en oeuvre ? Autant de questions aujourd'hui sans réponse.
Tout aussi choquante est la façon dont les producteurs peuvent choisir le mécanisme de certification : soit sur dossier, soit après une expertise technique. Dès lors qu'il estime que son produit est similaire à un dispositif déjà utilisé, le fabricant peut s'inscrire dans une ligne générique et échapper à toute démonstration autre que la sécurité du processus de fabrication. Ce fut notamment le cas avec les prothèses DePuy et les sondes Riata.
Tel est bien le noeud du problème : non seulement nul ne sait comment les organismes notifiés travaillent mais la réglementation européenne n'impose en aucun cas que le fabricant démontre le bénéfice apporté par son produit. Aux Etats-Unis, le système d' « équivalence substantielle » existe également mais les exigences sont bien différentes : le fabricant doit à la fois faire la preuve de la fiabilité de la fabrication et démontrer l'efficacité du nouveau dispositif. Le système américain du 510(k) permet de faire agréer un dispositif médical dans le cadre d'une procédure moins contraignante que le droit commun du « pre-market approval » délivré par la Food and Drug Administration (FDA). Il est similaire à ce qui existe en France pour les médicaments génériques.
J'en viens maintenant aux interventions à visée esthétique. Chirurgie esthétique mise à part, nous sommes dans un flou quasi complet. Le développement du tourisme esthétique ne favorise pas la transparence des pratiques. Internet pose aussi problème car ce qui est interdit ou réglementé ici est monnaie courante en ligne : je pense par exemple à la publicité pour la chirurgie esthétique ou à l'achat de produits ou matériels à visée esthétique. Dès lors qu'on se situe hors du territoire national, aucun contrôle n'est possible. J'en veux pour preuve ce que nous avons pu voir chez Eurofeedback la semaine dernière : ce fabricant a volontairement limité la puissance des appareils à lumière pulsée qu'il vend aux médecins et aux esthéticiennes. Mais rien ne dit que ses concurrents font de même et n'utilisent pas des matériels dangereux pour leurs clients.
Pour autant, ce n'est pas parce que l'offre est disponible à l'étranger qu'il ne faut rien faire chez nous. Je sais bien que les techniques évoluent, si ce n'est chaque jour, tout du moins très rapidement. Le temps que nous prenions la mesure du secteur des lasers à usage de dépilation, un nouveau matériel est sorti sur le marché, évidemment présenté comme révolutionnaire. Dans le même ordre d'idées, les appareils à lumière pulsée en vente libre se multiplient. Fort heureusement, la plupart semblent plutôt s'apparenter à des jouets qu'à des objets dangereux. Du fait de leur trop faible puissance, ils auraient même un effet paradoxal, favoriser la pousse des poils. Mais ce n'est pas toujours le cas et vous avez sans doute en mémoire les mises en garde répétées quant à l'utilisation des cabines de bronzage.
Sur le plan économique, chacun veut sa part du gâteau : c'est bien naturel. Je crois d'ailleurs qu'il faut que nous prenions garde à bien concilier sécurité sanitaire et maintien d'une filière industrielle. Il est évident que les intérêts en jeu sont énormes. Ceux d'entre nous qui y ont assisté se souviennent sans doute des débats acharnés qui ont opposé médecins esthétiques, dentistes et dermatologues sur les injections, notamment autour du canal naso-génien. Les dentistes souhaitent pouvoir le traiter car il constitue, selon eux, la continuation de la mâchoire.
Je n'oublie pas non plus les récriminations des esthéticiennes quant à l'interdiction qui leur est faite d'utiliser le terme « massage », en théorie réservé aux seuls kinésithérapeutes, mais très largement utilisé, sous couvert de « massage bien être », « massage traditionnel » ou encore de « massage thaïlandais ». On voit de telles enseignes fleurir dans nos villes.
Le manque de rigueur est tout aussi préoccupant en matière de formation. Le diplôme interuniversitaire en médecine esthétique délivré par l'université de Lyon n'est probablement pas suffisant. Encore faut-il s'entendre sur des priorités et prendre garde à être cohérents dans notre analyse : je rappelle que la commission du développement durable a constitué en son sein un groupe de travail sur la présence médicale sur l'ensemble du territoire ; on ne peut pas en même temps dénoncer le « désert médical » et suggérer de consacrer des moyens supplémentaire pour une « spécialité » qui, justement, n'en est pas une.
En définitive, le point essentiel est d'inciter les consommateurs à la vigilance, ce qui nous impose de réfléchir en termes de sécurité sanitaire et non pas de techniques. Sinon, nos recommandations seraient très vite dépassées.

Le lien entre démographie médicale et création d'une nouvelle spécialité ne me semble pas évident. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins qu'il ne faut pas mieux former les médecins esthétiques. Je ne partage pas votre point de vue sur ce point et je considère qu'il ne faut pas laisser de côté cette spécialité qui, selon vous, n'en est pas une. Vous ne pourrez pas empêcher un médecin de se spécialiser en médecine esthétique, et le refus d'améliorer la formation ne fera rien pour diminuer les risques existants.

Il n'y a pas de problème pour la chirurgie esthétique. En revanche, il me semble légitime de s'interroger sur les évolutions à apporter en ce qui concerne la formation à la médecine esthétique. C'est le rôle de notre mission d'information.

En matière de dispositifs médicaux, je crois que les choses sont simples : il est essentiel de renforcer le contrôle à toutes les étapes.
La première mesure consiste à s'attaquer aux conditions de mise sur le marché. Il est primordial de revoir en profondeur le rôle des organismes notifiés et le contrôle que les autorités de santé exercent sur eux. En revanche, je ne suis pas sûr que l'institution d'une véritable autorisation de mise sur le marché soit une idée transposable du médicament aux dispositifs médicaux. Non seulement les dispositifs médicaux sont beaucoup plus nombreux et variés que les médicaments mais il est très difficile de les tester avant leur commercialisation. Il ne faut pas renoncer à mener des essais cliniques, mais il faut être conscients qu'il ne s'agira jamais de la même réalité que pour le médicament : on ne peut mener des essais avec placebo et les populations concernées sont souvent de taille réduite.
Je pense qu'il nous faut également nous pencher à nouveau sur les relations entre les professionnels de santé et les fabricants. Le sujet n'est pas simple car plus les spécialités sont pointues plus il est difficile de trouve des experts qui ne soient pas en relation avec des industriels. Les Etats-Unis ont résolu la question de manière pragmatique en généralisant la transparence : c'est le Sunshine Act. Les médecins ont tout à gagner à ne plus être soupçonnés d'une connivence qui altèrerait leur jugement sur l'intérêt thérapeutique et le risque d'un nouveau dispositif.
Si ces liens se traduisent par des flux financiers, ceux-ci pourraient être mutualisés au sein d'un fonds qui servirait d'intermédiaire entre le laboratoire et le professionnel de santé, afin qu'il n'y ait pas de lien direct entre eux. Force est de constater que, dès les études de médecine, les industriels prennent en charge des dépenses en faveur des médecins, puis à travers des congrès ou un soutien à la recherche. La plupart des experts ne peuvent se passer de tels financements. Les spécialistes ont besoin des laboratoires pour mener des expérimentations. Un lien de dépendance s'installe, et la mutualisation des fonds reçus permettrait d'y mettre fin. Cela permettrait également de financer la matériovigilance, qui reste un parent pauvre au sein de notre système de soins.
Toutes les étapes du processus doivent faire l'objet d'une réflexion d'ensemble car on ne pourra prévenir de nouveaux incidents, voire accidents, sans assurer la traçabilité des dispositifs. Pour ce faire, plusieurs conditions doivent être réunies : en premier lieu, pouvoir identifier les matériels. Pour l'instant, chacun met en oeuvre son propre système, qu'il s'agisse des fabricants ou des établissements de santé. Comment, dans ces conditions, peut-on avoir une chance de retrouver un dispositif si la nécessité se présente ? La moindre des choses est de mettre en oeuvre un identifiant unique (UDI). Un projet international existe, nous devons jouer un rôle moteur en ce domaine, ce qui ne sera pas facile tant la crédibilité de l'Union européenne est remise en cause par le fonctionnement du système des organismes notifiés.
Une fois que le dispositif implanté dispose d'un numéro, il est évidemment essentiel d'alimenter une base de données lors de l'implantation sur un patient. Et c'est ainsi qu'on constitue un registre des matériels, qui permettra par la suite de détecter les éventuelles défaillances et de contacter les personnes concernées. En France, de tels registres restent le fruit d'initiatives individuelles.
Pour être efficace, un registre doit être le plus représentatif possible : il ne peut être efficace que s'il contient des données sur au moins 70 % des matériels implantés. Les exemples étrangers montrent que la réussite dépend de l'implication de tous les acteurs. En Suède par exemple, un registre sur la chirurgie de la main est rempli par le chirurgien dès sa sortie du bloc opératoire, grâce à des rubriques synthétiques et précisément définies. L'implication du monde médical est capitale. Le meilleur moyen de l'associer consiste, selon moi, à confier à des équipes dédiées la tenue d'un registre en particulier. Il faut faire des registres spécifiques à un produit ou une pathologie. On ne conçoit pas un registre de prothèses de hanche comme un fichier de stents héparinés. Chaque spécialité a ses spécificités, ses données cliniques propres.
Cependant, ces registres ont un coût : la participation de l'Etat, dans leur gestion ou leur financement, n'est donc pas à exclure a priori. On peut éventuellement envisager une taxe sur la publicité pour les dispositifs médicaux afin de financer ces registres.
Dernière piste possible, lier le remboursement des dispositifs à l'alimentation du registre. Au cours de nos auditions, cette piste a été plusieurs fois présentée comme intéressante.

Ne faudrait-il pas prévoir dès aujourd'hui l'inscription de la pose d'un dispositif médical implantable à un patient sur sa carte Vitale personnelle ou son dossier médical personnel (DMP), dispositif qui sera amené à se développer dans les années à venir ?

Garantir la traçabilité des dispositifs passe aussi par la déclaration de tous les événements indésirables. Nous devons donc nous interroger sur les moyens à mettre en oeuvre pour garantir la qualité et l'exhaustivité de l'information disponible : faut-il rendre plus facile la déclaration d'événements indésirables par les professionnels de santé ? Faut-il permettre aux patients de le faire directement ? Doit-on s'appuyer sur le relais que pourraient constituer les associations de malades ? Faut-il créer une base de données accessible à tous, retraçant tous les incidents répertoriés de chaque dispositif ?
Autant de pistes à explorer, sachant que beaucoup reste à faire en matière d'éducation à la santé.
C'est aussi vrai dans le domaine de l'esthétique : il est grand temps de responsabiliser l'ensemble de la filière.
La première chose à faire est de clairement distinguer les actes de médecine esthétique de ceux qui peuvent être pratiqués par des non-professionnels de santé. Afin de ne pas être rapidement contredits par les faits, nos propositions devront s'appuyer sur des distinctions claires et précises, par exemple entre interventions définitives et réversibles ou entre actes pratiqués sur des tissus vivants ou non vivants. Ici encore il peut y avoir débat. A mes yeux, la peau est vivante, mais pour les Américains la desquamation ne touche que des cellules mortes. Je ne suis pas de leur avis : il ne faut jamais oublier ce qu'il y a en dessous de la peau.
Une fois ces bases posées, il nous faudra définir les voies d'un renforcement des exigences de formation. L'institution d'un véritable diplôme d'études spécialisées complémentaires (Desc) dédié à la médecine esthétique me parait préférable à l'institution d'une nouvelle spécialité médicale. La médecine esthétique deviendrait ainsi un exercice particulier, au même titre que l'allergologie par exemple. Il importe aussi de préciser les conditions de délégation des fonctions médicales à des non médecins. En matière de chirurgie esthétique, la réglementation est précise, sans doute devons nous nous pencher sur sa transposition à la médecine esthétique lorsque c'est possible.
Quant aux pratiques en cabinet d'esthétique, je crois qu'il faut être très clair : il est impératif de privilégier la sécurité en limitant strictement celles qui présentent des risques potentiels. Il en va de même pour les cabines de bronzage. Un récent congrès international de cancérologie à Chicago a d'ailleurs rappelé le rôle des UV artificiels dans le développement des mélanomes, tumeurs cancéreuses extrêmement malignes.
Bien évidemment, cet effort rencontrera des obstacles. J'en veux pour preuve l'émoi suscité par le décret relatif à l'interdiction de certains actes de lyse adipocytaire, pris par le gouvernement en avril 2011 chez les professionnels, qui ont réussi à obtenir l'annulation, par le Conseil d'Etat, des dispositions qui concernaient les procédés avec une suspicion de danger. Le précédent gouvernement était en train de réfléchir à une nouvelle rédaction juridiquement plus solide. Je pense que le nouveau va aussi le faire. Comme en matière d'UV ou d'actes pouvant être accomplis par les esthéticiennes, il nous faudra approfondir la question.
Toutes proportions gardées, il convient de mettre en place un véritable parcours de soins esthétiques destiné à garantir la sécurité des interventions. Il est difficile d'empêcher une personne d'abuser de ces procédés ou actes mais au moins peut-on multiplier les dispositifs d'alerte et de mise en garde. Un site internet dédié pourrait constituer un autre outil intéressant pour diffuser des messages à destination du plus grand nombre. On peut également imaginer la délivrance d'une sorte de carnet de soins esthétiques. Encore faut-il que la personne soit rigoureuse car si on voit bien comment il peut être rempli pour les actes les plus lourds, ceux qui sont réalisés par un médecin, je suis plus sceptique pour ceux réalisés en dehors de tout contrôle médical.

Qu'en est-il de l'explantation de certains dispositifs médicaux implantables après le décès du porteur ? Nous avions déjà discuté de cette question qui semblait poser des problèmes lors de l'incinération du corps. Des précautions spécifiques doivent être prises, notamment avec les pacemakers. Ces détails sont-ils correctement mentionnés dans les certificats de décès ?

Il faut absolument explanter les pacemakers car ce sont des appareils à pile qui peuvent exploser durant la crémation. Pour les autres prothèses, qui ne sont pas détruites par la crémation, les matériaux sont récupérés et valorisés. Disons que ce n'est peut être pas très éthique de réaliser des bénéfices sur le dos d'un mort.

Le certificat de décès rempli par le médecin comporte des dispositions claires à ce sujet. L'encadrement légal et réglementaire existant semble donc suffisant.

Les dispositifs médicaux récupérés après l'incinération ne sont pas réutilisés, ce sont simplement leurs composants qui sont démantelés et parfois revendus au poids, à la manière des carcasses de voitures. De plus, les pacemakers ont une durée de vie limitée, ils ne pourraient pas être réutilisés.

Les dispositifs médicaux implantables ne sont pas des médicaments. Pourtant, je suis convaincue que si le public apprend que les produits qui peuvent lui être implantés ne sont pas soumis à la même réglementation que les médicaments, sa réaction sera faite, au-delà de l'étonnement initial, de stupeur voire d'effroi. Comme il ne faut pas confondre les législations, car l'innovation et les évolutions technologiques ne doivent pas être oubliées, comment annoncer à nos concitoyens que les règles de sécurité diffèrent très largement entre ces deux catégories de produits de santé dont les effets sur la santé peuvent être très importants ?

Vous soulignez justement l'un des problèmes majeurs relevés par la mission lors de ses travaux. Une des réponses se situe dans la classification utilisée : on parle des dispositifs médicaux implantables les plus critiques, disons les classes IIb et III. La réglementation n'est pas la même que pour les brosses à dents ou les dispositifs médicaux de classe I en général.

Ne serait-il pas envisageable de mettre en place une AMM pour les dispositifs médicaux implantables avec des critères différents de ceux de l'AMM pour les médicaments ?

En ce qui concerne la certification et la commercialisation des dispositifs médicaux, la réglementation n'est pas nationale mais européenne. C'est la directive européenne, dont la refonte est en cours, qui s'applique. Il ne peut y avoir de spécificité française sur ce point, au risque de retarder la mise sur le marché de certains dispositifs médicaux que nos compatriotes se feraient implanter à l'étranger. Il faut absolument distinguer les dispositifs médicaux implantables des classes IIb et III - stents, sondes cardiaques, prothèses - des autres dispositifs médicaux qui ne présentent pas les mêmes risques pour la santé.

Durant notre déplacement aux Etats-Unis, un professeur de Harvard nous avait exposé plusieurs principes importants. Il est tout à fait possible d'avoir une liste positive de dispositifs médicaux soumis à une exigence renforcée d'essais cliniques préalables, et celle-ci peut être d'autant plus importante que les dispositifs en question n'ont pas un rôle thérapeutique capital. Toutefois, à l'avenir, la possibilité de réaliser des essais cliniques sera grandement limitée par l'évolution de la nature des dispositifs médicaux implantables : ils seront de plus en plus individualisés, interactifs, liés à des médicaments et faits à partir de cellules vivantes, spécifiques à chaque patient.
La leçon à retenir est qu'il est peut être souhaitable de distinguer la lourdeur de l'évaluation et des exigences cliniques en fonction du caractère vital ou non du dispositif : lorsque la vie du patient est en jeu, on peut accepter de renoncer à certaines d'entre elles. En revanche, les obligations en matière de sécurité et d'évaluation doivent être les plus élevées pour les dispositifs médicaux implantables dont l'indication thérapeutique est la plus faible. Ainsi, l'innovation est favorisée et le principe du bénéfice/risque respecté.

Tout cela n'empêche pas d'avoir un suivi clinique national, voire même européen le cas échéant. Il faut toutefois déterminer si celui-ci doit avoir lieu avant ou après la certification, car à l'heure actuelle après celle-ci le seul suivi est celui réalisé par les chirurgiens sur leurs patients de manière plus ou moins régulière.

En effet, mais cela ne permet pas de réaliser un suivi clinique. De plus, si le chirurgien s'aperçoit que l'opération qu'il a réalisée n'a pas les effets escomptés, il peut être tenté de masquer ce fait plutôt que de signaler un incident de matériovigilance.

Et lorsque le chirurgien part à la retraite, le suivi du patient est interrompu et les informations peuvent disparaitre...

Bien que cela ne règle pas tous les problèmes, la mise en place de registres de dispositifs médicaux implantés constituera l'une des propositions de la mission. Il faudra toutefois être réaliste afin que tout cela ne paraisse pas illusoire. La Suède constitue un bon exemple. Serons-nous écoutés par le législateur ? Je ne peux pas l'assurer, mais nous pouvons toujours le préconiser.

En ce qui concerne l'esthétique, je trouve que les travaux de la mission vont dans la bonne direction et ont d'ores et déjà permis de réaliser plusieurs constats pertinents.

Il est très difficile de faire la distinction entre les actes purement esthétiques et ceux devant être effectués par un médecin, comme le montre l'exemple de l'épilation à la lumière pulsée, qui peut être réalisée par les esthéticiennes, contrairement à l'épilation au laser. Où placer le curseur, le critère légal entre ces deux pratiques ?

Comme il nous l'a été expliqué, il faut prendre comme base la puissance des appareils.

Le bronzage peut-il être un traitement médical prescrit par un médecin ?

Les UV et le bronzage relèvent du champ de l'esthétique commerciale, tandis que le laser est bel et bien un outil de traitement médical.

Il me semble que des médecins prescrivent des UV pour traiter certaines formes d'acné importantes.

Il existe effectivement quelques indications cliniques, comme les psoriasis, mais le traitement doit être réalisé par un médecin.

Un projet de décret sur les cabines de bronzage est en préparation. Une meilleure réglementation est indispensable, car le nombre de cancers de la peau a été multiplié par trois depuis les années 1980. Il y aurait 10 000 nouveaux cas de mélanomes chaque année. C'est un véritable problème de santé publique.

Nous avons entendu un dermatologue, médecin spécialiste le mieux placé pour se prononcer sur les dangers des UV.

Le dermatologue détecte les mélanomes puis oriente son patient vers un cancérologue.

Il ne faut pas oublier que les UV dont nous parlons, ceux des cabines de bronzage, sont différents de ceux du soleil et souvent plus dangereux.

Les esthéticiennes préconisent parfois de réaliser des séances de bronzage en cabine avant d'aller à la plage pour préparer la peau au soleil.

Elle est très pratiquée en Suède ; elle l'est également à l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) pour préparer les sportifs au décalage horaire.

Ce n'est pas prouvé médicalement.
Sur le fond, il faut s'assurer que les préconisations du rapport ne pénalisent pas l'innovation et ne fragilisent pas des filières qui peuvent être à l'origine de plusieurs milliers d'emplois. Ces questions doivent rester présentes à l'esprit, sans bien sûr laisser au second plan la santé publique. Il faut trouver la juste articulation entre ces impératifs et développer, par la mesure du rapport entre risque et bénéfice, les incitations nécessaires au développement du secteur.

C'est le sens même de notre travail : veiller à l'équilibre des propositions que nous serons amenés à formuler.