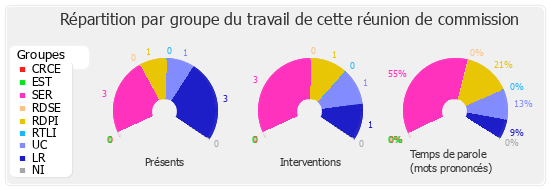Commission des affaires européennes
Réunion du 7 décembre 2021 à 14h00
Sommaire
La réunion

Monsieur le commissaire, nous sommes heureux de vous accueillir pour vous permettre de nous présenter les projets que vous portez au nom de la Commission européenne, d'autant que la France s'apprête à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne.
Certains de ses principes sont contestés par des États membres ; aussi, vous nous indiquerez comment la Commission entend réagir.

Monsieur le commissaire, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez en charge la justice et la protection des consommateurs, ce qui vous place à double titre au coeur du projet européen, fondé à la fois sur le partage de valeurs communes et sur le marché unique.
Sur le volet des valeurs communes, vous avez reçu la mission délicate de garantir la défense de l'État de droit, alors même que la pandémie oblige à de nombreuses restrictions de libertés et que certains États membres prennent leurs distances avec les principes d'indépendance de la justice ou de pluralisme des médias.
En juillet dernier, dans son second rapport sur l'État de droit, la Commission n'a pu que constater l'aggravation de la situation, malgré les condamnations de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Notre commission des affaires européennes a adopté au printemps dernier un rapport sur ce sujet : elle y constate que l'Union européenne semble malheureusement bien démunie face à ces dérives et se heurte à l'inefficacité des mécanismes de suivi et de sanction prévus par les traités.
Les condamnations sous astreinte prononcées par la Cour ne suffisent apparemment pas à infléchir le cours des choses. En octobre, le tribunal constitutionnel polonais a même été jusqu'à écarter l'application de certains articles des traités européens jugés contraires à la Constitution polonaise. Pensez-vous qu'avec le nouveau mécanisme de conditionnalité « État de droit » qui a été mis en place lors de l'adoption du plan de relance européen - le président Larcher et moi-même avons évoqué ce sujet avec la présidente von der Leyen lors de notre entrevue la semaine dernière -, et devrait bientôt être consolidé par une décision de la CJUE, l'Union s'est enfin dotée d'un outil qui pourrait changer la donne ?
Nous aimerions aussi vous interroger sur le Parquet européen, dont le Sénat a activement accompagné la mise en place. Alors qu'il fonctionne depuis à peine six mois, est-il possible d'en tirer un premier bilan ? Certains projettent déjà d'étendre ses compétences aux infractions environnementales les plus graves, et non plus au terrorisme transfrontière, comme envisagé. Ce projet nous inquiète, car il nous semble précipité : pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous serions aussi intéressés de vous entendre sur plusieurs autres sujets : la mise en place du devoir de vigilance pour des entreprises, la perspective d'un possible code européen des affaires pour simplifier les règles du jeu pour les entreprises actives sur notre continent, les défis du numérique, qu'il s'agisse de l'application effective du règlement général sur la protection des données (RGPD), de la protection des consommateurs en ligne prévue par l'acte sur les services numériques - le Digital Services Act (DSA) -, ou encore de la régulation éthique de l'intelligence artificielle.
Nous espérons enfin que vous pourrez évoquer devant nous l'avancement des propositions législatives en cours - sécurité des produits, commercialisation à distance de services financiers, etc. -, mais aussi le contenu et le calendrier des prochaines initiatives législatives de la Commission, notamment en matière de liberté des médias, de transmission des procédures pénales entre États membres, ou de reconnaissance de la parentalité entre les États membres.
Je suis heureux de pouvoir échanger avec vous sur les thèmes prioritaires du portefeuille dont j'ai la charge au sein de la Commission européenne : le respect de l'État de droit ; la numérisation dans le domaine de la justice ; la protection des données ; le certificat covid numérique européen.
Quelques mots sur l'État de droit.
L'Union européenne est avant tout une communauté de valeurs fondamentales, en particulier le respect de l'État de droit, qui est inscrit à l'article 2 de son traité et que nous avons cru acquis. Au cours des dernières années, malheureusement, il est apparu que ce n'était pas le cas dans certains États membres, et cela s'est même aggravé. En réaction, nous avons développé un certain nombre d'instruments, alors que nous avions sans doute trop longtemps été préoccupés par la convergence économique et sociale, la mise en place du semestre européen et le suivi budgétaire.
Premier instrument : le rapport annuel sur l'État de droit, publié pour la première fois le 30 septembre 2020, sa deuxième édition l'ayant été le 20 juillet dernier. Nous attendons des réponses des États membres sur les remarques qui y sont formulées, sur certains projets de réformes, l'objectif étant d'améliorer la situation de l'État de droit dans l'Union, à tout le moins d'éviter toute régression. Mes services, avec d'autres, préparent la troisième édition du rapport, qui sera publiée en juillet prochain.
Ce rapport se veut avant tout préventif : il vise essentiellement à éviter que des difficultés n'émergent et ne s'aggravent, et à installer une culture de l'État de droit. Cette évaluation se base sur une multitude de consultations. Nous en débattons avec les ministres au sein du Conseil Affaires générales, au sein du Conseil Justice, au Parlement européen, mais il est important que les États membres et leurs assemblées parlementaires se saisissent également de ce sujet, précisément pour développer une culture de l'État de droit. D'ailleurs, une large majorité d'entre eux, sur la base de nos observations, ont à coeur d'engager des réformes pour améliorer la situation.
En tant que gardienne des traités, la Commission doit parfois se montrer plus coercitive, notamment en lançant des procédures d'infraction contre des États membres pour protéger un certain nombre de principes, en particulier l'indépendance de la justice, qui conditionne le respect des valeurs inscrites à l'article 2 et la protection de la démocratie et des droits fondamentaux.
Ainsi, la Commission a lancé un certain nombre de procédures contre la Pologne au regard du respect de l'indépendance de la justice. De fait, ce pays n'a pas pleinement mis en oeuvre les récentes décisions de la CJUE en la matière, même si l'on note des évolutions, notamment en ce qui concerne la retraite des magistrats polonais. Nous avons d'ailleurs demandé à la CJUE d'infliger des sanctions financières à la Pologne pour assurer le respect d'une ordonnance de référé relative au régime disciplinaire applicable aux juges. Ainsi, le 27 octobre dernier, la CJUE a infligé à la Pologne 1 million d'euros d'astreinte journalière tant que cette ordonnance du 14 juillet 2021 ne sera pas pleinement exécutée.
La CJUE nous a donné à plusieurs reprises raison dans ces différents recours.
Autre voie d'action, lorsque les atteintes à l'État de droit prennent de l'importance : saisir le Conseil. La précédente Commission avait engagé une procédure au titre de l'article 7 du traité à l'encontre de la Pologne, et le Parlement européen a fait de même en 2018 à l'encontre de la Hongrie. Ces deux procédures sont en cours et contribuent à maintenir la pression politique sur ces États membres. Je crois qu'il est dans les intentions de la présidence française de poursuivre cette démarche.
Dernier outil en date dont dispose la Commission : le règlement sur la conditionnalité « État de droit », qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Ce règlement vise de possibles violations de l'État de droit, mais aussi des violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Nous sommes en train d'identifier les cas litigieux, et nous avons ainsi demandé des clarifications à la Hongrie sur des réformes en matière de lutte contre la corruption et à la Pologne sur l'indépendance de sa justice. Les informations recueillies détermineront les suites que donnera le Conseil aux procédures engagées. Au préalable, il importe de connaître la décision définitive de la CJUE sur le recours introduit par la Hongrie et la Pologne à l'encontre du règlement : l'avocat général vient de se prononcer pour son rejet.
Nous avons fixé des lignes directrices pour garantir une application équitable et objective de ce mécanisme à tous les États membres et pour protéger les citoyens bénéficiaires ultimes. Par exemple, si le versement de fonds devait être suspendu, il ne faudrait pas pénaliser les agriculteurs bénéficiaires d'un certain nombre de subventions agricoles ou des associations chargées de promouvoir l'État de droit.
Nous avons également déployé d'autres instruments pour protéger l'État de droit dans l'Union. Dans le cadre du semestre européen, cycle annuel d'alignement des politiques économiques et budgétaires, la Commission a formulé plusieurs recommandations par pays, devenues recommandations du Conseil, sur les réformes conduites par certains États membres, en particulier dans le domaine de la justice.
La protection de l'État de droit passe aussi par les plans nationaux de reprise et de résilience, d'un montant compris entre 670 et 700 milliards d'euros, selon le mode de calcul retenu. Nous demandons aux États membres de consacrer 30 % de leurs investissements à la transition écologique, dans le cadre du Pacte Vert ou Green Deal, 20 % au moins à la transition numérique, mais aussi de mettre en oeuvre les réformes spécifiques qui ont été recommandées à chaque État dans le cadre du semestre européen.
Ce traitement est parfaitement équitable puisque la plupart des plans prévoient des conditions très strictes. Par exemple, l'Italie est en train de mener un vaste chantier de réformes dans le domaine de la justice selon des conditions fixées dans le plan.
Une large part du rapport annuel est consacrée à la pandémie. Nous sommes conscients que des mesures nécessaires et urgentes s'imposaient au début de la crise, mais nous souhaitons qu'un contrôle tant parlementaire que judiciaire s'impose sur les décisions prises, qui devaient être limitées dans le temps, nécessaires et proportionnelles à l'objectif recherché.
Toutefois, la pandémie a mis à mal la résilience de nos systèmes judiciaires : certains citoyens ont été empêchés d'exercer leurs droits et des retards ont été constatés, ce qui nous a conduits à accélérer la numérisation de la justice. Un effort important a été mené afin que le numérique rende la justice plus accessible, plus efficace et plus résiliente face aux crises futures. Je salue à cet égard le programme ambitieux de transformation numérique de la justice, mené par le gouvernement français. C'est l'une des priorités de la Commission européenne, et je me réjouis que plusieurs États membres prennent la même direction.
Sur mon initiative, la Commission a adopté un paquet législatif ambitieux visant à moderniser l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne.
Nous entendons introduire le canal numérique comme moyen de communication privilégié entre les entreprises, les citoyens et les autorités compétentes, dans le domaine des procédures civiles, commerciales et pénales transfrontalières.
Nous souhaitons également faciliter l'échange d'informations en matière de lutte contre le terrorisme, notamment entre les États membres et Eurojust, l'agence située aux Pays-Bas facilitant les coopérations transfrontalières. Les équipes communes d'enquête, à l'instar de celle qui a été créée entre la France et la Belgique après les attentats du 13 novembre 2015, constituent un autre outil efficace.
Notre proposition législative vise à créer une plateforme de collaboration informatique sécurisée facilitant les échanges entre les États membres, qui doivent également développer leurs propres outils législatifs dans ce domaine. Je compte sur la présidence française à partir du 1er janvier 2022 pour progresser rapidement sur ces questions.
Monsieur le président, vous avez évoqué le sujet de la protection des données, consacré par une charte au sein du RGPD. Ce règlement et la directive relative à la protection des données en matière de police et de justice offrent une protection effective. Trois ans après son entrée en vigueur, la mise en oeuvre de ce règlement est un succès : il a permis aux personnes concernées d'accéder au contrôle de leurs données et de faire valoir leurs droits auprès des autorités nationales compétentes, telles que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en France.
Le règlement a fait montre de sa capacité d'adaptation face à la situation exceptionnelle née de l'épidémie de covid-19. Pas moins de 740 millions de certificats européens, qui constituent désormais un standard mondial, ont été émis. Nous sommes en lien avec cinquante-deux États sur les cinq continents, de la Nouvelle-Zélande au Togo, en passant par le Salvador.
Notre priorité consiste à développer un cadre juridique harmonieux pour l'application du RGPD. Le dialogue avec les États membres doit être poursuivi. Toutefois, nous sommes parfois contraints d'introduire des recours en manquement devant la CJUE. Nous avons ainsi agi contre une législation visant la protection des données en Pologne et en Hongrie, mais aussi contre l'indépendance insuffisante accordée à l'autorité belge de protection des données. Nous intervenons partout à travers l'Union européenne.
À cet égard, il est primordial que les autorités nationales utilisent pleinement les pouvoirs qui leur ont été conférés par le règlement général. Les amendes infligées à WhatsApp et Amazon, pour un montant d'un milliard d'euros, sont emblématiques. Toutefois, des améliorations sont toujours possibles, comme nous l'avions déjà signalé dans le rapport d'évaluation du règlement général, publié en juin 2020.
Nous devons également veiller à la diffusion et à l'application de la protection des données dans l'ensemble des politiques de l'Union européenne. Cela concerne notamment la régulation de l'intelligence artificielle et la valorisation de l'usage des données. Nous vérifions ainsi dans quelles conditions les données peuvent être échangées avec le Japon, notre premier partenaire en la matière, le Royaume-Uni après le Brexit, ou encore avec la Corée du Sud. En outre, nous travaillons à la rédaction d'une nouvelle décision d'adéquation avec les États-Unis, car le Privacy Shield a été invalidé par la CJUE.
Pour ce qui concerne le certificat covid-UE, nous avons déposé une nouvelle proposition visant à faciliter la libre circulation au sein de l'Union européenne, laquelle tient compte de l'accélération de la vaccination depuis la dernière mise à jour des règles de voyage avant l'été. Nous souhaitons que le rappel de vaccination - la troisième dose - puisse être administré entre six et neuf mois à l'ensemble des citoyens ; à défaut, le certificat ne sera plus valide. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er février. Nous ne sommes pas sortis de la pandémie et les mesures de protection telles que la vaccination et le respect des gestes barrières doivent être maintenues. Les vaccins ne sauraient tout résoudre à eux seuls, même s'ils sont l'arme la plus utile dans la lutte contre la covid-19. Le certificat se fondera sur la situation individuelle de chaque personne. Si la situation devait s'aggraver, des mesures complémentaires pourraient être prises.
La libre circulation des personnes, qui représente un droit fondamental, suppose de coordonner les règles applicables aux voyages entre les États membres. Bien sûr, les gouvernements peuvent prendre des décisions spécifiques en fonction de la situation de chaque pays.
Par ailleurs, nous nous réjouissons de la création du Parquet européen le 1er juin dernier, lequel fonctionne déjà de manière très efficace : tous les procureurs délégués ont été désignés, et pas moins de 350 dossiers d'enquête ont été ouverts, ce qui pourrait aboutir au recouvrement de 4,5 milliards d'euros, mais nous devons être prudents et vérifier les sommes disponibles à l'issue des procédures. Je ne suis pas opposé à l'extension des compétences du Parquet européen, notamment en matière de terrorisme ou d'atteintes à l'environnement. Cependant, une évaluation de son efficacité est nécessaire au préalable.
Pour revenir au sujet de l'État de droit, nous sommes inquiets quant aux décisions du tribunal constitutionnel polonais, dont l'indépendance avait déjà fait l'objet de la procédure de l'article 7 du traité pour manquement à l'État de droit. Nous comptons en outre introduire des recours devant la CJUE, au regard de la primauté du droit européen sur la législation nationale et du caractère contraignant des décisions de la Cour, qui dispose d'une compétence exclusive d'interprétation du droit européen. Nous avions déjà réagi à des décisions des cours constitutionnelles allemande et roumaine, mais, en Pologne, la justice souffre d'un manque d'indépendance. C'est là une différence fondamentale.
Comme vous le savez, Thierry Breton et moi-même avons engagé l'initiative relative au devoir de vigilance des entreprises multinationales, en matière de protection de l'environnement et de respect des droits humains. J'espère que nous pourrons présenter cette proposition, qui fait écho aux développements de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) en France, lors du premier conseil de l'Union européenne consacré à la compétitivité, au mois de février 2022. Sont également prévus une révision de la directive relative au crédit à la consommation, ainsi que le passage à un règlement pour la sécurité des produits. Nous entendons apporter une meilleure information aux consommateurs en matière d'obsolescence programmée ou de droit à la réparation des produits.
Enfin, le rapport relatif à l'État de droit fait mention de la crise que traversent les médias, qui souffrent d'une atteinte à leur liberté et à leur indépendance. De nombreux journalistes souffrent de pressions - comme les associations ou les représentants de la société civile d'ailleurs - et la pluralité des médias est remise en cause. Nous proposerons l'année prochaine un acte législatif visant à répondre à ces problèmes.

Dans votre rapport spécifique à la France, vous dénoncez l'adoption de procédures accélérées pour le vote de lois sensibles au Parlement. Cette mention nous va droit au coeur.
Le concept de l'État de droit est en constante évolution. Il ne saurait se résumer au seul respect du droit européen ; celui-ci constitue toutefois un préalable nécessaire. À cet égard, les contestations des décisions de la CJUE, notamment en Pologne, sont préoccupantes. Par ailleurs, comment percevez-vous le débat autour du bouclier constitutionnel en France ?
Vous avez évoqué la procédure de l'article 7 du traité pour manquement à l'État de droit. Toutefois, même lorsque la procédure est engagée, un accord politique au sein du Conseil est quasiment impossible à obtenir pour voter des sanctions, sinon au prix de marchandages sur d'autres sujets. Dans ces conditions, comment analysez-vous l'efficacité de l'article 7 ?
Des outils sont-ils à votre disposition pour suivre le respect de l'État de droit et l'utilisation des subventions accordées par l'Union européenne à des partenaires étrangers ?
Enfin, je tiens à souligner que, s'ils sont identiques sur la forme, les certificats covid-UE ne sont pas respectés d'un pays à l'autre, compte tenu des exigences divergentes en matière de vaccination. Les Européens se rendent compte de l'imperfection de la situation.

Sur quels fondements la Commission européenne s'occupe-t-elle de la question de la numérisation de la justice ? Quelle plus-value pourrait-elle apporter sur ce point par rapport aux actions possibles au niveau national ?
Par ailleurs, j'ai cru vous entendre dire que la primauté du droit européen s'appliquait également aux questions constitutionnelles. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Plusieurs signaux de tension s'observent au sein de l'Union européenne. Ainsi, dix pays ont écrit à la présidente de la Commission européenne pour solliciter le financement par l'Europe de la construction de murs à leurs frontières, ce qui est manifestement contraire au droit européen. Nous croulons en outre en France, dans la précampagne présidentielle, sous les propositions de bouclier constitutionnel. L'arrêt de la CJUE sur le temps de travail des militaires a constitué par ailleurs une véritable déflagration dans le ciel politique français. N'y aurait-il pas une forme de régulation ou de dialogue à inventer entre le système judiciaire européen et les opinions publiques nationales, ou à tout le moins les parlements nationaux - qui ont le sentiment d'être dépossédés d'une partie de leurs attributions par le fait que les juges créent de la norme ?
Si l'État de droit me paraît solide en Europe, je crains pour l'Europe elle-même au vu de toutes ces tensions, dont je redoute qu'elles ne s'exaspèrent.

Les dérogations aux règles européennes du droit d'asile proposées par la Commission européenne le 1er décembre aux frontières de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie ne sont-elles pas à la limite du respect de l'État de droit tel qu'il a été établi par les traités ? Elles comprennent en effet une extension des délais d'enregistrement des demandes d'asile - de trois à quatre semaines -, la possibilité de traiter toutes les demandes d'asile, y compris la phase de recours, dans un délai maximal de seize semaines, la possibilité pour les États concernés de créer des campements ou des hébergements temporaires ainsi que l'utilisation de procédures nationales simplifiées pour accélérer le retour des migrants déboutés de l'asile.
Par ailleurs, pourquoi la Commission européenne tarde-t-elle à présenter un projet de directive sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales ? En effet, alors que le projet de directive sur ce sujet a été reporté à février ou mars 2022, le programme de travail de la Commission pour 2022 ne semble pas en faire mention. Y a-t-il des divergences au sein de la Commission sur ce sujet ? Le niveau de responsabilité attendu de la part des entreprises ou le niveau de sanction prévu posent-t-ils question ? Pourriez-vous vous engager sur un calendrier prévisionnel permettant l'examen de cette proposition de directive dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne ?
La définition de la notion d'État de droit que nous avons employée dans le rapport sur l'État du droit dans l'Union a pour références l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux sur le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que la jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l'Homme, et plusieurs décisions du Conseil de l'Europe. Nous demandons en outre aux États membres de consulter la commission de Venise pour qu'elle s'assure du respect des standards européens dans leurs projets de réforme importants.
Si, en Pologne, c'est l'indépendance de la justice qui est en cause de manière systémique, les débats sur la primauté du droit européen sur les droits nationaux qui s'ouvrent dans d'autres situations portent plutôt sur certaines décisions d'institutions - par exemple, la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe. Nous n'en sommes pas moins très attentifs à cette question.
Nous avons rappelé à plusieurs reprises cette primauté du droit européen, qui vaut aussi - j'y insiste - à l'égard des constitutions nationales. De même, le caractère contraignant des décisions de la Cour de justice s'impose aux autorités nationales, y compris les cours et tribunaux, cours suprêmes et cours constitutionnelles. S'il en allait autrement, nous travaillerions « à la carte » et pourrions à tout moment décider de nous éloigner de telle ou telle politique européenne, ce qui contreviendrait au principe de l'application uniforme du droit de l'Union européenne sur l'ensemble du territoire européen ainsi qu'au principe de confiance entre les États membres.
Nous réagissons aux décisions prises par les autorités nationales, moins aux propos tenus par les candidats aux élections. Néanmoins, chaque fois que l'on envisage de mettre de côté le droit européen ou la jurisprudence de la Cour de justice, nous nous inquiétons. Chaque fois que cela s'est traduit dans une décision, nous avons réagi. Dans le cas allemand, la procédure est désormais terminée. À la suite de la mise en demeure que nous avons envoyée au gouvernement allemand, ce dernier s'est engagé clairement à respecter la primauté du droit européen. De plus, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe n'a eu aucun impact sur la politique monétaire de la BCE ou de la Bundesbank. Nous restons toutefois vigilants.
Les tensions que vous avez évoquées sont effectivement préoccupantes. Comme l'a souligné la présidente de la Commission européenne, le rôle de la Commission n'est pas de construire des murs, mais des ponts. Nous sommes désireux néanmoins de protéger les frontières extérieures de l'Union. Nous avons d'ailleurs proposé que des agences européennes comme Frontex participent à des démarches en ce sens et soutenu le déploiement d'équipements numériques.
Pour réguler la situation à l'avenir, je crois plutôt au dialogue. Je me suis ainsi rendu à Budapest et à Varsovie dans le cadre de nos dialogues avec les États membres concernés. Les parlements nationaux doivent aussi échanger entre eux et avec le Parlement européen. Je propose également que les cours organisent ce même dialogue. Des contacts sont déjà noués entre les cours suprêmes et constitutionnelles et les deux cours de Luxembourg et de Strasbourg. En outre, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État organiseront des réunions entre les présidents des juridictions les plus élevées des différents États membres.
Ce dialogue est important pour évoquer les modalités de traitement des questions préjudicielles par la Cour de justice et sa compréhension des questions qui lui sont soumises. Nous continuerons par ailleurs à tenter de faire respecter nos principes fondamentaux, dans la ligne du rôle de la Commission, gardienne des traités.
Nous sommes attachés à ce que la mise en oeuvre de l'article 7 se poursuive à travers les deux procédures en cours concernant la Hongrie et la Pologne, car cela constitue une forte pression politique. Il est néanmoins difficile d'atteindre une majorité des quatre cinquièmes pour décider d'un risque de violation de l'État de droit, et plus encore d'obtenir l'unanimité pour décider de la suspension des droits de vote des deux membres concernés. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la conditionnalité portant sur les outils financiers de l'Union a pu être mise en place, car elle requiert une majorité qualifiée au Conseil de l'Union européenne. Il s'agira donc d'une solution plus simple à mettre en oeuvre. De plus, la pression budgétaire et financière a toujours un impact sur les comportements.
Nous travaillons beaucoup sur la question des subventions étrangères, à travers notamment des outils comme l'Office européen de la lutte antifraude (OLAF). En outre, le Parquet européen conclura de plus en plus d'accords avec des pays tiers pour suivre la gestion des programmes financiers. Il est vrai toutefois que les moyens d'action varient selon que l'on se trouve en dehors ou à l'intérieur de l'Union.
Les États membres ont été soucieux de bénéficier de financements dans le cadre de la numérisation des services publics en général, et de la justice en particulier. D'après les dernières évaluations, 1,6 milliard d'euros sont prévus dans les plans nationaux sur cette question. Nous déployons en outre des formations, visant à former les praticiens du droit au droit européen et aux nouveaux outils technologiques, et mettons en place des outils transfrontaliers comme e-Justice Communication via Online Data Exchange (e-CODEX). De plus, trois propositions législatives tendant à renforcer les échanges dans ce domaine seront soumises au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne. De manière générale, nous devons développer la numérisation sur le plan national comme à l'échelle européenne, à travers des plateformes ou via de nouveaux investissements.
S'agissant du devoir de vigilance des entreprises, il existe très peu de textes en Europe. Nous proposons une initiative horizontale couvrant l'ensemble des secteurs sur l'ensemble du continent. Un important travail de sensibilisation est requis pour convaincre tous les États membres d'aller dans cette voie. Les études d'impact que nous avons menées ont entraîné effectivement un certain retard dans l'élaboration du projet de directive. Nous essayons d'être prêts pour le premier Conseil « compétitivité » de la présidence française, la proposition devant être adoptée par la Commission en février 2022.
Il existe évidemment des points de vue différents sur ce sujet. L'essentiel est de parvenir à une solution ambitieuse sur la capacité des entreprises à prendre en compte les risques que nous connaissons pour l'environnement et les droits humains. Cette initiative doit d'ailleurs rester concomitante de celle de Nicolas Schmit portant sur le travail décent.
Dans le cadre de la proposition de la Commission d'utiliser le paragraphe 3 de l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant les possibilités de dérogation aux dispositifs existants en matière d'asile, nous avons bien rappelé que le droit d'asile était garanti, qu'il n'y aurait pas de refoulement et que la Charte des droits fondamentaux devait être respectée.
Je rappelle toutefois qu'il ne s'agit pas d'une crise migratoire classique, mais d'un trafic d'êtres humains organisé par un dictateur pour faire pression sur l'Union européenne, en réponse aux sanctions que nous avons imposées au régime de Minsk. La Commission s'est efforcée de stopper ce flux, en menaçant notamment les compagnies aériennes qui y participaient de ne plus pouvoir opérer sur le territoire de l'Union. Nous continuerons à oeuvrer en ce sens, tout en restant vigilants sur la situation des personnes victimes de ce trafic. Il faut s'assurer notamment de garder un accès ouvert aux frontières, notamment de la Pologne, aux organisations humanitaires et aux journalistes.

Je souhaite évoquer le partenariat oriental et les contrats d'association souscrits avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, qui souhaitaient entrer dans l'Union, mais dont l'adhésion n'a pas été jugée prioritaire.
Pour m'être rendue dans certains pays du Partenariat oriental, au nom de la commission des affaires européennes, je puis dire que, en règle générale, les normes relatives à l'État de droit requises par les contrats d'association sont respectées. Cependant, force est de constater que les réformes de la justice s'y traduisent par des régressions démocratiques - je pense notamment à la Géorgie.
Quand on voit comment la Chine ou la Russie ont repris pied dans la région, jusqu'à compromettre le poids de la puissance européenne, il faut plus que jamais que nous soignions la politique de voisinage, essentielle pour nos équilibres géostratégiques.
Au sein de la commission des affaires européennes, je suis également chargée, avec mes collègues Pascal Allizard et André Gattolin, de suivre les relations avec la Chine. Après un premier rapport sur les nouvelles routes de la soie, il y a quatre ans, nous avons, en septembre dernier, rendu un rapport sur la puissance chinoise en Europe, parce qu'il nous semblait important de faire le point. Si notre premier rapport avait reçu un accueil très silencieux de l'Europe, le second a bénéficié d'une plus large audience, ce dont nous sommes satisfaits.
Ce dernier s'articule autour de quatre axes : comment faire face aux moyens mis en oeuvre par la Chine pour déployer sa puissance en Europe ? Comment réagir à l'avance technologique prise par ce pays ? Comment trouver le chemin d'une relation commerciale équitable avec lui ? Enfin, comment définir une stratégie géopolitique répondant aux enjeux du XXIè siècle chinois ?
Dans le monde actuel, instable et dangereux, l'Union européenne voit la Chine multiplier les marqueurs de puissance, au point de devenir probablement plus vite qu'escompté la prochaine puissance mondiale. Dans le même temps, elle assiste à la poursuite de la politique égoïste américaine, plus soucieuse de l'America First que de la stabilité mondiale. L'Union européenne doit s'affirmer comme la puissance stratégique et stabilisatrice qu'elle doit être. Pour cela, elle doit notamment développer son régime de sanctions politiques et économiques et envisager cet outil de puissance géo-économique sous toutes ses facettes : les sanctions, le droit extraterritorial européen, le contrôle des exportations, notamment pour ce qui concerne les technologies de rupture, la lutte contre la corruption et le contrôle des investissements.
Monsieur le commissaire, vous avez récemment donné à la justice européenne une dimension d'autorité et d'efficacité, attendue depuis de nombreuses années, par votre fermeté envers la Pologne. Que pensez-vous du développement des sanctions politiques et économiques que je viens d'évoquer pour servir la puissance géo-économique européenne ?

Je suis très heureuse que cette audition ait lieu aujourd'hui, parce qu'il se trouve que le groupe d'amitié France-Balkans occidentaux, que je préside, a reçu ce matin Mme Majlinda Bregu, secrétaire générale du Conseil de coopération régionale pour les Balkans, lequel a tenu sa conférence annuelle hier à Paris. L'État de droit fait bien évidemment partie des sujets qui ont été évoqués à l'occasion de la conférence.
Vous avez parlé de votre préférence pour les ponts plutôt que pour les murs. Je partage pleinement cette idée.
Comment la Commission européenne travaille-t-elle avec le Conseil de coopération régionale pour les Balkans ? Quel est votre regard sur l'élargissement aux pays de cette zone ? Au sein de la commission des affaires européennes, Didier Marie et moi-même avons reçu pour mission d'organiser un certain nombre d'auditions sur ce sujet.

Monsieur le commissaire, c'est toujours pour moi un très grand bonheur d'écouter vos réponses limpides et précises.
Je veux souligner la pertinence de votre réflexion concernant la Biélorussie. Lorsque voilà trois mois j'ai dit au Conseil de l'Europe qu'il fallait vraisemblablement créer un crime de « traite humaine de masse », on m'a regardé un peu de travers...
Je veux revenir sur la gestion de l'État de droit en Europe, dont on sent bien que ce n'est pas la base fondamentale de l'adhésion européenne. L'Union européenne s'appuie beaucoup sur les institutions du Conseil de l'Europe, sur la Commission de Venise et sur la Cour européenne des droits de l'homme.
Je me suis beaucoup préoccupé du respect d'un droit à mon sens fondamental : celui de la liberté académique. L'Europe s'est aussi construite autour de ses universités, de leur autonomie, de la liberté de recherche et de la liberté de pensée. Or, en ce domaine, on a l'impression que les instruments juridiques dont dispose l'Union sont assez faibles. Au-delà de l'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on a beaucoup de mal, comme je le disais encore hier au parlementaire européen Christian Heller, à faire entrer cette notion dans les textes et traités.
Or, quand il a fallu juger de la fermeture de l'université d'Europe centrale en Hongrie, la CJUE a dû recourir à un succédané d'accord du GATT, quand le Conseil de l'Europe, dans sa gêne, a évoqué un simple avatar de la liberté d'expression, alors qu'il s'agit de bien autre chose.
Je déposerai très prochainement, devant la commission des affaires européennes, une proposition de résolution pour une véritable reconnaissance et mise en oeuvre de la liberté académique au niveau européen. Si l'Europe, à travers le plan Horizon Europe, a le premier plan de financement public de la recherche au monde, il a fallu livrer une bataille incroyable pour faire entrer, dans le règlement, la notion de « liberté académique ». Il y va de la protection de nos valeurs européennes et de la nature de la construction démocratique que nous voulons.
Notre travail sur l'État de droit à travers le rapport annuel, vise bien entendu à vérifier la situation dans les 27 États membres. Il vise aussi à asseoir notre crédibilité lorsque nous débattons, en dehors du territoire de l'Union, de l'État de droit, de la démocratie, des droits fondamentaux.
J'ai récemment participé à la « Nuit du droit » au Conseil constitutionnel, aux côtés de la candidate à l'élection présidentielle en Biélorussie et du Dr. Mukwege, prix Nobel de la paix qui répare les femmes dans l'est du Congo. Je devais moi-même évoquer l'État de droit dans l'Union. Bien évidemment, par comparaison, le premier réflexe pourrait être de dire que tout va très bien chez nous ! Cependant, nous devons demeurer vigilants sur le respect de l'État de droit. Si les « pères fondateurs de l'Union européenne » avaient déjà conçu la construction européenne autour des valeurs, nous avons fort probablement trop souvent considéré que c'était un acquis, que les régressions n'étaient pas possibles et qu'un État qui entrait dans l'Union respectait ces valeurs. Or on a malheureusement vu, ces dernières années, que la régression était tout à fait possible.
J'étais vendredi dernier encore à Ljubljana avec les ministres de la justice des six pays candidats des Balkans. Il est évident que nous disposons, dans notre stratégie relative à ces pays, de toute une série d'instruments : investissements, travaux avec un certain nombre d'organes chargés de suivre la situation... Quoi qu'il en soit, l'État de droit sera déterminant dans les discussions avec ces pays : nous voulons être certains que, si un jour ces pays entrent dans l'Union, ce soit avec un niveau de respect des valeurs fondatrices de l'Union européenne comparable à celui qui est demandé aux États membres. Nous ne voulons pas avoir à remettre en place des mécanismes comme le mécanisme de coopération et de vérification (CVM) pour la Bulgarie et la Roumanie, ou à connaître de nouveaux retours en arrière.
Comme je l'ai expliqué, les réformes en matière de justice sont des éléments importants. Concernant le Partenariat oriental, un certain nombre d'États, comme la Géorgie ou la Moldavie, ont engagé des réformes encourageantes. Ils doivent les poursuivre et les mettre en oeuvre effectivement pour se rapprocher des standards européens. Nous devons entreprendre la même démarche dans le cadre de la politique de voisinage. Je ne dirai pas que nous avons la même démarche à l'égard de la Chine, mais, j'y insiste, si l'on veut être crédible dans les débats sur la démocratie, les droits de l'Homme et l'État de droit à travers le monde, nous devons d'abord démontrer que nous faisons le travail « à la maison ». Cela ne nous empêche pas de prendre un certain nombre de mesures concrètes relatives à la Chine ou de mener notre propre réflexion sur la place de l'Europe dans le monde.
En matière commerciale, lorsque la commissaire Cecilia Malmström était chargée de cette matière, nous avions mis en place des outils de protection contre des investissements dans des secteurs stratégiques. Cela explique le débat important que nous avons eu avec nos collègues américains sur certains investissements chinois, notamment sur la 5G : en effet, peut-on accepter des investissements dans nos secteurs stratégiques sans vérification, sans protection ?
Vous savez que des sanctions politiques ont déjà été décidées à l'égard de certains responsables russes, dans l'affaire Navalny, mais aussi à l'égard de responsables chinois, s'agissant du travail forcé des Ouïghours au Xinjiang. Ces dernières ont provoqué des sanctions en retour, y compris à l'égard de parlementaires en Europe, lesquelles bloquent d'ailleurs la discussion sur le projet d'accord euro-chinois sur les investissements. On ne peut donc pas dire que nous ne réagissons pas, mais la spécificité européenne consiste à essayer de passer par la voie du dialogue, avec, de temps en temps, des réactions qui doivent être plus fortes.
Nous venons de débattre, au sein de la Commission, sur la façon, pour l'Union européenne, d'être présente dans le monde. Nous essayons très souvent de faire en sorte que les actions de l'Europe et celles des États membres soient regroupées - c'est ce que l'on appelle la « Team Europe », l'équipe européenne. Cependant, à certains endroits du monde, des drapeaux nationaux passent parfois devant le drapeau européen, et nos entreprises sont parfois en compétition sur les marchés internationaux.
Au début de la pandémie, nous nous sommes rendus à Addis-Abeba pour rencontrer la Commission de l'Union africaine. Je peux vous dire que l'Union européenne investit beaucoup plus que la Chine en Afrique, en particulier dans cette partie de l'Afrique. Or, s'il y avait des publicités sur les investissements chinois un peu partout dans la ville, la visibilité européenne était beaucoup moins forte... Il y a peut-être là une réflexion à avoir. Ma collègue Jutta Urpilainen travaille beaucoup sur ce volet du développement.
De temps en temps, nous parvenons à collaborer avec les Chinois. Dans le dernier dialogue entre l'Union européenne et la Chine, mon département a mis en avant l'idée de la sécurité des produits et d'un plan d'action commun, parce que 70 % des produits non sûrs dans l'Union européenne viennent de l'extérieur de celle-ci. Nous avons pu avancer avec la Chine sur un plan d'action sur la sécurité des produits. Je pense que c'est lié à un effet réputationnel - si des produits ne sont pas sûrs, ils seront de plus en plus rejetés par les consommateurs -, mais peut-être aussi à l'émergence d'une classe moyenne en Chine, qui souhaite elle aussi une évolution. Au reste, il ne vous surprendra pas que la Chine ait demandé une réciprocité... Il faut prendre conscience que la relation avec ce pays a changé.
Concernant la liberté académique, je peux également citer l'exemple de la loi hongroise de protection des mineurs, que nous considérons comme discriminatoire à l'égard de la communauté LGBTIQ. La précédente Commission européenne avait déjà pu obtenir une condamnation de la Hongrie en matière notamment de liberté académique. Aux termes de la charte européenne des droits fondamentaux, pour être invoquée, la discrimination doit être caractérisée par le droit européen, et vous savez comme moi que l'Union n'a pas une grande compétence en matière d'éducation... Nous avons donc dû chercher des critères de rattachement dans les règles européennes pour poursuivre la Hongrie. Avec mon collègue Thierry Breton, nous avons considéré que nous pouvions agir sur le fondement de l'atteinte à la libre circulation des livres ainsi que du traitement réservé aux services audiovisuels. Nous pouvions dès lors introduire un avis motivé auprès de la Cour de justice.
Certaines violations créent une sorte de malaise intuitif, mais nous sommes bien obligés de constater le caractère purement national de certaines problématiques lorsque nous ne parvenons pas à les raccrocher à une compétence européenne. Ainsi, pour réagir politiquement à une régression du droit à l'avortement en Pologne, nous devons démontrer que cette réaction se fonde sur le droit européen. Même si on nous le reproche régulièrement, nous sommes tout autant attachés au respect de la primauté du droit européen et des décisions de la Cour qu'à celui des compétences spécifiques des États membres qui ne nous ont pas été transférées.
À cet égard, je comprends votre préoccupation concernant la liberté académique, mais, pour l'instant, nous sommes un peu démunis, l'éducation en tant que telle n'étant pas la première des compétences de l'Union européenne.

Merci beaucoup, monsieur le commissaire, de vos réponses précises. Vous êtes toujours le bienvenu au Sénat.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 15 h 25.