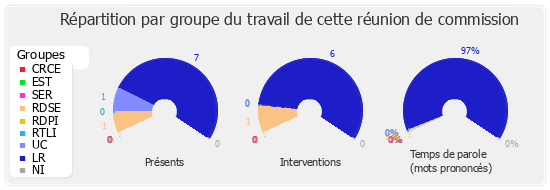Commission des affaires sociales
Réunion du 31 octobre 2007 : 1ère réunion
Sommaire
- Projet de loi de finances pour 2008
- Missions « travail et emploi » et « solidarité insertion et égalité des chances » - audition de m. xavier bertrand ministre du travail des relations sociales et de la solidarité mme valérie létard secrétaire d'etat chargée de la solidarité et m. martin hirsch haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté (voir le dossier)
- Communication
La réunion
Projet de loi de finances pour 2008
Missions « travail et emploi » et « solidarité insertion et égalité des chances » - Audition de M. Xavier Bertrand ministre du travail des relations sociales et de la solidarité Mme Valérie Létard secrétaire d'etat chargée de la solidarité et M. Martin Hirsch haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté

a indiqué que la réflexion de la Mecss porte sur deux séries de questions touchant au financement de la sécurité sociale : avec quelles ressources peut-on alimenter aujourd'hui la protection sociale ? Faut-il fusionner la loi de finances et la loi de financement, dès lors qu'elles sont toutes deux alimentées par des prélèvements obligatoires payés par les mêmes personnes ?
La Mecss a procédé à une trentaine d'auditions pour entendre les représentants des principales institutions de la protection sociale et des corps de contrôle, des hauts fonctionnaires, des universitaires et des praticiens du secteur social. Ces auditions ont laissé apparaître une grande convergence de vues sur chacune des questions posées.
Le premier sujet, celui du financement de la protection sociale, conduit évidemment à évoquer la question de la TVA sociale.
Sa réussite repose sur le fait que son effet potentiellement inflationniste serait compensé par la baisse du coût du travail engendrée par la diminution, ou la disparition, des cotisations patronales et que cette baisse inciterait l'employeur à embaucher. Or, deux phénomènes sont susceptibles de faire dérailler ce scénario et d'entraîner un surcroît d'inflation, sans avoir un effet positif sur l'emploi :
- tout d'abord, le fait que les entreprises françaises affichent aujourd'hui des marges très faibles. Elles auront spontanément tendance à les reconstituer si la diminution des cotisations patronales le leur permet. L'exemple allemand incite de ce point de vue à la plus extrême prudence : alors que leurs entreprises sont dans une situation plus favorable que les nôtres, on constate des effets inflationnistes, même s'ils restent pour l'instant relativement maîtrisés ;
- ensuite, le fait que l'impact de la TVA sociale sur l'emploi est réputé d'autant plus fort que la mesure est ciblée sur les entreprises employant des salariés payés au Smic ou proche du Smic. Or, les allégements Fillon font qu'il n'existe d'ores et déjà quasiment plus de cotisations patronales à ce niveau. Pour ces entreprises, évidemment, la hausse de TVA aura un effet nul en matière d'emplois et leur perte de compétitivité sera immédiate, sauf à créer pour elles des cotisations sociales négatives, ce qui serait mal venu dans le contexte actuel de déficit de la sécurité sociale.
D'autres pistes doivent donc être explorées pour le financement futur de la protection sociale.
La première est celle des « niches sociales ». Deux méthodes sont possibles, sans être d'ailleurs exclusives l'une de l'autre : soit remettre en cause certaines de ces niches, en les taxant dans des conditions normales, comme a commencé de le faire l'Assemblée nationale avec les stock options ; soit appliquer une flat tax, c'est-à-dire taxer faiblement toutes les niches, ou du moins le plus grand nombre possible.
On peut aussi envisager la création de taxes nutritionnelles, ciblées sur des produits alimentaires nocifs, notamment les sodas et sucreries, ainsi que la nouvelle fiscalité écologique, dont il serait légitime qu'une partie au moins soit fléchée vers le financement de l'assurance maladie. S'il fallait choisir de renforcer un prélèvement déjà existant, la CSG présente de réels avantages : elle est simple d'utilisation, bien acceptée par les Français, car clairement identifiée comme allant au financement de la protection sociale, essentiellement de la maladie, et dépourvue d'impact potentiellement dépressif sur l'économie, à la différence de la taxe à la valeur ajoutée.
Puis M. Alain Vasselle, rapporteur, a abordé le second volet de la réflexion de la Mecss portant sur l'évaluation des avantages et des inconvénients d'une budgétisation, totale ou partielle, de la sécurité sociale.
Cette option a notamment été envisagée dans le rapport présenté en 2006 par Alain Lambert et Didier Migaud, qui faisait valoir, à l'appui de cette thèse, que les finances publiques sont « unes », sont alimentées par des prélèvements obligatoires versés par les mêmes contribuables, ménages ou entreprises, et que la cohabitation de deux lois financières est une source de complexité.
Certes, a reconnu le rapporteur, l'existence de deux textes, l'un pour le budget de l'Etat, l'autre pour la sécurité sociale, crée des risques d'incohérence. Mais la réalité du problème est un peu différente : en effet, la sécurité sociale constitue une « variable d'ajustement » commode du budget de l'Etat ; celui-ci n'hésite pas à s'affranchir des contraintes de la Lolf, en ne payant pas ses dettes et en reportant unilatéralement une partie de ses charges sur les organismes de protection sociale. Le sentiment de confusion et de complexité créé par l'existence de deux textes vient d'abord de ce mélange des genres. D'ailleurs, ce jugement est désormais largement partagé, au point de figurer dans un rapport conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales.
Dans ces conditions, on peut régler la principale difficulté suscitée par l'existence de deux textes en obtenant de l'Etat qu'il reconnaisse les obligations contractées à l'égard de la sécurité sociale et en traçant une ligne de séparation plus nette et plus stricte entre les champs couverts par les deux lois financières.
C'est d'ailleurs à cet objectif que participent la création d'un ministère des comptes publics et le remboursement récent de 5,1 milliards d'euros de dette cumulée, au 31 décembre 2006, par l'Etat à l'égard du régime général.
D'autres progrès restent toutefois à réaliser : d'abord, pour que l'Etat rembourse aussi la dette contractée à l'égard des régimes de base autres que le régime général, soit 1,3 milliard d'euros ; ensuite, pour qu'il ne laisse pas se reconstituer une telle dette, préjudiciable au régime général. Or, les arriérés de paiement pour l'exercice 2007 seraient d'environ 1,5 à 2 milliards d'euros et dépasseront les 2 milliards en 2008, si rien n'est fait.
Par ailleurs, la Mecss propose que soit reconnue aux lois de financement une plus grande autonomie en matière de recettes : instauration d'un monopole des lois de financement pour autoriser les exonérations de cotisations et de contributions sociales ; suppression de l'asymétrie existant au profit de la loi de finances, qui conserve une compétence de principe dès lors qu'une fraction, même minime, d'une ressource reste attribuée au budget de l'Etat, alors que la loi de financement n'a de compétence sur une recette que si celle-ci est intégralement affectée à la sécurité sociale. La logique voudrait que l'une ou l'autre loi soit compétente lorsque plus de 50 % de la ressource revient soit à l'Etat, soit à la sécurité sociale.
Parmi les nombreux arguments qui militent contre la fusion ou contre la budgétisation, même partielle, de la sécurité sociale, l'un paraît plus particulièrement convaincant : le fait qu'on y perdrait les avantages tirés du pilotage de la sécurité sociale par des soldes individualisés, un pour chaque branche.
La gestion par les soldes non seulement facilite le repérage des origines du déficit, mais elle a aussi une fonction pédagogique essentielle : d'abord, parce qu'elle confronte des recettes et des dépenses, ce qui rend plus acceptable par le cotisant ou le contribuable l'effort qu'on lui demande ; ensuite, parce qu'elle donne aux gestionnaires, notamment l'assurance maladie, un instrument essentiel de négociation à l'égard des professionnels de santé en montrant les limites de la ressource face à une dépense potentiellement dynamique.
A ces arguments, s'en ajoute un autre, subsidiaire peut-être, mais qui a son importance : la budgétisation entraînerait la disparition de la participation des partenaires sociaux, ce qui n'est pas souhaitable.
Si la fusion ou la budgétisation sont donc de « fausses bonnes » idées, il n'est pas douteux que les instruments offerts par les lois de finances et les lois de financement pourraient être mieux coordonnés et plus performants.
Le Parlement pourrait ainsi légitimement réclamer un document de politique transversale ou un « Jaune » budgétaire consacré à la politique familiale, pour laquelle il ne dispose d'aucune vision d'ensemble. De même, les finances sociales doivent se voir accorder plus de place dans le débat d'orientation qui se tient traditionnellement au début de l'été et qui réserve au budget de l'Etat l'essentiel de la réflexion.
D'une façon générale, les commissions des affaires sociales devraient se montrer plus présentes dans la discussion de la première partie du projet de loi de finances et dans celle du collectif budgétaire où des dispositifs importants, à fort impact sur l'équilibre de la loi de financement de la sécurité sociale, se trouvent souvent insérés. Dans le même souci, ces commissions devraient être destinataires des référés relevant de leur compétence, que la Cour des comptes envoie aux ministres lorsque la gestion de leur administration est en cause. Enfin, un travail pourrait être mené sur certains sujets d'intérêt commun, avec la commission des finances, par exemple, sur la question du financement de la dépendance.
Au-delà de cette meilleure coordination entre les organes parlementaires, des améliorations techniques peuvent encore être apportées, notamment dans la présentation des annexes pluriannuelles retraçant les prévisions du projet de loi de financement.
De même, la procédure du comité d'alerte pourrait utilement prévoir d'inscrire, dans la loi de financement de l'année, les mesures susceptibles d'être prises si l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) est dépassé en cours d'exercice.
Pour conclure, M. Alain Vasselle, rapporteur, a envisagé, suivant la recommandation du rapport Pébereau, que l'on confère valeur organique, voire constitutionnelle, au principe du vote à l'équilibre de la branche maladie, lorsque les déficits passés auront été résorbés, comme symbole d'une interdiction morale de report des dépenses sur les générations futures.

a souhaité que la commission des affaires sociales prenne toute sa place, aux côtés de la commission des finances, dans les débats touchant aux finances publiques. Il a plaidé pour une meilleure maîtrise du Parlement sur les finances sociales, alors que les équilibres restent aujourd'hui encore trop dépendants de décisions échappant à son contrôle. De ce point de vue, la proposition du rapport Pébereau de prévoir un vote à l'équilibre de l'assurance maladie doit être approuvée.

s'est dit en accord avec les conclusions du rapporteur sur la TVA sociale et l'absence de fusion des lois de finances et des lois de financement, mais sceptique sur la réalisation de l'objectif fixé par le Président de la République d'une baisse de quatre points des prélèvements obligatoires sur la législature, le jugeant irréaliste au regard de l'importance des déficits publics.
Contestant le lien entre baisse des cotisations et hausse du travail, il a estimé qu'un rapport peut en revanche être établi entre baisse des cotisations et chute du pouvoir d'achat, dans la mesure où la première a favorisé le développement d'emplois rémunérés au Smic.
Il s'est enfin interrogé sur la portée du transfert, vers un ministère des comptes publics, de la compétence générale sur les lois de financement de la sécurité sociale, faisant observer que cette nouvelle organisation semble légitimer le principe de maîtrise comptable des dépenses d'assurance maladie.

a estimé nécessaire une remise à plat des exonérations de cotisations sociales car elles ont favorisé, à son avis, la « smicardisation » de la société française.
Il a approuvé les propos du rapporteur sur la nécessité de préserver l'autonomie de la branche famille, souhaitant même que son champ de compétence soit élargi aux congés de maternité, qui relèvent pour l'instant de la branche maladie.
Sur l'obligation de vote à l'équilibre, il a soutenu qu'elle devrait s'appliquer à toutes les branches, car même celles qui semblent les mieux préservées sont susceptibles de recevoir des charges nouvelles : la réparation des affections liées à l'amiante pour la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) ou la mise en place de nouvelles prestations coûteuses, comme les allocations familiales au premier enfant, dont le poids incomberait à la branche famille.

a demandé des précisions sur les montants supplémentaires des ressources susceptibles d'être mobilisées par une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG).

a indiqué que la CSG est un impôt très productif, mais que la Mecss ne propose d'y recourir qu'après la mobilisation d'autres recettes, et au premier chef la taxation des « niches sociales ».

a souhaité que la Mecss approfondisse sa réflexion sur ces « niches », ce à quoi M. Alain Vasselle, rapporteur, s'est engagé en rappelant que tous les membres de la commission peuvent s'associer aux travaux de la mission, même s'ils n'en sont pas formellement membres.
Enfin, la commission a approuvé ces propositions et autorisé la publication du présent rapport.
La commission a ensuite entendu une communication de M. Nicolas About, président, sur le programme de travail de la commission.

a indiqué avoir réuni le bureau de la commission le 10 octobre dernier, pour faire le point des travaux susceptibles d'être engagés si l'ordre du jour législatif en laisse le loisir.
Il a au préalable présenté les nouvelles règles applicables aux missions à l'étranger, qui ont été récemment arrêtées par le Bureau du Sénat. La première décision, qui paraît très opportune, est d'interdire la présence de tiers dans les délégations des commissions, qu'il s'agisse des conjoints ou de journalistes.
La seconde, moins convaincante, a été de limiter désormais l'effectif d'une mission à 10 % de l'effectif de la commission, soit en l'occurrence cinq commissaires, plus le président de la délégation. Cette formation ne permettra donc plus d'assurer la présence minimale d'un représentant par groupe si l'on veut aussi respecter une certaine proportionnalité dans la représentation de chacun des groupes. Dès lors que le Bureau de la commission a estimé que ces missions ont aussi pour objectif de favoriser les échanges entre commissaires d'appartenance politique différente, la commission sera sans doute amenée à effectuer désormais deux missions par an.
Pour 2008, qui a pour particularité d'être une année de renouvellement sénatorial, le Bureau a envisagé de conduire une double mission outre-mer pour étudier les différences de législation existant sur les droits sociaux : l'une pourrait se rendre dans les Dom, l'autre dans les Tom, pour établir ensuite un rapport commun. Ceci étant, d'autres suggestions ou propositions peuvent être présentées avant le choix définitif de la destination et de l'objet de ces missions.
a ensuite énuméré les différentes études que la commission pourrait engager au cours de cette session. Elle mènera notamment un certain nombre de travaux communs avec la commission des finances : d'abord, une mission d'information commune sur la dépendance, à lancer en janvier ; ensuite, un contrôle budgétaire commun qui pourrait porter sur l'agence française de l'adoption.
Par ailleurs, M. Bernard Seillier a évoqué le projet de constituer une mission d'information sur la lutte contre les exclusions, qui fera l'objet prochainement d'une demande d'autorisation si la commission en est d'accord. M. Alain Milon travaillera sur la question de la prise en charge psychiatrique, d'abord dans le cadre de l'Opeps qui l'a désigné en qualité de rapporteur, puis le cas échéant, en complétant cette première étude par une réflexion à mener au sein de la commission.
Enfin, divers autres sujets ont été évoqués lors de la réunion de Bureau : M. Jean-Pierre Godefroy propose de poursuivre le suivi de l'application de la loi handicap et des travaux de la mission d'information « amiante » ; Mme Anne-Marie Payet demande l'organisation d'une journée d'auditions sur les addictions, notamment celle aux jeux, en complément de l'étude récemment établie par M. François Trucy pour la commission des finances ; Mme Annie David a soumis le thème de la pénibilité au travail qui, en tout état de cause, sera étudié lors de la réforme des retraites.
Enfin, M. Nicolas About, président, a indiqué avoir demandé l'organisation de deux journées d'étude ouvertes aux commissaires : la première dans un laboratoire de recherches ; la seconde à Bruxelles en prévision de la prochaine présidence française de l'Union européenne.

a évoqué la question des cellules prélevées sur le sang de cordon ombilical. Le faible nombre de lignées disponibles en France conduit à des importations coûteuses pour la sécurité sociale. Il conviendrait d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point et de prendre des mesures, simples à son sens, pour améliorer cette situation.

A M. François Autain qui voulait obtenir confirmation du travail auquel s'était engagée précédemment la commission sur les programmes d'observance, M. Nicolas About, président, a indiqué que des auditions seront organisées en janvier dans l'objectif d'établir une proposition de loi sur ce sujet qui semble, désormais, ne plus faire l'objet d'une polémique.

a précisé que la mission d'information qu'il souhaite voir constituer a pour objectif de démontrer l'utilité de mener des politiques globales et cohérentes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, seules à même de produire l'effet transversal nécessaire à leur efficacité.

Enfin, la commission a entendu une communication de M. Nicolas About, président, sur l'application des lois.
a rappelé combien le contrôle de l'application des lois est un exercice fondamental pour mesurer le degré de difficulté pratique d'application de la législation votée et, plus encore, pour savoir si les lois adoptées cette année et au cours des précédentes sessions s'appliquent réellement.
Le bilan de l'activité de la commission, au cours de l'année parlementaire écoulée, montre que sur les quarante-cinq lois adoptées par le Parlement, onze ont relevé, au fond, de la compétence de la commission ; douze en réalité, en comptant la loi « service minimum dans les transports », soumise à une commission spéciale. Ce sont donc deux fois plus de textes qui ont été étudiés que l'année précédente, pour une période de travail amputée d'un bon tiers en raison des échéances électorales du printemps.
S'y ajoutent huit avis présentés sur le projet de loi de finances, deux saisines pour avis sur les textes « protection juridique des majeurs » et « travail, emploi et pouvoir d'achat » ainsi que neuf rapports d'information publiés cette année, dont quatre rédigés par la Mecss.
a ensuite présenté les statistiques établies pour cette année. Sur les douze lois votées, quatre étaient d'application directe et sont donc pleinement en vigueur. En revanche, aucune des huit autres n'a reçu l'ensemble de ses mesures d'application. Ceci étant, cinq sont déjà partiellement applicables dans des proportions allant de 13 % (participation et actionnariat salarié) à 89 % (création d'un ordre des infirmiers).
Le bilan est donc plutôt favorable, surtout si l'on rappelle la tendance lourde des lois à caractère sanitaire et social à requérir un volume important de textes d'application. Ainsi, les douze lois votées cette année appellent 192 mesures, soit une moyenne de dix sept par loi, c'est-à-dire près de 35 % de l'ensemble des mesures réglementaires découlant de toutes les lois votées au cours de la session écoulée.
La situation des lois plus anciennes est également assez satisfaisante, car on note aussi un effort soutenu d'application.
Cette année, 141 mesures réglementaires ont été prises, contre 241 en 2004-2005 et 189 en 2003-2004. Cette moindre progression est la conséquence des efforts accomplis précédemment pour résorber le stock en attente plutôt qu'elle ne traduit un relâchement du suivi des lois. Notamment, les grandes lois emblématiques votées depuis 2002 ont été particulièrement bien traitées : 89 % d'application pour la loi « retraites » et pour la loi « programmation pour la cohésion sociale » ; 84 % pour la loi « assurance maladie » et 83 % pour la loi « handicap ». Ces taux sont d'autant plus notables que ces quatre lois attendaient, en tout, 388 mesures d'application, dont 139 pour la loi « handicap » et 136 pour la loi « retraites ».
Trois lois de la session 2005-2006 sont en outre devenues pleinement applicables cette année (majoration de retraite pour les personnes handicapées ; retour à l'emploi ; égalité salariale homme-femme). En conséquence, le taux d'application moyen de cette session est désormais de 71 %, contre 43 % un an plus tôt.
En définitive, le bilan de la XIIe législature s'établit comme suit : entre 2002 et 2007, la commission a examiné quarante-sept lois et trente-quatre d'entre elles ont reçu au moins 75 % de leurs décrets.
Qui plus est, les délais moyens de parution des mesures ont eu tendance à raccourcir au fil de la législature. Pour les textes votés cette année, 97 % d'entre elles ont été prises dans les six mois prescrits par la circulaire du 1er juillet 2004, contre 68 % l'an dernier.
a ensuite évoqué les motifs d'insatisfaction qui perdurent.
D'abord, trois lois de la dernière session n'ont reçu aucune mesure d'application : « organisation des professions de santé », « adaptation des médicaments au droit communautaire » et « protection de l'enfance ».
Ensuite, la loi-symbole « égalité des chances » du 31 mars 2006 n'est applicable qu'à 64 % : c'est trop peu pour un texte dont on soulignait l'importance et l'urgence. On observera d'ailleurs que l'ouverture des classes préparatoires aux élèves provenant de zones d'éducation prioritaires ou le CV anonyme - deux dispositions issues d'initiatives sénatoriales - sont toujours inapplicables, ce qui rend plus visible, et peut-être même choquante, l'absence de texte d'application.
Enfin, deux lois de 2004 sur la bioéthique et la politique de santé publique ne sont applicables qu'à 51 % et 64 %. La situation s'améliore mais bien lentement et ce, malgré les initiatives prises par la commission pour accélérer leur mise en oeuvre réglementaire.
En ce qui concerne l'urgence, on constate à nouveau qu'elle n'a pas d'effet d'accélération sur les délais de parution des mesures réglementaires. Cette année, le résultat est même flagrant en sens inverse, car le taux d'application des lois votées selon cette procédure (« médicaments », « participation » ou « droit au logement opposable ») est en moyenne deux fois moins élevé que pour celles examinées selon la procédure classique.
Un autre aspect décevant tient au fait que le suivi réglementaire des dispositions législatives issues d'initiatives sénatoriales, que l'on pensait en amélioration, se dégrade cette année. Ce taux approchait 33 % pour la dernière session, soit presque celui des mesures introduites par voie d'amendements gouvernementaux (36 %). Il n'est désormais plus que de 16 %, au moment où le Sénat marque de plus en plus son empreinte sur les textes, comme le montre l'adoption cette année d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale : celle relative aux menaces sanitaires de grande ampleur.
Enfin, en ce qui concerne les rapports demandés au Gouvernement dans les textes, les statistiques confirment leur manque d'opérabilité : sur les 107 rapports réclamés par les lois adoptées avant 2006, seuls 42 ont effectivement été déposés. Pour cette raison, la commission a sensiblement réduit ses exigences au fil des ans : vingt-sept rapports demandés en 2004, quatorze en 2005, quatre seulement en 2006, mais douze cette année.

A Mme Catherine Procaccia, qui souhaitait savoir ce que recouvrait exactement l'expression « initiatives sénatoriales », M. Nicolas About, président, a indiqué qu'elle vise à la fois les propositions de loi déposées par des sénateurs et les amendements adoptés à leur initiative.

a déploré le fait que des dispositions législatives votées quatre ou cinq ans auparavant puissent n'être toujours pas applicables. L'exemple du comité de démographie médicale créé par la loi « assurance maladie » de 2004 et jamais constitué depuis lors, illustre ce travers. Ne serait-il pas légitime dans ce cas de procéder formellement à la suppression de ces dispositions et de rendre officiel un constat d'impuissance ou de carence ?

a distingué le cas de figure particulier dans lequel la majorité politique a changé entretemps : on peut alors comprendre que, pour des dispositions qui ne correspondent plus au programme de la nouvelle majorité, l'abstention soit volontaire. En revanche, lorsque le Parlement a voté des dispositions auxquelles il est attaché, mais que le gouvernement qu'il soutient tarde à mettre en oeuvre, ne serait-il pas singulier qu'il se soumette, de lui-même, à cette résistance et retire volontairement les mesures en cause ?

a rappelé qu'il plaide de longue date pour la présentation simultanée des projets de loi et des décrets qui sont susceptibles de permettre sa mise en oeuvre.

a souligné les limites techniques de cet exercice et a indiqué qu'il est arrivé une fois cette année, sur la loi « droit au logement opposable », qu'un décret soit publié simultanément avec la promulgation du texte législatif.

et Gisèle Printz ont fait observer que la loi « accès au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé » semble être mal respectée dans les faits.

a fait observer que le problème n'est pas ici celui de l'application de la loi. Ce texte ne nécessitait pas de mesure réglementaire, il est donc entré en vigueur aussitôt. Ceci étant, il est évidemment nécessaire que les autorités s'assurent de la stricte application et du respect de la loi par les établissements de crédit.
Enfin, la commission a donné acte à son président de cette communication.