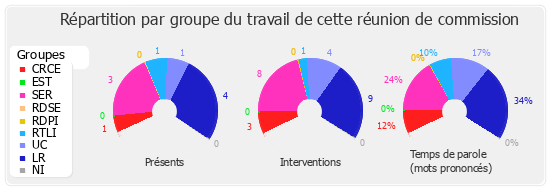Commission d'enquête Incendie de l'usine Lubrizol
Réunion du 29 octobre 2019 à 16h00
Sommaire
- Audition de m. denis merville président et mme véronique delmas directrice d'atmo normandie (voir le dossier)
- Audition de m. arnaud brennetot maître de conférences en géographie politique à l'université de rouen (voir le dossier)
- Audition de m. yves blein président de l'association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs amaris (voir le dossier)
La réunion

Mes chers collègues, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence du président de notre commission d'enquête, Hervé Maurey. Nous procédons aujourd'hui à trois auditions sur la gestion des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse ; un compte rendu en sera publié avec le rapport. J'appelle l'attention du public ici présent qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence. Toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des marques d'approbation ou d'improbation, sera exclue. Je ne reviens pas sur les conditions et le contexte ayant conduit l'ensemble des présidents de groupes et des présidents de commissions du Sénat à souhaiter qu'une commission d'enquête puisse faire toute la lumière sur la gestion des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen et formuler, le cas échéant, des propositions pour, notamment, améliorer la maîtrise des risques technologiques.
Après avoir entendu le PDG du groupe Lubrizol et effectué un déplacement très marquant sur le terrain jeudi dernier, nous débutons cet après-midi nos travaux en recevant M. Denis Merville, président, et Mme Véronique Delmas, directrice, d'ATMO Normandie.
Avec cette audition, nous abordons les conséquences sanitaires de l'incendie. En effet, ATMO France est la fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. La loi de 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie leur a confié différentes missions, dont plusieurs intéressent directement notre commission d'enquête, notamment la mise en oeuvre de la surveillance et de l'information sur la qualité de l'air, la diffusion des résultats et des prévisions et la transmission des informations relatives aux dépassements ou prévisions de dépassement des seuils d'alerte. Pour la crise qui nous occupe aujourd'hui, ATMO Normandie a joué un rôle important. Je rappelle d'ailleurs que vous aviez déjà réalisé une analyse approfondie et formulé des recommandations lors du précédent accident de l'usine Lubrizol, en 2013. À l'époque, vous aviez noté qu'il convenait de « tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour pouvoir améliorer les points qui se sont révélés défaillants », notamment en termes d'organisation et de communication. C'est dire si votre éclairage sur la gestion des suites de l'accident du 26 septembre dernier nous intéresse.
Avant de vous laisser la parole, je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Denis Merville et Mme Véronique Delmas prêtent serment.
Je vous remercie, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, de procéder à notre audition. Mes propos seront opportunément complétés par l'intervention de Véronique Delmas, qui dirige depuis longtemps notre association et qui était en première ligne lors de la catastrophe de Lubrizol.
Notre association est issue de la loi de 1996 ; elle comprend des représentants de l'État, des collectivités locales et des industriels, ainsi qu'un collège regroupant des responsables associatifs, des personnalités qualifiées et des médecins. Cette structure quadripartite est une garantie d'indépendance à laquelle nous tenons particulièrement. Conformément aux recommandations de la loi, chaque collège pèse pour 25 % dans l'association, et seuls les trois premiers participent à son financement. Il est important en effet que personne ne finance ces réseaux à plus de 50 %.
Notre association, agréée par le ministère de l'environnement, est chargée de surveiller la qualité de l'air et la pollution de fond. Les spécialistes dénombrent malheureusement 40 000 décès par an dus à la pollution atmosphérique. Sans minimiser l'incendie de l'usine Lubrizol, notre priorité reste donc la mesure de cette pollution de fond.
Notre activité est très réglementée par les directives européennes. Nous publions un indice qui synthétise les mesures des quatre polluants principaux. Les interventions sur les accidents ponctuels relèvent plutôt de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) ou de bureaux spécialisés comme Veritas. Elles ne font donc pas partie de nos missions réglementaires, mais nous essayons d'apporter notre concours aux pouvoirs publics dans ce genre de situations.
Lors de l'accident de 2013, nous avions déjà effectué des observations et participé à des groupes de travail régionaux et nationaux. Nous avons été parmi les premiers en France à signer, en 2018, une convention avec le SDIS 76 pour mettre à disposition des sapeurs-pompiers, tous les trois mois, des canisters (NB - récipient métallique vide qui capture l'air devant être analysé). Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a pu ainsi réaliser des prélèvements à plusieurs reprises, le jour même de l'accident et par la suite.
ATMO Normandie résulte de la fusion entre Air Normand, pour la Haute-Normandie, et Air Com, pour la Basse-Normandie, dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). La Normandie reste une région à taille humaine et cette fusion s'est effectuée dans de bonnes conditions.
Le jour de l'accident, Mme Delmas a été appelée vers 4 heures du matin. J'ai, pour ma part, été alerté alors que j'étais en route pour le conseil départemental, où je suis également élu. Toute l'équipe d'ATMO Normandie a été mobilisée le jour de l'accident et les suivants.
Notre association emploie une trentaine de collaborateurs et gère un budget de 4,5 millions d'euros environ, financé à parts égales par l'État, les collectivités territoriales et les industriels, via la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). La part de Lubrizol est faible dans notre budget, puisque, avec l'usine du Havre, elle ne représente que 0,12 % de notre financement. Un ancien directeur d'usine retraité de Lubrizol siège à notre conseil d'administration, en qualité de représentant de l'Union des industries chimiques.
La loi NOTRe a compliqué notre financement du côté des départements. Aujourd'hui, seule la Seine-Maritime joue le jeu, les autres nous renvoyant vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Nous mesurons la qualité de l'air mais les études épidémiologiques ne sont pas de notre ressort. Les habitants se sont beaucoup plaints des odeurs, mais cela ne signifie pas forcément que les fumées soient toxiques. Il peut aussi y avoir des pollutions sans odeur. Tout dépend de la nature des produits qui brûlent.

Nous avons bien compris que la priorité d'ATMO, c'est la mesure de la pollution de fond et pas les incidents ponctuels. Vous avez néanmoins été mis dans la boucle dès le début de l'incident. Madame la directrice, comment ATMO Normandie s'est-elle impliquée dans la gestion de la crise ?
Nous sommes intervenus à plusieurs niveaux. Je me suis rendue à la préfecture dès 4 heures 30 du matin pour participer à la cellule de crise. Nous avons tout d'abord décidé de mettre des canisters à disposition des pompiers. Il s'agit de bonbonnes destinées à effectuer des prélèvements d'air. Nous en avions à Rouen, mais vu l'importance du sinistre, nous en avons rapatrié deux du Havre. Au total, les pompiers ont pu effectuer six prélèvements différents. Les premiers tests effectués dans un camion venant de Nogent-le-Rotrou n'ayant pas été concluants, nous sommes convenus avec le SDIS et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), pour plus de sûreté, de faire faire les analyses à l'Ineris.
Ensuite, nous avons regardé ce que mesurait notre réseau de capteurs fixes. La situation était normale, ce qui est compréhensible, le panache de fumée ne se dirigeant pas vers nos stations, mais plus au nord. La Dreal et la préfecture m'ont demandé d'ajouter une station mobile sur les hauteurs de Rouen, à Mont-Saint-Aignan. J'ai donc fait en sorte de rapatrier du matériel disponible pour équiper cette station en début d'après-midi. Il m'a également été demandé d'installer des jauges pour récupérer les dépôts secs et les eaux de pluie sous le panache, des précipitations ayant été annoncées. Enfin, nous avons installé un filtre sur la station de Saint-Saëns pour effectuer des mesures d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Voilà pour la partie métrologique.
S'agissant de l'information du public, instruits par le précédent incendie de 2013, nous avons décidé de suspendre la diffusion de l'indice ATMO, la situation étant trop incertaine. Cet indice, dont la diffusion quotidienne nous est imposée par un arrêté ministériel, est basé sur la mesure de quatre polluants chroniques - le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules PM10 et l'ozone. Il s'agit de surcroît d'un indice d'agglomération : il n'était donc pas vraiment représentatif, toute l'agglomération n'étant pas également concernée. Par ailleurs, c'est un indice de prévision. Or, vous l'avez compris, nous ne savions pas vraiment comment la situation allait évoluer. Enfin, comme nous étions dans le cadre d'un plan particulier d'intervention (PPI), nous avons considéré que l'information relevait du préfet.
Nous avons donc décidé de ne plus publier l'indice ATMO sur Internet et d'en expliquer les raisons dans une fenêtre pop-up. Nous avons également précisé que des signalements concernant des odeurs et des symptômes physiques nous étaient remontés de la population.

Juste après l'incendie, vous avez donc décidé de ne plus publier l'indice, qui est basé sur quatre éléments. Pourquoi cet indice ne permettait-il pas de rendre compte de la toxicité des fumées émises ?
Par ailleurs, vous venez de dire que les panaches de fumée s'étaient dirigés vers le plateau nord de l'agglomération. Or vous ne disposez pas de stations de mesure dans cette zone. Vous avez cependant continué d'enregistrer les mesures sur le reste de l'agglomération, mais vous n'avez pas diffusé d'indice global pour ne pas, selon vous, contribuer à provoquer de l'incompréhension. Ce choix n'a pas été compris par la population, qui vous a accusés de dissimulation. N'est-ce pas plutôt votre attitude qui a suscité de l'incompréhension ?

Je pense aussi que vous avez participé à augmenter l'inquiétude de la population. Quel est votre avis ?
Ensuite, la presse a signalé des indices de pollution de l'air inquiétants, des chiffres contestés par l'État, car les mesures auraient été faites avec du matériel contaminé. De quelles informations disposez-vous à ce sujet ?
Ce que nous devons mesurer est déterminé par les pouvoirs publics. Il s'agit seulement des quatre polluants mentionnés tout à l'heure. C'est de plus un indice d'agglomération. Il est vrai que nous avons plus de capteurs sur la rive gauche que sur la rive droite, où se trouvent des communes qui ont été touchées, comme Mont-Saint-Aignan, mais on est plus proche de zones industrielles quand on est à Petit-Quevilly que quand on est à Bois-Guillaume.
Si vous voulez que nous mesurions plus de polluants, il faut que la réglementation change. De plus, vous le savez comme moi, la nature des produits qui brûlaient a été connue tardivement. En tout état de cause, il faut du matériel adéquat, ce qui coûte cher.
La décision avait été prise, après l'accident de Lubrizol en 2013, de ne plus diffuser cet indice, pas forcément représentatif en cas d'incident majeur. Cet indice ne rend pas compte non plus des odeurs. Il faut savoir que nous avons un réseau de « nez » bénévoles à Rouen, à Port--Jérôme-sur-Seine et au Havre. Leur retour a montré qu'il y a moins d'odeurs qu'avant, mais c'est difficile à quantifier avec un indice représentatif, et l'indice que nous publions en temps normal ne rend absolument pas compte de ces phénomènes. Pour éviter de perdre en crédibilité, nous avions donc décidé cette suspension en cas d'incident, après 2013.
Vous dites qu'il n'y a plus eu d'information, mais c'est faux, puisque les capteurs ont continué de fonctionner et les résultats ont été publiés en temps réel. Seul l'indice ATMO a été suspendu, et nous nous en sommes expliqués dans une fenêtre pop-up, en précisant qu'un certain nombre d'éléments interviendraient après une analyse plus poussée. Pour moi, ce choix était compréhensible.
Absolument, et il a été dicté par le retour d'expérience de l'accident Lubrizol en 2013.

Il y a, d'un côté, informer et, de l'autre, rassurer. Ce choix était-il de nature à rassurer ?
Ce n'est pas notre rôle de rassurer. Notre travail consiste à donner des informations le plus honnêtement possible. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. On ne pouvait pas publier un indice global sur l'agglomération avec les données dont on disposait. Nous risquions de donner une information potentiellement erronée.
Beaucoup d'analyses ont été réalisées par différents organismes ! L'incendie a duré plusieurs jours et la qualité de l'air a continué de se dégrader. Le premier jour a été marqué par le gros panache, mais la combustion a continué les jours suivants. Aujourd'hui, elle est terminée. Toutefois, le problème de la qualité de l'air reste posé. Beaucoup de structures sont intervenues, pas seulement ATMO Normandie. Les services de l'État ont ainsi fait appel, par exemple, au réseau des intervenants en situation post-accidentelle, réseau RIPA, coordonné par l'Ineris et dont fait partie Bureau Veritas. Des mesures d'amiante ont été réalisées par trois laboratoires.

Quels enseignements avez-vous tirés de l'accident de Lubrizol en 2013, lié à une fuite de gaz ? Avez-vous revu vos procédures et, notamment, votre communication ?
Une commission d'enquête, après l'accident de 2013, avait estimé que la communication d'Air Normand à l'époque avait été bonne parce que l'on avait tenu compte des retours des habitants et des signalements d'odeurs. Je crois que tout le monde a reconnu que la communication avait été pertinente et adaptée.
Pour le reste, on a travaillé sur d'autres axes d'amélioration avec d'autres associations comme ATMO-Rhône-Alpes et ATMO-Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de groupes de travail nationaux sur l'instruction du gouvernement du 12 août 2014, dite instruction Lubrizol. Au cours de ces travaux, nous avons fait des propositions pour améliorer, en cas d'accident, la connaissance de l'événement et mieux comprendre l'impact sanitaire. Nous avions ainsi préconisé des conventions avec les SDIS, à l'image de la convention avec le SDIS 76. La Seine-Maritime fait partie des trois seuls départements où une telle convention a été signée.
L'incident de 2013 n'était pas lié à un incendie, mais à une émanation de mercaptan, et l'instruction du 12 août 2014 visait à apporter des réponses en cas d'émission de substances dangereuses. Cette année, on a dû faire face à un incendie. On a utilisé des canisters, mais il faut reconnaître que nos dispositifs de prélèvement ne sont pas forcément adaptés aux incendies. Il y a là, à mon avis, matière à ouvrir une réflexion.

Vous avez évoqué les pistes de travail qui ont été les vôtres après l'accident de 2013. L'incendie appelle d'autres réflexions. Vous utilisez quatre indicateurs pour élaborer votre indice. Est-ce suffisant ? Quels composants pourriez-vous mesurer en fonction des différents types d'accidents industriels susceptibles de se produire ?

Ma question est similaire et porte sur les retours d'expérience. Quels enseignements pouvez-vous d'ores et déjà tirer de l'incendie pour améliorer les choses ? Que pouvez-vous nous dire du fonctionnement du centre opérationnel, de la coordination entre le préfet et le commandant des opérations de secours ? D'où provenaient vos instructions ?

Dès les premières mesures enregistrées, vous vous êtes tournés vers un autre laboratoire. Pourquoi ? Vous n'avez pas souhaité transmettre les indices de qualité de l'air durant l'incendie. Avez-vous conservé les mesures que vous avez réalisées ? Dans ce cas, pourriez-vous nous les communiquer ?
Les pompiers ne travaillent pas à partir d'analyses, mais utilisent des capteurs. Travaillez-vous avec eux pour les aider à les régler ? Le SDIS a-t-il utilisé vos relevés pendant l'incendie ?

Je voudrais plus de précisions sur la coordination des informations. Vous avez décidé de ne pas communiquer l'indice ATMO le premier jour. Qui coordonnait la diffusion des informations ? Publiez-vous à nouveau l'indice ATMO ? Qui a décidé de republier l'indice ? Est-ce vous ? Est-ce la préfecture ?
Notre fédération a été davantage associée à la gestion de la crise qu'en 2013 où nous avions été un peu oubliés. Mon prédécesseur avait écrit au préfet pour lui dire que nous étions à disposition si de tels événements se reproduisaient.
Quels enseignements tirer ? On peut certes mesurer d'autres polluants, mais notre indice de qualité de l'air est défini sur la base de seuils réglementaires. Pour le modifier, il faudrait modifier la réglementation. Notre indice repose sur une échelle allant de un à dix. Cela a l'avantage de la clarté pour le grand public, mais la qualité de l'air est une notion complexe. De même que pour l'amiante ou les dioxines, il faut mener des études épidémiologiques pour apprécier les effets des substances.
Monsieur Tissot, nous disposons des mesures que nous avons réalisées et nous pouvons vous les fournir. Si l'on avait publié un indice faisant apparaître une bonne qualité de l'air alors que l'incendie était en cours, on nous aurait immanquablement accusés de ne pas dire la vérité ; d'un autre côté, en gardant le silence, on a pu être suspectés de dissimuler la vérité.... L'équilibre est difficile à trouver !

Nous vous adresserons un courrier pour obtenir communication de vos mesures de la qualité de l'air.
Les mesures des polluants qui permettent de calculer l'indice de qualité de l'air ont toujours été accessibles sur le site Internet d'ATMO Normandie pendant l'incendie à mesure qu'elles étaient réalisées, et n'ont jamais été retirées. Elles ont toujours été disponibles. Simplement, le premier jour, nous n'avons pas calculé d'indice synthétique. Le lendemain, alors que le panache de suie et de particules s'était dissipé, nous avons, à la demande du préfet, installé un camion avec des capteurs sur les hauteurs de Rouen, à Bois-Guillaume, qui indiquaient que la situation était normale s'agissant des quatre polluants. Dès lors, nous avons recalculé l'indice, assorti d'une fenêtre pop-up indiquant clairement que l'indice n'était pas représentatif pour les odeurs ni pour les polluants atypiques émis lors d'un incendie.
S'agissant du retour d'expérience, nous avons beaucoup d'idées. Il serait trop long de toutes les exposer. Je vous propose de vous les adresser par écrit. En particulier, la cellule post-accidentelle devrait jouer un rôle plus important ; elle devrait se réunir dès le démarrage. J'ai regretté l'absence de lieu où nous réunir entre spécialistes des mesures. On se réunissait au centre opérationnel départemental où la priorité était le sinistre. Il manque un lieu d'échanges.
Un mot enfin sur les mesures. Pour pouvoir pomper de l'air dans les canisters, il faut les équiper d'embouts spécifiques. Or l'appareil de Nogent-sur-Seine n'en possédait pas, ce qui explique qu'il n'a pas pu être connecté aux canisters. Très peu de laboratoires savent le faire. Nous avons aussi le projet d'installer un PTR-MS (Proton Transfer Reaction - Mass Spectrometer), appareil qui permettrait de mesurer les composés chimiques collectés dans les canisters. Nous souhaiterions en installer un au Havre afin de pouvoir procéder très rapidement à des analyses en cas d'incident, car cet appareil fonctionne en continu et permet d'avoir des résultats très rapidement.

Éric Schnur, le président-directeur général de Lubrizol a comparé l'incendie de l'usine Lubrizol avec celui d'une habitation, estimant que l'un n'était pas plus dangereux que l'autre. Trouvez-vous cette comparaison opportune ? De même, avez-vous pu analyser et modéliser les conséquences des fréquents incendies de voitures contenant, avec une probabilité quasi certaine, des produits Lubrizol ?
Il me semble délicat de comparer l'incendie de Lubrizol avec un incendie d'habitation : les quantités de produits chimiques en cause ne sont pas les mêmes. Les incendies de pneumatiques dégagent également des fumées et nous recevons parfois des plaintes au Havre ou à Rouen.
S'agissant des incendies de voiture, vous devriez poser la question à l'Ineris, qui effectue de tels essais dans des tunnels pour en mesurer l'impact.

Je vous remercie. S'il existe une contribution du réseau ATMO, nous serons heureux d'en être destinataires.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Nous poursuivons les auditions de notre commission d'enquête sur la gestion des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen et nous entendons maintenant M. Arnaud Brennetot, géographe et professeur à l'université Rouen Normandie.
Deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, vous avez réalisé une analyse de la communication mise en place autour de cette catastrophe industrielle et technologique. Votre analyse pointe de manière précise plusieurs erreurs dans cette communication. Il nous a donc paru intéressant que vous puissiez nous en faire partager les résultats, voire la compléter compte tenu des nouveaux éléments portés à la connaissance du public depuis que vous l'avez réalisée.
Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Arnaud Brennetot prête serment.
Je vous remercie de m'auditionner aujourd'hui. J'ai commencé à analyser la communication officielle des services de l'État chargés du dossier de l'incendie de l'usine Lubrizol à partir du moment où, assez rapidement, j'ai eu l'intuition que la transparence de l'information donnée au public depuis le jeudi 26 septembre, et promise par le Premier ministre, n'était pas totale, mais plutôt partielle. Cette insuffisante transparence s'est accompagnée à la fois d'une sous-évaluation de l'impact géographique de l'incendie et d'une imprécision quant aux mesures de précaution à appliquer.
En premier lieu, l'information de crise concernant les zones exposées a été insuffisante. Je ne reviens pas sur les conditions d'information et d'alerte des populations qui, de l'avis unanime, présentent des points d'amélioration évidents. Je voudrais en revanche revenir plus longuement sur les mesures de précaution communiquées au public : confinement dans un rayon de 500 mètres, blocage des accès routiers, fermeture des établissements scolaires dans une douzaine de communes, ainsi qu'un certain nombre d'autres consignes adressées au public via différents canaux, notamment les médias. Il a ainsi été conseillé d'éviter, dans l'agglomération de Rouen, « les déplacements non indispensables » : mais qu'est-ce qu'un déplacement non indispensable ? Se rendre sur son lieu de travail, à un rendez-vous médical ou à un stage de formation relève-t-il d'un déplacement non indispensable ? Il a également été conseillé de « ne pas s'exposer inutilement aux fumées » et de « rester à l'intérieur autant que possible » : quelle différence y a-t-il, pour le public, entre « rester à l'intérieur », « se mettre à l'abri » et « se confiner » ? Il s'agit d'expressions normalisées qui ne sont pas forcément transparentes pour le public. Un document mis en ligne sur le site de la préfecture entretient cette confusion en décrivant la mise à l'abri comme un confinement, alors qu'il s'agit de deux procédures distinctes.
L'étendue géographique concernée a également été imprécise. La référence à « l'agglomération rouennaise » est vague : s'agit-il de la commune ? De la rive gauche ? D'Elbeuf ? Des communes plus au nord ? De Barentin ? De Clères ? À Forges-les-Eaux ou à Saint-Saëns, doit-on se considérer hors de la zone concernée par le danger ? La préfecture a arrêté, dès le matin du jeudi 26 septembre, le périmètre du plan particulier d'intervention (PPI), limité à douze communes. Mais, très rapidement, celui-ci s'est révélé trop restreint au regard de l'étendue du nuage ; les services de l'État ont alors élargi la zone à protéger selon un axe sud-ouest nord-est qui correspondait à la trajectoire du vent. Les critères qui ont présidé à la définition de ce périmètre me semblent à la fois obscurs et critiquables : il était en effet prévisible que le nuage allait s'étendre au-delà des douze communes, comme l'a d'ailleurs bien montré l'arrêté du 28 septembre qui interdit la commercialisation des productions agricoles. Il était donc tout à fait possible que la pluie attendue en milieu de matinée allait faire retomber les substances véhiculées par le nuage sur l'ensemble de la zone couverte par le panache et non sur les seules douze communes visées par l'arrêté. En dehors de ce périmètre, qui concerne une centaine de communes, aucune mesure de précaution n'a été émise : les activités d'extérieur - jardinage, sport, chantier, cour de récréation - se sont poursuivies sans aucune mise en garde ! L'imprécision qui a présidé à l'édiction des mesures de précaution à suivre a conduit à des réactions extrêmement hétérogènes selon les personnes, les établissements ou les entreprises.
En second lieu, l'information a été à la fois confuse concernant les polluants et imprécise quant aux moyens de s'en protéger. Les premiers jours, les services de l'État ont concentré leur discours sur les suies déposées par la pluie. Ils ont insisté à plusieurs reprises sur le caractère visible de la pollution ; mais, en focalisant l'attention du public sur ces pollutions visibles, ils ne l'ont pas incité à prendre conscience d'un risque spécifique lié à la présence éventuelle d'éléments toxiques non visibles - hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines ou métaux lourds. Les services de l'État n'ont pas non plus mis en garde le public sur le fait que les éventuelles particules fines qui pouvaient s'être déposées dans l'environnement, notamment là où aucun nettoyage n'avait été préconisé - toitures, chaussées, végétation -, étaient susceptibles d'être soit inhalées si elles étaient en suspension, soit remobilisées par le vent et déposées là où des nettoyages préalables avaient été effectués. Les services de l'État n'ont pas non plus précisé le temps ou la quantité d'eau de ruissellement nécessaires pour nettoyer naturellement les surfaces et pour que les polluants s'infiltrent dans les sols.
Mercredi 2 octobre, M. Raymond Cointe, directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), a annoncé que l'incendie avait probablement conduit à l'émission de dioxines potentiellement contaminantes soit par l'alimentation soit, notamment pour les jeunes enfants, par le fait de porter à la bouche des éléments contaminés. De ces deux constats - présence potentielle de dioxines et risque accru pour les enfants -, les responsables de l'agence régionale de santé (ARS) comme du rectorat n'ont tiré aucune conclusion et ont continué à insister sur les faibles teneurs attestées par les premiers résultats et à rappeler la consigne de précaution de nettoyage des suies, conformément au protocole de l'ARS publié le matin du vendredi 27 septembre.
Dans la soirée du 26 septembre, on apprenait que seuls les établissements scolaires des douze communes du périmètre initial seraient fermés le 27 afin de nettoyer les suies. Or ce périmètre aurait dû, à l'évidence, être bien plus large ! Pour les autres communes, le préfet a annoncé que les mesures à prendre étaient laissées à l'appréciation des maires. S'agissant des particules fines, aucune précaution particulière n'a été prise, les services de l'État laissant entendre que le nettoyage des suies était suffisant pour dépolluer l'environnement et indiquant à plusieurs reprises que, une fois les suies nettoyées, l'usage normal des espaces publics et privés - trottoirs, aires de jeu, espaces verts, jardins, équipements sportifs - pouvait reprendre, alors que l'on ignorait s'il y avait ou non des composés organiques volatils, des métaux lourds ou des dioxines. Aucune mesure de précaution particulière n'a été préconisée dans les premiers jours à l'adresse des personnes travaillant en plein air - jardiniers, travailleurs du bâtiment, couvreurs - ni concernant la pratique des activités extérieures, notamment pour les enfants, en dépit du risque souligné par le directeur général de l'Ineris. Les mesures de précaution à prendre ont été laissées à la libre appréciation de chacun. Le ton rassurant qui a accompagné la publication des résultats d'analyse et le caractère vague des mesures de précaution tranchent non seulement avec l'inquiétude d'une partie importante de la population, mais aussi avec l'avis d'un certain nombre d'experts qui ont préconisé, par exemple, de retirer ses chaussures quand on passe de l'extérieur à l'intérieur, de se laver les mains de façon préventive, de ne pas laisser les enfants fréquenter les espaces enherbés pendant plusieurs semaines ou pour les amateurs de champignons, de renoncer pendant quelques mois à leur cueillette dans la partie couverte par le panache. Une enquête de l'Union régionale des médecins libéraux menée auprès de 81 médecins révèle que 67 d'entre eux considèrent que les informations transmises au public ainsi qu'aux praticiens étaient insuffisantes.
En troisième lieu, les zones touchées par les risques liés à l'amiante ont été sous-évaluées. La toiture du bâtiment qui a brûlé le 26 septembre sur le site de l'usine Lubrizol contenait de l'amiante ; pendant plusieurs jours, les services de l'État ont postulé que les débris avaient brûlé sur place ou étaient restés sur site, sans envisager l'hypothèse d'une dispersion beaucoup plus large : les tests sur les fibres d'amiante présentes dans l'air ont donc été réalisés dans un rayon de 300 mètres puis de 800 mètres autour de l'usine. Les habitants du nord de l'agglomération ont pourtant rapidement retrouvé des fragments de fibrociment et en ont diffusé les photographies sur les réseaux sociaux. Or il a fallu attendre le vendredi 4 octobre pour que les services de l'État reconnaissent que neuf communes avaient potentiellement été touchées par des rejets d'amiante, dans un rayon de 7 à 8 kilomètres au nord-est de l'usine.
S'agissant enfin de la nature et de l'identité des entreprises impliquées dans l'incendie, nous savons désormais que deux entreprises ont été concernées par l'incendie : Lubrizol et Normandie Logistique. Mais l'implication de Normandie Logistique n'a été connue que tardivement. L'information la concernant est donnée, pour la première fois, par le directeur de l'entreprise Lubrizol, dans une interview à Paris Normandie, le lundi 30 septembre au matin. Lors du conseil métropolitain du lundi soir, M. Patrick Berg, directeur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), l'évoque de manière incidente à plusieurs reprises. Pendant plusieurs jours, les médias ont donc eu le plus grand mal à identifier l'implication de cette deuxième entreprise et ce n'est que le 4 octobre, une semaine après le début de l'incendie, qu'un premier article titre sur Normandie Logistique dans Normandie actu. Il faudra attendre le 14 octobre pour apprendre que, sur les 9 500 tonnes qui ont brûlé, 4 200 l'ont été sur le site de Normandie Logistique, soit 44 % de l'ensemble des produits brûlés !
L'évocation confuse de l'implication de cette entreprise pendant plusieurs jours a pu laisser croire que l'identification des responsables pourrait être relativement simple, alors que l'évaluation et la répartition des responsabilités vont vraisemblablement être beaucoup plus compliquées. Dans un contexte d'inquiétude et d'angoisse fortes, ce retard dans l'information a pu renforcer une certaine suspicion de la part du public.
En conclusion, la transparence ne s'improvise pas : elle exige de reconnaître qu'une situation d'accident peut entraîner des incertitudes. Celles-ci doivent être communiquées au public et méritent d'être assorties de mesures de précaution claires, pédagogiques et adaptées à l'étendue du danger potentiel et éventuellement de ce que l'on ignore, le temps de recouper les informations.

Je vous remercie pour cette présentation. Comment analysez-vous les manques de communication de la préfecture ? Le préfet a délivré un message très rassurant pour la population, avec des éléments de langage tels que « situation dominée », « toxicité variable » ou encore « inflammabilité nulle ». Mais n'est-ce pas là de la langue de bois, certes bien maîtrisée, mais qui n'est ni très pédagogique, ni très rassurante pour le grand public ?
Je n'utiliserais pas l'expression « langue de bois ». À côté des formes discursives que vous mentionnez, ont également été utilisées les doubles négations - « ne pas accomplir de déplacement non indispensable » - qui rendent le message confus. Le discours a également eu recours aux litotes et euphémisations - « absence de toxicité aiguë » -, mais quid d'éventuelles toxicités intermédiaires ? Ces figures de style témoignent d'une volonté de rassurer le public à bon compte, sans admettre les inconnues ou les incertitudes et de minimiser l'ampleur de l'événement pour donner l'impression que la situation est maîtrisée.
Comment l'expliquer ? Je peux formuler quelques hypothèses que je n'ai cependant pas les moyens de vérifier scientifiquement.
Tout d'abord, les services de l'État ont peut-être moins l'habitude que les élus locaux d'être en contact direct avec le grand public et les médias en situation de crise. Ensuite, depuis les lois de décentralisation, le public a été habitué à recevoir des explications de la part de responsables politiques qui sont des élus locaux et qui ont cette aptitude à communiquer avec différents types de publics. Enfin, il y a peut-être eu aussi, dans les premières heures suivant l'événement, une différence de perception entre acteurs : pour le préfet et le colonel Lagalle, l'enjeu était d'éviter le sur-accident - sortir des fûts, éviter que d'autres ne fuient -, ce qui aurait conduit à une catastrophe absolument dramatique ; or le public ne le découvrira que de façon décalée. Ces différences de perception de la part des acteurs accroissent l'incompréhension voire l'incommunicabilité.

Il y a eu beaucoup de communication, peut-être même trop ! Et pourtant elle n'a pas rassuré les gens. De nombreuses personnes sont intervenues dans cette communication : n'aurait-il pas mieux valu moins de prises de parole, mais plus efficaces et mieux argumentées ? Je pense notamment à la communication du Gouvernement qui a fait intervenir plusieurs ministres qui se sont parfois contredits ! Tout cela a abouti à une communication confuse qui n'a rassuré personne. Qu'en pensez-vous ?
Sur des sites aussi dangereux, je pensais, en tant que simple citoyenne, que les risques industriels étaient totalement appréhendés. Or, même s'il existe un plan de prévention des risques et des procédures, on s'aperçoit, lorsque le problème surgit, qu'il y a encore beaucoup à améliorer. Quelles propositions pourrions-nous faire pour améliorer la situation, dans le cadre d'une culture du risque industriel qui, aujourd'hui, nous fait largement défaut ?
Plus que d'être rassuré, le public demande à être informé, y compris sur ce qui n'est pas rassurant ou ce qui est inconnu. Cela demande une préparation en amont, avec l'intervention de professionnels spécialisés dans la communication de crise pour éviter les dérapages. Les différentes interventions autour du préfet ne m'ont pas semblé créer les mêmes interférences qu'avec les ministres, car chacun intervenait dans son domaine de compétences : l'ARS pour la santé, le SDIS pour la gestion de l'incendie, la Dreal pour l'information concernant les sites classés et les substances concernées. J'ai toutefois le sentiment que les informations ont pu être interprétées différemment selon les services ; par exemple, le périmètre des douze communes a été identifié par le SDIS au cours d'un survol de la partie noire du panache de fumée alors que les enjeux en matière de santé et de précaution allaient bien au-delà ; cette information émanant du SDIS a été transmise telle quelle aux autres services et a pu servir de base à des décisions insuffisantes en termes de précaution.
Concernant votre question sur la prévention du risque, notamment auprès des populations, cet accident révèle la forte insuffisance des moyens mis en oeuvre jusqu'alors. Cela s'explique par le fait que les accidents technologiques sont beaucoup plus rares que les catastrophes environnementales, comme les inondations ou les incendies. Les processus d'apprentissage sont plus longs, d'autant plus quand l'événement a un caractère exceptionnel, comme c'est le cas ici, qui le rend encore plus rare : on pense à AZF ou à la raffinerie de Feyzin, c'est une histoire pluridécennale.
On s'aperçoit, par exemple, que le périmètre du PPI de Rouen est insuffisant pour faire face à un nuage toxique. Heureusement, les services de l'État en sont sortis très vite et ont défini des mesures de précaution sur une superficie plus vaste, même si celle-ci était encore insuffisante.
La question de la préparation en amont des populations se pose, avec la maîtrise du vocabulaire ou l'organisation d'exercices de confinement. La plupart des ménages, ou des équipements publics d'ailleurs, ne sont pas dotés de mallettes de confinement, parce qu'ils sont en dehors des zones dans lesquelles ce matériel est prévu. C'est un problème. Malgré tout, les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en ont diminué l'impact : il a eu lieu en pleine nuit, en dehors des grandes fêtes locales, alors que la situation météorologique n'était pas anticyclonique. Que se serait-il passé si cela n'avait pas été le cas ? Il y a donc des enseignements à en tirer, y compris en préparant des simulations, des entraînements ou des modélisations avec des situations différentes.
Un de mes collègues a travaillé sur l'interprétation par la population des sirènes d'alarme. Ses résultats ne sont pas encore publiés, mais ils sont édifiants : la population n'est pas assez préparée, sans compter que 8 % des personnes présentes dans l'agglomération n'en sont pas résidents ni travailleurs réguliers.
La culture de prévention des risques n'est donc pas à la hauteur des enjeux.

Lors de l'enquête en vue de la réalisation du plan de prévention des risques, en 2014, soit après l'accident de 2013, il semble que l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été sollicité et n'a donc pas été intégré dans le cahier des charges de l'enquête publique. Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas d'information à ce sujet.

Je m'étonne que vous ayez évoqué la communication des services de l'État, mais peu celle des ministres eux-mêmes. Vous avez d'ailleurs relevé que ceux-ci intervenaient chacun dans leur domaine. N'est-ce pas justement un problème, alors que la gestion de crise devrait s'appuyer sur une action collective des membres du Gouvernement concernés ?
S'agissant des défauts de communication en tant que tels, selon vos recherches, ceux-ci tiennent-ils à une volonté de rassurer plutôt que d'informer ou à l'utilisation d'un jargon consacré ? Peut-on faire la part des choses ?
Enfin, dans vos recherches et celles de vos confrères, peut-on cerner les différences de niveau de culture de risque selon les territoires ?

Je précise que les cinq ministres concernés comprennent le Premier ministre dont, par définition, le domaine s'étend sur 360 degrés.

Je suis frappé par l'immaturité fantastique de l'organisation d'alerte et de la prise en compte de la situation. On a le sentiment qu'il ne s'est jamais rien passé, et que les territoires sont bordés de frontières infranchissables.
J'habite dans la vallée de la Bresle, à la limite entre la Somme et la Seine-Maritime. On s'y est préoccupé de la question très longtemps après l'accident, on avait le sentiment que le nuage touchait une commune, mais pas l'autre, trois communes en cercle ont été concernées, mais pas celle qui se trouvait à l'intérieur du cercle, c'était surréaliste.
Pourquoi le périmètre considéré a-t-il été limité à quelques communes, pourquoi n'a-t-on pas pris en compte le panache du vent ? Le nuage est passé sur mon jardin, mais la préfète, à qui j'en ai parlé, m'a dit que j'exagérais et qu'aucun indice de suie n'avait été signalé. Toutefois, aucune démarche étatique n'a été engagée pour mesurer les retombées sur le terrain, les indices n'étaient relevés que si les gens apportaient eux-mêmes les informations.
Cela m'inquiète, parce que je suis sous le vent de Penly et de Paluel et je frémis pour tout le Nord-Ouest en cas de pépin nucléaire. Savez-vous si le préfet de Normandie a pris l'attache du préfet des Hauts-de-France pour le prévenir ? Cela concerne l'Aisne, la Somme, ainsi, peut-être, que quelques villages de l'Oise et du Pas-de-Calais.

Pour avoir participé aux auditions à Rouen, je ne voudrais pas que les SDIS se sentent concernés par l'immaturité qu'évoque notre collègue : ils ont eu une capacité de réaction très rapide.

Je suis étonné de voir la carte du périmètre, en forme d'entonnoir, qui se resserre puis s'évase plus loin. Le principe de précaution a-t-il été appliqué ? Nous avons vécu la grippe aviaire : alors que rien ne démontrait le moindre risque, le principe de précaution a conduit à confiner ou à abattre des volailles par milliers. Ici, le risque était avéré, mais je n'ai pas entendu parler du principe de précaution.

Je suis élue de l'Aisne. Chacun des départements des Hauts-de-France est concerné. Avez-vous discuté avec des collègues qui se sont penchés professionnellement sur ces sujets ?
Certes, le nuage est passé au-dessus de nous, mais il n'y a pas eu de pluie, donc de suie, partout. En matière de communication, la situation était confuse à proximité de l'incendie, imaginez ce qu'il en était chez nous ! J'ai été sollicitée par des gens qui ne savaient pas s'ils pouvaient manger les carottes de leur jardin, qui étaient dans une inquiétude terrible, alors que je n'avais pas de réponse simple. Je pense que certaines communes impactées n'ont pas été reconnues comme telles.
Chez moi, les instances agricoles ont assisté à des réunions à Paris, mais en sont revenues catastrophées, avec le sentiment que, dans la perspective d'un accident nucléaire, ils nourrissaient des doutes à la fois sur la communication et sur la prise en charge.
L'usine Lubrizol était un site Seveso, mais pas Normandie Logistique. Pensez-vous qu'il faut travailler sur ce point ? Dans une usine qui n'est pas classée Seveso, je sais qu'il y a un document unique d'évaluation des risques, le cadre Seveso est encore plus contraignant.
Il y a, près de chez moi, une usine L'Oréal dans laquelle on a récemment mené des exercices dans l'hypothèse d'un accident. Faut-il aller plus loin ?
À Fécamp, certains habitants ont reçu un bon pour aller chercher de l'iode en pharmacie, mais cela ne concerne pas toute la ville. On se pose donc des questions.

Je suis élu de Seine-Maritime, département qui compte 60 établissements Seveso, soit le chiffre le plus important avec les Bouches-du-Rhône, et 2 centrales nucléaires. S'agissant de ces dernières, la commission locale d'information nucléaire (CLIN) organise des réunions avec la population pour l'informer sur la conduite à tenir en cas de risque nucléaire à Paluel ou à Penly. Cela fonctionne correctement.
Les inondations de janvier 2018 ont matérialisé un autre risque naturel majeur. À cette occasion, nous avons constaté que les habitants avaient oublié que la Seine pouvait sortir de son lit. Notre réponse a été d'implanter à des endroits pertinents proches du fleuve des oeuvres culturelles rappelant les hauteurs d'eau atteintes très récemment, dans le but de diffuser la conscience du risque auprès des populations. Ne faut-il donc pas, sur ce modèle, sensibiliser très fortement les populations aux risques industriels ?
J'attends les conclusions de l'étude sur les réflexes en cas de déclenchement de sirène, mais je sais déjà que beaucoup d'habitants auront tendance à sortir de chez eux, alors même que la sirène, le plus souvent, aura pour objectif de les appeler à rester confinés. Cette impréparation me semble relever de la responsabilité de l'éducation nationale et des autorités locales.
Sur les différences de culture du risque, l'enquête dont je vous parlais montre que les responsables d'établissements qui accueillent du public depuis longtemps sont plus à même de prendre des décisions adaptées. L'expérience est bien de nature à améliorer les pratiques de prévention.
S'agissant du principe de précaution, il a été appliqué partiellement, mais de façon volontariste, par l'État et relayé par les chambres d'agriculture ou les syndicats professionnels, comme le montre le gel des produits agricoles décidé dès le 26 septembre pour résoudre provisoirement le problème, même si les fortes inquiétudes des agriculteurs sont compréhensibles. En revanche, cela n'a pas été le cas en ce qui concerne le cadre de vie, alors que les collectivités territoriales et les intercommunalités étaient tout à fait disponibles pour accompagner les populations.
Ainsi, je ne m'explique pas que l'on ait été aussi réducteur en ce qui concerne le périmètre et la durée des fermetures d'écoles, d'établissements recevant du public (ERP) ou d'équipements sportifs. En Seine-Maritime, quand il neige, on n'hésite pourtant pas à interrompre les transports scolaires. Quand une canicule se produit, on diffère le brevet, pourtant, quand un nuage potentiellement toxique émane d'une usine classée « Seveso seuil haut », on applique des précautions qui paraissent perfectibles.
Faut-il améliorer les dispositifs dans les sites Seveso ? Il me semble que l'on peut le faire, en effet. Il n'est pas normal que le feu soit ainsi passé d'un site à l'autre ; c'est une défaillance inacceptable, et cela mérite une réglementation plus ambitieuse en matière d'isolement des sites « Seveso seuil haut ». La zone concernée mêle différentes entreprises sur un périmètre très restreint et une usine « Seveso seuil bas » se trouve juste de l'autre côté de Normandie Logistique et aurait également pu être touchée.
Des questions doivent donc être posées sur la logistique : quelle quantité de combustible peut-on stocker sur un périmètre restreint ? L'incendie en a consommé un énorme volume.
Je suis tout à fait d'accord pour sensibiliser les populations, mais il faut aller au-delà, vers une implication dans la culture du risque. Cela passe par la pratique, par l'organisation d'exercices ; c'est ainsi que l'on pourra rassurer les populations qui sont inquiètes aujourd'hui ; quand les gens sauront comment se confiner, on pourra éviter la panique qui conduit les gens à fuir.
L'enquête que j'ai évoquée montre bien que, lorsque l'on incite les gens à rester chez eux, ils sont nombreux à respecter la consigne. Certes, ces données sont tirées d'un questionnaire et l'on ne sait pas ce que cela donnerait en situation réelle. Tout cela demande un travail collectif associant les services de l'État, la population, les collectivités territoriales, les entreprises et les établissements publics pour construire et partager cette culture du risque, en analysant les retours d'expérience. Cela a un coût collectif qu'il convient de mesurer pour savoir jusqu'où aller.

Pour conclure, le préfet de région a mis en place un comité de transparence et de dialogue avec pour objectif de remédier à la communication hésitante qui a immédiatement suivi l'incendie. Quelle appréciation portez-vous sur cet organe, qui s'est réuni deux fois jusqu'à maintenant ?
Je n'ai pas d'avis à ce sujet, mais je me réjouis qu'un comité évalue les conditions de mise en oeuvre de la transparence et identifie les points à améliorer, car c'est salutaire. Peut-être faut-il ouvrir ces réunions aux médias, qui ont également besoin d'être formés pour délivrer des informations maîtrisées aux populations en situation de crise, car les journalistes n'y sont pas préparés. Toutefois, pour parvenir à des conclusions consistantes, il faut une ambition forte.

Je vous remercie de votre participation.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Audition de M. Yves Blein président de l'association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs amaris
Audition de M. Yves Blein président de l'association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs amaris

Nous poursuivons les auditions de notre commission d'enquête sur la gestion des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen.
Nous entendons maintenant M. Yves Blein, président de l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (Amoris), qui regroupe plus de 100 collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exposés à de tels risques. Cette association poursuit une action déterminante en matière d'accompagnement des collectivités concernées, notamment par la mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Elle place le retour d'expérience au coeur de ses interventions. Et c'est bien à ce titre, monsieur le président, que nous souhaitions vous entendre aujourd'hui.
Dans le dernier rapport d'activité de l'association, vous estimez que les PPRT « aux niveaux local et national, ne sont plus un sujet d'actualité de premier plan ». Vous expliquez également que « maintenir la dynamique est pourtant la condition sine qua non pour assurer la mise en oeuvre effective des règlements ».
L'incendie de l'usine Lubrizol le 26 septembre dernier a confirmé de manière dramatique la pertinence de vos observations. Il est donc d'autant plus intéressant que vous nous expliquiez l'appréciation que vous portez sur la manière dont il a été géré.
Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Yves Blein prête serment.
Amaris a été créée en 1990, après l'adoption de la directive Seveso qui a suivi le premier accident industriel important en Europe, dans la ville éponyme. Je la préside depuis 2008 et j'en ai été élu administrateur en qualité de maire de Feyzin. Je suis député et encore conseiller municipal de Feyzin, mais je quitterai l'association au terme de ce dernier mandat. Il me semble que l'expérience du maire d'une ville qui accueille des industries classées « Seveso seuil haut » peut vous intéresser.
Amaris a été très active après l'accident d'AZF pour contribuer à la mise en oeuvre de la loi du 30 juillet 2003, dite « loi Bachelot », relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. En 2019, nous commençons seulement à entrer dans la mise en oeuvre concrète des mesures de protection prévues qui concernent les habitants : les travaux ont été réalisés dans 600 logements sur les 16 000 qu'il faut protéger.
Pourquoi a-t-il été si long de mettre en oeuvre ces mesures ? La doctrine de la France en matière d'appréciation des risques a été refondue en 2003. Jusque-là, la France appliquait la méthode dite « déterministe », qui consiste, avec un site Seveso, à se caler sur l'hypothèse de risque la plus élevée et à en tirer toutes les conséquences possibles, telles que l'interdiction de l'urbanisation, la réglementation autour du site, etc.
À partir de 2003, la France adopte la méthode probabiliste, en cours dans la plupart des pays d'Europe. On ne se contente donc plus de prendre le scénario le plus haut, mais on étudie tous les scénarios d'accidents sur un risque industriel, avec tous les arbres de cause et tous les arbres de conséquence. Sur un site complexe, comme celui de ma commune, cela requiert un millier d'études de dangers que les industriels doivent réaliser, qui sont ensuite expertisées par les services de l'État, et qui donnent lieu à des mesures de résorption, c'est-à-dire à des mesures sur site pour réduire les dangers identifiés.
À l'issue de ce travail, lorsque l'on ne parvient pas à réduire la totalité des risques et que certains scénarios d'accidents indiquent la possibilité de conséquences en dehors du site, on prend alors des mesures d'urbanisme.
Cette période, qui a duré cinq ou six ans, est importante, et a nécessité plusieurs centaines de millions d'euros d'investissements de la part des industriels sur leurs sites en France. On a ensuite commencé à étudier les plans de prévention des risques technologiques, c'est-à-dire les mesures d'urbanisme à prendre là où le danger s'étendait au-delà de l'enceinte de l'usine.
Ces mesures se déclinent en trois dispositions : expropriation, délaissement ou obligation de réaliser des travaux sur les maisons riveraines.
Leur application a été ralentie par la capacité offerte aux habitants de les mettre en oeuvre. La loi Bachelot prévoyait un crédit d'impôt de 10 % pour la prise en charge des travaux à concurrence de 10 000 euros. Or autour des sites industriels résident souvent des foyers modestes, pour lesquels il est exclu de réaliser 9 000 euros de travaux.
Le législateur a progressivement pris conscience de ce phénomène et le taux a évolué : la loi prévoyait initialement 15 % du montant total plafonné à 10 000 euros de travaux ; en 2010, la loi Grenelle 2 impose 40 % du coût, plafonné à 30 000 euros de travaux, ce taux est ramené à 36 % en décembre suivant, à 15 %, en 2011, il remonte à 30 %, puis, en 2012, il atteint de nouveau 40 %. Durant deux ou trois années, les riverains ne savaient donc pas « à quelle sauce ils allaient être mangés ».
En 2012, l'association que je préside a convaincu les industriels que l'État n'irait pas au-delà de 40 % de prise en charge et que tout le monde devait mettre la main à la poche pour protéger les habitants. Nous avons donc signé une convention de principe invitant les industriels et les collectivités locales à prendre à charge pour moitié les 50 % des travaux restants et nous avons pu inscrire cela dans la loi en 2012. Aujourd'hui, donc, 90 % du coût des travaux sont pris en charge, les 10 % restant à la charge des habitants s'expliquent par le fait que ces travaux améliorent, en particulier, la qualité thermique des logements. Nous étudions toutefois en ce moment, avec la Caisse des dépôts et consignations, la possibilité de prise en charge de ces 10 % restants pour les foyers les plus modestes. Il existe donc un itinéraire de prise en charge qui rend possibles ces mesures de protection complexes.
En parallèle, les services de l'État ont conçu les PPRT, dont les collectivités, via les plans locaux de l'urbanisme, doivent assurer la mise en oeuvre dans les décisions en matière d'urbanisme.
Tout ce travail, qui a pour objet la prévention auprès des populations, la maîtrise des risques et leur limitation dans les installations industrielles concernées, a demandé beaucoup de temps. C'est pourquoi les administrateurs d'Amaris, lorsqu'un accident se produit, espèrent qu'il ne donnera pas lieu à de nouvelles règles : il a fallu quinze ans pour mettre en place une réglementation conçue en 2003 ; nous préférerions que l'on achève son application avant d'imposer de nouvelles mesures.
En matière de protection des populations, la France est donc dotée d'une loi efficace, et qui permettra, si elle est bien déployée, d'atteindre l'objectif de protection des riverains formulé après l'accident d'AZF.
Reste le problème de gestion de crise qu'a posé Lubrizol. Malheureusement, peu de progrès ont été accomplis et peu d'enseignements ont été tirés des retours d'expérience d'autres accidents industriels. La déléguée générale d'Amaris me faisait ainsi remarquer que l'on retrouvait, dans les reportages qui ont suivi l'accident d'AZF, les mêmes réactions de riverains : ils se plaignent de n'avoir pas été prévenus à temps, de ne pas disposer d'information claire et précise. Nous estimons que les systèmes utilisés pour prévenir les populations, ainsi que la chaîne de gestion de crise, ne sont pas au point. Les sirènes, par exemple, ne sont pas efficaces. Une étude menée dans les Bouches-du-Rhône, où il y a des sites industriels importants, comme Fos-sur-Mer, montre que celles-ci n'atteignent que 35 % de la population, alors que les réseaux sociaux peuvent en informer 70 % dans le même temps. Moi-même, qui suis un peu averti sur le sujet, je ne suis pas certain de pouvoir reconnaître les différentes sirènes indiquant la nature des dangers.
Il existe d'autres systèmes, notamment le Cell Broadcast, grâce auquel tous les opérateurs téléphoniques dans un certain périmètre diffusent une alerte sur tous les supports, portables et autres, de façon immédiate. Ce système fonctionne dans d'autres pays, comme les États-Unis, les Pays-Bas ou le Japon.
Nous observons également un dispositif utilisé en Belgique, qui fonctionne selon une logique complètement différente, que nous trouvons pertinente. Le Centre de crise national répond directement aux questions que posent les personnes concernées par un accident au moment où il se produit. L'expérience montre que ce que l'on perçoit d'un accident industriel et sa réalité peuvent grandement différer. J'ai ainsi assisté à un feu de bac dans la raffinerie de Feyzin, qui contenait de l'eau et une fine couche d'hydrocarbures et qui avait été touché par la foudre ; l'incendie était sans aucune gravité, mais visuellement très impressionnant. On constate cela à propos de Lubrizol : la taille du panache de fumée ne donne aucune indication sur la réalité du danger.
Ce système belge ne s'attache pas à donner des informations très verticales par tweets, comme le font aujourd'hui les préfets, lesquelles, certes, s'approchent de la vérité scientifique, mais ne correspondent pas à ce qui intéresse l'opinion ; il apporte des réponses aux questions posées sur les réseaux sociaux, élaborées par des spécialistes éclairés que la plateforme parvient à mobiliser. Cela fonctionne bien, et, selon nous, c'est mieux adapté et beaucoup plus efficace pour apporter des réponses aux habitants concernés.
La manière de prévenir n'est donc pas au point en France, mais le ministère de l'intérieur considère qu'il s'acquitte de sa responsabilité en gérant le système d'alerte et d'information des populations. Un de vos collègues, M. Jean-Pierre Vogel, a rendu un excellent rapport sur le sujet, dont nous soutenons les conclusions.

Nous rappellerons au ministère que les deux assemblées y accordent la plus grande importance.
Outre l'information des populations, en matière de gestion de crise, la qualité du lien entre le préfet, qui déclenche le plan particulier d'intervention (PPI), et les élus locaux, qui sont comptables du déclenchement du plan communal de sauvegarde (PCS), compte. Sur ce plan, il y a beaucoup de progrès à faire en matière de coopération pour que l'information soit fluide, car ce n'est pas toujours le cas. S'agissant de situations d'urgence, il faut de l'entraînement, des exercices, qui permettent d'être dans le bon timing.
Rouen est une grande ville, mais Amaris se penche aussi parfois sur le cas de toutes petites communes : j'ai à l'esprit le cas de Céré-la-Ronde, commune de 200 ou 300 habitants qui comporte des zones de stockage de gaz considérables dans son sous-sol. Son maire n'est pas en capacité d'élaborer seul un plan communal de sauvegarde à la hauteur du danger ; saisi, le ministère de l'intérieur renvoie vers le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), le SDIS est débordé et n'a pas de temps à consacrer à cela - c'est une impasse.
Lorsque les services sont suffisamment développés, les plans communaux de sauvegarde sont bien faits, même si leur chaînage avec l'autorité préfectorale peut être perfectionné ; en revanche, dans de petites communes, l'appui des intercommunalités et des services de l'État est vraiment indispensable pour que ces plans soient à la hauteur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Vous indiquez que, depuis la loi Bachelot de 2003, seuls 600 logements ont été l'objet des travaux requis sur les 16 000 qui sont concernés. Quel serait le coût de ces travaux pour les logements qui restent à aménager et combien de temps faudrait-il pour les mener à bien ?
Ces travaux, dites-vous, doivent être réalisés, parce qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour que les catastrophes que l'on a connues ne se reproduisent pas. Au-delà des financements disponibles, comment améliorer la manière dont l'État, les collectivités territoriales et les industriels jouent leur rôle ?
Il est difficile de vous répondre sur le temps nécessaire. À partir de la publication d'un PPRT, les riverains ont huit ans pour actionner leurs droits. Aujourd'hui, la quasitotalité des PPRT a été publiée, mais l'on peut considérer que les plus simples, qui ne requéraient pas tous des travaux, l'ont été en premier et les plus complexes en dernier. On peut sans doute considérer que, en 2025, l'échéance aura été atteinte pour la majorité des plans.
Sur le coût, il est impossible de vous répondre, parce que chaque logement doit faire l'objet d'une analyse par un bureau d'études, qui indiquera les risques auxquels il est exposé : risque thermique, toxique, surpression, etc. Les travaux sont donc spécifiques à chaque logement.
À titre d'exemple, si le logement est exposé à l'incendie, il faudra appliquer une peinture qui amortit la chaleur ; s'il s'agit de surpression, issue d'un phénomène de Bleve, par exemple, on remplace les cadres de fenêtres pour les renforcer par triple ancrage avec un vitrage renforcé selon la distance, éventuellement un filmage pour éviter que le verre n'explose, ou on pose un haubanage sur les cheminées ; face au risque toxique, on aménage une pièce de confinement dans laquelle les habitants pourront s'isoler durant deux heures.

C'est un peu paradoxal : la proximité d'un site Seveso dévalue les logements, mais on impose des obligations aux propriétaires. Si les travaux ne sont pas effectués, les assureurs font-ils pression sous peine de ne pas rembourser en cas d'incident ?
Il y a une sorte d'impensé sur ce point. Les assureurs nous indiquent que le risque technologique est inclus dans les primes habituelles, mais si un jour un accident se produisait, qui causait un décès dans une maison n'ayant pas fait l'objet de travaux, je ne réponds pas des responsabilités.

S'agissant des processus d'indemnisation en cas d'accident industriel, quels sont les principaux dispositifs, et pour quels bénéficiaires ? Les collectivités territoriales prennent-elles des initiatives spécifiques en la matière ?
Je n'ai pas connaissance de règle générale, chaque accident est particulier et l'on prend en compte les dégâts qui lui sont propres. Il existe un fonds d'indemnisation national, abondé par les industriels, l'État et les assurances, me semble-t-il.

Pour Lubrizol, nous avons relevé un problème d'information des maires, qui ont été mis dans la boucle très tardivement. Dans le cadre de la mise en oeuvre des PPRT, savez-vous si des expériences d'organisation particulière de la diffusion de l'information à destination des élus ont été menées, dans le cadre de la promotion de la culture du risque industriel ?
La population a, quant à elle, eu des difficultés à comprendre les sirènes et à en déduire l'attitude à adopter, ce qui démontre le manque d'exercices préventifs. D'après les retours d'expérience, à quelle fréquence ceux-ci devraient-ils être organisés pour sensibiliser les populations ?

Vous avez dit sur le ton de l'humour que vous ne souhaitiez pas que la réglementation évolue. Cependant, des assouplissements ont déjà été apportés en matière, notamment, d'études de dangers. Notre commission traitera sans doute de ce sujet.
En outre, cet accident ne diffère-t-il pas de ceux qui ont servi de socle à l'élaboration de la présente législation ? Il n'a en effet fait aucune victime immédiate, mais fera peut-être des victimes à terme. Il pourrait donc s'agir d'un nouveau cas d'accident industriel, imposant de nouvelles pistes.
Enfin, les PPRT et les dispositifs que vous avez évoqués concernent des zones qui se trouvent à proximité des sites, mais un panache de fumée va très loin, bien au-delà du périmètre du PPRT et gagne plusieurs départements. Les outils de planification existants ne sont donc peut-être pas adaptés.
Sur la temporalité des expériences, on sait que les vingt premières minutes sont les plus compliquées parce qu'on ne sait pas quoi dire à la population, il y a un temps de latence - qui a peut-être été trop long pour Lubrizol - nécessaire pour donner consignes éclairées. C'est pourquoi j'insiste auprès de vous sur les améliorations à apporter au moment de la conception des PPI par les préfets afin que les maires y soient bien associés.
Aujourd'hui, le maire, s'il ne souhaite pas trop s'avancer, dispose d'une fiche réflexe fournie par les autorités préfectorales, l'industriel a également la sienne, mais ce n'est pas suffisant.
L'élaboration des schémas d'information, de sauvegarde et de gestion de crise doit être plus collégiale, afin que les élus soient mieux informés et puissent piloter ce qui leur incombe : ils sont censés participer à l'évacuation, mettre des équipements publics équipés à disposition de la population, prendre toute une série de mesures qui nécessitent une bonne synchronisation avec la préfecture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
S'agissant des moyens de prévenir, il en existe, et beaucoup de communes qui ont des sites Seveso les utilisent. Je pense, par exemple, aux standards automatiques d'appel qui équipent une partie des communes concernées. Certaines villes, comme Gonfreville-l'Orcher, où se trouve une raffinerie, ont développé leur propre système d'alerte, avec des dispositions particulières à destination des personnes malentendantes. Sur cet aspect, on progresse donc beaucoup.
Sur la sensibilisation de la population, les dispositions réglementaires ne sont pas suffisantes ; pour autant, il n'en faut pas plus. Il existe des commissions de suivi de site (CSS), qui sont des lieux d'information, mais, pour avoir participé à la CSS de la raffinerie de Feyzin, ce sont des instances un peu magistrales dans lesquelles le préfet, les services d'incendie et de secours, les élus et quelques habitants reçoivent une information technique de haut niveau. Seulement deux habitants y assistaient ! On n'y pratique pas du tout la vulgarisation qui permettrait à la population de comprendre, de se familiariser avec la situation ou de savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur de l'usine.
Dans ma commune, nous avons mis en place une conférence riveraine qui se réunit trois fois par an. Elle comprend le directeur du site, le maire et quarante riverains, et permet de faire le point sur l'activité de l'usine, pas seulement sur les risques, mais aussi sur les questions de santé ou d'emploi.
On peut donc favoriser la culture du risque sans créer de psychose, à condition de mener un travail régulier qui, d'une certaine manière, échappe à la logique réglementaire. Les maires sont les mieux placés pour cela.
Madame la Sénatrice, vous évoquez les aspects spécifiques de l'accident de Lubrizol. On ne peut y répondre que par la mise en place d'un observatoire de la santé, sur plusieurs années, des personnes qui se sont trouvées sous le panache, pour évaluer ses éventuelles conséquences sanitaires. C'est une situation particulière, le dernier panache dont nous avons entendu parler était celui de Tchernobyl, auquel on ne peut pas ne pas penser, même si ses conséquences auront sans doute été très différentes.

Nous avons rencontré les représentants du personnel de Lubrizol, qui ne s'expliquaient pas la violence de l'incendie, alors même qu'ils ont la culture du risque et qu'ils sont formés.
Je vous rejoins sur l'idée qu'il faut améliorer l'articulation entre les pouvoirs de police spéciale du préfet, qui est chargé de l'élaboration du PPI avec les industriels, et les maires. J'ai été maire d'une commune de 5 000 habitants comprenant une usine classée Seveso, mais je n'ai jamais été convié aux discussions entre l'industriel et l'État. Je n'obtenais des informations que de l'industriel lui-même, car nous entretenions de bons rapports. Pourtant, c'est le maire qui est amené, par exemple, à évacuer ; il devrait donc être associé. Pour Lubrizol, ce problème est apparu de manière criante.
C'est aussi mon expérience. Comme maire de Feyzin, j'ai connu des accidents à la raffinerie, mais aussi à l'occasion d'un exercice en situation avec le préfet du Rhône, j'ai ainsi vécu le déclenchement de l'alerte par un standard automatique, les consignes d'évacuation, les décisions qu'il faut prendre très vite, en pesant sa responsabilité, en mobilisant les services municipaux pour canaliser la population. Seuls les maires peuvent le faire, ne serait-ce que parce qu'ils en ont les moyens matériels, les barrières pour régler la circulation et diriger les habitants et une connaissance fine du terrain. Ces compétences doivent être parfaitement synchronisées avec les services de l'État, afin que ceux-ci se concentrent sur les causes de l'accident.

Il a été question des relations entre la préfecture et les élus locaux, qui s'améliorent grâce à des exercices. Existe-t-il une réglementation sur le sujet ? À quelle fréquence faut-il les organiser ?
Dans le Rhône, il y a 23 usines classées Seveso, comment fait-on pour organiser des exercices dans tous ces sites ?

Nous avons vu, sur le site, que l'équipe d'intervention était bien rodée, qu'elle faisait des exercices chaque semestre et que le SDIS avait tiré des enseignements d'expériences précédentes.

Il s'agissait seulement d'améliorer la relation entre préfecture et élus.

Certains élus, pour peu qu'ils ne soient pas de la commune concernée, n'ont d'ailleurs aucune information et sont complètement démunis.
Il n'y a pas d'obligation d'organisation d'exercices coordonnés entre les services de l'État, les SDIS, les services de protection des entreprises et les collectivités territoriales, mais c'est une démarche tout à fait vertueuse.

Ce n'est pas normal. Dans les établissements scolaires, l'organisation d'un exercice d'évacuation est obligatoire dans le mois de la rentrée. Nos préconisations incluront peut-être l'organisation d'exercices réguliers dans les établissements Seveso.
Des exercices sont organisés par les industriels dans les sites eux-mêmes.

Il reste à les coordonner avec l'environnement du site afin que se développe la culture du risque et que tous acquièrent des réflexes.
Tout à fait.

Je vous remercie de votre participation.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 18 h 25.