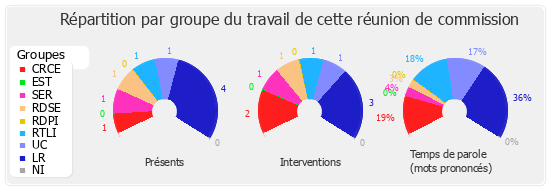Délégation sénatoriale à la prospective
Réunion du 9 avril 2020 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Merci beaucoup, Monsieur Djaïz, d'avoir accepté notre invitation. La réunion de ce matin se tient sous forme de visioconférence compte tenu des circonstances. J'indique à mes collègues que vous avez 29 ans, que vous êtes normalien et inspecteur des finances et que, depuis quelques mois, vous occupez la fonction de directeur de la stratégie et de la formation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Vous avez publié récemment un ouvrage de réflexion sur la mondialisation ainsi que des articles sur les conséquences de celle-ci au regard de l'épidémie actuelle. C'est sur ce thème que nous souhaitons vous interroger ce matin.
Merci, monsieur le président, de votre invitation.
Mon dernier ouvrage, Slow Démocratie, est une tentative de penser l'action publique à l'heure de la mondialisation. Il trouve un écho intéressant dans la crise sanitaire actuelle, qui peut être lue comme une intensification et une amplification des problèmes qui se posent depuis plus de 40 ans, mais qui n'ont jamais été véritablement pensés dans toute leur radicalité.
Durant les Trente Glorieuses, l'équation entre la politique et l'économie se jouait à un niveau largement national : il s'agissait d'assurer une juste répartition de la richesse entre le capital et le travail, dans une économie relativement fermée (avec un taux d'ouverture de 10 % en moyenne pour la France) et avec une croissance élevée (environ 5 % par an), dans le contexte du gigantesque effort de reconstruction entrepris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout le sens du compromis gaulliste, qui conjuguait le « national » et le « social » : redistribuer les fruits de la croissance, tout en assurant que les salaires n'augmentent pas plus vite que la productivité pour éviter l'inflation.
Puis la mondialisation est arrivée, et avec elle un désajustement total de la politique et de l'économie. Les choses sont allées très vite : en quelques années, le taux d'ouverture de notre économie est passé à 35 %, et l'intégration financière s'est considérablement accélérée dans les années 1980. Deux facteurs principaux expliquent cette « hypermondialisation » : la chute de l'URSS d'une part, avec l'entrée de centaines de millions de travailleurs à bas salaire sur le marché mondial, et l'irruption du numérique d'autre part, qui a permis une chute des coûts de coordination et donc une fragmentation des chaînes de valeur.
Pendant vingt ans, cette mondialisation a suscité un enthousiasme immodéré - après tout, elle permettait la sortie de la pauvreté de centaines de millions de personnes, tandis que la fin de la Guerre froide laissait place à l'espoir d'une unification par le « doux commerce ».
Pourtant, dans le même temps, d'autres fractures étaient en train de naître, sans qu'on n'y prête suffisamment attention.
Premièrement, des fractures sociales, à l'intérieur des États-nations occidentaux, sont apparues : les « perdants » de la mondialisation et de la numérisation sont tous ces métiers intermédiaires qui peuvent être soit délocalisés, soit remplacés par des ordinateurs (contremaîtres, assistantes de direction, etc.), tandis que seules demeurent les fonctions à haute valeur ajoutée, de direction ou encore de R&D. C'est la « bipolarité » décrite par David Reich entre les « manipulateurs de symboles » (de chiffres, de tableurs Excel, de rapports...) et les « valets » qui se retrouvent relégués dans des métiers de services à faible valeur ajoutée.
Deuxièmement, des fractures territoriales, que l'on n'a pas assez vues dans les pays occidentaux car la dette publique, en évitant à des territoires entiers de sombrer, a agi comme un antalgique : ainsi la Lorraine a-t-elle été facilement « sauvée », lorsqu'elle a perdu son industrie sidérurgique, par des transferts publics massifs sous la forme de subventions, d'emplois de fonctionnaires, etc. Aux États-Unis, où l'intervention publique n'a pas le même poids, des villes comme Detroit et Baltimore ont littéralement sombré et fait faillite lorsque la crise a touché l'industrie automobile. Mais, partout, la crise financière de 2008 a mis un coup d'arrêt à l'antalgique que constituait la dépense publique.
Troisièmement, des fractures aggravées par l'existence de chocs exponentiels. En l'absence d'« écluses » ou de politiques de prévention, un choc local peut devenir une crise globale - ces « crises-monde » dont parlait Fernand Braudel. C'est ce qui s'est passé avec la crise des subprimes de 2008, qui était initialement une crise sur le marché du crédit immobilier américain et qui s'est muée en catastrophe mondiale par le jeu de l'imbrication des bilans bancaires et de l'appétit des institutions financières pour le dollar. D'une certaine manière, c'est aussi le cas de la crise du coronavirus : elle est apparue sur le marché aux animaux de Wuhan, ville qui se trouve être aussi un point nodal de la mondialisation industrielle, reliée aux aéroports du monde entier.
Parmi les outils théoriques qui permettent de penser ce nouveau paradigme, on peut évoquer le « triangle d'incompatibilité » de l'économiste turco-américain Dani Rodrik : on ne peut pas avoir tout à la fois les bénéfices de l'hypermondialisation, de l'État-nation, et de la démocratie. Il faut forcément abandonner l'un des trois « côtés » du triangle.
Par exemple, Singapour est un pays hypermondialisé (c'est l'un des principaux hubs financiers de la planète), mais également une nation très souverainiste : le prix à payer est une certaine mise en sourdine de la démocratie, l'unanimité nécessaire à cette insertion dans la mondialisation s'accommodant mal du pluralisme qui fait la vitalité démocratique. Or un tel compromis n'est pas désirable, et il est du reste bien plus facile à mettre en oeuvre dans des cités-États tels que Singapour et le Qatar que dans des États-nations de type européen.
À l'inverse, on peut vouloir conserver la mondialisation et la démocratie : c'est l'idée du fédéralisme européen, dont l'horizon est un marché unique régi par le droit, mais qui implique des abandons de souveraineté de la part des États-nations. Mais à vrai dire, l'Union européenne a voulu le beurre et l'argent du beurre : l'hypermondialisation (avec la monnaie unique, la libre circulation, etc.), la démocratie, mais aussi la conservation de la forme nationale, les États du « Nord » refusant ainsi obstinément de mutualiser leur dette avec ceux du « Sud ». Le résultat affligeant de la réunion de l'Eurogroupe du 8 avril 2020 n'en est qu'une nouvelle illustration.
En réalité, la forme nationale apparaît difficile à remplacer - et pas seulement en Europe. Ainsi, les résultats du World Value Survey confirment, au fil des enquêtes menées dans quelque 79 pays, que l'attachement au niveau national tend plutôt à se renforcer au fil du temps, y compris d'ailleurs au détriment du niveau local dans des pays « mosaïques » comme l'Inde. L'échelon national est le seul où l'on retrouve véritablement à la fois le consentement à l'impôt et la solidarité nationale.
Ce grand retour de la nation peut être « subi » : c'est ce que nous voyons avec l'élection de nombreux leaders populistes ces dernières années. Mais il peut aussi être « voulu » : c'est le sens du projet proposé dans Slow Démocratie.
Le choix, celui qu'impose le « triangle de Rodrik», est le suivant : soit une décélération de la démocratie - et notre horizon est celui d'un libéralisme autoritaire à la façon de Singapour ; soit une décélération de la mondialisation - étant entendu qu'il ne s'agit pas pour autant de revenir à notre « village d'Astérix ». Du reste, la mondialisation est en crise - il suffit pour s'en convaincre de constater le retour de l'unilatéralisme américain, la faiblesse de l'Union européenne, la vulnérabilité des pays exportateurs comme l'Allemagne ou encore la montée des discours autarciques -, et cette décélération est aussi un moyen de la sauver.
Dans cette perspective, plusieurs propositions concrètes, qui dépassent le traditionnel clivage gauche/droite, peuvent être esquissées.
La première serait de cartographier les actifs stratégiques et la chaîne de valeur. C'est un chantier inévitable, qui s'annonce avec les médicaments (80 % des principes actifs sont aujourd'hui fabriqués en Inde et en Chine), et qu'il faut étendre à l'alimentation (l'UE importe 90 % de ses protéines végétales pour l'élevage), à l'énergie et bien sûr aux nouvelles technologies (en témoigne notre retard dans la 5G ou l'Internet des objets).
La deuxième piste consiste à développer une culture du risque beaucoup plus forte, qui n'empêche pas la vigilance, comme ont su le faire des nations comme Singapour, la Corée du Sud ou encore Israël.
La troisième est de réviser nos accords commerciaux, non pas pour les défaire complètement mais pour y ajouter des « écluses » environnementales, sanitaires, sociales ou fiscales. Les tarifs douaniers ne sont ni la seule solution ni la plus pertinente car ils pénalisent les importateurs. En revanche, l'intégration dans le prix des dommages causés, par exemple, à l'environnement est une bonne piste.
La quatrième orientation concerne la hiérarchie des biens et des services. La baisse des prix consécutive à la déréglementation ne se vérifie pas en effet dans toutes les catégories, et nous devrions nous en préoccuper : nous payons certes moins cher notre smartphone ou notre télévision, mais ce n'est pas forcément le cas pour des services essentiels comme le logement, l'éducation ou encore la santé - du moins dans des pays comme les États-Unis, où la dépense publique ne permet pas de compenser la hausse des prix.
Ma dernière préconisation est de penser la réconciliation des territoires qui ont été « détraqués » par la mondialisation - sujet qui me tient particulièrement à coeur, en tant que directeur de la stratégie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Il s'agit, d'une part, de conserver dans ces territoires des activités compétitives et industrielles, ce qui ne pourra pas se faire en se reposant sur la seule intervention de l'État : plusieurs exemples dans l'Ouest de la France montrent que les acteurs privés peuvent aussi jouer un rôle. Il s'agit, d'autre part, de rendre leur dignité à ces 80 % d'emplois « sédentaires » qui ne sont pas menacés par la mondialisation (boulanger, boucher, aide-soignante, caissier, etc.) mais qui ont été trop longtemps sous-estimés, et pour lesquels l'effort de rémunération, d'investissement et de formation est insuffisant. Les perspectives de développement sont pourtant nombreuses, de la rénovation thermique des logements au passage au bio dans les cantines.
Cette décélération de la mondialisation dans les secteurs stratégiques - une forme de « nouveau Bretton Woods » - présente un autre avantage, celui de s'orienter sans fracas vers un modèle économique à bas carbone. Mais, pour tout cela, un grand niveau de consensus politique national est nécessaire.

Merci pour ces propos très intéressants et merci à Jean-Raymond Hugonet d'avoir suggéré votre invitation.

Je regrette que cette lecture des choses soit avant tout d'ordre intellectuel, comme si le problème venait d'une mauvaise compréhension des mécanismes à l'oeuvre et des mauvais choix qui en ont résulté. Il n'en est rien : la situation actuelle résulte avant tout d'un rapport de force, et le recul historique de la puissance publique face à la mondialisation libérale ne conduit pas à être optimiste. Il ne suffira pas de « mieux réfléchir pour mieux y arriver ».
L'évolution du rapport de force résulte à la fois d'intérêts sociaux et économiques. Sur le plan social, l'éloignement des structures de décision du « chaudron » démocratique a été théorisé dès les années 1960, avec les discours sur l'« ingouvernabilité » de la démocratie, dont le rapport rédigé en 1965 par Michel Crozier et Samuel Huntington pour la Commission trilatérale, intitulé The Crisis of Democracy, est un bon exemple. Sur le plan économique, l'offensive victorieuse des néoclassiques dans les années 1970 a fait de la déréglementation et de la lutte contre l'inflation les nouvelles priorités politiques. Ces deux types de facteurs ont abouti à un système politique décorrélé de la démocratie nationale.

Il s'agit du fond du problème. Je renvoie, à cet égard, au rapport rédigé sur la crise bancaire et financière.
Les rapports de force vont être profondément remodelés par la crise actuelle - en quelques semaines, dix millions de personnes ont été licenciées aux États-Unis ! Tout l'enjeu pour les gaullistes et les sociaux-démocrates sera de construire des coalitions politiques pour apporter des solutions.

Je remercie chaleureusement Monsieur Djaïz pour l'énergie de son propos et l'exactitude de sa vision, impressionnante à 29 ans seulement. Comme le disait déjà Philippe Séguin dans son discours prononcé le 5 mai 1992 à l'occasion de la discussion du traité de Maastricht, cela fait 35 ans que toute une oligarchie de fonctionnaires et autres juges non élus prend, au nom du peuple, des décisions sans en avoir reçu le mandat. Comment peut-on lutter contre le travail de sape organisé par cette haute administration dont le Président de la République est lui-même un représentant ? Ce dernier, d'ailleurs, a-t-il lu votre ouvrage ?
Oui, j'ai envoyé mon ouvrage au Président de la République, mais j'ignore s'il la lu. Il ne faut pas faire de l'administration le bouc-émissaire : lorsqu'il n'y a plus de vision politique, plus de projet de société, alors l'administration se met en « pilotage automatique » avec pour seul mandat d'assurer une trajectoire - en l'occurrence une trajectoire budgétaire. Il ne faut pas attendre de l'administration qu'elle joue un rôle qui n'est pas le sien : c'est aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités et de fixer un cap, et l'administration suivra.

Je partage l'idée d'un nécessaire renforcement de l'État, mais comment cela peut-il se concilier avec la décentralisation ?
C'est un sujet majeur : les vagues de décentralisation se sont contenté de transférer des compétences successives, mais sans jamais poser vraiment la question de ce que devrait être le pouvoir local par rapport au pouvoir national. Il convient de dépasser les oppositions datées entre jacobins et girondins, entre souverainisme et fédéralisme. Chaque échelon doit avoir sa mission.
La mission de l'Europe devrait être avant tout la production de biens publics, compte tenu des investissements importants qu'impose la préparation de l'avenir : transition énergétique et agricole, recherche médicale, numérique, etc. Mais puisque les États ne sont pas disposés à mutualiser leur effort budgétaire, l'UE se résume aujourd'hui à un marché unique et à des règles de droit.
La mission de l'État devrait être avant tout régalienne : il s'agit de protéger les citoyens des crises qui les frappent, que ce soit en matière de sécurité (au lendemain des attentats du 11 septembre 2001), en matière économique (avec la crise de 2008-2010), ou comme aujourd'hui en matière sanitaire. C'est aussi à l'État qu'incombe prioritairement la mission de redistribution et de répartition des richesses, dans un contexte où les inégalités sociales et territoriales se creusent.
La mission des collectivités territoriales, enfin, est fondamentale : il s'agit d'accompagner le changement de modèle dans la proximité, en s'appuyant sur leur capacité à structurer les systèmes locaux. Mais ce rôle doit être « pensé », et ne pas se réduire à des transferts de compétences.

Je partage l'idée d'une intégration des externalités négatives dans les prix des biens et des services. Mais votre réflexion s'étend-elle à la valorisation des externalités positives, par exemple avec les « puits à carbone » ?
Je ne suis pas spécialiste de ces questions mais il me semble en effet qu'il s'agit d'une voie à suivre.

On ne peut pas faire semblant de découvrir aujourd'hui des problèmes qui, en réalité, sont connus depuis des années : la dépendance en matière de médicaments ou d'alimentation, la désindustrialisation, la financiarisation, etc. Ils remontent à l'époque où les « financiers » ont pris le pouvoir sur les « industriels ». Face à ce phénomène, l'UE est désunie et les États membres sont en concurrence les uns avec les autres. Nous sommes donc dos au mur. Si vous étiez Président de la République, quelle serait votre première décision ?
Un système fondé sur la règle de droit, comme celui de l'UE, est en effet un système qui favorise la moins-disance. L'exemple des Pays-Bas, qui capte les recettes fiscales des autres États membres et qui aujourd'hui refuse de participer à l'effort commun de relance, est éloquent.

L'idée de réindustrialiser les territoires ruraux, de remettre « des usines à la campagne », n'est pas nouvelle - mais encore faut-il y mettre les moyens, entretenir les routes, déployer la fibre optique, etc. Les collectivités n'ont plus cette capacité : qu'en est-il de l'État et de l'UE ? En tant qu'élu de la Vienne, je vois avec regret aujourd'hui les jeunes chercheurs quitter Poitiers pour Bordeaux, devenue la folle capitale d'une immense région Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, le choix d'installer une technopôle dans un territoire rural - comme ce fut le cas avec le Futuroscope - apparaît impossible.
La question de la réindustrialisation des territoires et de la relocalisation de la chaîne de valeur va nécessairement se poser. Elle est d'ores et déjà à l'oeuvre, depuis le milieu des années 2010, mais plutôt au niveau des grandes régions du globe (Amérique, Asie, Europe...). Mais ce chantier immense doit être pensé, car la réindustrialisation du « monde d'après » ne ressemblera pas à l'industrie du « monde d'avant » : on ne parle pas forcément d'usines, mais surtout de technologies, de logiciels, d'énergie etc. L'organisation du travail doit aussi être repensée : si le besoin de grandes emprises physiques est moindre qu'auparavant, le développement du télétravail ainsi que la transition énergétique offrent en revanche des perspectives importantes aux territoires ruraux et périurbains, ainsi que l'a bien souligné Éric Charmes dans son récent essai La revanche des villages.
En tout état de cause, rien ne se fera sans un immense effort d'investissement public, si possible au niveau européen. Ceci pose la question du plan de relance qui est en préparation : en 2008-2009, il fallait dépenser vite, quitte à ne pas toujours dépenser bien - de nombreux ronds-points ont été construits... Les choses sont différentes aujourd'hui : la demande va repartir d'elle-même, c'est donc l'occasion de dépenser mieux. Par exemple, le nécessaire sauvetage d'Europcar pourrait être l'occasion de demander à cette entreprise de s'engager sur la voie de l'hybride et de l'électrique, ce qui doperait ensuite la filière européenne de batteries que la France et l'Allemagne souhaitent construire.

Pour apporter des solutions concrètes dans les territoires - qu'il s'agisse comme aujourd'hui de trouver des masques et des blouses, ou plus généralement de soutenir le tissu économique local -, il faut de l'« immédiateté », ce qui semble peu compatible avec la « médiation » de l'administration centrale et ses lourdeurs.
C'est bien là que se trouve la force des collectivités locales : délivrer un service immédiat et de proximité. Il ne faut pas hésiter à aller plus loin dans cette voie - sans que cela remette en cause l'importance de la « médiateté » de l'État, par exemple en matière de protection sociale. En tout état de cause, ce sont ces métiers sédentaires du soin, du lien, du liant - soignants, enseignants, caissiers, etc. - qui font tourner la société, qu'on ne remarque pas lorsque tout va bien mais dont on mesure - comme en ce moment - toute l'importance dès qu'il y a un problème.

Quels moyens a-t-on pour enrayer le phénomène de métropolisation et de redonner une place aux territoires ruraux ?
Le problème du débat entre les « pro » et les « anti »-métropolisation est qu'il favorise une défiance réciproque et l'accumulation de griefs mutuels, alors qu'il faudrait au contraire encourager les synergies et l'horizontalité entre les strates - du bourg à la métropole en passant par les petites villes et les villes moyennes. De telles coopérations sont trop rares aujourd'hui, et dépendent beaucoup des élus. Notre système est resté très vertical : hier l'État majestueux concédait des compétences, aujourd'hui les collectivités lui demandent des moyens. La résilience de l'Allemagne tient en partie à cette capacité de l'ensemble des acteurs locaux - collectivités, entreprises, associations, structures familiales, etc. - à mener un effort collectif.