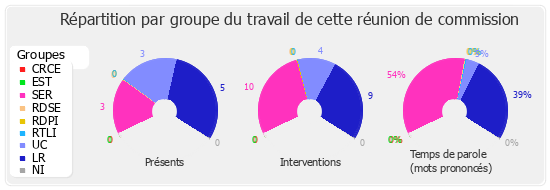Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 28 septembre 2022 à 9h30
Sommaire
La réunion
La réunion est ouverte à 9 h 30.

Mes chers collègues, les rapporteurs spéciaux de la mission « Économie », Thierry Cozic et Frédérique Espagnac, ont mené un contrôle budgétaire sur la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

L'idée de ce contrôle nous est venue à l'occasion de l'audition de la DGCCRF dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2022.
Si des enjeux importants concernant cette administration étaient apparus au cours de cette audition, tels que la réduction des effectifs ou les questions d'organisation, c'est en réalité au cours des auditions et déplacements conduits dans le cadre du contrôle que la profondeur de certains enjeux s'est révélée.
La DGCCRF dispose d'importants atouts et fait preuve d'une véritable capacité d'adaptation et de modernisation. Pour autant, elle apparaît affaiblie, d'abord en raison des réductions significatives d'effectifs qu'elle a connues depuis 2007, ensuite par la succession de réformes et de projets avortés de réformes la concernant. Ce double contexte déstabilise en outre les agents de la DGCCRF, qui nous ont souvent fait part d'un sentiment de « fatigue » et ont déploré la « perte de sens » de leur métier.
Or la DGCCRF accomplit de manière très concrète des missions qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'économie et à la protection du consommateur. Cette utilité est structurelle, mais elle l'est encore davantage aujourd'hui du fait du contexte économique. En effet, l'inflation, l'explosion des coûts de l'énergie ou encore le contexte économique international augmentent aussi bien les risques de fraude que l'importance de la protection des consommateurs et de leur pouvoir d'achat.
Attendre beaucoup d'une administration affaiblie et à laquelle l'on donne de moins en moins, c'est le dilemme auquel est confrontée la DGCCRF. Dans ce contexte, nous formulons des recommandations qui nous semblent pouvoir renforcer cette administration, au service de l'économie et des consommateurs.

Je commencerai par détailler les missions de la DGCCRF, ainsi que ses atouts et sa capacité d'adaptation et de modernisation.
Depuis sa création en 1985, la DGCCRF est chargée de trois grandes missions : elle s'assure du respect des règles de concurrence, de la protection économique des consommateurs et de la sécurité des produits et des services.
Dans ces domaines, elle n'est pas le seul acteur administratif à intervenir. D'autres administrations et autorités administratives sont compétentes, parmi lesquelles les douanes, la direction générale des finances publiques (DGFiP), l'Autorité de la concurrence et les autorités de régulation sectorielles, comme l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Dans ces conditions, une coordination entre ces autorités administratives est indispensable. En effet, si leur nombre contribue à une spécialisation fructueuse, il crée mécaniquement un risque de chevauchement et un risque d'impasses. Il est aussi susceptible de conduire à une utilisation des informations et des données en silo.
Nous avons constaté que la coopération entre ces acteurs s'est significativement accrue, en particulier ces dernières années. Toutefois, des marges d'amélioration existent et nous considérons que des efforts doivent encore être fournis pour que ces institutions forment un front commun contre la fraude. C'est pourquoi nous formulons deux recommandations, qui visent l'approfondissement de la coopération entre ces acteurs publics, avec un point d'attention spécifique concernant le partage de données.
Mais si la DGCCRF n'est pas la seule autorité administrative à intervenir en matière de concurrence et de protection du consommateur, elle en est l'acteur central.
D'une part, ses compétences ne sont pas spécifiques à un secteur ou à un domaine, contrairement à ce qu'il en est pour les autres acteurs administratifs. Elles touchent tous les champs de la consommation, que ce soit les produits ou les services, tous les stades de l'activité économique et toutes les formes de commerce.
D'autre part, ses pouvoirs sont importants, que ce soit ses pouvoirs d'information, de contrôle et d'enquête ou sa capacité à sanctionner les manquements et fraudes.
La DGCCRF est en outre une administration très active et inscrite dans le concret. En 2021, elle a mené près de 135 000 contrôles, dans plus de 90 000 établissements. Elle a adressé près de 25 000 avertissements, émis 8 000 injonctions, conduit à l'ouverture de 4 000 dossiers pénaux et prononcé 1 300 amendes.
Pour exercer ses missions, la DGCCRF sait, par ailleurs, faire évoluer ses priorités. Depuis 2019, sur le fondement de son plan stratégique 2020-2025, elle se fixe trois priorités : préférer l'enquête au contrôle routinier, se concentrer sur les risques les plus importants, et investir les nouvelles formes de l'économie et les nouveaux risques.
La DGCCRF apporte donc une plus forte valeur ajoutée à son travail en privilégiant l'enquête sur le contrôle « standard ». Elle peut ainsi s'attaquer aux risques forts et aux fraudes les plus préjudiciables. En 2022, elle a par exemple identifié les enjeux de la transition écologique et de l'économie numérique pour guider le choix de ses enquêtes.
Nous estimons que ce recentrage sur les enquêtes constitue une bonne stratégie, a fortiori dans un contexte d'effectifs contraints. Néanmoins, nous émettons une réserve. En effet, il est important qu'en parallèle de ces enquêtes, un certain nombre de contrôles routiniers soient maintenus. Sans eux, la « peur du gendarme » ne serait plus garantie.
Ensuite, la DGCCRF s'adapte aux évolutions de l'économie en s'intéressant aux nouveaux modèles économiques. Elle investit ainsi en particulier le domaine du numérique, en traitant du commerce en ligne ou des pratiques des influenceurs par exemple. Elle identifie et lutte contre les risques émergents, par exemple sur l'origine des produits et les allégations environnementales ou nutritionnelles.
En parallèle, la DGCCRF adapte ses outils et moyens d'action avec une célérité qu'il convient de souligner. En moins de trois ans, elle a mis en place un logiciel d'enquête perfectionné nommé « Sesam », utilisable par les agents lors de leurs déplacements, une structure centralisée et spécialisée d'échanges avec les consommateurs baptisée « Réponse Conso », un site internet interministériel centralisant les alertes sur les produits dangereux (rappel.conso.gouv.fr), une plateforme de signalement par les consommateurs de fraudes ou manquements d'entreprises, nommée « Signal Conso », et, enfin, une cellule de renseignement antifraude économique (la CRAFE) pour mieux détecter et enquêter sur les fraudes les plus complexes et les plus préjudiciables.
En outre, elle s'appuie sur des pratiques et pouvoirs élargis et modernisés, parmi lesquels la transaction pénale et administrative pour simplifier la procédure de sanction, le déréférencement de sites internet pour lutter contre les pratiques illégales sur internet, et la politique du name and shame pour les entreprises les plus indélicates.
Enfin, la plus grande force de la DGCCRF que nous ayons identifiée à l'occasion de notre contrôle est peut-être la qualité et l'implication de ses agents, dont le mode de recrutement et de formation spécifique a fait ses preuves. La DGCCRF peut donc s'appuyer sur des atouts importants et une véritable capacité d'adaptation et de modernisation.
Pour autant, le contrôle a été l'occasion de constater que la DGCCRF est également une administration affaiblie.

Affaiblie, la DGCCRF l'est tout d'abord et surtout du fait de la baisse de ses effectifs. En quinze ans, depuis 2007, ses effectifs ont été réduits d'un quart. Alors que 3 723 équivalents temps plein travaillé (ETPT) avaient été consommés en 2007, 2 812 ETPT devraient l'être au maximum en 2022, soit une diminution de 911 ETPT. C'est considérable pour une petite administration avec des missions étendues. Une part de la baisse des effectifs est certes liée à des transferts de compétences, notamment vers l'Autorité de la concurrence ou le service commun des laboratoires, mais la réduction nette d'effectifs concerne près de 400 ETPT.
Dans ces conditions, nous avons constaté sans surprise que les équipes étaient mises sous tension, et que la bonne exécution des missions de la DGCCRF était parfois menacée. C'est a fortiori le cas dans les territoires peu dotés en personnels. Pour vous donner une idée, en 2010, dans l'Hexagone et en Corse, aucun département ne comptabilisait moins de 8 ETPT. En 2021, quatorze départements disposaient de 5 ETPT ou moins. Au-delà de ces chiffres, un exemple montre la gravité de la situation dans certains territoires : dans le Lot, le nombre très faible d'agents, auquel il faut ajouter les congés et départs, a abouti à ce que les services de la répression des fraudes n'aient temporairement qu'un seul agent en poste pour tout le département au cours de l'année 2022...
Or les réductions d'effectifs conduisent mécaniquement, in fine, à limiter le nombre des enquêtes et des opérations de contrôle. En outre, en dessous d'un certain seuil d'agents, ceux-ci perdent en spécialisation et les enquêtes et contrôles baissent en qualité. Et si les mutualisations interdépartementales mises en place dans les territoires les moins dotés peuvent être utiles, elles ne suffiront absolument pas à répondre à la baisse des effectifs.
Face à cette situation, nous estimons qu'il est indispensable de réagir, afin de donner à la DGCCRF les moyens d'exercer ses missions sur l'ensemble du territoire.
Nous proposons donc l'établissement d'un effectif « socle » de 7 ETPT par département. Ce seuil a été identifié comme un plancher garantissant un minimum de spécialisation des équipes. Nous rappelons de nouveau, pour ceux qui s'inquiéteraient de la légitimité d'une telle hausse, qu'en 2010 tous les départements de l'Hexagone disposaient d'au moins 8 ETPT.
La mise en place de ce socle ne pourra raisonnablement se faire par le biais du redéploiement d'agents au niveau national. En effet, la tension sur les effectifs est une réalité sur tout le territoire et à tous les échelons de la DGCCRF. Il faudra donc prévoir de recréer quelques postes : moins de 50 ETPT selon notre estimation sur les 911 ETPT qui ont été supprimés au cours des quinze dernières années. Nous notons d'ailleurs que, dans le dossier de presse du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement annonce des renforts d'effectifs pour l'année prochaine. Si nous n'en connaissons pas le détail exact, nous nous félicitons de cette évolution.
La deuxième raison pour laquelle la DGCCRF est affaiblie tient à la succession des réformes l'affectant, qu'elles soient d'ailleurs mises en oeuvre ou finalement avortées. La DGCCRF a d'abord connu d'importantes modifications de son organisation déconcentrée depuis 2009. Depuis cette date, les services déconcentrés sont en effet rattachés à des directions départementales ou régionales interministérielles. Depuis 2021, les services régionaux sont ainsi rattachés au pôle « concurrence, consommation et métrologie », dit « pôle C », des nouvelles directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). Les services départementaux dépendent quant à eux soit d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP), soit d'une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP), selon la taille de la population.
Le rattachement à un directeur départemental interministériel, lui-même soumis au préfet, en lieu et place de l'ancienne ligne hiérarchique directe de la DGCCRF, a déstabilisé les agents départementaux. Ces derniers continuent de s'en plaindre aujourd'hui, pour diverses raisons, parmi lesquelles ce qu'ils estiment être une dilution de leurs compétences spécifiques et un manque de lisibilité de la ligne hiérarchique.
Un certain nombre de réformes ont également concerné ses compétences, parmi lesquelles le transfert en cours de la police de sécurité sanitaire des aliments vers le ministère de l'agriculture. Au demeurant, nous considérons que cette réforme est opportune. En premier lieu, elle simplifie utilement l'organisation administrative des compétences dans un domaine aussi stratégique. En second lieu, elle recentre la DGCCRF sur ses compétences premières, la protection économique du consommateur et l'ordre public économique.
Nous formulons toutefois une recommandation, qui vise à préserver la compétence du service commun des laboratoires s'agissant des analyses sanitaires des aliments qui relevaient de la compétence de la DGCCRF. Cela permettra à la fois d'assurer la qualité des analyses et de préserver le savoir-faire du service commun des laboratoires.
Plus largement, cette réforme, même opportune, appelle à la vigilance. Elle ne doit en aucun cas conduire à une dispersion progressive généralisée des compétences de la DGCCRF vers d'autres administrations. Son positionnement administratif et son rattachement direct au ministère de l'économie ne doivent pas non plus être mis en cause.
Enfin, l'hypothèse d'une fusion avec l'administration des douanes est évoquée depuis de nombreuses années, y compris au niveau du Gouvernement. Elle suscite à la fois intérêt et inquiétudes.
En définitive, au-delà de l'opportunité ou non de ces réformes ou projets de réformes, il faut reconnaître que le climat général a causé chez les agents, confrontés à une « perte de sens », un sentiment de « fatigue » assez fort - ce sont des termes qui sont revenus très souvent lors de nos échanges. Ces changements ont mis sous tension, plus généralement, l'ensemble de la DGCCRF.
Dans ce contexte, nous estimons qu'il est temps que cette dernière et ses agents puissent se focaliser sur leurs missions. Il est donc nécessaire de s'abstenir de toute réforme d'ampleur concernant l'organisation de la DGCCRF à moyen terme. Une hypothétique fusion avec les douanes doit ainsi être écartée, même si des coopérations concrètes renforcées entre ces deux administrations peuvent être développées. Cette fusion se heurterait en effet, en dépit de certains avantages, à de sérieux obstacles, que nous décrivons dans notre rapport. Surtout, elle créerait davantage d'instabilité au détriment du travail des agents, déjà trop peu nombreux. Nous le répétons : il faut aujourd'hui donner la priorité à la stabilité et laisser les agents de la DGCCRF se concentrer sur leurs missions.

Les relations de la DGCCRF avec les entreprises constituent ce que l'on pourrait considérer comme sa troisième faiblesse.
Certes, cette administration garantit une information satisfaisante des consommateurs et des entreprises sur leurs droits et devoirs, quand bien même il existe malgré tout des marges d'amélioration dans ce domaine, exposées dans notre rapport. Nous recommandons notamment de maintenir l'accueil physique des consommateurs et de rapprocher la DGCCRF de ces derniers par le biais du réseau France Services.
Mais ce qui pêche surtout, malgré des efforts tangibles en ce sens, c'est l'établissement d'une relation de confiance avec les entreprises et d'une logique d'accompagnement de ces dernières. Nous avons ainsi constaté que la DGCCRF ne produit pas un effort pédagogique suffisant vis-à-vis des professionnels, sans doute parce qu'elle se définit dans le fond avant tout comme une administration de contrôle.
Or nous considérons que pour garantir l'ordre public économique et la protection du consommateur, la prévention, la pédagogie et l'accompagnement des professionnels doivent primer sur la répression. De manière générale, nous invitons la DGCCRF à adopter cette logique de prévention et d'accompagnement, y compris à l'occasion des contrôles.
Nous formulons à cet égard deux recommandations concrètes. D'une part, nous estimons que la DGCCRF doit davantage adopter une position de conseil vis-à-vis des entreprises : il faut donc notamment envisager l'élargissement aux professionnels du service « Réponse Conso », actuellement chargé de répondre aux sollicitations des consommateurs. D'autre part, il est indispensable de renforcer la confiance des entreprises, même celles qui ont été sanctionnées : il convient donc notamment que la DGCCRF adopte une approche proportionnée de sa politique de communication autour de ses sanctions, notamment dans le cadre du name and shame.
À l'issue de ce contrôle, nous estimons que la DGCCRF est bien un acteur central du bon fonctionnement de l'économie et de la protection des consommateurs. Elle est en outre efficace et s'inscrit dans le réel. Toutefois, elle est affaiblie par la réduction continue de ses effectifs, la succession des réformes mises en oeuvre et avortées et le manque d'accompagnement des entreprises. Nos recommandations concrètes visent à lui donner les outils, les moyens et l'approche nécessaires pour retrouver son efficacité, au moment où l'on a le plus besoin d'elle.

Je laisse la parole à Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis de la mission « Économie » pour la commission des affaires économiques.

Je suis particulièrement intéressée par le rapport de nos deux collègues, dans la mesure où la commission des affaires économiques, dans le cadre du suivi de la loi Égalim, s'interroge sur un certain nombre de dispositions.
Je pense tout d'abord à l'encadrement du régime des pénalités logistiques, car on constate divers abus sur le terrain, notamment le fait que certains acteurs économiques utilisent ces pénalités comme des sources de trésorerie auprès de leurs fournisseurs.
J'évoquerai ensuite le dispositif de relèvement du seuil de revente à perte, prévu par la loi Égalim 1 en 2018, qui avait pour objet de favoriser un meilleur ruissellement, et donc une meilleure rémunération des agriculteurs en fonction des coûts de production. La DGCCRF est censée remettre un rapport sur cette question le 1er octobre prochain au plus tard : qu'en est-il ? Nous avons hâte de savoir si l'administration conclut à un processus de ruissellement effectif au bénéfice des agriculteurs, ce dont nous doutons.
Enfin, Daniel Gremillet et moi-même sommes les auteurs d'un récent rapport sur les négociations commerciales et l'inflation, qui met en évidence l'absence d'une hausse massive, généralisée et suspecte des tarifs de la part des fournisseurs. Or la DGCCRF a lancé une plateforme de signalement des pratiques contestables : comment ces phénomènes sont-ils suivis dans le contexte d'inflation que nous connaissons ?

Avant de donner la parole au rapporteur général, je tiens à vous faire part de mon propre sentiment : la situation dans laquelle se trouve la DGCCRF aujourd'hui traduit, selon moi, un mal typiquement français, à savoir une absence de prise de décisions au niveau de notre administration.
Au fond, on a créé des autorités administratives indépendantes à qui l'on a demandé d'assumer une partie des missions qu'exerçait déjà l'administration, ce qui a conduit à une baisse des effectifs et à une confusion générale. La preuve en est que, bien souvent, tout cela se termine en réunions de concertation au niveau des préfectures pour tenter d'y voir clair dans ce maelstrom et parvenir à coordonner les actions des uns et des autres.
Ne serait-il pas plus simple de clarifier le rôle de chacun, et de décider, par exemple, que les autorités administratives indépendantes ne devraient pas être chargées de la répression des fraudes ?

Le rapport de nos collègues est un peu le symbole du grand flou de certaines réformes.
D'un côté, depuis 2010, quelle que soit la majorité au pouvoir, plus de 900 ETPT ont été supprimés. De l'autre, les missions de l'administration ne sont plus menées avec efficacité, ce que veulent pourtant avant tout les Français.
Je partage l'idée selon laquelle il faudrait un redéploiement des personnels et leur interdépartementalisation mais, en l'absence de pilotage, je crains un émiettement des effectifs et une perte de repères. On assiste actuellement à une sédimentation des structures et des compétences sans stratégie ni réflexion globale. Résultat : une baisse des effectifs qui s'accompagne d'une perte d'efficacité, et cela coûte toujours beaucoup d'argent !
La proposition des rapporteurs spéciaux d'un effectif socle de 7 ETPT par département permettrait de redonner du sens aux missions exercées par la DGCCRF.
À ce jour, l'échelon départemental reste le plus pertinent. L'interdépartementalisation est utile, mais il est indispensable de désigner un pilote, de fixer un périmètre, et de se doter des effectifs suffisants.
Ce contrôle est évidemment très utile, notamment en vue du prochain projet de loi de finances.

En tant qu'ancien vice-président du conseil départemental de Corrèze chargé de l'économie - c'était il y a vingt ans environ -, je souhaite témoigner des difficultés que la DGCCRF causait à tout le monde. Si elle subit aujourd'hui une baisse de ses effectifs, de ses compétences et de son efficacité, elle l'a bien cherché !
J'ai pu constater que les contrôles étaient parfois menés à charge contre certaines entreprises, selon le bon vouloir d'agents tout-puissants. J'ai aussi assisté à plusieurs échanges entre le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'époque et le préfet, qui montraient bien que cette administration ne tenait aucunement compte des messages de prudence et de prévention du représentant de l'État.
J'ai connu un directeur départemental, en poste pendant huit ans, qui a coûté 500 emplois à mon territoire ! J'ai également vu des agents de la DGCCRF se comporter comme des cow-boys dans les entreprises. C'est pourquoi j'adhère aux propos de Frédérique Espagnac sur la nécessité pour la DGCCRF de faire preuve de davantage de pédagogie, car une autorité disproportionnée, une répression déséquilibrée et discrétionnaire posent problème.
Dernière remarque, je considère que l'on devrait pouvoir faire appel des décisions de ces agents avant d'en arriver à une action en justice.

Les rapporteurs spéciaux ont évoqué l'hypothèse d'une fusion de la DGCCRF avec l'administration des douanes. On comprend bien les risques et inconvénients d'un tel rapprochement, mais pouvez-vous nous dire ce qui explique qu'un tel scénario ait été mis en avant ?
D'une certaine façon, votre communication conduit à rejeter ce scénario, tout autant que celui d'une hausse des effectifs : dans ces conditions, comment envisagez-vous l'avenir ?

Dans notre pays, les associations de consommateurs sont très bien organisées et plutôt efficaces. J'observe que les usagers et les clients, quand ils rencontrent un problème, se tournent naturellement vers ces associations, parce qu'elles ont pignon sur rue. La DGCCRF, de son côté, a-t-elle entrepris des actions de communication pour se faire connaître ?
Autre question : est-on en mesure d'évaluer le volume des affaires traitées par la DGCCRF qui n'aboutissent pas à une action en justice ?

Je partage la position des rapporteurs spéciaux.
Cela étant, je m'interroge comme Claude Nougein sur le lien hiérarchique auquel sont soumis les agents de la DGCCRF : ces agents sont-ils réellement sous l'autorité des représentants de l'État, préfets et sous-préfets ?
Je me demande également s'il est réellement possible de renforcer la communication et la pédagogie au sein de la DGCCRF.

Je comprends les remarques de Claude Nougein ; nous avons d'ailleurs entendu durant ce contrôle des représentants d'entreprises nous indiquer ce type de préoccupations, que nous développons dans le rapport. Nous considérons que la DGCCRF fait un travail sérieux auprès des entreprises, mais que cette administration doit adopter une démarche plus pédagogique.
Sur le sujet de l'autorité du préfet sur le directeur départemental, je peux vous assurer que ce dernier agit bien aujourd'hui, en droit et dans les faits, sous l'autorité du préfet. C'est un sujet qui fait l'objet de développements dans le rapport.
Autre point sur lequel je souhaite rassurer nos collègues Claude Nougein et Marc Laménie : les décisions de la DGCCRF concernant une entreprise, a fortiori s'agissant des sanctions administratives, peuvent faire l'objet d'un recours administratif hiérarchique ou gracieux, ou d'un recours devant le juge administratif. Par ailleurs, les sanctions administratives se sont pour une part substituées à ce qui relevait auparavant du pouvoir du juge : 1 300 amendes administratives ont par exemple été prononcées en 2021. Mais encore une fois, celles-ci peuvent faire l'objet de recours.
À toutes fins utiles, je tiens à préciser que, fidèles à la culture du compromis du Sénat, nos recommandations traduisent la recherche d'un certain équilibre entre la nécessité de renforcer la DGCCRF, notamment au service de ses enquêtes et contrôles, et la nécessité de la mettre également au service d'un accompagnement des entreprises.

Nous sommes nombreux ici à connaître des entreprises mises au pilori, parfois à plusieurs reprises, à la suite de contrôles de la DGCCRF.
C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons estimé que son rôle ne pouvait se cantonner à celui de gendarme : elle doit également accompagner les entreprises et faire preuve de pédagogie. C'est le sens de notre rapport.
Pour répondre à Jean-Marie Mizzon et Marc Laménie, nous estimons effectivement que la DGCCRF doit encore communiquer de façon plus efficace notamment à destination des consommateurs. De même, une coordination plus forte doit être opérée avec les associations de consommateurs sur ce point. Nous développons ces éléments dans le rapport. Nous recommandons en outre que l'accueil physique des consommateurs soit maintenu et développé, notamment dans le cadre du Réseau France Services.

Pour répondre à M. Vincent Capo-Cannellas, la fusion de la DGCCRF avec les Douanes (DGDDI) est évoquée depuis longtemps, y compris au niveau gouvernemental.
Cette idée résulte sans doute du fait que les deux administrations sont rattachées à un même ministère, que certaines de leurs compétences sont proches et que leurs agents ont une culture du contrôle partagée. Cette fusion présenterait en effet quelques avantages, développés dans le rapport.
Mais, il existe de sérieux obstacles concrets à cette réforme hypothétique. En voici quelques uns.
Tout d'abord, il y a des différences très importantes entre les catégories de personnels, les agents de la DGCCRF appartenant pour leur grande majorité à la catégorie A quand ceux des douanes peuvent majoritairement des catégories B et C. J'ajoute que les personnels de catégorie A de la DGCCRF ne sont pas formés pour encadrer une équipe mais pour mener des enquêtes. Il y aurait donc de lourds problèmes catégoriels et de perspectives de carrière à gérer en cas de fusion des deux administrations.
Ensuite, on observe une différence de taille : la DGCCRF est petite par rapport à l'administration des douanes. La fusion pourrait donc se transformer en absorption, ce qui déstabiliserait encore davantage les agents de la DGCCRF, au détriment de l'exercice des missions.
En outre, l'implantation territoriale de ces deux administrations est très différente. Les services des douanes ne sont pas présents de façon permanente dans tous les départements. En effet, leur travail dépend des frontières nationales. A l'inverse, la DGCCRF est présente dans tous les départements.
Surtout, il s'agirait d'une réforme lourde à négocier et mettre en place, qui déstabiliserait encore la DGCCRF et ses agents.
En définitive, nous considérons qu'il est préférable de tendre vers une meilleure coordination entre ces deux structures, en excluant leur fusion. Il y a beaucoup à gagner à améliorer les échanges d'informations, d'autant que les administrations - j'ai découvert cela durant le contrôle - sont encore trop cloisonnées. Ainsi, le partage d'informations et de données, qui s'est amélioré, doit encore être largement développé.
Enfin, je précise que l'établissement d'un effectif socle de 7 ETPT par département conduit à une hausse d'effectifs de la DGCCRF de 49 ETPT selon notre estimation. Nous estimons qu'une telle hausse permettra de renforcer la DGCCRF.
Le président Claude Raynal et le rapporteur général Jean-François Husson ont évoqué la création des autorités administratives indépendantes et ses conséquences en termes de problèmes de coordination et de baisse d'effectifs des administrations. En ce qui concerne la protection du consommateur et le respect de la concurrence, il y a en effet plusieurs administrations et autorités administratives indépendantes. Le nombre d'acteurs publics génère effectivement mécaniquement des risques de chevauchements voire d'impasses. Une meilleure coordination est donc indispensable. Mais je veux préciser que le nombre d'acteurs publics présente aussi des avantages, en particulier la spécialisation de certaines autorités ou administrations sur certains secteurs ou activités spécifiques, que les agents généralistes de la DGCCRF aborderaient moins efficacement.

J'indique, pour répondre à notre collègue Anne-Catherine Loisier, que le rapport attendu sur le dispositif de relèvement du seuil de revente à perte qu'elle évoque n'a pas été abordé par nos interlocuteurs durant le contrôle. Par conséquent, je m'engage à discuter de ce point précis avec la DGCCRF lors de son audition prochaine dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Nous aborderons également le sujet des pénalités logistiques. Par ailleurs, la plateforme Signal Conso est un outil dont nous saluons l'utilité dans le rapport ; il peut permettre de signaler des manquements de toutes sortes et est de plus en plus utilisé.
J'ajouterai que l'augmentation des effectifs annoncée dans le dossier de presse du PLF pour 2023 concernant la DGCCRF, dont je parlais dans mon intervention liminaire, prendrait la forme de renforts en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et viserait également à renforcer le contrôle de l'accessibilité des biens et services pour les personnes porteuses de handicap. C'est une bonne nouvelle mais cela ne suffira pas à répondre aux enjeux qui pèsent sur la bonne exécution des missions de la DGCCRF dans tous les territoires.

Comme le rapporteur général Jean-François Husson, j'estime que l'échelon départemental est le plus pertinent pour la DGCCRF, même si les mouvements d'inter-départementalisation, présentés dans le rapport, sont utiles. Je pense notamment à l'exemple vertueux du rapprochement entre les services des départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.
Nous remercions le rapporteur général pour son soutien à nos recommandations, notamment celle sur l'établissement d'un effectif socle par département de 7 ETPT.
La commission adopte les recommandations des rapporteurs spéciaux et autorise la publication de leur communication sous la forme d'un rapport d'information.

Je laisse maintenant la parole au rapporteur spécial de la mission « Santé », Christian Klinger, qui a mené un contrôle budgétaire sur le dispositif d'indemnisation pour les victimes de la Dépakine.

En tant que rapporteur spécial de la mission « Santé », j'ai choisi de consacrer un contrôle budgétaire au dispositif d'indemnisation pour les victimes de la Dépakine, dispositif qui a été créé par la loi de finances pour 2017, à la suite de ce que l'on a appelé « l'affaire de la Dépakine ».
Il me semble pertinent de faire un bref retour sur cette affaire, afin que nous puissions bien comprendre les enjeux de ce dispositif.
La Dépakine est le nom d'un médicament contenant du valproate de sodium, qui est utilisé pour lutter contre l'épilepsie. Produit par Sanofi, il s'agit du médicament le plus utilisé dans le monde contre l'épilepsie.
Or on sait depuis les années 1980 que la prise de ce médicament par les femmes enceintes provoque des malformations congénitales graves. De plus, il a été établi dans les années 2000 que sa prise durant la grossesse est également à l'origine de troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme par exemple.
Le nombre des victimes est élevé : on estime qu'entre 2 150 et 4 100 enfants seraient touchés par des malformations, et qu'entre 16 600 et 30 400 enfants souffriraient de troubles du développement consécutifs à l'exposition au valproate de sodium.
En 2011, la lanceuse d'alerte Marine Martin a médiatisé l'affaire. Elle a également fondé l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, mieux connue sous son acronyme d'Apesac, qui est la principale association des familles victimes de la Dépakine.
Depuis lors, de nombreux contentieux ont été portés devant les tribunaux.
Tout cela a mené à la création d'un dispositif d'indemnisation pour les victimes de la Dépakine, adossé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), qui se veut une procédure d'indemnisation amiable permettant d'éviter aux familles de passer par la voie contentieuse.
Prévu au départ pour une durée de six ans, ce dispositif devrait perdurer neuf ans de plus, soit quinze ans au total.
En raison des dysfonctionnements de son organisation initiale, celui-ci a fait l'objet d'une réforme d'ampleur en 2019.
J'en présente brièvement le fonctionnement actuel.
Chaque victime peut déposer un dossier à l'Oniam, qu'un collège d'experts se charge ensuite d'instruire avant de rendre un avis dans lequel il se prononce sur l'imputabilité des dommages liés à la prescription du valproate de sodium, ainsi que sur la nature et l'étendue des dommages. Le collège d'experts se prononce également sur les personnes responsables.
Ensuite, il y a deux possibilités : soit l'État est reconnu responsable ou personne n'a été identifié comme responsable et dans ce cas l'Oniam formule directement une offre, soit une personne a été désignée comme responsable - pour l'essentiel, il s'agit de Sanofi - et celle-ci doit alors présenter une offre dans un délai d'un mois. Si elle ne présente pas d'offre ou une offre manifestement insuffisante, l'Oniam présente alors une offre de substitution et se tourne vers la personne désignée responsable pour recouvrer les fonds.
La personne désignée responsable a bien entendu la possibilité de contester la décision de recouvrement de l'Oniam devant les juridictions. Jusqu'à présent, les personnes désignées responsables ont contesté tous les titres émis par l'Oniam.
À ce stade, il me semble pertinent de se demander si ce dispositif d'indemnisation fonctionne correctement.
La première constatation que met en avant le contrôle est l'importance du non-recours au dispositif. Environ 850 dossiers ont été déposés à l'Oniam, alors que les estimations initiales, qui se fondaient pourtant sur des prévisions épidémiologiques plus optimistes que celles que nous avons actuellement, prévoyaient le dépôt de 8 000 à 10 000 dossiers en six ans.
Ce non-recours se traduit donc par une sous-exécution budgétaire continue et importante du dispositif depuis sa création. Ainsi, jusqu'au 30 juin 2022, seuls 46,6 millions d'euros ont été engagés et 38 millions d'euros de crédits de paiement ont été consommés. L'exécution des crédits a atteint 16,8 millions d'euros, ce qui est presque cinq fois inférieur aux prévisions initiales pour une année.
Les explications à ce non-recours sont multiples.
La première est que l'indemnisation accordée aux familles est en moyenne inférieure de 30 à 50 % à l'indemnisation accordée par les juridictions civiles. La procédure amiable est ainsi moins intéressante pour les victimes à mesure que les préjudices sont importants.
En contrepartie de cette indemnisation moindre, le dispositif amiable était censé être plus simple et plus rapide que la voie contentieuse. Or le dispositif d'indemnisation ne tient malheureusement pas ses promesses sur ces deux points. Il est obligatoire pour les familles de constituer des dossiers qui font, en règle générale, des centaines de pages, sachant que certains documents sont particulièrement difficiles à retrouver - je pense à des pièces médicales datant de plusieurs décennies.
Il faut également rappeler que les femmes qui font ces démarches sont fragiles : elles souffrent d'épilepsie, maladie chronique fortement handicapante.
Par ailleurs, le délai réglementaire de six mois prévu pour que le collège remette son avis est loin d'être respecté. Actuellement, le délai moyen de la procédure tourne autour de trente-deux mois. Ce délai résulte certes de l'accumulation du stock de dossiers à la suite des défaillances de l'organisation initiale du dispositif, de la complexité médicale et juridique des dossiers, de ralentissements liés à l'épidémie de la covid-19, mais il n'en est pas moins inacceptable pour les victimes. De tels délais viennent remettre en cause l'un des intérêts du dispositif amiable qui était de proposer une procédure plus rapide que la justice.
Toutes ces difficultés étaient prévisibles et auraient dû être mieux anticipées.
Aujourd'hui, le rythme de traitement des dossiers est satisfaisant. En 2021, le collège d'experts s'est réuni 130 fois, ce qui correspond à environ trois séances par semaine. Il est difficile d'exiger davantage de praticiens en exercice. Pour cette raison, une nouvelle réforme du dispositif ne serait pas pertinente. Par contre, celui-ci pourrait être renforcé.
Néanmoins, le recrutement de ce collège présente des fragilités. Tous les membres du collège d'experts n'ont pas un nombre de suppléants correspondant à ce qui est prévu par les textes. Une revalorisation de leur indemnité devrait être envisagée : pour mémoire une séance est actuellement indemnisée à hauteur de 230 euros par demi-journée, montant qui est inférieur aux indemnités prévues devant les juridictions civiles.
La contestation systématique par Sanofi des titres de recette émis par l'Oniam a donné lieu à un contentieux important. En mars 2022, ce sont 240 procédures qui ont été enregistrées par l'Oniam. Cet afflux de contentieux est un risque pour le bon fonctionnement du dispositif. Il convient donc de s'assurer que l'Office dispose d'un nombre de juristes suffisant pour le traiter.
La relation avec les familles est l'un des points faibles du dispositif actuel. Bien qu'il ait été prévu, il n'existe toujours pas de baromètre de satisfaction des personnes ayant eu recours au dispositif d'indemnisation. Plus généralement, d'après les témoignages que nous avons eus, les familles témoignent d'une forte incompréhension vis-à-vis de la procédure.
Pour ces raisons, il est essentiel que le personnel support de l'Oniam soit en mesure d'accompagner convenablement les familles ayant saisi le dispositif d'indemnisation et d'énoncer des règles claires quant aux documents pouvant être communiqués au collège d'experts.
Ces recommandations, rapides à mettre en oeuvre, devraient être accompagnées d'une réflexion sur un temps plus long.
Aujourd'hui, l'hypothèse de la transmission intergénérationnelle des dommages causés par la Dépakine est sérieusement envisagée. Il reste des études à mener sur la question, mais l'INSERM l'identifie comme un axe prioritaire de recherches. Toujours est-il qu'elle pourrait avoir des conséquences importantes sur l'indemnisation des victimes, puisqu'une nouvelle génération aurait à être indemnisée, et que les victimes actuelles connaîtraient un préjudice d'anxiété. Des scénarios d'adaptation du dispositif doivent donc être envisagés.
Depuis la mise en place du dispositif amiable, aucune somme n'a été recouvrée auprès de personnes désignées comme responsables - autres que l'État. Le laboratoire conteste systématiquement devant les tribunaux les titres de recette émis par l'Oniam. Les sommes avancées par l'Office lorsqu'il indemnise en substitution représentent 91 % des montants alloués, soit plus de 34 millions d'euros. Au rythme où vont les procédures judiciaires, de nombreuses années pourraient encore s'écouler avant que Sanofi ne soit obligé de participer au dispositif d'indemnisation.
Enfin, il est à noter que le mécanisme d'indemnisation des victimes est souvent appelé « fonds d'indemnisation » des victimes de la Dépakine dans les médias, comme s'il était implicitement admis que l'État paierait l'ensemble des victimes.
La situation est délicate : les victimes doivent évidemment être indemnisées, mais la présomption d'innocence doit aussi être respectée. En effet, aucune décision de justice définitive condamnant Sanofi n'a été rendue jusqu'à présent. Mais pour autant, l'État a-t-il vocation à assumer le risque lié aux accidents dus aux médicaments ? Il serait souhaitable d'engager une réflexion plus globale pour faire face à ce risque.
En outre, le médicament relève du régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Ce régime est celui de l'article 1245-15 du code civil, aux termes duquel « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage ». Or ce délai de dix ans est particulièrement contraignant dans le secteur des médicaments.
Si la position du laboratoire précité devait faire école à l'échelle de l'ensemble des autres laboratoires, le risque lié aux médicaments finirait par être supporté essentiellement par la collectivité et non par les laboratoires. C'est pourquoi il serait intéressant de lancer une réflexion sur l'implication des exploitants de médicaments dans la couverture du risque lié à ces médicaments, et de profiter de la réécriture de la directive sur les produits défectueux par la Commission européenne pour envisager la sortie des médicaments de ce régime.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, vous aurez compris que ce dispositif est perfectible. L'Oniam souffre qu'à chaque scandale sanitaire une mission nouvelle lui soit à nouveau confiée. Je propose donc une réflexion plus large, afin que l'État ne soit pas dans la réaction, mais dans l'anticipation.

À titre personnel, je trouve cette communication très intéressante car, au-delà du dispositif concerné, c'est la question plus générale de la manière de gérer le risque qui est posée.
J'ai deux interrogations : l'État est-il mis en cause en tant que tel au titre de la mise en circulation du médicament sur le marché ? Dans son offre de substitution, l'Oniam intègre-t-il les coûts intermédiaires ?

Ce contrôle budgétaire nous donne l'occasion d'évoquer des situations humaines très délicates. Le dispositif d'indemnisation pour les victimes de la Dépakine a le mérite d'exister et de proposer une solution intermédiaire avant la saisine des tribunaux. Hélas, le mécanisme prévu ne facilite pas autant les choses qu'on l'espérait...
Ma question porte sur votre recommandation de mieux indemniser les experts, qui sont au nombre de neuf : pour quelle raison sont-ils moins bien rémunérés que devant les autres juridictions ? Sont-ils mobilisés toute l'année ?

La mise sur le marché de la Dépakine a-t-elle résulté d'une décision favorable de nos autorités de santé ou d'une autorisation européenne, auquel cas la responsabilité de l'État serait indirecte ?

Je souhaite m'attarder sur la recommandation n° 10, au titre de laquelle le rapporteur spécial préconise d'engager un dialogue au niveau européen : quelle est la répartition exacte des responsabilités entre États et Union européenne dans ce domaine ?

Pour répondre au président Raynal, je précise que l'État est bien mis en cause au travers de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. D'après l'Oniam, sa responsabilité serait engagée dans 9 % des cas, les 91 % des cas restants étant imputables à Sanofi.
Je précise à l'attention du rapporteur général que, même si la comparaison est difficile, la rémunération des neuf experts est effectivement relativement faible. Les experts bénéficient d'un montant forfaitaire de 230 euros par demi-journée de séance, et la rémunération des experts dans les juridictions civiles est de 1 500 euros à 2 000 euros par dossier. Une rémunération plus faible est partiellement justifiée par le fait que les revenus du collège d'experts sont plus réguliers, mais cela ne suffit pas à compenser le déficit d'attractivité du collège d'experts.
S'agissant de la question de Vincent Capo-Canellas, je rappelle que le médicament relève d'une loi de 1998, qui transpose une directive européenne relative à la responsabilité pour les produits défectueux, texte qui prévoit une prescription de dix ans pour engager la responsabilité du fabricant. Ce délai de dix ans me paraît insuffisant tant il est vrai que les effets nocifs d'un médicament peuvent se révéler très longtemps après ; sans parler d'imprescriptibilité, l'exemple de l'Allemagne montre qu'il est envisageable de mettre en place une procédure spécifique pour les médicaments.
Concernant les coûts intermédiaires, il n'existe à ma connaissance aucun projet de faire peser ces coûts sur les laboratoires.
Autre précision, 240 titres de recettes sont actuellement contestés par Sanofi, ce qui fait peser sur les finances de l'Oniam des frais d'avocats, qui excèdent le coût du fonctionnement du collège d'experts. Il conviendrait certainement de renforcer temporairement l'équipe de juristes de l'Office pour procéder à ces recouvrements.
Je précise à l'attention de Roger Karoutchi que la Dépakine a bel et bien obtenu une autorisation de mise sur le marché, et que le contentieux porte sur la question de savoir si Sanofi a suffisamment alerté les autorités de santé. Cette question n'est pas tranchée à l'heure actuelle.

Sanofi est une très grande entreprise, qui reçoit de considérables commandes de la part de l'État et qui bénéficie pour ces divers projets de subventions publiques importantes : j'ai du mal à comprendre que l'État ne dispose pas de moyens suffisants pour obliger ce laboratoire à assumer ses responsabilités concernant ce médicament défectueux qu'est la Dépakine !

Il faut savoir qu'un tiers de la production mondiale de Dépakine est produit dans mon département et que Sanofi emploie dans son usine une cinquantaine de personnes. Pourtant, j'ose le dire, Sanofi est régulièrement mis en cause pour des rejets toxiques près de Pau. C'est pourquoi je rejoins Roger Karoutchi sur le fait que Sanofi se doit d'être exemplaire.

Mon intention n'est évidemment pas de faire le procès de Sanofi. Cela étant, j'observe une différence entre l'attitude de ce laboratoire et celle du laboratoire Servier, qui commercialisait le fameux Mediator et qui, aujourd'hui, rembourse l'intégralité du montant réclamé par l'Oniam au nom des victimes.