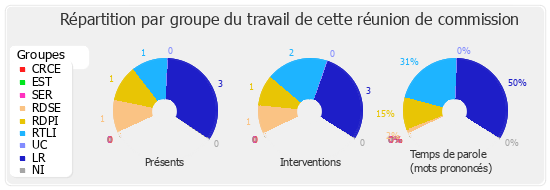Délégation sénatoriale à la prospective
Réunion du 3 novembre 2022 à 8h35
La réunion

Nous sommes réunis ce matin pour aborder un sujet assez méconnu mais néanmoins passionnant : l'exploitation des ressources spatiales, à commencer par celles de la Lune, puisqu'il n'aura échappé à personne que les Américains entendent y retourner d'ici à 2025, dans le cadre de la mission Artemis, et que les Chinois, associés aux Russes, n'entendent nullement se laisser distancer sur ce terrain.
La Lune pourrait bel et bien offrir des ressources exploitables, d'abord en appui direct aux missions d'exploration, pour fabriquer de l'oxygène pour l'équipage ou du carburant pour le retour, mais aussi, pourquoi pas, à la place ou en plus des ressources terrestres.
Disons-le tout de suite, ce n'est pas pour demain : on peut évidemment rêver à des centrales nucléaires tournant à l'hélium-3 lunaire, ou à des voitures dont les batteries seraient faites de métal d'astéroïde, mais pour l'instant nous ne sommes même pas capables d'envoyer des hommes sur la Lune. Alors de là à espérer y produire quelque chose en quantité industrielle...
Pour autant, ce n'est pas de la science-fiction : plusieurs projets concrets sont déjà annoncés, les États-Unis et la Chine sont entrés dans la course, et des entreprises privées travaillent à des solutions utiles à relativement court terme. Nous aurions tort de ne pas prendre cela au sérieux, comme nous avons pu le faire à propos des lanceurs réutilisables d'Elon Musk...
L'exploitation des ressources de la Lune, c'est un sujet prospectif par excellence, encore assez loin de nous pour que l'on puisse tout imaginer, mais déjà assez proche pour qu'on puisse le faire avec rigueur et réalisme. Nos collègues Christine Lavarde et Vanina Paoli-Gagin s'y attachent dans le cadre du rapport qui leur a été confié, et dont l'audition de ce matin, centrée sur la Lune, constitue en quelque sorte le lancement. Mais qu'il s'agisse d'exploitation des ressources ou du reste, chacun sait que la Lune n'est qu'un premier pas vers Mars, et sans doute plus loin encore.
Il est naturel, sur un sujet comme celui-ci, de croiser le regard des chercheurs, des grandes agences gouvernementales et des entreprises. C'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir ce matin :
- Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
- Pascale Ultré-Guérard, directrice adjointe des programmes au Centre national d'études spatiales (CNES) ;
- Clarisse Angelier, déléguée générale de l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) ;
- Alban Guyomarc'h, doctorant en droit et coordinateur du programme Objectif Lune à l'ANRT.

Je souhaiterais pour ma part insister sur la dimension géopolitique du sujet. Si l'exploitation effective des ressources spatiales n'est pas pour demain, elle s'envisage dès aujourd'hui. Or tout ceci arrive dans un contexte bien particulier, qui ne vous a pas échappé, de renouveau des tensions internationales, de militarisation de l'espace, de retour des rapports de force au détriment de la coopération. On l'a bien vu avec la guerre en Ukraine, qui a conduit à la remise en cause de plusieurs programmes importants - et encore ceci n'est-il pas grand-chose au regard de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui structure chaque jour un peu plus les questions spatiales.
La course à l'exploitation des ressources spatiales fait partie de cette nouvelle équation géopolitique. Il y a des signes qui ne trompent pas, par exemple lorsque les Américains décident, dans le cadre des accords Artemis, d'instituer des « zones de sécurité » sur la Lune afin, je cite, « de réduire les interférences ou les conflits entre les opérations rivales ».
De ce point de vue, il y a sans doute quelques enseignements à tirer du cas de la première des « ressources spatiales », la véritable ressource rare, ou le « bien rival » comme disent les économistes : l'orbite basse, cet espace de plus en plus encombré avec l'essor des constellations de satellites et l'augmentation exponentielle des débris spatiaux. En principe, la seule manière de préserver cette ressource, ce sont la coopération et la régulation. Pourtant, on ne peut pas dire que les résultats soient très satisfaisants, en dépit des efforts menés depuis longtemps au niveau international, au sein du COPUOS, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, comme nous l'a raconté son ancien président, Gérard Brachet, lors de la réunion interparlementaire sur l'espace qui s'est tenue au Sénat en septembre dernier.
Comment cela va-t-il se passer pour les « autres » ressources spatiales, celles qu'on pourrait exploiter sur la Lune ou sur Mars ? En tout cas, le COPUOS, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de l'ONU, vient tout juste de se saisir officiellement de la question, que l'on pourrait résumer ainsi : le droit de l'espace est-il « prêt » pour l'exploitation des ressources, ou sommes-nous, pour ainsi dire, dans un nouveau Far West, avec ses mines d'or, ses cowboys, mais pas vraiment de shérif ?

Christine Lavarde vient d'évoquer les aspects politiques et juridiques du sujet, mais il comporte aussi une forte dimension économique, sur laquelle je souhaiterais insister. Avec les ressources spatiales, on parle bien « d'exploitation », et non plus seulement « d'exploration » de l'espace. C'est important, car ceci revient à admettre qu'il puisse y avoir dans tout cela une logique commerciale, ce qui suppose une forme de rentabilité pour les entreprises, un retour sur investissement, une viabilité des modèles économiques. Car au final, c'est bien cela qui permettra de faire le tri entre les projets « réalistes », et ceux qui resteront du domaine de la science-fiction.
Aux États-Unis, dire cela relèverait de l'évidence, et c'est bien dans cette perspective que se positionnent les acteurs du New Space : ils y vont parce qu'ils pensent qu'il y a un business. Par contre, en France et en Europe, où la politique spatiale est traditionnellement menée au nom d'objectifs plus « nobles » comme la connaissance scientifique ou le progrès humain, cela revient à s'attaquer à une forme de tabou.
Cela me semble pourtant nécessaire, car le plus difficile, ce n'est pas de lever le tabou, c'est tout ce que cette levée provoque, toutes les questions auxquelles il faudra répondre : comment favoriser l'innovation ? Quel rôle pour les grandes entreprises et pour les start-up, pour les acteurs du spatial et les autres (je pense par exemple aux compagnies minières, dont le savoir-faire pourrait être précieux) ? Quid de la politique de concurrence, de la commande publique ? Quel régime de propriété sur la Lune, et quel régime de responsabilité sur Mars ?
Tous les débats que nous avons ici-bas sur la souveraineté économique, industrielle et technologique de la France et de l'Europe se retrouvent en quelque sorte « là-haut ». La question est de savoir si, oui ou non, nous souhaitons y avoir une place.
La question de l'occupation de l'espace est entrée depuis peu dans les préoccupations des chercheurs en sciences humaines et sociales. Je suis d'ailleurs la seule géographe à travailler sur ce sujet en France, ce qui, vu mon âge, n'est pas sans m'inquiéter pour l'avenir.
La question des ressources de l'espace a été tenue à l'écart parce que la géographie c'est en principe l'analyse de la Terre, Gê, mais il suffit de s'intéresser à l'orbite basse pour constater que des activités humaines sortent de l'enveloppe terrestre, notamment grâce à des engins artificiels non habités. On se souviendra que dès 1956, soit avant le lancement du premier Spoutnik, le géographe Jean Gottman affirmait qu'il y aura nécessairement une géographie de l'espace, puisque l'homme a une propension à se saisir de tous les milieux et à y installer une compétition économique et géopolitique, et cela à partir du point d'ancrage qu'est la Lune, le seul point où l'on pouvait alors se projeter pour y envisager une activité pérenne.
Pour mémoire, la première photo de la face cachée de la Lune, en 1959, est une photo soviétique. Lorsque Neil Armstrong pose le pied sur la Lune en 1969 et plante le drapeau américain, en faisant accomplir « un pas de géant pour l'humanité », cela marque le fait que les États-Unis appréhendent cet astre comme une nouvelle frontière, car leur expansion dans l'espace leur semble naturelle. La vision actuelle de la Lune, sous la forme de la carte américano-japonaise Unified Geologic Map of the Moon de 2020 qui répertorie toutes les ressources géologiques de la Lune, prépare évidemment une exploitation de ses ressources minières. Reste à savoir à quel coût il sera possible de forer, et si ce sera rentable.
Une photo de la Terre en arrière-plan prise en 2014 depuis l'orbite de la Lune par la mission chinoise Chang'e ravive la prise de conscience, qu'avaient permise les missions Apollo, de la nécessité de la préservation écologique du « vaisseau Terre ». Cette dimension concerne aussi la Lune, à 400 000 kilomètres de nous, aussi inhospitalière soit-elle.
Autour de la Terre, l'activité humaine présente de fortes densités au niveau des orbites des satellites à défilement en orbite basse et de l'orbite géostationnaire, avec entre les deux de grandes zones assez vides, de sorte que la question du trafic ne se pose pas partout avec la même acuité.
Si la Lune et Mars nous apparaissent comme des destinations familières, elles n'ont pas été souvent fréquentées. La grande période d'exploration de la Lune s'achève en 1976 avec la dernière sonde soviétique Luna. On remarque une chose : cette période a été marquée par un grand nombre d'échecs, qui étaient considérés comme faisant partie du développement de l'activité spatiale. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, comme en attestent les reports multiples du lancement du SLS (Space Launch System), par souci de minimiser les risques au maximum. Après les missions vers la Lune des années 1990, qui ont été des échecs, puis la mission européenne SMART en 2004, celles qui ont suivi dans les années 2010 ont été le fait des nouveaux acteurs japonais, chinois et indien. À partir de 2019 et jusqu'en 2024-2025, on assiste à une nouvelle multiplication des missions lunaires, avec la Corée du Sud, l'Inde, la Chine, les États-Unis, peut-être la Russie et l'Europe en coopération. Quant aux rovers martiens, ils sont tous Américains à l'exception d'un véhicule chinois, tandis que la sonde européenne Mars Express a vu son lancement retardé par la crise Covid, avant d'être reportée sine die, puisqu'elle reposait sur une coopération avec les Russes que les tensions géopolitiques ont remise en question.
Deux mots clés caractérisent le projet américain de retour sur la Lune : d'une part, le leadership, hier face aux Soviétiques et aujourd'hui face à la Chine, qui reconnaît cependant qu'elle est encore en retard ; d'autre part, la nécessité de la commercialisation, ce qui suppose d'investir pour permettre à des acteurs privés de trouver leur place, à l'instar d'Elon Musk avec SpaceX, qui se positionne en sous-traitant de la NASA pour assurer les transports en orbite basse et vers la Lune, ou de Jeff Bezos avec Blue Origin.
La mission du gros lanceur SLS de la NASA est d'ouvrir la voie, en faisant notamment alunir, dans le cadre de la mission Artemis, la première femme et la première personne de couleur - cette dimension « politiquement correcte » étant davantage mise en avant, en termes de communication, que les enjeux commerciaux.
S'agissant des grilles de lecture, il importe de découpler les ambitions chinoises et leur perception par les Occidentaux dans le contexte global des relations terrestres entre la Chine et les États-Unis. La Chine décline, que ce soit au sujet de la Lune ou de Mars, le slogan de Xi Jinping sur « le rêve chinois ». L'objectif affiché est d'arriver à la parité avec les États-Unis à l'horizon 2049, en cochant d'ici-là toutes les cases de ce que les anciennes puissances spatiales ont su faire, dont la conquête de la Lune, mais en s'appuyant sur les nouveaux moyens de l'informatique, de l'électronique et de l'intelligence artificielle. Le face-à-face entre les États-Unis et la Chine est tel que la décision de Barack Obama de ne pas donner suite au programme lunaire lancé par Georges Bush Jr., sous prétexte que cela n'avait plus aucun intérêt cinquante ans après Apollo, a, par effet miroir, grandement déprécié le programme lunaire chinois, avant que Donald Trump ne le ranime par ses prises de position. La propagande chinoise a ensuite beau jeu de citer le New York Times lorsqu'il pose la Chine comme principal concurrent des États-Unis.
S'agissant des autres acteurs, l'Europe doit encore confirmer ses ambitions, qui figurent dans l'étude lancée par l'Agence nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), en lançant un programme majeur, avec l'adhésion du public, ce qui suppose de mettre en avant les valeurs d'indépendance européenne, d'image de haute technologie - les discours sur la compétitivité et la militarisation seront en revanche plus difficiles à développer.
Les missions japonaises sont très fortement intégrées dans le programme Artemis américain.
L'effacement de la Russie reste à confirmer, car elle n'acceptera sans doute pas, malgré ses difficultés de financement, de disparaître de la scène spatiale. Elle a bien passé un accord avec la Chine en vue de l'implantation d'une station dans le cadre de la mission Luna 25, mais seulement à des fins de recherche, et ce projet devrait avoir dix ans de retard sur le programme américain.
La politique spatiale indienne n'est pas sans ambiguïtés : les missions Chandrayaan 3 et Gaganyaan reposent sur un budget d'un milliard d'euros par an, contre 13 à 14 milliards d'euros pour l'Europe et 50 milliards d'euros pour les États-Unis, et privilégient a priori un vol spatial habité sur l'envoi de robots sur la Lune.
Les ambitions de la Corée du Sud se traduisent par la mission Danuri, lancée en août 2022 grâce à SpaceX.
Les nouveaux explorateurs sont aussi des financiers. C'est le cas des Émirats arabes unis, qui mènent une coopération très ouverte avec les États-Unis et le Japon, et sont impliqués dans la mission lunaire chinoise Chang'e 7 pour 2026. C'est aussi le cas du Luxembourg, où ont été récemment organisés, à Esch-sur-Alzette, une compétition de robots lunaires, par l'ESA et l'ESRIC, le Centre européen d'innovation en matière de ressources spatiales, ainsi que l'exposition Esch-Mars, de terres rouges en terres rouges.
Le mode d'exploitation des ressources est un choix essentiel. Comme il est peu probable que l'on ramène des minerais de la Lune pour les exploiter sur terre (même si c'est envisagé pour les astéroïdes), l'exploitation et l'usage des ressources se feront sans doute essentiellement in situ. La question des débouchés commerciaux se pose, ainsi que l'organisation des flux entre les sites miniers et les sites d'usage et le statut public ou privé des acteurs, dans l'optique de la mise en place d'une véritable économie orbitale - voilà un sujet de prospective ! La question des utilisateurs non autonomes, dont fait partie l'Europe, se pose aussi.
Au-delà de la question de la rentabilité, qui doit être évaluée en intégrant les retombées technologiques, se pose la question de la durabilité : le coût en carbone, le devenir des sites lunaires après la période d'exploitation, et, d'une manière générale, les questions de protection planétaire qui préoccupent beaucoup les astronomes et le public - l'émission de poussières autour de la Lune, par exemple, perturberait grandement les observations. Sur tous ces sujets, nous commençons à peine à construire notre réflexion ; cela se fait notamment dans le cadre du projet de révision de la loi sur les opérations spatiales (LOS) de 2008, entrepris par le CNES.
Enfin se pose la question de la relation entre la puissance publique, les médias et l'opinion publique, alors que le discours des médias européens est souvent calqué sur celui des médias anglo-saxons.
Pour parler des « ressources », nous allons partir des éléments du tableau périodique de Mendeleïev, c'est-à-dire des atomes et des molécules qui en dérivent, comme l'eau, l'hydrogène, l'oxygène et les minéraux. Or notre connaissance des ressources spatiales n'est que très parcellaire, car acquise par des observations à distance, notamment grâce à la spectrométrie ; elle est aussi macroscopique et ne couvre que la surface, sauf à l'occasion d'observations in situ très locales et limitées à la proche surface de la Lune.
Des missions robotiques ou habitées in situ ont en effet permis d'effectuer des prospections en surface, mais avec assez peu de points d'observation, en ayant parcouru à peine quelques dizaines de kilomètres sur la surface de la Lune. Les retours d'échantillons ont atteint quelques centaines de kilos de roches lunaires dans le cadre des missions Apollo, et quelques grammes lors de missions sur des astéroïdes comme la mission japonaise Yakuza ou la mission américaine Osiris-REX sur l'astéroïde Bennu. Des retours d'échantillons de Mars sont par ailleurs prévus pour 2030.
Comme ces missions coûtent plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards, le coût rapporté des échantillons de matières extraterrestres est très largement prohibitif, de sorte que ce n'est pas demain que l'on fera un usage terrestre de ces ressources. Même le Luxembourg, un pays très en pointe sur ce sujet, se projette à un horizon à vingt ans et au-delà.
C'est pourquoi les efforts portent essentiellement sur l'utilisation in situ des ressources, soit l'ISRU (In Situ Resource Utilization), que ce soit pour du support vie en cas de vol habité, pour produire de l'eau ou de l'oxygène pour l'équipage, ou pour des éléments de construction - métaux, minéraux, régolithe - afin de construire des habitats et des infrastructures, ou encore pour produire du carburant, la Lune faisant office de tremplin pour explorer des corps plus lointains comme Mars.
Les enjeux technologiques associés portent sur le forage, le conditionnement, le stockage et l'usinage des ressources, en tenant compte de toutes les contraintes liées à l'environnement spatial. Pour l'ISRU, l'horizon de mise en oeuvre est de dix ans.
S'agissant des activités actuelles et à venir, un travail de prospection est en cours, comme c'est le cas au niveau européen avec le projet Prospect, qui s'appuie sur le lanceur Luna 27, pour un forage et un laboratoire d'analyse in situ afin d'étudier la présence d'eau dans le sous-sol martien. Des expérimentations en conditions réelles ont déjà été menées, à l'image de la mission Moxie de la NASA qui est parvenue à produire en avril 2021 quelque 10 grammes d'oxygène à partir du CO2 de l'atmosphère martienne, soit l'équivalent de 10 minutes de respiration pour un astronaute, au prix d'une consommation d'énergie très élevée.
Des simulations autour du régolithe de la Lune sont par ailleurs menées par l'ESA dans le cadre de l'European Astronaut Center (EAC), à partir de roches basaltiques. Un consortium français mené par l'INRAP et l'ONERA cherche à faire la même chose à partir de roches de volcans d'Auvergne. Il reste que le régolithe est une substance très abrasive qui pose beaucoup de difficultés dans l'environnement des astronautes.
L'International space exploration coordination group (ISECG), qui rassemble les agences spatiales gouvernementales, a produit en 2021 un rapport intitulé ISRU gap assessment report qui dresse l'inventaire des problématiques et des innovations associées à l'exploitation des ressources spatiales in situ.
Sur le plan juridique, il s'agit de mener cette activité dans le respect des traités existants, dont le Traité de l'espace de 1967, qui a posé le principe de non-appropriation par un État des ressources issues de corps extra-terrestres. Ma collègue Clémence Lambrecht, spécialiste du droit spatial, pourra répondre à vos éventuelles questions sur ce sujet.
Plusieurs pays se sont dotés de lois nationales sur l'exploitation des ressources extraterrestres, dont les États-Unis avec un executive order en 2020, le Luxembourg dès 2007, et les Émirats arabes unis en 2020. Ces lois visent à autoriser l'exploitation des ressources spatiales et leur appropriation.
La loi relative aux opérations spatiales (LOS) votée par la France en 2008, qui vise à protéger les biens et les personnes dans le cadre de l'accès et de l'utilisation de l'espace, ne couvre pas les aspects d'exploitation des ressources. Une révision de cette loi est en cours pour prendre en compte les évolutions récentes des activités spatiales.
Sur le plan multilatéral, les accords Artemis ont été proposés par les États-Unis à leurs partenaires internationaux et la France les a signés en juin 2022. Ils comportent une section dédiée à l'exploitation des ressources, qui met en avant le bénéfice pour l'humanité, l'importance du support aux opérations, la nécessaire cohérence avec le traité de 1967 et le besoin d'informer les Nations Unies de telles activités, tout en incitant à des efforts multilatéraux dans ce domaine.
La France a signé les accords Artemis en insistant beaucoup sur le besoin de continuer les travaux dans un cadre multilatéral plus large, au sein du COPUOS, en poussant à la création d'un groupe de travail qui couvre l'exploration, l'exploitation et l'utilisation des ressources spatiales. Celle-ci a été actée lors de la 68ème réunion du comité juridique du COPUOS, avec pour mandat : l'échange d'informations ; la définition des activités de recherche-développement et d'innovation nécessaires ; la prise en compte des aspects juridiques et le respect des traités existants ; les avantages de nouveaux instruments de gouvernance ; l'adoption de principes de base susceptibles de faire l'objet d'une résolution des Nations Unies. Ce processus est assez long, mais il présente l'avantage d'embarquer toutes les grandes puissances spatiales.
En ce qui concerne la stimulation du secteur privé, de nombreuses initiatives ont été prises par les Américains, avec de multiples challenges et prix, et avec le programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) mis en place en 2019, de sorte que les acteurs privés agissent très majoritairement sur fonds publics.
L'ESA mène des programmes similaires de stimulation des acteurs commerciaux, mais cela reste une démarche émergente. Côté français, on peut citer l'initiative de l'ANRT Objectif Lune qui vous sera présentée tout à l'heure. Le CNES est associé à l'incubateur Nubbo, qui accompagne huit start-up sélectionnées dans le cadre du programme Tech The Moon. Le CNES mène également des activités de prospective à travers Spaceibles, tout en travaillant à l'élaboration d'une feuille de route technologique qui recouvre, outre l'aspect ressources spatiales, le vol habité et le support vie aux astronautes, c'est-à-dire comment se nourrir, boire et respirer dans l'espace.
Comme vous le voyez, ces activités en sont encore à un stade préliminaire au niveau européen, mais les agences spatiales, dont le CNES, font preuve d'une volonté de s'y impliquer de plus en plus. La France a toujours été assez exemplaire dans ses activités spatiales, notamment en se dotant très tôt d'une loi relative aux opérations spatiales. À mon sens, le souci de la protection des biens et des personnes et de la durabilité des activités doit rester notre marque de fabrique.
Je souhaiterais commencer par saluer les propos introductifs du Président et des rapporteurs, car vous y osez des mots comme « souveraineté », « militarisation », « géopolitique » ou encore « commercialisation », et c'est assez nouveau. Je le salue au nom des membres de l'ANRT qui ont participé aux travaux menés avec le CNES, sous la présidence de Claudie Haigneré, et qui ont débouché sur un livre blanc qui aborde tous ces sujets. Il est en effet essentiel de « dégoupiller les tabous ».
Bien que la France soit un acteur historique du spatial, il est impératif de développer une approche européenne, puisque c'est à ce niveau seulement que nous pourrons discuter avec les États-Unis et la Chine, qui ont décidé de s'emparer de la « maison Lune ». Car, à moins que l'humanité ne disparaisse à l'horizon 2100, l'humain ira bien sur la Lune. La question est donc de savoir si l'Europe doit participer ou non à cette aventure, sur l'autel du bien commun, de l'humanisme, des valeurs de durabilité et de la protection de la « maison Terre » - car il ne s'agit évidemment pas de détruire notre berceau au bénéfice de quelques happy few qui iraient sur la Lune.
Pour en être, il ne suffit pas de beaux discours, il faudra actionner le levier scientifique et technologique. Les entreprises du spatial historique sont prêtes à le faire, mais aussi des acteurs du non-spatial - j'en veux pour preuve le fait que l'organisation du gala Objectif Lune du 7 juin dernier ait pu être autofinancée, notamment grâce à des industriels automobiles, du bâtiment et de la communication. Et nous avons milité ensemble pour une constellation européenne de télécommunications autour de la Lune, et pour que nos entreprises privées du spatial et du non-spatial assument ensemble la dimension française et européenne d'un tel objectif stratégique, qui se déclinerait au niveau militaire, scientifique, technologique, d'exploration et peut-être d'exploitation.
Nous avons encore à apprendre de l'exploration spatiale à partir de la face cachée de la Lune, mais aussi sur la physiologie et la psychologie de l'humain dans l'espace, alors même que la Station spatiale internationale va être fermée.
Qu'elles le disent ou qu'elles ne le disent pas, pour des raisons d'image, toutes les entreprises du CAC 40 ont pensé à ces champs de recherche, et s'y investissent au travers de programmes souvent organisés par la NASA. La clé est de financer des projets pour le spatial avec un retour sur investissement terrestre, en lien par exemple avec les capacités de recyclage ou de survie dans les milieux extrêmes.
Le fait d'assumer ces enjeux est tout à fait compatible avec nos valeurs humanistes. Cela nécessite aussi de renforcer les compétences scientifiques au sein des entreprises, que ce soit au niveau de l'ingénieur ou du doctorat, pour construire un spatial « propre » avec les jeunes générations.
Permettez-moi de commencer par deux remarques. Tout d'abord, quand on envoie des objets dans l'espace, on n'a pas la même conception du temps que le commun des mortels : le « demain » d'ici-bas n'est pas le « demain » de l'espace, qui renvoie à une grosse dizaine d'années. Ensuite, ce qui caractérise ces nouvelles ambitions lunaires, c'est le projet d'installer une base lunaire permanente, avec des besoins en énergie, en support de vie et en espace beaucoup plus importants que lors d'un aller-retour Terre-Lune, tout en assurant un retour sécurisé des astronautes. Contrairement à ce qu'a pu laisser penser Barack Obama, il ne s'agit pas seulement de retourner sur la Lune, mais bien de s'y installer.
Les ressources étant au coeur des nouveaux programmes lunaires américain et chinois, il ne s'agit pas seulement d'un sujet de prospective lointaine. Malgré les barrières technologiques qui subsistent pour exploiter ces ressources et y trouver une logique économique avec les financements qui en découlent, l'exploitation des ressources spatiales n'est pas pour après-demain, mais pour demain, et ce « demain » s'élabore dans l'immédiat.
À mon sens, il faut distinguer deux types d'exploitation des ressources spatiales. L'une qui relève de la prospective pure, et qui n'est pas à considérer dans l'immédiat, à savoir l'exploitation des ressources à des fins terrestres, et l'autre qui relève d'enjeux beaucoup plus concrets, soit l'exploitation de ressources spatiales à des fins spatiales, en particulier la production de carburant.
Les États-Unis ont déjà investi un milliard de dollars dans l'ISRU - soit un demi-budget spatial annuel français -, qui repose sur des technologies en cours de développement ou développées pour la Terre, notamment dans l'optique de la transition énergétique à l'hydrogène.
Si le juriste que je suis est incapable de construire des machines capables d'exploiter les ressources lunaires, l'ANRT a la chance de compter dans ses rangs, au sein du groupe Objectif Lune, des scientifiques qui ont produit dans son livre blanc un mode d'emploi partiel sur le sujet. En quelques mots, il s'agit d'extraire de l'oxygène à partir du régolithe lunaire, en le chauffant dans un réacteur catalyseur, pour obtenir de l'eau lunaire par électrolyse, puis de l'hydrogène. Or si vous mettez de l'hydrogène et de l'oxygène dans le réacteur d'une fusée, elle démarre ! Il s'agit donc de transformer la Lune en une sorte de station-service pour fusées qui, après un voyage Terre-Lune, partiraient au-delà, vers une destination « Lune vers l'infini », ce qui est beaucoup plus facile qu'en partant de la Terre pour un voyage « Terre vers l'infini ». Les ressources lunaires auront d'autres applications dans le domaine de la construction de l'habitat et du support de vie.
L'exploitation des ressources spatiales ne s'oppose pas à la durabilité ; au contraire, elle la sert pour trois raisons. D'abord, contribuer à fabriquer du carburant dans l'espace, c'est encourager le réapprovisionnement en carburant des objets spatiaux et des missions spatiales, et donc la réutilisation des équipements. Ensuite, ponctionner le maximum de ressources sur la Lune, c'est évidemment préserver les ressources terrestres. Enfin, dans le cadre d'une transition énergétique terrestre qui reposerait sur l'exploitation de l'hydrogène, les technologies développées pour l'ISRU et pour la Terre sont à peu près les mêmes : catalyseur, électrolyse, utilisation de l'hydrogène.
En ce qui concerne l'encadrement juridique de l'exploitation des ressources, la relance de la course à l'espace et l'apparition d'un nouvel affrontement est-ouest, cette fois-ci entre les États-Unis et la Chine, s'inscrivent dans un contexte où la guerre des grands traités spatiaux n'est plus. En effet, depuis 1979 et l'échec de l'accord sur la Lune, le dialogue multilatéral qui pourrait aboutir à des grands traités sur l'espace est au moins compromis, au mieux impossible. Aussi la plupart des juristes s'accordent-ils pour conserver l'acquis des grands traités spatiaux sans les remettre en négociation.
Quand les Américains ont initié les accords Artemis, ils ont d'ailleurs contribué à renforcer cette logique de l'impossible accord multilatéral sur la Lune et sur l'exploitation des ressources spatiales. Il ne s'agit en effet pas d'un accord multilatéral, mais au mieux d'une constellation d'accords bilatéraux dominés par les Américains, soit en quelque sorte un contrat d'adhésion où la marge de négociation est très limitée, ces derniers imposant à leurs partenaires leur interprétation du droit de l'espace. C'est le cas en particulier sur la remise en question du principe de non-appropriation des ressources, qui a choqué beaucoup de juristes. Ainsi la nouvelle conquête de la Lune est-elle bien aussi une nouvelle conquête du droit.
Et nous dans tout cela ? Pourquoi les Européens ne se sont-ils pas mis autour de la table pour mettre en place une charte de l'engagement européen vers la Lune d'une dizaine d'articles ? Quant à la révision de loi française sur les opérations spatiales évoquée par Pascale Ultré-Guérard, elle devra composer avec le fait que la France a signé les accords Artemis en juin dernier, lesquels mettent en avant l'exploitation des ressources lunaires. Nous avons cependant besoin d'une telle loi pour clarifier le cadre français d'une exploitation des ressources, pour sécuriser un environnement d'innovations en France autour de ces mêmes ressources, et enfin pour attirer les projets des entreprises dans ce domaine.
Et pourquoi ne pas imaginer une loi européenne sur l'exploitation des ressources spatiales ? Certes, l'article 189 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) relatif à l'élaboration d'une politique spatiale européenne semble être une barrière difficilement contournable, puisqu'il stipule que « le Parlement européen et le Conseil établissent les mesures nécessaires, [...] à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ». Toutefois, rien n'empêche de s'accorder entre partenaires ESA sur un texte de quelques articles, en gageant que chacun des États membres saura les intégrer dans son droit interne.
Il est impératif de nous armer économiquement, techniquement et juridiquement pour exister dans le cadre de la nouvelle conquête de la Lune. Il est urgent de s'engager dans cette voie, car l'affrontement entre États-Unis et Chine a besoin d'une tierce partie qui croie en la durabilité, en la science et au progrès, pour se poser en puissance d'apaisement.
Inquiétons-nous, enfin, de la baisse de l'investissement des jeunes lycéens dans les disciplines scientifiques et mathématiques, car ces jeunes étudiants sont nos ingénieurs de demain. Or si pour le spatial dix ans c'est demain, dix ans c'est aussi le temps qu'il faut à un jeune bachelier pour obtenir son doctorat et pouvoir se mettre au service des ambitions spatiales européennes. On le constate donc, les enjeux de l'exploitation des ressources lunaires sont immédiats, et à quelques mètres d'ici.

Merci beaucoup pour vos exposés très complémentaires. Pourquoi, selon vous, l'Europe n'arrive-t-elle pas à émerger en tant que troisième puissance spatiale ? Est-ce lié au fait qu'en Chine, le parti est capable d'impulser une politique puissante dans la durée, tout comme l'État fédéral américain à sa façon, alors que l'ESA, qui n'est pas l'Union européenne, doit faire cohabiter 25 ou 30 avis individuels, avec des priorités qui divergent. Comment, par exemple, les Pays baltes, qui sont confrontés à une inflation de plus de 20 %, vont-ils convaincre leur population qu'il est important d'alimenter le budget de l'Agence pour exploiter des ressources dans le futur ?
S'agissant du droit, un acteur privé a besoin, pour s'engager, d'être certain d'être protégé dans le temps. Or on ne sait pas encore qui sera propriétaire des ressources lunaires. Le premier qui développera une technologie d'exploitation va-t-il tout capter, ou voit-on s'élaborer les prémices d'une régulation prenant en compte les enjeux de développement durable ?
L'Europe a développé une culture de la négociation entre plusieurs États autour des grands projets spatiaux, c'est heureux même si c'est coûteux en temps, et que cela conduit parfois à des discussions de marchands de tapis. Nous devons conserver cette fierté de pouvoir coopérer. À cet égard, il faut souligner que le spatial n'est pas qu'un coût : la NASA a estimé que le programme Artemis générait 37 000 emplois aux États-Unis et 2 milliards de dollars d'impôts directs. Il faut donc expliquer aux contribuables européens que l'investissement réalisé pour la Lune a des bénéfices terriens immédiats : on parle d'emplois locaux, de PME qui fabriquent des câbles dans le sud de la France et de contrats pour des entreprises du CAC 40.

Merci beaucoup pour vos interventions passionnantes : on aurait envie de vous écouter toute la journée. Pensez-vous que la commande publique européenne devrait être mobilisée pour permettre un passage à l'acte des acteurs que vous avez cités ?
Je partage à 100 % votre opinion selon laquelle il faut faire valoir l'avantage compétitif de l'Europe, qui consiste à privilégier le dual et la durabilité. Notre seul moyen de retrouver une avance est d'être porteurs d'une approche éthique de la technologie et de la science.

En quoi consiste la singularité du Luxembourg ? Vous avez parlé de faire une escale sur la Lune avant d'aller vers l'infini, mais ne peut-on trouver sur Terre des ressources qui permettent d'éviter cette escale ?

Vous avez évoqué des projets scientifiques économiquement coûteux, qui sont menés dans un contexte d'insécurité juridique. Nous sommes dans un cas extrême de législation extraterritoriale, où les États qui légifèrent n'ont aucune légitimité pour le faire, et où le seul instrument juridique envisageable serait comparable au traité de l'Antarctique. Dans la mesure où ce type de traité universel est très certainement hors d'atteinte, l'ensemble des activités touchant le corps lunaire va se faire sous des régimes étatiques terrestres qui autoproclament leur capacité à fixer des normes, alors que n'importe quel autre des 195 États des Nations Unies peut la leur contester. Tout indique que cette prétention à légiférer va se démultiplier. Cela nous promet un Far West potentiellement prospère pour les avocats et les assureurs, étant entendu que si cela rendra beaucoup plus fragiles les opérations d'investissement dans l'espace, cela ne les arrêtera pas.
L'appel obligé à une contribution plus forte de l'Union européenne est bienvenu, mais il ne nous protégera pas de la réalité du rapport de force économique et juridique actuel.

J'ai bien compris que la question n'est pas de savoir si l'homme retournera sur la Lune, car ce sera le cas, mais de savoir si l'Europe participera ou non à ce voyage. Quel est votre ressenti sur le degré de mobilisation de pays européens comme l'Allemagne par exemple ?
En matière d'exploitation des ressources, l'Europe a fait le choix, notamment à travers l'ESA, de la coopération, en apportant des briques à des missions d'envergure internationale. Le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité pour l'Europe de se doter d'une autonomie en matière de vols habités pour l'orbite basse, mais ce type d'approche ne fait pas l'unanimité. Il s'avèrerait sans doute difficile - si tant est que cela soit souhaitable - de passer de la coopération internationale à la souveraineté.
En tant que telle, l'Union européenne n'est pas très impliquée dans l'exploration spatiale, contrairement à l'ESA, qui n'est cependant qu'une agence intergouvernementale de recherche-développement, sans ambition politique et sans capacité à légiférer. Une implication plus grande de l'UE me paraît incontournable.
La collaboration entre l'ESA et la Commission européenne doit passer, comme le souhaite le commissaire Thierry Breton, par des dialogues, des intégrations et des modes de coopération susceptibles de faire émerger une méta-gouvernance de cet ensemble dont les frontières ne sont pas cohérentes.
J'ai le sentiment que l'Allemagne mène une démarche intéressante de mobilisation de son industrie privée du non-spatial, notamment dans le domaine de la robotique et de la mobilité. L'Italie est aussi assez présente, y compris en dehors du lanceur spatial historique. On nous invite d'ailleurs, au sein de l'ANRT, à travailler avec des entreprises non-spatiales européennes, même si cela sort parfois de notre domaine de légitimité.
En réponse à Alain Richard, je dirai que le fait d'être certain d'aller quelque part malgré un contexte d'incertitude économique et juridique est fréquent dans le monde de la recherche-développement, comme on a pu le constater récemment pour la recherche de vaccins. S'y ajoute l'incertitude des comportements humains et des choix politiques, car rien n'est jamais acquis en la matière !
La privatisation et la commercialisation des activités spatiales se sont effectuées dans un cadre juridique en partie produit par l'industrie elle-même, dans la mesure où les lois spatiales nationales déclinent les engagements pris dans les traités : surveillance et autorisation d'opérations, immatriculation, etc. Il en résulte trois grands traits du droit des activités spatiales privées : un recours systématique à l'arbitrage ; l'importance de la source contractuelle ; la diversification des sources de financements, notamment via le capital-risque.
Alors que la négociation d'un droit public interétatique spatial relatif à la Lune est à l'arrêt, gageons que la régulation contractuelle et la régulation des assurances permettront de trouver une souplesse suffisante.
À propos du droit de propriété dans l'espace, je m'intéresse actuellement à l'histoire juridique de la conquête du Nouveau Monde, qui s'est appuyée sur un passage du Second traité du gouvernement civil de Locke pour faire valoir que les Indigènes, ne travaillant pas leur terre puisqu'ils étaient selon les colons des chasseurs-cueilleurs, n'avaient aucun titre de propriété ou de souveraineté sur le territoire qu'ils occupaient. De manière similaire, le premier à utiliser un site d'alunissage pourrait bien bénéficier d'un droit exclusif sur le territoire attaché.
Sans doute le débat sur la propriété spatiale et la propriété des ressources aurait-il pu se dérouler de façon plus apaisée si les États-Unis n'avaient pas glissé dans les accords Artemis la notion de safety zone, ou zone de sécurité, qui pourrait s'apparenter à une forme de titre de propriété. On pourrait aussi imaginer un modèle de non-propriété du territoire sous-jacent à un module lunaire avec néanmoins un droit exclusif à l'exploiter à l'instar du mobile-home qui « exploite » un terrain sans être propriétaire du sol. Au-delà de la question des titres de propriété lunaire, il me semble plus important de réfléchir aux questions de propriété intellectuelle et de propriété des découvertes faites à partir des ressources. C'est pourquoi j'aimerais savoir quels accords ont été passés, dans le cadre d'Artemis, sur l'immatriculation des objets spatiaux utilisés et des activités réalisées. Ces enjeux sont beaucoup plus immédiats que celui de la propriété du sol.
Le Luxembourg a été le premier à suivre la loi américaine sur la commercialisation des ressources. Il a donc très tôt mis en place des incitations pour les sociétés qui seraient domiciliées au Luxembourg, en se portant pour elles garant de leurs activités en tant qu'État, puisque ce sont les États qui sont signataires du traité de 1967. La politique luxembourgeoise a consisté à permettre une continuité entre la ressource minière, la ressource financière et l'innovation.
S'agissant de la question de Vanina Paoli-Gagin sur la commande publique, il est possible de faire émerger un secteur autour des activités lunaires, avec un retour sur investissement pour les activités terrestres, au travers d'un programme comme TechTheMoon auquel le CNES participe via l'incubateur Nubbo. Nous encourageons beaucoup l'ESA à passer des contrats avec ces acteurs émergents de l'exploration et de l'exploitation des ressources lunaires.

Je vous remercie pour ces échanges passionnants et riches, qui appellent beaucoup d'autres questionnements dans le cadre des travaux qui sont les nôtres, et qui sont une première pour le Sénat. Nous aurons certainement à échanger encore sur ces questions dans les semaines à venir.
La réunion est close à 10 h 10.