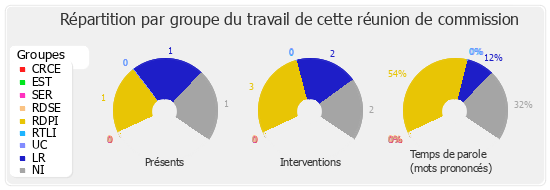Commission des affaires européennes
Réunion du 25 juillet 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Nous avons deux sujets fort importants à notre ordre du jour : l'avenir de la recherche et de l'innovation en Europe, et la taxe sur les transactions financières. Nous allons commencer par le programme de recherche européen « Horizon 2020 » qui constitue le volet « recherche » du projet de cadre financier européen. Je donne la parole à André Gattolin.

Merci monsieur le Président !
Vaste sujet que la recherche et l'innovation ! Dans le cadre des perspectives 2014-2020 actuellement en discussion à Bruxelles, la Commission européenne a présenté son huitième programme-cadre pour la recherche. Et après s'être prononcée sur la politique agricole commune et la politique de cohésion, il était important que notre commission s'y intéresse. Et ce d'autant que notre dernier travail sur ce sujet remonte au 5è programme-cadre !
Qu'est-ce que ce programme ?
Le 30 novembre dernier, la Commission européenne a dévoilé un paquet législatif de sept textes consacrés au programme-cadre pour la recherche et l'innovation baptisé « Horizon 2020 » (ou Horizon « vingt-vingt »). Vous le savez, depuis 1984, la Communauté puis l'Union européenne ont apporté un soutien financier toujours plus important à la recherche et au développement technologique à travers des programmes pluriannuels. Nous sommes actuellement dans l'exécution du septième programme-cadre qui couvre les années 2007 à 2013 et, comme pour les autres politiques européennes, des discussions ont commencé au Conseil et au Parlement européen pour la période 2014-2020.
Or, ce programme présente deux nouveautés majeures.
Tout d'abord, je dirais qu'Horizon 2020 est un peu plus que le huitième-programme cadre pour la recherche. Pourquoi ? Dans sa stratégie Europe 2020 pour la relance de l'économie, le Conseil européen a fixé comme objectif d'atteindre un niveau de 3 % du produit intérieur brut pour les investissements en recherche et développement. L'idée est qu'en investissant dans le renforcement du savoir, dans le partage des connaissances et dans l'innovation technologique, on créera les produits, les entreprises et les emplois de demain. Or, cet objectif de 3 % figurait déjà dans la stratégie de Lisbonne mais il n'a jamais été atteint.
Que s'est-il passé ?
Premièrement, si les investissements de l'Union européenne en recherche et innovation ont augmenté sur la période, ils sont restés bien en-dessous de ceux de ses concurrents mondiaux : jusqu'à 2 % en 2009 en Europe contre 2,9 % aux États-Unis et 3,36 % au Japon ! Deuxièmement, l'investissement privé a fait défaut. En France, il ne représente que 51 % de l'effort de recherche contre 78 % au Japon. L'objectif ayant été réaffirmé, cette situation ne pouvait plus durer. L'Europe dispose d'un niveau de recherche qui figure parmi les meilleurs du monde, mais ce niveau d'excellence ne se traduit pas dans la production de brevets et de produits nouveaux. Autrement dit, l'Europe cherche beaucoup, trouve souvent, mais elle peine à innover au profit de sa compétitivité, de son économie et de la société tout entière.
C'est la raison pour laquelle la Commission européenne propose désormais d'associer au sein d'un même programme-cadre la recherche et l'innovation pour les faire travailler ensemble sur des sujets déterminés. Par innovation on entend transformation technologique et mise en oeuvre industrielle.
Cette évolution me paraît bienvenue. Pour retrouver de la compétitivité, nous ne devons pas seulement nous lancer dans une course à la baisse des coûts de production dans laquelle nous perdrons toujours face à des pays où la main-d'oeuvre est beaucoup moins chère. Mais nous devons nous appuyer sur notre intelligence, sur notre créativité et sur une production de qualité !
Le programme-cadre est assez complexe et manque parfois de lisibilité. Il comporte de nombreux programmes et domaines d'action pour lesquels je n'entrerai pas dans le détail, Je me contenterai de vous en présenter les trois grandes priorités.
En premier lieu, la Commission propose de renforcer l'excellence scientifique européenne. Elle est essentielle et elle doit le rester ! Vouloir intégrer davantage le secteur marchand aux programmes de recherche et d'innovation est nécessaire, mais cela ne doit pas se faire au détriment du soutien à la recherche et aux chercheurs. En outre, l'excellence doit rester le maître mot pour la recherche en Europe. La Commission semble l'avoir bien compris puisqu'elle propose de renforcer les outils dédiés uniquement à la recherche en les dotant d'un budget de plus de 27 milliards d'euros sur sept ans.
Ces fonds seront affectés, d'une part, à des outils anciens et connus des chercheurs comme les actions Marie Curie pour leur formation et leur mobilité et, d'autre part, au financement d'infrastructures d'envergure mondiale et à la promotion de technologies radicalement nouvelles. Surtout, il est prévu de doubler le budget du Conseil européen de la recherche qui définit la stratégie scientifique générale de l'Union européenne et attribue des bourses à des scientifiques sélectionnés uniquement sur le critère de l'excellence. Indépendamment des sujets de recherche et des cadres nationaux, ces bourses viennent aider le travail des chercheurs dans les laboratoires.
Deuxième priorité : assurer la primauté industrielle de l'Union européenne dans le monde. Ce programme vise à intégrer dans le programme-cadre les politiques dites d'innovation et de leur attribuer une enveloppe de 20 milliards d'euros sur la période. Cela passe par trois formes distinctes de soutien. Tout d'abord, il s'agira de soutenir l'innovation dans le domaine des technologies génériques industrielles comme les technologies de l'information et la communication. Ce sont des technologies qui ont la capacité d'être utilisées dans toute une série de domaines. Ensuite, cela passera par un renforcement de l'accès au financement à risque avec la mise en place d'un mécanisme d'emprunt à l'échelle de l'Union et l'instauration d'un mécanisme de fonds propres pour remédier aux carences du marché européen du capital-risque. Enfin, et c'est un point très important, la Commission propose de centrer son action sur les petites et moyennes entreprises innovantes. C'est en elles que réside le plus grand potentiel d'innovation et de créativité. Aussi, elles bénéficieraient d'un outil de financement qui interviendrait en complément du programme COSME (Competitiveness of enterprises and small and medium enterprises), le nouveau programme pour la compétitivité des entreprises. Surtout, l'Union prévoit que 20 % des financements totaux doivent leur être destinés. Un gros effort serait ainsi fait, puisqu'on estime qu'actuellement se pourcentage se situe autour de 12 à 15 %.
Troisième priorité et deuxième grande nouveauté d'Horizon 2020, une approche radicalement nouvelle est proposée pour l'orientation des subventions. Elle consiste à non plus orienter les financements vers des secteurs de recherche déterminés, mais en ciblant les grands défis de société auxquels l'Europe est confrontée et dont l'ampleur est telle qu'aucun État membre ne peut y répondre seul. L'idée est d'améliorer l'impact des politiques européennes de recherche et d'innovation dans le cadre de politiques générales. Différents programmes de recherche et d'innovation associant universités, laboratoires, grandes et petites entreprises permettraient de trouver des solutions à ces problèmes sociétaux.
Sans les détailler - vous les trouverez dans le rapport -, sept défis ont été identifiés. Ils couvrent l'ensemble des politiques européennes. Un gros effort budgétaire serait fait, puisque près de 36 milliards d'euros seraient affectés à cette orientation nouvelle, soit 45 % du budget.
Je m'arrête là pour la présentation du programme et aborde des aspects plus politiques.
Cet ensemble de propositions a été bien accueilli en Europe. Il est frappant de constater que tant du côté du Conseil que du côté du Parlement européen, il n'y a pas d'opposition majeure aux nouvelles orientations proposées par la Commission. Les chercheurs que j'ai pu rencontrer, des représentants du CNRS ou de la Conférence des présidents d'université, se sont montrés eux aussi favorables au projet. Un grand groupe comme GDF-Suez le soutient, lui aussi.
Enfin, l'effort de simplification a été salué et est soutenu par beaucoup. Les procédures d'appel d'offres, les règles de participation et d'éligibilité rendent difficiles d'accès les financements européens, notamment pour les acteurs les plus petits : PME-PMI, mais également les petits laboratoires. Et il existe une vraie demande de simplifier l'ensemble de ces procédures. Des discussions sont encore en cours à ce sujet qui reste... complexe !
Bien entendu, un programme aussi important comporte beaucoup de détails qui feront l'objet de longues négociations, mais la nouvelle orientation et la nouvelle architecture semblent satisfaire l'ensemble des acteurs politiques. Certes, la volonté de la Commission européenne, et surtout de son Président, de vouloir faire de l'Institut européen d'innovation un « M.I.T. » à l'européenne suscite quelques réserves au Conseil et au Parlement européen, mais il n'y a pas d'opposition majeure. Il faut dire que le consensus obtenu tient beaucoup à la méthode de travail choisie par la Présidence danoise. Elle avait proposé que les délégations du Conseil se mettent d'accord sur le fond du programme sans évoquer le budget qui serait négocié dans le cadre plus large du cadre financier pluriannuel pour 2014-2020.
Aussi, la véritable interrogation qui demeure concerne le budget d'Horizon 2020. Le Parlement européen avait demandé 100 milliards d'euros. Nous n'en sommes pas là, mais la proposition de la Commission européenne est ambitieuse : plus de 80 milliards d'euros. Cela en fait le troisième poste de dépense en Europe derrière la politique agricole commune et la politique de cohésion. Mais loin derrière ! Dans le projet initial de la Commission, la PAC se verrait dotée de 387 milliards d'euros et la politique de cohésion près de 376 ! Nous ne sommes pas dans la même catégorie et pourtant les dépenses en recherche et développement figurent au second rang des objectifs de la stratégie Europe 2020...
Ce budget est en augmentation, certes, mais celle-ci est relative. Le précédent budget comportait une forte progressivité. Tant et si bien que pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le budget proposé dans Horizon 2020 pour 2014 permettrait tout juste un maintien des subventions pour la recherche au niveau de celles de 2013. Car il faut tenir compte du fait que, désormais, un certain nombre de subventions viseront des activités proches du marché et non plus seulement la recherche. C'est pourquoi, il me paraît important de soutenir le budget proposé.
Ce ne sera pas simple. Nous savons tous d'expérience que les discussions qui vont s'engager à l'automne sur le cadre financier pluriannuel, le CFP, seront très difficiles. Aujourd'hui, la plupart des délégations au Conseil sont favorables à un budget fort pour la recherche, même les États les moins sujets à la dépense européenne. Le 6 juillet, une première étape est intervenue en ce sens avec la réintégration d'ITER et GMES dans le CFP, avec une ligne propre à chacun et distincte du budget global de la recherche. Cependant, la situation économique et financière de l'Europe pourrait freiner un certain nombre de pays lorsqu'il faudra s'engager dans des investissements d'avenir.
Lors de son audition la semaine dernière au Sénat, Bernard Cazeneuve nous a affirmé que le Gouvernement français avait indiqué à la présidence chypriote qu'il souhaitait que le budget d'Horizon 2020 soit préservé. Ces dépenses sont nécessaires non seulement pour relancer l'économie et créer les emplois de demain, mais aussi pour conserver une recherche d'excellence. Préservons-les !
Sur le fond, vous l'aurez compris, ce programme est un bon programme, qui est bien accueilli. C'est pourquoi j'ai préféré soumettre à l'approbation de notre commission la publication d'un rapport d'information. Néanmoins, la question de l'enveloppe budgétaire d'Horizon 2020 reste pour moi préoccupante et je regarderai avec attention les propositions qui seront faites en octobre. Le cas échéant, je me permettrai de revenir vers vous si une prise de position plus forte de notre commission et de notre assemblée est nécessaire.
Je vous remercie.

Je voudrais remercier le rapporteur pour la clarté et la précision de son rapport, qui nous permet de bien situer la part de ce programme dans les grands équilibres budgétaires. Je souhaite également faire quelques remarques.
Concernant les fonds de cohésion, je suis en charge d'un groupement d'action locale dans le cadre d'un « pays ». Je constate avec satisfaction qu'en ce qui concerne la dévolution, la maîtrise et l'utilisation des fonds de cohésion, tout est fait au plus proche du territoire. J'y attache beaucoup d'importance, car c'est comme cela qu'on utilisera le plus intelligemment et le plus pertinemment ces fonds. J'ai vu deux périodes se succéder et je trouve qu'il y a une amélioration, par le canal des régions, de leur emploi.
Au sujet de la recherche et l'innovation, le budget est élevé, certes, mais j'espère qu'il pourra être maintenu, même dans cette période de restriction budgétaire. L'objectif de 3 % de dépenses me paraît justifié, tout comme le fait de renforcer notre compétitivité sur la base de l'intelligence et de l'innovation. Cependant, comme notre rapporteur, je regrette la faiblesse de l'investissement privé en la matière. Il serait intéressant de comprendre d'où provient cette carence, car il n'est pas dans notre culture, en Europe et particulièrement en France, de jouer la carte de la recherche et de l'innovation et du dépôt de brevets. Je me réjouis de la focalisation des investissements vers les PME-PMI qui me paraissent stratégiques et quant à la simplification, elle me paraît toujours souhaitable.
A la marge de notre sujet, je voudrais évoquer la question du brevet. Si cela est possible, Monsieur le Président, j'aimerais bien qu'à la rentrée notre collègue Richard Yung, qui suit ces questions, nous explique les dernières évolutions de ce dossier. L'adoption du brevet européen a encore été repoussée, alors que nous étions dans la dernière ligne droite et qu'un point d'équilibre avait été trouvé. Les députés européens ont rejeté ce compromis et j'aimerais en connaître les raisons.
Enfin, une question me tient à coeur, c'est celle d'un titre de propriété intellectuelle un peu particulier, le certificat d'obtention végétale. Ce brevet a été pensé en France mais ne trouve pas assez d'écho en Europe. Il existe en ce domaine une grande rivalité avec les États-Unis qui ne voient qu'à travers le brevet. Or, le certificat d'obtention végétale est beaucoup plus pertinent en matière de recherche : plutôt que de la capter, il permet la progression de la recherche. Quand vous déposez un brevet, vous sanctuarisez le domaine breveté, tandis qu'un certificat d'obtention végétal peut être utilisé par un chercheur pour le faire évoluer. Nous sommes en train de perdre une bataille avec les États-Unis et c'est dommage.

Ce sujet est ardu et les programmes sont souvent complexes. Le rapport de notre collègue me semble en un éclairage tout à fait utile et je l'en remercie. Je souhaite que nous ayons un budget pour la recherche et l'innovation conséquent, parce qu'on ne peut pas toujours en faire une priorité et ne pas s'en donner les moyens.
Sur la simplification, je me permettrai d'émettre un petit doute, car toutes les fois où on a voulu simplifier les choses à Bruxelles, on les a compliquées ! Je me souviens que lors des négociations sur le précédent PCRDT, les députés européens dénonçaient déjà la complexité des programmes et les difficultés pour accéder aux financements. Je crois également qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'exécution du programme. Il faudra gagner en efficacité sur ce point dans le huitième programme.
Par ailleurs, je me réjouis de la réintégration d'ITER et GMES dans le cadre financier pluriannuel. Cela permettra de les pérenniser. Ce sont des programmes très lourds et les laisser en-dehors de ce cadre financier les aurait menacés.
Enfin, je partage l'avis de Jean Bizet sur l'importance de la question des brevets et je crois qu'il serait utile de faire un point sur ce sujet.

La question des brevets nécessiterait une approche plus globale. J'ai découvert comme vous les informations concernant l'ajournement des décisions. J'ai le sentiment qu'il y a une polémique autour des trois centres et que sur les critères, l'idée est d'arriver à un brevet véritablement européen et de sortir d'une compétition interne à l'Europe qui est dommageable. Je crois aussi que cette décision du Parlement européen s'inscrit dans les relations conflictuelles qu'il entretient avec le Conseil ces derniers temps. En tous cas, je le regrette, car un brevet européen est très important pour la recherche. Je rappelle que le premier producteur de brevets en France c'est le CNRS !
Sur la faiblesse de l'investissement privé dans la recherche en France et dans l'Union, je crois que cela tient au fait qu'il n'y a pas assez de recherche « bottom-up » ou ascendante. Contrairement à la recherche «top-down » où une décision politique oriente les recherches, on peine a faire remonter des projets innovants. Lors de son audition, le ministre Bernard Cazeneuve a envisagé de faire du « bottom-up » dans le cadre du pacte de croissance et d'emploi. Cela consistera à identifier des projets au niveau des villes et des régions et de les faire remonter vers l'Union européenne. Cela me semble judicieux.
Concernant le pacte de croissance, ce qui d'une certaine façon me préoccupe, c'est qu'il comporte de fortes orientations vers l'innovation et la recherche. Je crains que lorsque les négociations sur le CFP se durciront, les partisans de la PAC, d'une part, et les partisans de la cohésion, d'autre part, ne disent : « la recherche et l'innovation ont déjà été bien aidées par le pacte de croissance, il n'est pas nécessaire d'affecter un budget si important au programme-cadre Horizon 2020 ».
Sur les PME, un aspect important concerne leur taille qui est très différente en France et en Allemagne, par exemple. Il existe même des conglomérats de PME, soutenus par les Länder allemands pour l'exportation et la demande de subventions européennes. C'est un exemple dont on pourrait s'inspirer.
Cela nous permettrait d'améliorer la part des soutiens européens à la recherche française. La France finance près de 17 % du budget européen et ne reçoit que 11 % des fonds alloués à la recherche. Pour améliorer ce résultat, il faudra mettre fin en France à la concurrence entre les appels d'offres nationaux et les appels d'offres européens. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso nous a redit combien les chercheurs s'étaient détournés des fonds européens quand le plan de relance français a été adopté en 2009. Or, il existe des initiatives intéressantes ailleurs en Europe : le Royaume-Uni a prévu que les projets de qualité étaient d'abord soumis à l'Union européenne pour une demande de subvention et, s'ils n'obtenaient pas cette dernière, ils étaient réintégrés dans le programme national. C'est tout à fait pertinent. Et, de plus, cela évite aux chercheurs de devoir monter des dossiers sur des critères différents et allège ainsi leurs charges administratives, dont tous ceux auditionnés ont souligné la lourdeur.
Concernant ITER et GMES, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Des programmes aussi importants ont besoin de visibilité sur leurs financements à moyen terme.
Sur la simplification, il ne faut pas qu'elle soit une simplification pour la Commission qui gère les financements mais bien pour les acteurs qui les demandent ! Cela reste un sujet complexe...
À l'issue du débat, la commission a autorisé la publication du rapport.

C'est un sujet d'étude au long cours qui alimente le débat international et national puisque nous allons en reparler à propos du projet de loi de finances rectificative !
Après des déplacements à Londres, à Bruxelles, au Luxembourg et à Zürich, je reviens donc devant vous pour vous exposer l'évolution de ce projet et pour commencer, permettez-moi de rappeler rapidement les principes qui sont à l'origine du projet de la directive créant la taxe sur les transactions financières :
- s'assurer que le secteur financier contribue de manière satisfaisante aux charges publiques, c'est-à-dire en clair qu'il soit taxé à hauteur de sa capacité de contribution ;
- limiter l'activité financière indésirable (entendez le trading trop fréquent) et stabiliser les marchés ;
- augmenter les recettes publiques ;
- améliorer le fonctionnement du marché unique en éliminant les doubles taxations et les distorsions de concurrence.
Ce sont des principes fondamentaux généraux, mais ce sont surtout des objectifs très ambitieux assignés à la TTF qui elle-même, en tant que mécanisme fiscal, se présente comme suit :
- une base très large, car la taxe concerne l'ensemble du marché secondaire des actions et des obligations, mais aussi l'ensemble des dérivés ;
- un taux minimal de 0,1 % sur les actions et les obligations et de 0,01 % sur l'ensemble des autres transactions financières ;
- l'application du principe de résidence, c'est-à-dire que la taxe est perçue dans l'Etat membre où réside au moins une des parties à la transaction, quel que soit le lieu où a lieu cette transaction.
C'est l'aspect peut-être trop global (l'ensemble des transactions) et le choix du principe de résidence (qui astreint au paiement de la taxe des parties non résidentes) qui a détourné de ce projet la plupart des Etats membres. Outre cela, beaucoup craignent que les places financières européennes (Londres et Luxembourg en particulier) perdent des pans entiers du marché au profit de New York, Singapour et Hong Kong, et demain Rabat et Ryad qui se préparent.
Ainsi le projet de directive dans sa rédaction actuelle n'a pas pu obtenir l'appui des 27 Etats membres et nous nous orientons désormais vers une coopération renforcée dont les contours se dessinent lentement.
Le projet de la Commission a affiché des ambitions démesurées qui ont fait obstacle au consensus.
D'abord, le principe de résidence est ainsi formulé dans l'article du projet de directive qui délimite son champ d'application : « La présente directive s'applique à toute transaction financière dès lors qu'au moins une des parties à la transaction est établie dans un Etat membre et qu'un établissement financier établi sur le territoire d'un Etat membre est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction. »
Ce principe de résidence a pour conséquence qu'une institution financière est considérée comme établie dans un Etat membre et donc redevable de la taxe dès lors que (article 3 du projet) :
- elle a été autorisée à agir comme institution financière par l'Etat membre où elle se trouve ;
- elle a son siège social dans l'Etat membre concerné ;
- elle a son domicile ou sa résidence usuelle dans l'Etat membre ;
- elle dispose d'une succursale dans cet Etat membre ;
- elle est partie à une transaction avec une institution financière ou une autre partie résidant dans un Etat membre.
Ce principe a été conçu pour être particulièrement extensif et sa première conséquence est que si une transaction met en rapport deux parties ayant leur résidence dans l'Union européenne, la taxe est due deux fois, une fois par chacune des parties, quel que soit le lieu où la transaction est conclue.
A contrario, une transaction entre deux parties non résidentes mais prenant place dans l'Union européenne ne donne pas lieu au paiement de la taxe.
De même, il convient de remarquer qu'en application de la cinquième condition, une transaction entre une partie résidente et une partie non résidente donne aussi lieu au paiement de la taxe à deux reprises : la partie résidente parce qu'elle est résidente et la partie non résidente parce qu'elle traite avec une partie résidente.
Dans ces conditions, les adversaires de la taxe ont eu beau jeu de conclure que le principe de résidence portait mal son nom puisqu'il introduisait au contraire l'extraterritorialité de la taxe ; en effet, des parties étrangères à l 'Union seraient amenées à payer la taxe et des établissements financiers étrangers seraient requis pour encaisser la taxe et la verser à des fiscs étrangers. Le principe tel qu'il figure dans le projet de la Commission leur paraît donc assez difficile à appliquer. Pourtant, il s'agit d'une « mondialisation de la fiscalité de fait ».
Toutefois, la Commission a maintenu sa position en affirmant que le principe de résidence était le meilleur moyen d'éviter qu'on puisse échapper à la taxe ou délocaliser la transaction. Le principe de résidence, dans l'esprit de la Commission, implique que ce qui importe, ce n'est pas le lieu de la transaction, mais l'existence ou non d'un lien économique avec l'Union européenne. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un principe particulièrement astucieux, répondant bien au risque éventuel de délocalisation des transactions.
Cependant, à défaut de délocaliser les transactions, les institutions financières pourront toujours se délocaliser elles-mêmes ou passer par leurs filiales.
La Commission propose une base très large et un taux très bas mais en théorie seulement. L'article 2 du projet de directive entend par « transaction financière » l'achat ou la vente d'un instrument financier avant compensation et règlement et englobe les contrats de prêt et d'emprunt de titres, le transfert du droit de disposer d'un instrument financier ainsi que les contrats dérivés. La Commission veut toucher tous les acteurs, tous les marchés et tous les produits du secteur financier. Cette ambition a soulevé des craintes chez certains membres.
En théorie, les taux minimaux proposés sont de 0,1 % pour les actions et les obligations et de 0,01 % pour les produits dérivés. Ces taux sont loin d'être des taux dérisoires bien qu'ils soient présentés comme faibles.
Pourtant, à ce stade, la base en termes d'instruments financiers n'est large qu'en apparence dans la mesure où nous n'avons pas encore les moyens de connaître le volume des transactions sur les dérivés qui fonctionnent en dehors des marchés réglementés. Je plaide pour ma part depuis le début pour une obligation de déclaration de toutes les transactions, qu'elles aient lieu ou non sur un marché réglementé.
Nous serons aidés par EMIR et MIFID. EMIR vise à introduire une plus grande transparence et une meilleure gestion des risques sur le marché des dérivés de gré à gré (obligation de compensation, règles communes pour les contreparties centrales, obligation de reporting, etc). MIFID améliore la protection des clients mais garantit et accroît aussi la transparence des marchés financiers ; ce règlement concerne l'ensemble des sociétés d'investissement. Il est prévu que les dérivés soient négociés sur des marchés réglementés. MIFID nous aidera donc à connaître les flux.
Quant aux taux proposés, ce sont des minima selon la Commission qui laisse aux Etats membres le soin de les augmenter, en tant que de besoin, tout en signalant que des taux trop élevés seraient susceptibles d'encourager les délocalisations. On rappellera que le taux s'applique au prix effectif de la transaction.
Nos interlocuteurs du secteur financier nous ont fait remarquer que les taux n'étaient faibles qu'en apparence puisque l'effet de cascade propre aux transactions n'avait pas été pris en compte par la Commission. Ainsi un simple achat d'action à la Bourse entraîne des achats et des ventes entre plusieurs parties prenantes comprenant les courtiers, les chambres de compensation, et la centrale de compensation. A ce stade du projet, seule la centrale de compensation est exemptée du paiement de la taxe, si bien qu'il faut ajouter aux taxes payées par l'acheteur et le vendeur celles qui seraient payées par les deux courtiers et les deux chambres de compensation, chaque fois à l'achat et à la vente, ce qui conduit dans le meilleur des cas à un taux de 2,2 % pour une simple transaction. Cet effet de cascade sera peut-être corrigé dans le projet de coopération renforcée, mais dès le départ, il a naturellement joué contre le projet de directive. Pourtant, il n'entrait sans doute pas dans l'intention de la Commission pour qui la transaction n'est qu'un achat et une vente.
Mais il y a d'autres obstacles au consensus.
Ainsi les Etats membres qui s'opposent à la taxe ont rappelé que le coût de la taxe finirait par peser sur les clients du secteur bancaire et non sur les établissements financiers eux-mêmes.
Ces clients comprennent de simples particuliers, mais aussi des institutions qui interviennent constamment sur les marchés et tout particulièrement les fonds de pension. La taxe a été présentée alors comme une attaque directe contre le pouvoir d'achat des retraités. De même, les fonds d'investissement verraient leurs coûts de gestion alourdis alors que la mutualisation des dépôts avait pour mérite de diminuer les coûts de gestion pour les petits investisseurs.
Enfin, l'instauration de la TTF aurait, pour la Commission, un effet négatif sur la croissance. C'est ce qu'elle indique dans sa première étude d'impact du projet de directive. Cependant, à la demande réitérée du Parlement européen, la Commission a présenté une nouvelle étude d'impact moins négative, semant le doute dans les esprits.
En outre, il y a d'autres modèles de taxation du secteur financier qui vont influencer la coopération renforcée. En s'engageant dans la coopération renforcée, quelques Etats membres songent déjà plus à un droit de timbre qu'à une taxe Tobin européenne, et ils n'excluent pas de s'inspirer du droit de timbre à l'anglaise ou à la suisse, de l'impôt de bourse réintroduit par la France, voire d'une imposition nouvelle de l'activité financière (comme le « Financial Activities Tax »).
· Le « Stamp Duty » anglais et la « Bank Levy ».
Le « Stamp Duty » est un impôt dû au titre des transactions portant sur les actions de sociétés britanniques et sur les actions de sociétés étrangères enregistrées au Royaume-Uni, mais aussi sur les options d'achat et sur les droits provenant d'actions déjà détenues,
Le taux de cette taxe est de 0,5 % (1,5 % en cas de transfert à l'étranger). La recette annuelle varie entre 2,5 et 3,5 milliards de Livres.
A côté du « Stamp Duty » existe, depuis 2011, la « Bank Levy » sur le passif des banques établies au Royaume-Uni dès que la somme de leurs dettes dépasse 20 milliards de Livres.
Le taux de la taxe est actuellement de 0,04 % et les recettes d'environ 2 milliards de Livres.
Ce sont deux pistes qui peuvent entrer en concurrence avec la TTF.
· La « Financial Activities Tax » dite « taxe sur les bonus »
La F.A.T. est un concept soutenu par le FMI. Il s'agit d'une taxe sur la rémunération des banquiers et sur le résultat net des banques. Le FMI a présenté son projet devant les pays du G20. La Commission a soutenu quelque temps ce projet avant de se rallier à la TTF et de rédiger l'actuel projet de directive.
Cette taxe est injustement appelée « taxe sur les bonus », car elle se propose de taxer, au-delà des bonus, l'ensemble des rémunérations et des profits ; mais elle ne vise que le secteur bancaire.
· Le Droit de timbre suisse
C'est un impôt qui a fait ses preuves depuis 1918 parce qu'il a été régulièrement adapté. Il frappe le transfert de propriété lorsque la possession des titres passe d'un détenteur à un autre. Les titres concernés sont les actions, les obligations, les parts de fonds et certains produits dérivés. La mutation doit s'opérer à titre onéreux. La taxe est de 1,5 %o pour les titres suisses et de 3 %o pour les titres étrangers pour chaque transaction (chaque partie en paie la moitié). Banques et agents de change étrangers sont exonérés ainsi que les instruments collectifs suisses ou étrangers. C'est un impôt simple et efficace.
· La TTF à la française : un simple droit de timbre
La loi de finances rectificative du 14 mars 2012 crée une taxe sur les achats d'actions françaises. Le champ d'application est réduit par rapport au projet de directive sur la TTF et même par rapport à l'ancien impôt de bourse français supprimé en 2007, mais cette assiette réduite devait éviter de créer un désavantage compétitif pour les marchés financiers français.
Il s'agit d'imposer le transfert d'actions françaises, sur un marché réglementé français, mais seulement d'actions d'entreprises dont la capitalisation boursière dépasse le milliard d'euros. Le taux était de 0,1 %. Le dispositif était considéré comme une amorce en attendant l'adoption d'une TTF.
Le projet de la nouvelle loi de finances rectificative pour 2012 veut multiplier le taux par 2.
J'en viens maintenant aux contours prospectifs de la coopération renforcée.
Car, naturellement, le Parlement européen s'est prononcé sur le projet de directive de la Commission. Nous avons d'ailleurs rencontré l'auteur du rapport, Mme Annie Podimata, très optimiste sur l'issue de la coopération renforcée et considérant la TTF comme « un instrument de sortie de crise ». Les taux ont été jugés adaptés, mais il a été suggéré, avec beaucoup de réalisme, de dispenser de la taxe les fonds de pension.
Cependant, en contrepartie de cette option réaliste, le Parlement étend le champ d'application de la TTF en ajoutant un « principe de lieu d'émission » et en le combinant avec le principe de résidence. Ainsi les institutions financières situées en dehors de l'Union seraient également obligées de payer la TTF quand elles négocient des titres émis à l'origine dans l'Union européenne.
Le Parlement envisage de lourdes sanctions en cas de fraudes et souhaite que, tant que la taxe n'est pas payée, la mutation soit considérée comme nulle.
Le Parlement n'exige pas que le produit de la TTF soit transféré au budget de l'Union, laissant pour l'instant cette importante question pendante.
Pour ma part, je regrette de devoir signaler que le débat sur le partage du produit d'une éventuelle TTF s'est arrêté.
Quoi qu'il en soit, nous nous engageons dans une coopération renforcée et plusieurs étapes nous attendent. Au terme d'un débat d'orientation des ministres des finances des 27 Etats membres, le 22 juin, à Luxembourg, la présidence danoise de l'Union européenne a constaté qu'aucun accord ne pouvait être trouvé à l'unanimité sur la directive instaurant la TTF, mais qu'un nombre significatif de pays étaient prêts à former une avant-garde (ils seraient entre 9 et 12), à savoir l'Autriche, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Portugal, la Slovénie, la Grèce, l'Espagne et sans doute l'Italie, la Pologne, la Slovaquie et l'Estonie. Ces Etats doivent maintenant amorcer la deuxième étape : l'envoi à la Commission d'une lettre détaillant leur projet, ce qui est nettement plus difficile, car ils se divisent déjà en deux écoles (ceux qui veulent créer la TTF en amendant le texte du projet de directive et en avançant par petits pas, et ceux qui veulent une taxation du secteur financier adaptée et efficace tout de suite et pas forcément une TTF).
La troisième étape consistera pour la Commission à vérifier que toutes les conditions de la coopération renforcée fixées par le traité sont respectées et, entre autres, l'absence de risque de créer des distorsions au sein du marché intérieur. Si les conditions sont respectées, la Commission proposera au Conseil d'autoriser formellement la coopération renforcée. Le Conseil devra se prononcer à la majorité qualifiée quand le projet aura aussi reçu le consentement du Parlement, ce qui constitue la quatrième étape.
Enfin, la Commission fera une nouvelle proposition législative en bonne et due forme qui devra être adoptée selon la procédure de codécision.
Au cours de ces étapes, les pays opposés à la TTF auront tout le loisir de vérifier que le projet de coopération renforcée ne lèse pas leurs intérêts. C'est là que sont les difficultés.
Quant aux contours de la coopération renforcée, ils ne sont pas encore très précis d'autant plus que la France et l'Espagne ont demandé que l'on adopte une approche graduelle qui exclurait, dans un premier temps, les produits dérivés et les fonds de pension et peut-être même les fonds d'investissement.
Ailleurs, on étudie déjà des variantes à la TTF afin d'élargir, sinon d'affermir, le consensus. Une piste existerait du côté de la TVA selon l'Autriche. Une autre consisterait à généraliser le droit de timbre.
Le commissaire européen, M. Algirdas Semeta, s'est engagé à réaliser une nouvelle étude approfondie sur l'impact économique de la TTF.
De source officieuse, on s'orienterait peut-être vers une première étape minimaliste (champ d'application étroit) ; puis on procèderait par étapes. Toutefois, il faudrait d'abord convaincre du bien-fondé de la TTF ceux qui entrent dans la coopération renforcée avec l'idée que la TTF est dépassée et qu'il faut envisager un autre type de taxation du secteur financier.
Quoi qu'il en soit, un débat d'orientation sur le sujet aura lieu lors de l'ECOFIN du 9 octobre prochain.
Ce qui est curieux avec la TTF, c'est qu'il existe presque partout un consensus enthousiaste sur le principe et sa justesse et que très vite on se heurte aux difficultés dès qu'on aborde sa mise en oeuvre.
En conclusion, je dirai qu'une fois de plus, l'Europe avance lentement mais elle avance...
Si l'on regarde les choses avec objectivité et pragmatisme, rien n'est encore gagné pour la TTF, mais ce qui est acté et gagné à l'heure où je vous parle, c'est l'idée qu'il faut mettre sur pied une taxation européenne du secteur financier, en gardant à l'esprit qu'il faut le faire sans perdre de parts de marché dans ce secteur où l'Europe n'est déjà plus en position dominante.

Je remercie Mme Fabienne Keller pour la clarté de son exposé et je rappelle que je soutiens le principe de la TTF depuis plus de quinze ans.

J'avoue mon scepticisme et, selon moi, en matière de TTF, c'est « tout le monde ou personne » qui est le principe qui doit prévaloir. Sur le principe, je suis un adepte des coopérations renforcées. Après les contentieux matrimoniaux et le brevet, ce serait la troisième, mais le contexte est très différent. Il y aurait un risque sérieux de marginalisation des participants à cette coopération renforcée. Le Président d'Euronext nous a dit récemment que l'Europe n'était plus en position dominante sur les marchés financiers et que la City était la tête de pont des Etats-Unis. L'instauration de la TTF achèverait de faire décrocher l'Europe continentale.

Je remarque, si je comprends bien, que quelle que soit la solution choisie (directive européenne, proposition du Parlement européen, coopération renforcée selon la première école), la TTF implique des parties extérieures à l'Union européenne ou des pays qui n'entreraient pas dans la coopération renforcée. Cela complique la situation puisque ces pays seraient contraints de payer la TTF sans l'avoir voulu.
Quant au risque d'affaiblir les marchés européens, je n'y crois pas, car il y a une telle activité que quelques pourcents ne changeront rien.

C'est une idée qui fait son chemin. Pour la taxe française, il serait bon de savoir si son produit tombe dans le budget général ou pas... Je signale que le principe de résidence rend difficile la délocalisation des transactions. Je confirme que la TTF aurait bien des conséquences (fiscales ou simplement administratives) même sur les pays qui ne l'adopteraient pas, mais je ne peux pas me prononcer sur ce que sera le texte de la coopération renforcée. Il faudra être vigilant.

C'est une cause juste et pour savoir si sa mise en oeuvre est possible, il faut se lancer dans cette mise en oeuvre.