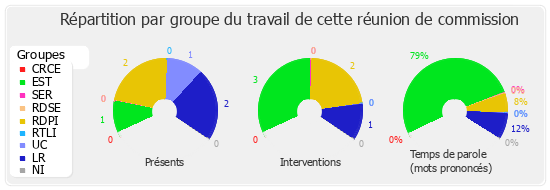Mission d'information Gratuité des transports collectifs
Réunion du 28 mai 2019 à 14h15
Sommaire
La réunion

Nos collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) ont demandé une mission d'information sur la gratuité des transports collectifs. M. Guillaume Gontard, membre de ce groupe, en est le rapporteur. La gratuité des transports collectifs est-elle une fausse bonne idée, ou bien faut-il au contraire la promouvoir, sachant que quelques réseaux ont d'ores et déjà choisi la gratuité ? De nombreuses questions se posent : s'agirait-il d'une gratuité totale ou partielle ? À quel moment la mettre en place ? Pour quel type de clientèle ? Nous sommes amenés à auditionner des experts de la question, dont vous faites partie. Transdev est en effet un opérateur de réseaux de transports publics réputé pour sa qualité.
De quoi parle-t-on quand on parle de gratuité ? Le service des transports publics a un coût pour la collectivité. On l'estime aujourd'hui à 20 milliards d'euros par an, avec un versement transport de l'ordre de 7,5 milliards d'euros. En moyenne, les usagers financent 25 % du coût des transports collectifs. Le versement transport représente un peu plus de 40 % du financement. Le reste est payé par la fiscalité locale, donc par les contribuables et le budget des collectivités territoriales. Une gratuité totale, pour tous, représente un budget minimal supplémentaire de 25 % de 20 milliards d'euros, soit 5 milliards d'euros. Pour l'Ile-de-France, par exemple, le coût du transport public est estimé à 10 milliards d'euros. La participation de l'usager représente 28 % des recettes par rapport aux dépenses, dont 35 millions de touristes qui prennent pour la plupart des billets payants. Globalement, 2,8 milliards d'euros sont financés par les recettes d'exploitation.
Pour la métropole du Grand Lyon, c'est 800 millions d'euros de budget annuel de fonctionnement, 25% des recettes sont payées par les usagers, soit 245 millions d'euros de recettes.

Les chiffres pour Lyon sont beaucoup plus élevés. La participation des usagers représente 60 % des frais de fonctionnement, ce qui est un niveau très haut, et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en France.
La gratuité dont nous parlons n'est pas celle des transports, mais de l'usage des transports. Permettez-moi avant toute chose de dresser le panorama de la mobilité.
L'évolution des mobilités concerne tous les territoires, du plus dense au moins dense. La mobilité du quotidien représente plus de 80 % des mobilités inférieures à 80 km. En outre, il est important de se projeter sur les évolutions démographiques. La ministre des transports, ce matin, a évoqué une augmentation de 7 millions d'habitants dans les trente ans à venir en France. Enfin, il faut prendre en compte la nécessaire transition énergétique, dont on a mesuré l'importance lors du vote aux élections européennes, avec un remplacement significatif voire total des véhicules thermiques par des véhicules zéro émission - l'électricité et à terme l'hydrogène. On peut rajouter les effets d'entraînement de la loi d'orientation des mobilités (LOM). Enfin, il faut prendre en compte la digitalisation, via des plateformes et des partenariats, pour augmenter l'approche et l'offre de services sur le territoire. L'exemple du MaaS (« mobility as a Service ») - qui est une plateforme digitale - permet de prendre en compte l'ensemble des services de mobilité. Ce type d'outil existe à Mulhouse avec le « compte mobilité ». L'expérience la plus aboutie en France verra le jour en septembre à Saint-Etienne : l'usager pourra prendre n'importe quel type de transport jusqu'au parking, au vélo, au covoiturage et avoir, à la fin du mois, une facturation mensuelle de la mobilité consommée. Ces évolutions vont continuer à développer des demandes et des besoins en termes de mobilité.
Transdev, avec sa filière Cityway, est à la pointe en matière de MaaS. Notre entreprise milite également dans le cadre de la LOM pour que l'accès aux données et aux canaux de vente se fasse au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité qui pourront les réutiliser. Nous ne pourrons pas améliorer la situation de l'ensemble des territoires, s'il n'y a pas une approche systémique de la mobilité.
Rajoutons l'augmentation des transports à la demande pour amplifier les services dans les zones peu denses, en particulier les territoires semi-ruraux et ruraux. Enfin, je rajouterai le développement des bus à haut niveau de services (BHNS), qui permettraient d'avoir des pénétrantes permettant de faciliter l'accès à la vie culturelle, à la vie sociale, entre les zones moins denses, les zones périurbaines et les zones urbaines. On peut également évoquer les projets existants de développement de tramways et de téléphériques. Ces services entraînent un accroissement de la fréquentation, mais pas systématiquement une augmentation des recettes, car de nombreux bénéficiaires sont déjà des abonnés, majorant ainsi la contribution des collectivités.
La mobilité de demain peut se résumer ainsi : plus de services, plus d'investissement, et donc des budgets plus importants assumés par les collectivités avec un versement transport qui atteint souvent le plafond légal. D'ailleurs, il faut rappeler que le versement transport est un impôt dit de « production », il fait souvent l'objet d'une contestation de la part des entreprises.
Des exemples de gratuité existent déjà en France dans de nombreuses collectivités territoriales, car la tarification relève des autorités organisatrices de la mobilité. Elle est décidée au bénéfice de certaines catégories de la population : les seniors, les jeunes, les demandeurs d'emplois, les allocataires du revenu de solidarité active (RSA), les familles. On a pu constater que la gratuité pour tous a plutôt été mise en oeuvre dans des réseaux où le ratio recettes/dépenses est faible, de l'ordre de 10 à 15 %, avec un versement transport important et déjà au plafond.
La vocation de Transdev est d'accompagner les collectivités territoriales dans leur vision et leurs choix en matière de politiques publiques. Lorsqu'une collectivité décide de mettre en place la gratuité pour tous, comme à Niort ou à Dunkerque, réseaux dans lesquels nous opérons, nous nous devons d'être force de propositions pour permettre à la collectivité d'atteindre ses objectifs. Ils peuvent être très différents en fonction de la taille de la collectivité, de son territoire, de sa complexité territoriale, de ses caractéristiques de population, de l'attractivité déjà existante de son centre-ville, et des enjeux en termes d'accessibilité aux services publics, à l'emploi, à la culture et à la vie sociale. Voici nos constats : oui, l'usage gratuit pour tous les transports permet d'augmenter la fréquentation. C'est indéniable. À Dunkerque, la fréquentation a augmenté de 50 %.
La gratuité permet également de revitaliser et de rendre plus attractif un centre-ville modulo une offre commerciale adaptée. S'il n'y a pas de service, d'attractivité de l'offre commerciale, vous n'atteignez pas votre objectif.
En revanche, il n'y a pas d'effet choc de report modal depuis l'automobile. Peu de données existent, mais c'est ce que nous constatons sur nos réseaux. Nous constatons même que l'augmentation de fréquentation peut se faire au détriment des modes doux : les utilisateurs de vélo, ceux qui marchent entre deux et trois stations, arrêtent et utilisent l'équipement mis à disposition. C'est moins bon pour la santé, mais cela fait une fréquentation virtuelle de personnes qui n'auraient pas pris les transports collectifs et qui auraient laissé de la place supplémentaire à ceux qui pourraient en avoir vraiment besoin.
La gratuité est une solution radicale au profit des personnes ayant un faible revenu. Mais, faut-il aller vers la gratuité pour tous ? L'égalité financière ne veut pas dire l'égalité d'accès. Cela dépend de l'offre disponible : les territoires sont-ils desservis ou non ? La gratuité peut permettre de lever un certain frein à la mobilité. L'usage gratuit conduit partiellement à donner plus d'autonomie, mais cette mobilité est inclusive et dépasse la question économique : existe-t-il des transports adaptés, à la séniorité et au handicap ?
La gratuité de l'usage est un choix politique qui relève de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité. Nous autres, opérateurs, sommes là pour l'accompagner. Il y a déjà une gratuité appliquée au bénéfice de certaines populations. On pourrait imaginer des tarifs spécifiques lors d'évènements culturels ou sportifs, de la gratuité temporaire. De manière générale, la gratuité existe aujourd'hui bien plus largement que l'on ne l'imagine.
La croissance de l'offre de services est inéluctable pour affronter les enjeux de demain, comme la croissance de la population. Une meilleure desserte des territoires par les autorités organisatrices de la mobilité est nécessaire. La LOM amplifie cette logique, dans un contexte où 29 % des territoires ne sont, pour le moment, pas du tout desservis par des autorités organisatrices de la mobilité.
Nous faisons face à des défis en termes de mobilité : un meilleur accès à l'emploi, la transformation vers des solutions zéro émission : cela va conduire à un accroissement des offres de services. Mais, cela nécessite des financements qui doivent être pérennes pour permettre une véritable transformation des usages. Or, la LOM n'apporte aucune réponse sur ce point. Pourtant, il faudra financer ces transitions numérique, écologique et sociétale.
La gratuité totale pour tous et partout en France, contrairement à une gratuité ciblée, déjà existante et qui peut être amplifiée, peut créer un déséquilibre supplémentaire entre les besoins à financer et les ressources dont disposeront les collectivités. Notre rôle d'opérateur est d'accompagner votre vision politique. Néanmoins, nous sommes tous confrontés à la réalité et aux enjeux futurs.

Vous avez eu raison de rappeler que la gratuité concerne l'usage des transports, et qu'elle pose la question de son financement. Mon groupe souhaitait s'interroger sur la question de la gratuité des transports, car elle existe dans une trentaine de collectivités en France, et ce thème fait régulièrement son apparition au moment des élections municipales. Or, les prochaines élections approchent, et il nous semblait important de poser le débat. Enfin se pose la question de l'accès au transport : l'accessibilité et les mobilités sont-elles un droit comme peut l'être l'accès à l'éducation ou bien au logement ?
Bien évidement se pose la question du financement. Vous avez indiqué que nous devrons faire face à un besoin supplémentaire de financement lié à l'augmentation de la population. Nous connaissons également les limites du versement transport. La question n'est-elle pas maintenant de réfléchir à d'autres modes de financement des transports collectifs ? À chaque fois que l'on aborde la gratuité, on le fait en restant sur le même schéma de financement : on enlève la part de l'usager sans la remplacer par autre chose. Ne pourrait-on envisager une taxe, comme une forme de vignette auto par exemple ? Avez-vous des idées sur d'autres types de financement en France ou à l'étranger ?
Je souhaite également revenir sur les études dont vous avez parlé. Depuis que je travaille sur cette mission, j'ai été particulièrement interpellé par le fait qu'il existe à ce jour très peu d'études sur les collectivités ayant mis en place la gratuité totale des transports collectifs. Une étude relative à la mise en oeuvre de la gratuité à Dunkerque devrait prochainement être publiée. Souvent, les impressions sont les mêmes que celles dont vous nous avez fait part : il y a très peu de report modal de la voiture vers les transports en commun. L'Ademe nous a indiqué la même chose en se référant à une étude de 2007 sur Châteauroux, réalisée à sa demande. Or, nous avons auditionné la personne du bureau d'études ADETEC qui l'a réalisée. Ses conclusions sont inverses : 55 % des nouveaux usagers viennent de la voiture. Il y a toujours une sorte de flou dans ce qu'on annonce. Cela est sans doute lié au fait que nous disposons de très peu d'études précises sur ce sujet. L'autre conclusion importante concernant Châteauroux est qu'un tiers des nouveaux usagers étaient des personnes qui ne se déplaçaient pas du tout. Je trouve ce point intéressant sur l'aspect social : pour certains, le tarif est une barrière importante. Disposez-vous d'autres études à ce sujet ? De même, nous ne disposons pas d'éléments chiffrés sur le fait qu'un grand nombre de nouveaux usagers du fait de la gratuité serait d'anciens utilisateurs de modes de transport doux.
En tant qu'opérateur, avez-vous des exemples de gratuité à l'étranger ? Avez-vous travaillé avec d'autres pays où elle a été mise en place ? Pour l'instant nous nous sommes principalement concentrés sur la France.
Enfin, en tant qu'opérateur, quelles sont les conséquences pour vous de la mise en place de la gratuité ou d'une tarification particulière ?
On peut constater que les collectivités ayant travaillé sur la gratuité ont également travaillé sur la redynamisation de leur centre-ville. Il me semble que c'est un objectif politique qu'il faut accompagner.
En matière de chiffres, je suis comme vous. Il me semble que le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publique (LIEPP) de Sciences Po Paris a réalisé en 2018 une étude sur la gratuité des transports en commun. Elle indique que le report modal de l'automobile est présent mais très faible. Nous ne disposons pas d'autres chiffres. À Dunkerque, on constate que les habitants d'un quartier viennent plus en masse qu'avant au centre-ville du fait de la gratuité. On se dit aussi qu'on pourrait cibler la gratuité de manière beaucoup plus directe et partielle, plutôt que de mettre en place une gratuité pour tous.
Comment fait-on pour accompagner ces projets ? J'ai en tête les villes de Templin et d'Hasselt, qui sont des exemples que tout le monde va vous citer. Il y a un aspect pionnier dans certains pays. Il est difficile de dire si les résultats sont probants ou pas. Nous n'en avons pas tiré de grands enseignements car l'approche est assez différente.
En matière de financement, on peut réfléchir à une nouvelle taxation. Mais je ne sais pas si le pays est en capacité de le supporter. Lorsqu'une collectivité nous dit vouloir passer à la gratuité totale, nous savons le faire et accompagner ses responsables. La question est de savoir comment la financer : soit une réduction d'autres budgets, soit une augmentation du produit du versement transport. On peut aussi avoir des approches d'optimisation. Mais à un moment donné, les limites sont atteintes et il faut offrir un service de qualité, avec de la fréquence et de la ponctualité. Certes, il n'y a rien de plus facile que de réduire la fréquence, de ne pas faire toutes les lignes, d'aménager moins d'arrêts. Mais, si on veut être sérieux, il faut une offre proposant de la qualité de service, de la ponctualité, et donc in fine la financer par de la fiscalité. En outre, la gratuité conduit vers davantage de besoins et de demandes de services. Les coûts augmentent pour la collectivité : on veut faire plus, rayonner davantage. Le service augmente et n'est plus financé. Ce sont des questions de choix politiques.
On peut simplifier la vie des usagers, c'est l'objectif de tous les dispositifs de MaaS. On peut également cibler la gratuité sur les bonnes personnes. Il ne faut pas oublier de traiter le sujet des stationnements en centre-ville. On observe que là où l'on fait de la dépénalisation structurée et organisée du stationnement de surface, on a des rentrées financières supplémentaires et moins de « voitures ventouse ».
Nous travaillons également avec les collectivités sur le contrôle, la médiation et la sûreté. C'est important pour réduire les taux de fraude. Lorsque l'on met en place la gratuité, il n'y a plus, en théorie, de sujet de compostage ou de validation du ticket. Mais, il faut continuer à gérer la sûreté sur le réseau, à mettre en place des dispositifs qui permettent de faire des arrêts à la demande la nuit. Ces sujets ne doivent pas être oubliés avec la gratuité.

Le fait qu'un réseau soit ou non gratuit change-t-il quelque chose pour votre gestion ?
Cela change l'offre, car vous allez saturer un réseau qui ne l'était pas forcément, avec des gens qui pouvaient faire autrement. Ce sont les marcheurs ou les cyclistes, qui vont davantage utiliser les transports en commun du fait de la gratuité. Il faudra se projeter avec la collectivité sur des moyens supplémentaires et différents. Si la collectivité veut augmenter sa fréquentation, elle est confrontée à un sujet budgétaire : elle doit arbitrer entre la ressource procurée par le versement transport, qu'elle a peut-être complétement consommée, et le soutien de l'offre.

Nous n'avons pas abordé le développement des incivilités. Avez-vous un retour d'expériences sur ce point, du fait de la gratuité ?
J'en ai un, mais il est anecdotique. Il concerne l'installation du Wifi. Cela a fait baisser le niveau d'incivilité : les gens sont focalisés sur leur téléphone. Il y a donc moins de regards entre les gens. Je ne l'invente pas ; nous l'avons constaté à Saint-Etienne.
Nous n'avons pas diminué les missions de contrôle, de médiation et de sûreté sur les réseaux gratuits. Cela dit, il me semble que nous avons toujours tendance à faire plus attention à ce que l'on paye qu'à ce que l'on ne paye pas.

En matière de financement, si les régions prennent la compétence mobilités, la question du financement sera de fait intégrée par ces dernières. On verra comment les choses se passent pour les intercommunalités. J'étais avec Élisabeth Borne tout à l'heure : la LOM, après la commission mixte paritaire, comportera des dispositions pour les financements des intercommunalités.
Je souhaite insister sur le fait que la transition énergétique va avoir un effet. Nous allons transformer nos parcs. Nous irons vers de l'électro-mobilité, ou dans un temps plus lointain sur des véhicules à hydrogène. Il est nécessaire de financer ces innovations technologiques.

Vous abordez la question du matériel roulant. Nous n'avons sans doute pas assez de recul sur la situation des autorités organisatrices de la mobilité qui ont choisi la gratuité en termes de renouvellement du matériel. Peut-être font-elles aller un peu plus loin le matériel par rapport à d'autres réseaux. Avez-vous des retours d'expérience sur des réseaux avec des modes lourds - métro, tramways ?
Il n'existe pas d'exemples de gratuité totale de ces réseaux. Quand on parle des réseaux qui pratiquent la gratuité, on peut dire que tous les réseaux, en France, font une gratuité partielle.

À Lyon, plus de la moitié de passagers bénéficient de réduction. Vous évoquez la nécessité de l'électro-mobilité. Un bus articulé, par exemple, coûte cher.
Ces modes de transport ont un coût et en électro-mobilité, le budget initial est élevé, mais les coûts de fonctionnement sont plus faibles.

Un mot de l'expérience dunkerquoise : il y a une dimension importante, qui fait qu'à Dunkerque, la mise en place de la gratuité a été plus facile qu'ailleurs : il n'y a pas dans cette ville de réseau en étoile. On est sur un linéaire.
C'est la raison pour laquelle j'indiquais qu'il y a des conditions de territoires qui jouent sur la décision de passer à la gratuité.

Depuis combien de temps êtes-vous amené à travailler sur des réseaux ayant fait le choix de la gratuité ?
Nous avons commencé en 1970 avec la ville de Compiègne. Ensuite, Aubagne en 2008, Libourne en 2010, Niort en 2017 ont fait le choix de la gratuité.
Je n'ai pas suffisamment de recul. Néanmoins, nous avons plus eu des évolutions dans les catégories et dans les évolutions sociales autour du réseau que dans la manière de le gérer. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un mouvement de fond dans les collectivités et les opérateurs qui travaillent sur « l'expérience client » et le marketing mixte. Lorsque les réseaux sont en délégation de service public, l'opérateur a une incitation à la recette et à la fréquentation. Nous travaillons cet aspect de manière plus professionnelle que dans les années 1975. Le service s'est amélioré. Plus l'utilisateur est en confort dans le moyen qu'il utilise, plus il l'utilise. C'est également vrai pour une gare.

Pour m'occuper des transports depuis plus de vingt ans, je constate que la mécanique interne des exploitants a évolué : ils ont pris en compte la « vision client ». La notion de client s'est affinée.
Vous avez complétement raison, et la LOM fait évoluer du transport de voyageurs vers la mobilité pour tous. C'est une différence fondamentale.

Vous avez évoqué les tarifs spéciaux et les tarifs sociaux. Disposez-vous d'un chiffre sur le non-recours à ces tarifs par des personnes qui ne font pas la démarche de les demander alors qu'ils y ont droit ?
Nous avons un retour et des expériences. Dans le canton de Fourmies dans le Sud avesnois, nous avons mis en place, avec l'aide de la région, des expérimentations. Elles vont être élargies à l'ensemble de la région Hauts-de-France, permettant d'offrir aux candidats à l'emploi le moyen de prendre un véhicule à la demande pour aller à leur rendez-vous d'embauche. 20 % des personnes en recherche d'emploi disent ne pas avoir pu s'y rendre faute de moyen de transport à disposition. Nous savons mettre en place de tels dispositifs.
Il faut également penser aux catégories de la population qui n'ont pas de smartphones et ne sont pas en capacité d'avoir accès à l'information : des maisons de la mobilité délivrant des informations doivent exister. Dans de nombreux réseaux, nous avons des guichets dans lesquels nous vendons des abonnements et des billets et où l'on peut donner des renseignements. Mais il est difficile d'aller au-devant de ceux qui ne viennent pas. D'ailleurs, tous les services ou commerces se posent la même question de savoir s'ils ont bien accès à tous les clients ou usagers potentiels.
Il faut travailler avec toutes les associations de commerçants, être en capacité d'être visible et de vendre des billets partout. Il ne faut pas que le ticketing soit accessible uniquement au point de vente de la gare locale.

Quand on met en place des tarifications spéciales pour les chômeurs par exemple, mais avec des démarches particulières, parvient-on à toucher l'ensemble de la population concernée ? Quel est le degré de non-recours ? Cela fonctionne-t-il réellement ?
La gratuité libère un certain nombre de gens qui n'osaient pas demander à bénéficier d'une tarification spéciale. Si c'est gratuit, c'est plus facile pour eux.

Le recours à des conseils en mobilité et l'inclusion de centres communaux d'action sociale (CCAS) et de Pôle emploi est nécessaire. Les travailleurs sociaux doivent bien être au fait des tarifications et de l'ensemble de possibilités en fonction des statuts et de l'âge. Cela veut dire qu'il faut que l'ensemble de la chaîne - Pôle emploi, CCAS, etc. - soit capable de renseigner, pour que le moins de gens possible passent au travers des mailles. Le conseil en mobilité doit être beaucoup plus déployé. Je l'ai vu fonctionner en Italie beaucoup mieux que chez nous. Il va au plus proche des citoyens qui ont besoin de se déplacer. Il existe encore des marges de progrès.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.