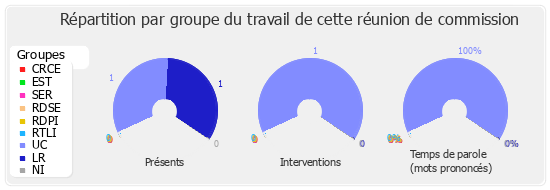Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 21 juin 2006 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Puis la commission a procédé à l'examen du rapport d'information de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier, au nom de la mission d'information, sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses.

a rappelé que la commission des lois avait créé à l'automne dernier une mission d'information sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises à l'égard des personnes considérées comme dangereuses afin de prolonger, dans un cadre parlementaire, la réflexion sur l'une des propositions présentées par la commission Santé-Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin, tendant à créer des centres fermés de protection sociale destinés à accueillir, après l'exécution de leur peine, des personnes considérées comme toujours dangereuses. Il a indiqué que limitant ses analyses aux auteurs d'infractions, la mission avait cherché à présenter, dans un esprit d'objectivité, des éléments de réponse à trois grandes interrogations :
- le dispositif français concernant les personnes dangereuses était-il adapté ?
- quels enseignements pouvait-on tirer des expériences étrangères ?
- pouvait-on envisager la mise en place de structures fermées pour accueillir des délinquants après l'accomplissement de leur peine et à quelle condition ?
a estimé nécessaire au préalable de clarifier la notion de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique, considérée comme le risque pour un individu de commettre une infraction, de la dangerosité psychiatrique, définie comme le risque de passer à l'acte à un moment donné en raison de troubles mentaux. Il a également observé que toute personne dangereuse n'était pas atteinte de troubles mentaux, que tout malade mental n'était pas ipso facto une personne dangereuse et que l'état de dangerosité ne constituait pas nécessairement un état permanent.
Présentant alors le dispositif français, il a relevé que le traitement de la dangerosité criminologique comme de la dangerosité psychiatrique aboutissait à une situation paradoxale, les personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux étant en majorité prises en charge par le système pénitentiaire. Il a noté ainsi que, selon une étude réalisée en 2003, 23 % des détenus souffriraient de troubles psychotiques, et près de 7 % présenteraient des pathologies lourdes (schizophrénie, paranoïa, psychose hallucinatoire chronique). Cette forte pénalisation des personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux s'expliquait, selon les co-rapporteurs par trois facteurs principaux : en premier lieu, la responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux pouvait être reconnue sur la base du deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal dès lors que le discernement avait été altéré (et non aboli) au moment des faits. Il a observé, comme l'avait rapporté M. Jean-Pierre Getty, président de la cour d'assises de Paris lors des auditions de la commission, que l'altération du discernement ne jouait pas comme une circonstance atténuante, mais conduisait en pratique le jury à prononcer des peines plus longues, au motif que certaines de ces personnes présentaient une dangerosité très élevée comportant un fort risque de récidive. Il a noté, en deuxième lieu, que la réorganisation des structures psychiatriques dans la période récente avait conduit à privilégier les soins ambulatoires plutôt que l'« hôpital asile ». L'insuffisance des capacités des hôpitaux psychiatriques et en particulier des unités pour malades difficiles conduisait souvent l'expert à orienter le choix du juge vers la reconnaissance de la responsabilité pénale du délinquant atteint d'un trouble mental. Enfin, il a observé que le besoin de réparation des victimes impliquait, au-delà de la mise en cause de la responsabilité civile de la personne atteinte de troubles mentaux, l'organisation d'un procès et la punition de l'auteur des faits.
a dressé un bilan contrasté de la prise en charge du malade mental reconnu responsable. Il a d'abord relevé que les services médicaux psychologiques régionaux implantés dans les établissements pénitentiaires avaient constitué un facteur de progrès dans les soins, grâce en particulier à la disponibilité du personnel médical, aux activités de soutien et à l'attention réelle du personnel de surveillance comme la mission avait pu le constater à Fresnes. Il a noté que l'hospitalisation d'office dans des structures hospitalières qui visaient les détenus non consentants aux soins se heurtait à certaines difficultés liées à l'insuffisance des places, en particulier dans les unités pour malades difficiles. Il a ajouté que les établissements psychiatriques ne présentaient pas toutes les garanties de sécurité nécessaires et que le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire, entendu par la commission, avait rappelé à cet égard que 47 évasions y avaient été dénombrées en 2005. Il a ainsi constaté le caractère paradoxal d'une situation qui tendait à laisser dans un cadre carcéral présentant les conditions de sécurité maximale les détenus consentants aux soins, tandis que les détenus non consentants dont le comportement apparaissait pourtant plus violent étaient traités dans des structures hospitalières dont la sécurisation était moindre qu'au sein d'un établissement pénitentiaire. Il a relevé néanmoins que ces difficultés pourraient trouver une réponse avec l'ouverture programmée pour 2008 d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) implantées dans des établissements hospitaliers et surveillés par l'administration pénitentiaire.
a également évoqué le cas spécifique du centre pénitentiaire de Château-Thierry destiné à accueillir des détenus souffrant de troubles psychologiques et de psychopathie. Il a estimé que si la dimension de cette structure à échelle humaine et la présence de surveillants expérimentés permettaient d'assurer un traitement individualisé des détenus, l'exiguïté des cellules, la faiblesse des installations collectives et de l'encadrement médical demeuraient des motifs de préoccupation.
Il a également souligné que les dispositifs de suivi des détenus après leur libération paraissaient insuffisants du fait d'abord des difficultés à apprécier la dangerosité des individus. En effet, il a relevé que cette dangerosité n'était actuellement appréciée que dans le cadre du centre national d'observation de Fresnes, en cours de détention et pour les seules personnes condamnées à de lourdes peines. Selon le rapporteur, si le dispositif présentait un intérêt certain en raison de la durée d'observation et du caractère pluridisciplinaire de l'équipe chargée d'évaluer le comportement du détenu, les délais d'attente dans cette structure apparaissaient trop importants. Il a souligné enfin que les mesures de sûreté, tel que le suivi socio-judiciaire, en particulier lorsque celui-ci était assorti d'une injonction de soins, rencontraient aujourd'hui incontestablement des limites compte tenu de l'insuffisance des moyens qui leur étaient dévolus.

a alors présenté les principales observations recueillies au cours des déplacements effectués par la mission aux Pays-Bas et en Allemagne. Il a souligné que si les systèmes allemand et néerlandais avaient pour point commun de prévoir des structures fermées pour les personnes ayant déjà exécuté leur peine et considérées comme toujours dangereuses, ils relevaient cependant de logiques différentes. Ainsi, la mesure de détention sûreté en Allemagne visait à neutraliser toutes les personnes supposées comme très dangereuses, tandis que le dispositif néerlandais ne concernait que les personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux en essayant de concilier l'objectif de sécurité pour la société et la prise en charge sanitaire des personnes.
Evoquant la situation des Pays-Bas, M. Charles Gautier, co-rapporteur, a d'abord relevé la forte progression de la population pénale liée pour une part à l'augmentation des infractions à la législation sur les stupéfiants et aux actes de violence. Il a indiqué que 10 % de détenus souffriraient de troubles mentaux. Il a précisé que le droit pénal néerlandais définissait, pour les personnes atteintes de troubles mentaux, un régime de responsabilité comparable à celui de l'article 122-1 du code pénal français. Ainsi, les personnes reconnues irresponsables pouvaient être placées dans des établissements psychiatriques ou dans des établissements dits « TBS » (structures fermées relevant de l'administration pénitentiaire), tandis que les condamnés étaient pris en charge par l'administration pénitentiaire dans des structures différenciées selon la gravité des troubles mentaux dont ils étaient atteints (y compris des établissements « TBS »).
a observé que les personnes soupçonnées d'infractions graves faisaient l'objet d'une expertise au sein du centre Pieter Baan dépendant du ministère de la justice afin d'évaluer la dangerosité de la personne et le risque possible de récidive. L'évaluation se fondait sur l'observation quotidienne des intéressés par des animateurs, le centre pouvant accueillir 32 détenus répartis en quatre unités. Un rapport final portant sur l'état mental de la personne placée dans le centre devait permettre de déterminer la responsabilité pénale de l'intéressé ainsi que sa dangerosité. Cette expertise représentait un coût élevé de l'ordre de 850 euros par jour, contre 150 euros pour le coût d'une journée en détention classique. A l'issue de l'observation au sein du centre Pieter Baan, la moitié des personnes étaient orientées vers un établissement TBS.
a noté que les personnes atteintes de troubles mentaux capables de s'adapter à une vie collective pouvaient être affectées dans des services de soins spéciaux (BZA) implantés au sein d'un établissement pénitentiaire. Les détenus pouvaient y être placés pendant tout le temps de la détention. En cas de crise (comportement dangereux pour un surveillant, pour un co-détenu ou pour soi-même), le condamné était adressé à une structure spécifique, le FOBA, permettant une prise en charge individuelle pour une durée déterminée, par des équipes pluridisciplinaires.
a indiqué que les personnes condamnées pouvaient faire l'objet, après l'exécution de la peine ou dans le cadre d'une condamnation avec sursis, d'un placement sous TBS, mesure de sûreté destinée à retenir dans des établissements de soins sécurisés dépendant de l'administration pénitentiaire des personnes atteintes de troubles mentaux. Il a détaillé trois types de TBS :
- le TBS illimité, initialement fixé à deux ans mais dont la durée pouvait être prorogée tous les deux ans sans limite particulière ;
- le TBS limité à quatre ans ;
- le TBS sous condition pour des infractions mineures qui s'apparentait au système français de sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de soins et pouvait être effectué en milieu ouvert.
Le placement ainsi que son renouvellement, a poursuivi M. Charles Gautier, co-rapporteur, doivent être autorisés par le juge à la demande, motivée, du procureur et après expertise, cette décision judiciaire pouvant toujours faire l'objet d'un recours en appel. Il existe actuellement 12 établissements TBS accueillant 1.400 personnes. Selon les informations communiquées par le ministère de la justice néerlandais, le placement sous TBS qui s'accompagne d'une attention particulière pour préparer la sortie de l'intéressé présente un bilan positif en matière de lutte contre la récidive. Il a noté toutefois que les capacités de ses structures n'étaient pas suffisantes et présentaient un coût élevé de l'ordre de 500 euros par jour.
Evoquant alors le système allemand et plus particulièrement la mesure de détention sûreté instituée en 1933 et maintenue depuis lors, M. Charles Gautier, co-rapporteur, a observé que ce dispositif destiné à maintenir une personne en détention après l'exécution de la peine pouvait notamment se justifier par le fait que les peines encourues en Allemagne étaient moins longues qu'en France. Il a indiqué que la détention-sûreté pouvait être décidée au moment de la condamnation dès lors qu'étaient réunies les conditions tenant à la nature de l'infraction commise, au passé pénal de l'intéressé ainsi qu'à sa dangerosité. Cette mesure pouvait être également décidée après la condamnation soit parce que la juridiction s'était réservée cette possibilité dans sa décision initiale, soit parce qu'une dangerosité extrême avait pu être démontrée en cours de détention. La décision juridictionnelle pouvait faire l'objet d'un appel et, le cas échéant, d'un recours en cassation. Elle était en principe précédée d'une expertise dont les conditions s'étaient améliorées dans la période récente dans la mesure où l'élaboration de critères d'appréciation homogènes avait été favorisée. La durée de la mesure n'était pas déterminée à l'avance même si le législateur avait fixé en principe un plafond de dix ans qui toutefois pouvait être dépassé dès lors que la dangerosité persistait. En tout état de cause, la mesure faisait l'objet d'un réexamen tous les deux ans. En pratique, les statistiques faisaient apparaître une durée moyenne de six ans et demi qui tendait à s'allonger dans la période récente. Près de 400 personnes avaient fait l'objet d'une mesure de détention-sûreté, soit un doublement par rapport au chiffre enregistré dix ans plus tôt.
a rappelé que la mission s'était rendue au centre de détention de Berlin Tegel où 22 personnes faisaient l'objet d'une détention-sûreté. Il a relevé que si les intéressés bénéficiaient d'un régime plus favorable du fait que la détention-sûreté constituait une mesure de sûreté et non une condamnation, ils ne disposaient pas cependant de soins psychiatriques spécifiques.
a indiqué que d'autres pays comme le Canada ou la Belgique disposaient d'un système de suivi des délinquants dangereux associant à des degrés divers des considérations liées à la sécurité et à la prise en charge sanitaire.

rapporteur, a alors présenté les pistes de réflexion que les auditions et les déplacements de la mission permettaient de dégager. Il a indiqué qu'il n'existait pas de modèle unique et optimal de traitement des personnes dangereuses. Il a souligné que la prise en compte de la dangerosité au-delà de l'exécution de la peine devait s'inscrire avant tout dans une perspective d'accompagnement et de thérapie et non de relégation. Il a indiqué par ailleurs que s'il était indispensable de limiter le plus possible le risque de récidive, celui-ci ne pouvait être, dans une société de droit respectueuse des libertés individuelles, complètement éliminé. Sur la base de ces constats, il a proposé de renforcer la capacité d'expertise par la mise en place de centres d'expertise sous la responsabilité d'une équipe pluridisciplinaire dans lesquels pourrait être placée, pour une durée de l'ordre de 25 jours, la personne poursuivie pour une condamnation particulièrement grave. Il a noté que ces structures qui s'inspireraient directement de l'expérience du centre nationale d'observation de Fresnes, pourraient également intervenir après la condamnation chaque fois qu'une expertise approfondie pourrait s'avérer nécessaire.
a souligné que la mission n'avait pas retenu le principe de centres de protection sociale fermés, envisagés par la commission Santé-Justice, mais qu'elle avait jugé nécessaire la mise en place d'unités spécifiques dans un cadre hospitalier pour les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux. Il a estimé que ces unités pourraient être « adossées » sur les unités hospitalières spécialement aménagées et accueillir, si nécessaire, pour toute la durée de la peine des détenus atteints de troubles mentaux -la prise en charge étant sous responsabilité médicale et l'administration pénitentiaire assurant la surveillance périphérique des locaux. Dans l'hypothèse où l'état de santé de la personne s'améliorerait, celle-ci serait réaffectée dans son établissement pénitentiaire d'origine, tandis que si, en revanche, l'état de dangerosité persistait à l'expiration de la peine, le tribunal de l'application des peines ou le juge des libertés et de la détention pourrait, à la demande du procureur de la République, après une double expertise convergente, décider le maintien de l'intéressé dans cette structure hospitalière pour une durée de deux ans éventuellement renouvelable. Ce dispositif, a poursuivi M. Philippe Goujon, qui serait réservé aux personnes ayant commis les infractions les plus graves, permettrait d'éviter toute rupture dans la prise en charge sanitaire.
Enfin, M. Philippe Goujon, co-rapporteur, a indiqué qu'il convenait de renforcer le suivi des personnes après leur libération en permettant au juge de l'application des peines de prononcer une injonction de soins, même si l'intéressé n'avait pas été condamné à un suivi socio-judiciaire, dès lors qu'une double expertise concordante aurait, dans les six mois précédant la remise en liberté, attesté la permanence d'un trouble mental qui ne présenterait pas cependant une dangerosité telle qu'elle justifierait le maintien ou le placement au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée de long séjour. Il a par ailleurs jugé opportun de mettre en place un fichier des personnes condamnées ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office ainsi que de celles ayant fait l'objet d'un placement dans une unité hospitalière spécialement aménagée de long séjour, afin de permettre un meilleur suivi sanitaire.
Les deux rapporteurs ont alors indiqué que ces orientations, qui devaient être encore précisées, impliquaient à l'évidence une forte mobilisation des moyens qui leur paraissaient justifiés au regard des enjeux de santé publique et de sécurité soulevés par la prise en charge des personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux.
A l'issue de l'exposé des co-rapporteurs, un débat s'est engagé au sein de la commission.

Après avoir rappelé qu'il avait été membre de la commission Santé-Justice, M. François Zocchetto s'est félicité de ce que le débat sur les propositions de cette instance puisse se prolonger et s'approfondir dans le cadre de la commission des lois. Il a attiré l'attention sur les difficultés liées à l'évaluation de la dangerosité et souligné la nécessité de sensibiliser l'opinion publique sur ce point. Il a souhaité que des moyens complémentaires puissent être mis en oeuvre pour renforcer les capacités d'expertise, en s'inspirant notamment des expériences conduites au Canada. Il a relevé également que les difficultés rencontrées aujourd'hui dans l'organisation des soins psychiatriques ne tenaient pas principalement à l'insuffisance du nombre de psychiatres, mais plutôt à leur inégale répartition sur le territoire français. Après avoir noté que la France avait récemment complété son arsenal juridique pour améliorer le suivi des personnes considérées comme dangereuses à travers notamment l'institution du fichier des auteurs d'infractions sexuelles et la mise en place du bracelet électronique mobile, il a regretté que les moyens nécessaires n'aient pas toujours été mis en oeuvre.

a souligné que les suggestions des rapporteurs concernant la création d'unités hospitalières spécialement aménagées de long séjour pour les délinquants atteints de troubles mentaux se distinguaient nettement de la proposition de la commission Santé-Justice tendant à créer des centres fermés de protection sociale, dans la mesure où elles s'inscrivaient résolument dans la perspective d'une prise en charge médicale des intéressés.

a relevé que les difficultés liées à la prise en charge psychiatrique des délinquants tenaient sans doute à une répartition déséquilibrée des psychiatres sur le territoire français, mais aussi à une rémunération plus faible que dans le secteur privé et enfin, sans doute, à un certain désintérêt d'une partie de la profession pour les questions criminologiques.

a observé que l'on pouvait dresser un parallèle entre l'augmentation du nombre de malades mentaux dans les prisons et la remise en cause des structures fermées du secteur psychiatrique. Il s'est par ailleurs demandé si l'incarcération ne favorisait pas le développement de nouvelles pathologies psychiatriques. Il a estimé nécessaire une meilleure formation des infirmiers en psychiatrie.

a jugé que cet effort de formation dans le domaine de la prise en charge psychiatrique devait également concerner les personnels de l'administration pénitentiaire. Il a souligné en effet que la mission avait, au cours de ses déplacements, rencontré des personnels très motivés, mais qui avaient été conduits à traiter des détenus atteints de troubles mentaux par choix plutôt qu'en raison d'une qualification spécifique.

a proposé que les pistes de réflexion présentées par la mission intègrent également la nécessité d'une formation adaptée pour les personnels spécialisés.

a observé que les conditions de détention tendaient en effet à aggraver les pathologies psychiatriques et qu'il était particulièrement nécessaire d'éviter toute rupture dans la prise en charge sanitaire des personnes atteintes de troubles mentaux. Il a observé en effet qu'une rupture de soins pouvait aggraver dans un facteur de quatre à sept le risque de passage à l'acte d'une personne dangereuse. Il a rappelé également que certains des psychiatres entendus par la commission avaient relevé que plus la peine était longue, plus elle prédisposait le détenu à souffrir d'un trouble psychiatrique. Il a confirmé à cet égard l'intérêt d'une prise en charge médicale renforcée des détenus.

a souligné que la mission portait sur une question très délicate touchant aux libertés fondamentales. Il a jugé indispensable de tirer parti de l'exécution de la peine dans le cadre de la détention ou de la libération conditionnelle pour assurer un traitement plus adapté des personnes atteintes de troubles mentaux, alors que tel n'était pas le cas aujourd'hui. Il a observé que le suivi socio-judiciaire illustrait les difficultés du système français, puisque ce dispositif avait été mis en place pour répondre à une forte pression de l'opinion publique mais que, faute de moyens, il n'avait pas répondu aux espoirs. Le législateur était alors conduit, selon lui, à adopter de nouveaux instruments juridiques sans plus de garanties que les moyens nécessaires soient mis en oeuvre. Il a estimé que l'on passait ainsi de la démocratie d'opinion à la démocratie d'émotion et il a souhaité que l'on revienne à la démocratie de réflexion.
a également souligné que l'insuffisance de la prise en charge psychiatrique dans un cadre judiciaire s'expliquait aussi par les disparités de rémunération entre les psychiatres du secteur public et du secteur privé. Après avoir jugé indispensable que la continuité des soins puisse être assurée, il a estimé que le maintien d'une personne atteinte de troubles mentaux dans une structure fermée après le temps de la peine ne pouvait être justifié que pour des raisons thérapeutiques dans une perspective liée à la santé publique et non pas dans le cadre de la prévention de la récidive. Il s'est déclaré opposé à tout système de relégation en rappelant que le dispositif allemand de « détention-sûreté » avait été créé en 1933. Enfin, M. Robert Badinter s'est demandé s'il ne serait pas utile de s'interroger sur une reformulation éventuelle de l'article 122-1 du code pénal.

s'est déclaré à cet égard avoir été frappé par le témoignage devant la commission de M. Jean-Pierre Getti, président de la cour d'assises de Paris, qui avait observé que l'altération du discernement au moment des faits ne constituait pas une circonstance atténuante, mais entraînait généralement une aggravation de la peine.
La commission a alors adopté le rapport de la mission d'information.