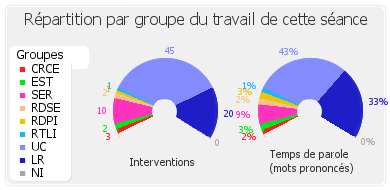Séance en hémicycle du 9 février 2021 à 22h00
La séance
La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Roger Karoutchi.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Les Républicains, sur l’avenir de la Métropole du Grand Paris.
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je rappelle que l’auteur de la demande dispose d’un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, l’auteur de la demande dispose d’un droit de conclusion pour une durée de cinq minutes.
Dans le débat, la parole est à Mme Christine Lavarde, pour le groupe auteur de la demande.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous allons évoquer un sujet dont nous avons à discuter chaque année, tel un marronnier, lors de l’examen de chaque projet de loi de finances et de chaque texte portant sur les collectivités locales. C’est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains a souhaité organiser un débat sur ce thème ce soir.
La problématique du Grand Paris n’est pas nouvelle. Dès le XIXe siècle, deux visions se sont opposées : celle de Napoléon III, …

… qui imaginait une capitale s’étendant de Saint-Germain-en-Laye à Marne-la-Vallée, s’est heurtée au réalisme du baron Haussmann, qui a fait justement remarquer qu’il avait fallu un combat de dix-sept ans pour unifier l’ensemble des communes d’Auteuil, de Passy ou des Batignolles et créer la ville de Paris.
Un peu plus tard, en 1932, André Morizet, ancien sénateur et maire de Boulogne-Billancourt – je ne pouvais pas ne pas le citer !
Sourires.

En 1949, le célèbre géographe Jean-François Gravier, auteur de Paris et le désert français, propose la création de seize régions avec des superpréfets à leur tête, ainsi que d’un « Grand Paris ».
Toutefois, la réforme de l’Île-de-France organisée par la loi du 10 juillet 1964 a eu raison de cette vision. Les trois départements créés en 1790 – Paris, la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne – sont subdivisés en sept nouveaux départements : la petite couronne et la grande couronne.
La réorganisation de l’Île-de-France redevient un sujet de conversation au début des années 2000, face au constat partagé d’un développement économique déséquilibré : pas de desserte ferroviaire directe entre le centre de Paris et ses aéroports ; difficultés à rejoindre le pôle technologique de Saclay ; réseau de transport construit en radiale, ne permettant pas des échanges faciles entre les zones d’emploi et les zones de logement.
C’est la loi de juin 2010, relative au Grand Paris, qui définit ce territoire comme « un projet urbain, social et économique d’intérêt national ».
En 2010, le législateur, dans sa grande sagesse peut-être, n’a pas retenu les propositions institutionnelles visant à regrouper les collectivités franciliennes dans de nouvelles structures. Cette réforme s’est faite plus tard, mais contre les élus.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ou Maptam, qui donne un nouveau statut aux agglomérations de plus de 400 000 habitants, prévoit un statut particulier pour les métropoles de Paris, de Lyon et de Marseille.
En première lecture, le Sénat rejette l’ensemble des articles relatifs à la zone parisienne. C’est l’Assemblée nationale qui dessine ce qui sera plus tard la métropole du Grand Paris, la MGP.
En septembre 2013, au cours de la navette, 75 % des élus de Paris Métropole adoptent un vœu contestant l’organisation institutionnelle proposée. Finalement, le projet de loi Maptam est adopté d’une courte majorité au Sénat en octobre 2013, par 156 voix pour et 147 contre.
L’opposition des élus s’est renforcée après les élections municipales de 2014, lesquelles ont modifié l’équilibre au sein du territoire métropolitain. En mai 2014, à l’unanimité, les élus de Paris Métropole réclament une révision de l’article 12 de la loi Maptam, qui supprime les intercommunalités.
Cette position est réaffirmée quelques mois plus tard : en octobre 2014, quelque 94 % des membres de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris réclament une personnalité juridique pour les territoires et un partage des recettes de la fiscalité économique.
Après d’importants débats parlementaires, le régime juridique de la métropole du Grand Paris prévu par la loi Maptam est profondément modifié par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou NOTRe, du 7 août 2015.
Les territoires de la loi Maptam, aires géographiques sans personnalité morale, dont le régime juridique aurait été proche de celui des arrondissements parisiens, sont remplacés par des établissements publics territoriaux, ou EPT, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale, des EPCI, sans fiscalité propre, dotés d’importantes compétences et d’un régime juridique spécifique.
La MGP est créée au 1er janvier 2016, avec Paris, les 123 communes de la petite couronne et 7 communes limitrophes de la grande couronne ayant choisi d’y adhérer. Sur les 11 territoires créés au sein de ce périmètre, seuls 3 préexistaient ; les 8 autres ont été imposés par les préfets et font parfois l’objet de mariages forcés.

Non soutenue par les maires, cette nouvelle organisation est restée un échelon supplémentaire dans une organisation territoriale déjà très compliquée, comprenant communes, territoires, départements, métropole, grands syndicats et région.
Chacun cherche à conserver les compétences que la loi lui a retirées. À titre d’exemple, une seule opération d’aménagement, la zone d’aménagement concerté, ou ZAC, des docks de Saint-Ouen, a été transférée à la métropole du Grand Paris lors de sa création. Seuls deux actes ont depuis été déclarés d’intérêt métropolitain.
Par ailleurs, la MGP reste un nain budgétaire. Si elle enregistre 3, 4 milliards d’euros de ressources, elle en reverse 98 % aux communes via les attributions de compensation pour permettre aux communes et aux territoires de continuer à assurer les missions du quotidien. Les capacités financières réelles de la MGP sont donc dérisoires.
Aujourd’hui, le changement se fait attendre. En juillet 2017, au Sénat, le Président de la République récemment élu, Emmanuel Macron, annonçait pourtant de futurs changements majeurs dans l’organisation du Grand Paris.
Depuis lors, tout le monde attend, comme le montre une rapide revue de presse.
Juillet 2017 : « Paris : Macron au secours de la MGP ? » Octobre 2017 : « Comment Macron veut réorganiser le Grand Paris ». Octobre 2017 toujours : « La fronde des départements contre la métropole “Macron” ». Novembre 2017 : « Métropole du Grand Paris : que va décider Emmanuel Macron ? » Janvier 2018 : « Quel sort Macron réserve-t-il à la métropole du Grand Paris ? » Octobre 2018 : « Métropolisation : le Paris en grand de Macron au point mort » et « Grand Paris, la réforme sans cesse repoussée ». Décembre 2019 : « Grand Paris : le Gouvernement annonce une réforme institutionnelle après les municipales ». Enfin – et j’en passe –, en décembre 2020 : « Des députés LREM veulent pulvériser la métropole du Grand Paris ».
Au cours de ces mois, plusieurs scénarios ont été envisagés : une métropole avec le périmètre actuel, au sein de laquelle seraient fusionnés les départements de la petite couronne avec Paris ; une fusion de la région Île-de-France et de l’actuelle métropole, pour associer Paris intra-muros et des secteurs périurbains ou ruraux. Cela étant, rien n’a été décidé.
Quel échelon supprimer ? Quel statut pour les territoires ? Quel périmètre pour définir la région capitale ? Qui doit exercer les compétences du quotidien ?
Ces questions ne manqueront pas d’être évoquées ce soir. Si je devais résumer la situation, je citerais l’analyse de Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS : « Nous avons une métropole qui est tout à fait sous-calibrée, une gouvernance éclatée et une MGP croupion qui a quelques dizaines de millions d’euros de budget réel. Donc, il faut réformer et c’est un tel imbroglio qu’il faut réformer fort. Tout le monde le sait, mais personne n’est prêt à assumer les coûts politiques pour le faire. »
L’histoire étant un éternel recommencement, on pourrait dire, comme l’aurait déclaré le général de Gaulle, alors qu’il survolait en hélicoptère la région parisienne : « Delouvrier, mettez-moi de l’ordre dans ce bordel ! » C’est ce que nous allons essayer de faire ce soir.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à remercier le groupe Les Républicains de nous permettre d’évoquer le devenir du Grand Paris.

Évoquer ce devenir, chacun le mesure, c’est se confronter à une grande complexité, comme vous l’avez fait remarquer, madame Lavarde, car tout est exacerbé : les enjeux, les attentes, les ambitions et parfois, aussi, bien sûr, les déceptions.
Pourtant, le contexte actuel est sans doute propice, comme le dit l’adage, à remettre le métier sur l’ouvrage. Je le disais récemment lors d’un colloque à l’Assemblée nationale consacré aux « métropoles résilientes » : la décennie 2010 aura été marquée par une relation passionnée, excessive même, avec le fait métropolitain et, a fortiori, avec le Grand Paris.
Elle s’est en effet ouverte, chacun s’en souvient, par une série de lois destinées à affirmer leur place sur la scène française et internationale : loi relative au Grand Paris en 2010, la loi Maptam en 2014, la loi NOTRe en 2015. Elle s’est achevée dans un climat de méfiance ou de défiance, voire de rejet de ces mêmes métropoles, tour à tour accusées d’être responsables des fractures territoriales et invivables pour leurs habitants.
Alors qu’une nouvelle décennie s’ouvre, tâchons, ensemble, d’y voir plus clair, au cœur de cette « assemblée des territoires ».
Sur ce sujet, aucun consensus n’émerge, à l’exception d’un seul : la situation actuelle ne satisfait personne. La raison en est simple : elle ne permet pas au Grand Paris, en tant que réalité métropolitaine – non en tant qu’institution – d’être à la hauteur des immenses défis auxquels ce territoire doit répondre, aujourd’hui comme demain.
Pour autant, je me permets de le rappeler, cette situation est le produit d’une histoire à laquelle nombre d’entre nous ont participé, une histoire faite de compromis, mais aussi d’occasions manquées et, il est vrai, d’un certain nombre de renoncements. Cette réalité, loin de la juger en procureurs implacables, nous devons la comprendre, pour éviter, collectivement, de refaire les mêmes erreurs.
En effet, les destins de notre pays et du Grand Paris sont, nolens volens, organiquement liés. Une large part de la capacité de notre pays à relever les immenses défis qui sont devant lui réside dans la réussite du Grand Paris. En cela, ce sujet relève, au sens le plus noble du terme, de l’intérêt général, transcendant nos personnes autant que nos mandats.
Aussi, aujourd’hui, faisons en sorte d’examiner ce sujet avec des yeux à la fois informés par cette histoire et en même temps délestés, autant que faire se peut, des antagonismes et postures trop bien connus. Laissons, en somme, toute sa place à ce que Nietzsche, dans une jolie formule, appelait « l’innocence du devenir ».
Comment, au fond, en sommes-nous arrivés à cette situation ? L’impasse actuelle pourrait se résumer, en le paraphrasant, par un célèbre mot de Raymond Aron : « réforme improbable, statu quo impossible ». Pour en sortir, faisons d’abord un rapide détour par l’histoire.
Il n’est pas besoin de rappeler la place exorbitante qu’occupent Paris et sa région dans l’histoire et la géographie françaises. Elle est, à dire vrai, unique dans le monde.
La complexité du paysage politique et institutionnel contemporain est l’héritière de cette histoire. La région Île-de-France, c’est en effet 1 300 communes, 11 établissements publics territoriaux, une métropole du Grand Paris, 8 départements, 800 syndicats, un conseil régional.
La région Île-de-France, c’est également un État aménageur puissant, comme en témoigne la création de nombreuses opérations d’intérêt national, de villes nouvelles, ou de grandes infrastructures.
Cette fragmentation institutionnelle se traduit logiquement, et malheureusement, par des politiques publiques elles aussi très fragmentées, évoquant une « orchestration sans chef d’orchestre », pour reprendre la belle formule du philosophe Wittgenstein.
Cette situation, vous la connaissez et, comme moi, vous la déplorez. Pourtant, depuis les années 2000 et les actions de coopération engagées par Bertrand Delanoë entre Paris et certaines communes avoisinantes, et depuis 2007, date du discours fondateur du président Sarkozy prononcé à Roissy, les réflexions n’ont pas manqué.
Aussi, d’où viennent ces blocages et quels sont-ils ? Comme pour l’œuf et la poule, il est difficile de faire la part des choses : sont-ce les fractures trop importantes qui empêchent l’émergence d’un destin commun ? Ou est-ce que l’absence d’un projet fédérateur conduit en retour à renforcer ces fractures ?
Quoi qu’il en soit, le constat est là : le territoire grand-parisien concentre, de manière particulièrement exacerbée, l’ensemble des tensions et contradictions propres aux réalités métropolitaines.
C’est une métropole-monde, dont le rayonnement ne se dément pas, mais c’est également un territoire marqué par de très grandes fractures, qui ne se résorbent pas. Selon l’expression d’Ernest Renan, la nation est le « plébiscite du quotidien ». Nous sommes loin du compte, tant il est vrai que ces immenses disparités ont des conséquences très concrètes sur la qualité de vie des habitants, et logiquement, sur l’attractivité de la métropole.
Aussi, que faire ? Tous ces constats nous ramènent au devenir de la région capitale, plus particulièrement à son devenir institutionnel. En tant que législateur, c’est ce qui vous intéresse au premier chef, et c’est bien normal, d’autant que la situation est marquée par une très forte fragmentation institutionnelle.
Quels sont les scénarios possibles ? Ce sujet a été très documenté. Les parlementaires, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, ont formulé des propositions, mais, durant tout le quinquennat, élus locaux et société civile ont également apporté leur contribution.
Si je devais résumer ces propositions pour introduire notre débat, je dirais qu’il existe trois grandes familles de scénarios, que je vais tâcher s’esquisser.
Le premier privilégie l’échelle de la région, prenant acte de la présence de nombreux sites essentiels à la vie de la métropole en grande couronne. Ainsi, cette première option consisterait à fusionner la région et les départements actuels et à renforcer la logique intercommunale au sein de cet espace.
Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Je vous prie de me laisser un peu de temps, monsieur le président.
La deuxième option consisterait à créer des élus communs aux échelons départementaux et régionaux et à assurer une rétribution des ressources financières.
Enfin – c’est la troisième option –, on pourrait imaginer réunir les départements au sein d’un syndicat interdépartemental.
Murmures sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Philippe Dallier rit.

Madame la ministre, il faut conclure ! Vous pourrez développer votre propos lors du débat interactif.

Je termine, monsieur le président.
La deuxième option privilégie le périmètre de la zone dense, c’est-à-dire, pour l’essentiel, de la petite couronne. Quant à la troisième option, je la développerai plus tard !
Sourires.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
Dans le cas où l’auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n’ait pas été dépassé.
Dans le débat interactif, la parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite aborder le sujet par la face financière, si j’ose dire.
La question du financement de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux a été repoussée depuis l’origine. Tout le monde convient que la formule choisie au départ tient davantage de l’usine à gaz que d’un financement clair des compétences exercées par chacun.
Cette formule provisoire devait muter dans un second temps, mais le nouveau pacte financier a été différé. L’attribution de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, demeure un sujet discuté et, si j’ose dire, disputé.
Nous nous trouvons depuis lors, à chaque loi de finances, dans la situation d’arrêter le moins mauvais compromis possible pour parvenir à financer la mise en œuvre des compétences des EPT et de la métropole, le tout en continuant à repousser la remise à plat de ce dispositif provisoire qui ne devait pas durer.
Évidemment, discuter du financement alors que la question des compétences et du périmètre reste pendante n’est pas simple. Toutefois, cette régulation annuelle n’offre pas de perspective claire pour les exécutifs et renforce la fragilité du système, alors même que le rôle de la métropole et des territoires est crucial pour la relance.
Ma question est donc la suivante, madame la ministre : ce mode de régulation du financement de la métropole et des territoires vous paraît-il soutenable, notamment compte tenu du contexte économique issu de la pandémie ?
Quelles garanties pouvez-vous donner pour assurer le financement de ces deux échelons tout en préservant les communes ? Les projections sur l’évolution de la CFE et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, seront bien sûr au centre du dispositif. Disposez-vous sur ce point d’éléments d’éclairage ?

Monsieur le sénateur, nous sommes d’accord sur le constat, à savoir que le schéma de financement de la MGP n’est pas viable à long terme.
En effet, comme vous l’avez rappelé, l’organisation actuelle, qui devait être transitoire, s’éternise malheureusement. Les règles actuelles sont illisibles, sauf pour quelques initiés, et les mécanismes de solidarité ne sont pas à la hauteur pour résorber les inégalités entre les territoires.
Ce système vaut encore pour deux ans. À court terme, il continue de fonctionner même s’il n’est pas performant. Le mécanisme adopté dans la loi de finances de 2021 maintient les équilibres antérieurs et affecte à la MGP deux tiers de la CFE en 2021, de sorte qu’elle ne porte pas seule la charge de la crise.
À plus long terme, une remise en cause est indispensable. Elle doit se faire en deux temps.
Tout d’abord, il convient d’effectuer une analyse correcte des difficultés existantes. Si la MGP ne produit pas suffisamment de services, c’est aussi parce qu’il a été décidé de ne pas lui transférer autant de compétences qu’à une autre métropole.
Ensuite, les moyens financiers de la MGP sont très inférieurs à ceux d’une intercommunalité classique. Pour l’avenir, il faut donc prendre le débat par le bon bout en partant des objectifs avant de concevoir les bons tuyaux. L’objectif est, à mon sens, de construire un espace de solidarité, donc de partage des ressources financières entre territoires, c’est-à-dire entre collectivités, soit entre Paris et sa banlieue et entre l’est et l’ouest.
On ne répondra pas aux enjeux de la région capitale en laissant chaque territoire replié dans son coin. À défaut d’une telle internalisation de la solidarité au sein d’une structure large, il faudra des transferts financiers plus directifs pour financer les grandes compétences structurantes.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Ma préoccupation est de préserver autant que possible la capacité d’agir des territoires et de la métropole, en n’oubliant pas que le pacte originel a été conclu avec les communes.
Le territoire métropolitain est confronté à de nombreux défis, et ses habitants ressentent le besoin de moyens publics plus importants pour y faire face. Comme vous l’avez indiqué, la métropole du Grand Paris est aussi un instrument de rééquilibrage territorial, qu’il faut préserver.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la coopération entre la métropole, la ville de Paris et les communes qui sont incluses dans le périmètre de l’autoroute A86 a abouti à l’instauration d’une zone à faibles émissions, ou ZFE, métropolitaine au 1er juillet 2019.
Poursuivant cette dynamique, le conseil métropolitain a adopté à l’unanimité la mise en œuvre d’une nouvelle étape de la ZFE au 1er juin prochain, confirmant ainsi des objectifs ambitieux, parmi lesquels la restriction d’accès aux véhicules diesel en 2024.
Néanmoins, pour assurer pleinement l’efficacité de cette ZFE, il faut aussi prévoir son contrôle et, pour cela, le système le plus performant est le contrôle-sanction automatisé.
Or, sur ce point, nous restons en attente des décisions de l’État. Le Gouvernement n’a pas encore annoncé la mise à disposition des outils existants, à savoir le Centre automatisé de constatation des infractions routières et l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, qui permettraient une mise en œuvre rapide et efficace du contrôle-sanction automatisé.
Dans une récente interview au Parisien, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports a d’abord renvoyé à une étape de transition, prévoyant la mise en place de la vidéo- verbalisation.
Notons que celle-ci est à la seule charge des territoires et qu’elle requiert des investissements importants alors que le dispositif n’est que transitoire. Par ailleurs, son efficacité reste en pratique assez faible, puisqu’elle repose sur des contrôles aléatoires, véhicule par véhicule. Pour ces raisons, la vidéoverbalisation ne nous paraît pas être la bonne solution.
Madame la ministre, ma question est la suivante : ne pensez-vous pas nécessaire et possible d’accélérer la mise en œuvre par l’État des contrôles-sanctions automatisés pour permettre à la métropole d’exercer pleinement et sans attendre sa responsabilité en matière de réduction de la pollution ?

Monsieur le sénateur, l’État s’est engagé activement dans la promotion des zones à faibles émissions, afin de diminuer la pollution dans les grandes agglomérations, et, ainsi, d’améliorer la qualité de l’air et donc les conditions de vie de nos concitoyens.
La ville de Paris et la MGP se sont volontairement engagées rapidement dans la démarche, en prévoyant dès le 1er juin 2021 que les véhicules particuliers classés Crit’Air 4 et 5 et non classés ne pourront circuler en semaine de huit heures à vingt heures dans la ZFE. Concrètement, il s’agit de véhicules diesel immatriculés avant le 31 décembre 2005 et de véhicules à essence immatriculés avant le 31 décembre 1996.
Cette interdiction sera étendue progressivement, comme prévu, aux autres vignettes. Dès juillet 2021, s’ajouteront les véhicules classés Crit’Air 3, et en janvier 2023, Crit’Air 2, afin d’atteindre l’objectif de 100 % de véhicules propres en circulation.
Le ministère de la transition écologique avait missionné M. le préfet Bartolt en décembre 2018 pour préfigurer un système de contrôle-sanction automatisé, notamment pour les ZFE. Les conclusions de ces travaux ont été remises l’été dernier, et depuis lors, les administrations concernées poursuivent activement leurs travaux d’expertise, pour élaborer ce système de contrôle-sanction automatisé dans les meilleurs délais.
D’ici à la fin de l’année, il devrait être possible de franchir une première étape en matière de contrôle du respect de la ZFE, en mettant en place un système de contrôle assisté par vidéo.
Ce système de contrôle par des officiers de police judiciaire, avec l’assistance d’un système informatique et vidéo, permettra de réaliser effectivement des contrôles en attendant de pouvoir en réaliser un nombre plus important lorsque le système automatisé sera opérationnel.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Toutefois, si vous faites le point sur la situation actuelle et les projets déjà annoncés par le Gouvernement, ma question portait volontairement sur un projet essentiel, à savoir la lutte contre la pollution.
Étant entendu qu’il est peu probable que nous avancions sur les questions institutionnelles dans les mois qui viennent, j’encourage le Gouvernement à faire preuve de volontarisme dans l’accompagnement de ce projet, qui réunit tous les élus de la métropole.

Madame la ministre, en 2007 j’étais plein d’espoir lorsque Nicolas Sarkozy, inaugurant une piste à Roissy, avait posé le sujet du Grand Paris sous l’angle des transports – c’est le seul point qui avance –, mais aussi sous l’angle institutionnel, dont il avait chargé le comité Balladur. J’avais d’ailleurs travaillé et rendu un rapport sur ce sujet.
Malheureusement, le temps a passé, et les lois NOTRe et Maptam ont été adoptées. J’étais encore une fois plein d’espoir lorsque ce dernier texte a été déposé, mais, au moment de le voter, j’avais bien conscience qu’il n’allait pas régler le problème, et pis encore, qu’il allait probablement poser des difficultés qui nous rattraperaient très vite.
En 2017, le préfet Cadot a été mandaté, mais ses propositions n’ont pas été rendues publiques. Celles-ci nous intéressent pourtant, madame la ministre, et nous souhaiterions en prendre connaissance. Puis, Sébastien Lecornu a été nommé ministre. Il devait traiter le sujet, mais il s’est concentré sur d’autres dossiers.
Nous allons peut-être examiner le texte 4D prochainement, mais vous avez indiqué que celui-ci ne traiterait pas de la métropole du Grand Paris.
Je souhaite donc vous réinterroger sur l’agenda du Gouvernement, madame la ministre. Il est évidemment trop tard pour proposer une réforme lourde, qui de toute façon ne pourrait entrer en application qu’en 2026 ou en 2027, soit après les prochaines élections municipales, départementales et régionales.
Toutefois, nous pouvons encore modifier ce qui peut l’être pour remédier à un certain nombre de difficultés, notamment celles qui ont été évoquées par Vincent Capo-Canellas, mais aussi pour faire un pas dans la bonne direction et faire en sorte que la métropole du Grand Paris, enfin, soit utile et efficace, et qu’elle contribue à mieux répartir la richesse fiscale, ce que la métropole actuelle ne fait absolument pas.
Madame la ministre, quel est donc l’agenda du Gouvernement ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Cher Philippe Dallier, en 2008, vous avez effectivement rédigé un rapport dont les conclusions ont été largement reprises par le rapport Balladur l’année suivante. D’autres rapports ont suivi, notamment celui de Michel Cadot, que vous avez cité, et celui de Roland Castro.
Permettez-moi de revenir sur les trois familles de scénarios que j’évoquai précédemment.
Le premier type de scénario privilégie l’échelle de la région, prenant acte de la présence de nombreux sites essentiels à la vie de la métropole en grande couronne.
Le deuxième privilégie le périmètre de la zone dense, c’est-à-dire pour l’essentiel de la petite couronne.
Il existe enfin une troisième famille de scénarios, qui tous consistent à faire entrer les institutions de la région capitale dans le droit commun, en prévoyant d’octroyer le statut d’EPCI à fiscalité propre aux EPT
M. Philippe Dallier s ’ exclame.

Ces scénarios et ces variantes sont présentés par leurs auteurs comme des étapes intermédiaires dans l’attente d’une réforme institutionnelle d’ampleur. Par nature, ils ne permettent donc pas d’embrasser l’intégralité des enjeux que je soulignais tout à l’heure.
Je ne puis vous indiquer de calendrier, cher Philippe Dallier. Vous le savez, d’ailleurs, et c’est pour cela que vous me posez la question. Je vous accorde qu’il s’agit d’un sujet important. Pour avoir longtemps siégé dans cette assemblée, je connais votre implication et je reconnais la permanence de votre analyse.
M. Julien Bargeton applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne suis pas un élu de l’Île-de-France ni un spécialiste du sujet.
Néanmoins, dans le cadre des travaux de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, j’ai assisté il y a quelques semaines à un débat réunissant Mme la maire de Paris, la présidente de la région Île-de-France et le président de la métropole du Grand Paris. Le dossier est complexe et pas forcément très bien parti… Il semble notamment difficile de déterminer la bonne échelle pour appliquer les compétences ou pour capter des financements. J’en ai tiré la conclusion que des solutions ne pourront être trouvées que si l’État et le Gouvernement s’en mêlent.
Je suis élu non pas de l’Île-de-France ou du Grand Paris, mais plutôt de l’immense Paris, puisque mon département, l’Aisne, se trouve comme d’autres à une distance comprise entre 100 et 150 kilomètres de Paris. Ces territoires sont concernés par l’essor du Grand Paris et par ses conséquences en termes de transport en commun, d’infrastructures et de développement économique.
Il serait donc intéressant d’associer les élus de ces territoires un peu plus éloignés à la définition du Grand Paris. La guerre entre les ruraux et les urbains a fait long feu : l’objectif est de développer les voies de communication, qu’elles soient routières – par exemple, pour l’Aisne, la RN2 – ferrées ou maritimes.
Nul n’est besoin pour cela de créer une nouvelle structure : il suffit d’associer ces territoires à la dynamique du futur Grand Paris.

Vous avez raison, monsieur le sénateur : on ne peut penser les mobilités en Île-de-France sans penser les relations entre l’Île-de-France et les régions voisines.
L’État est ainsi particulièrement vigilant à la bonne articulation entre régions. C’est pourquoi la rénovation de la gare du Nord et les projets de l’axe Seine, par exemple, sont pensés en concertation avec toutes les régions concernées. Les projets autour de l’axe Seine pilotés par le préfet Philizot sont d’ailleurs emblématiques de cette approche intégrée qui a abouti à la création ce mois-ci d’Haropa, qui regroupe les trois anciens ports du Havre, de Rouen et de Paris, afin de promouvoir une logistique fluviale intégrée sur la Seine.
Il en est de même du projet de ligne nouvelle Paris- Normandie, la LNPN, conçue à la fois pour améliorer les liaisons des villes normandes vers Paris, mais aussi pour améliorer et fiabiliser la desserte des Transiliens dans l’ouest de l’Île-de-France.
Ces exemples concrets répondent parfaitement à votre souhait. À mes yeux, une telle démarche ne peut pas ne pas exister.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la métropole du Grand Paris s’est donné comme objectif de contribuer à la réduction des inégalités territoriales, notamment en matière d’accès au logement. Au regard de la situation sociale dans laquelle nous nous trouvons, cet objectif est très loin d’être atteint.
Les politiques publiques en faveur du logement social sont pourtant un levier essentiel dans la bataille contre les inégalités. C’est un enjeu majeur pour la MGP, puisque 72 % des demandes de logement social de la région sont localisées à l’intérieur de la métropole. Or l’accès au logement social dans cette dernière relève encore aujourd’hui du parcours du combattant : les demandes de logement social, lorsqu’elles sont satisfaites, ne le sont qu’au terme d’un délai de neuf à dix ans.
Non seulement les objectifs initiaux ne sont pas atteints, mais les inégalités ont augmenté. Un processus de ségrégation est incontestablement à l’œuvre. Si le partage de la richesse fiscale est certainement un objectif important, celui de la richesse foncière et de la richesse spatiale l’est tout autant.
Vingt ans après son entrée en vigueur, l’application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, laisse toujours à désirer. Sur les 129 communes de la MGP, 56 n’ont toujours pas atteint le seuil fixé par la loi.
Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, qui devait permettre de transférer les compétences en matière de politique du logement, d’aide financière et d’action en faveur du logement social à la métropole, tarde à être adopté.
Ma question est donc la suivante, madame la ministre : comment comptez-vous faire en sorte que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement soit enfin adopté et que la loi SRU puisse être appliquée, non pas en permettant aux élus de provisionner les dépenses liées aux amendes, mais en faisant en sorte que la lutte contre les inégalités spatiales dans notre métropole du Grand Paris soit, enfin, à l’ordre du jour et une vraie priorité ?

Permettez-moi de rappeler que, l’année 2020 mise à part, les objectifs de la construction en Île-de-France sont atteints. La loi relative au Grand Paris fixe un objectif de 70 000 logements construits par an en Île-de-France. Entre 2017 et 2019, le nombre de logements mis en chantier a été supérieur à 80 000 logements. L’objectif est donc plus qu’atteint.
L’enjeu porte surtout sur le parc social. Il faut toutefois rappeler que la production de logements sociaux relève essentiellement de la responsabilité des collectivités, qui fixent les objectifs dans le cadre de la planification et accompagnent les bailleurs par leur action en matière de foncier, d’urbanisme et de permis de construire.
Il est vrai que les objectifs ne sont pas atteints, mais cela masque des réalités territoriales très différentes. En effet, les communes de la MGP sont plus nombreuses à respecter la loi SRU. Au sein de la métropole, le taux moyen de logements locatifs sociaux est de 30 %. Seulement 40 % des communes de la MGP ont des obligations de rattrapage, alors que 60 % des communes d’Île-de-France soumises à la loi SRU sont concernées. Cette situation est la traduction de disparités territoriales exacerbées.
Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour appliquer la loi SRU et carencer les communes qui ne tiennent pas leur engagement, soit 40 % des communes de la métropole, et seulement 20 % en Île-de-France.
Toutefois, je suis absolument convaincue que la mixité ne tient pas uniquement au rattrapage, mais aussi à la volonté de cesser de concentrer les populations pauvres au même endroit. C’est pourquoi nous avons pris l’engagement, lors du comité interministériel des villes qui s’est tenu il y a une semaine, d’encadrer davantage les agréments dans les communes qui ont déjà plus de 40 % de logements sociaux.

Il est indispensable de construire des logements locatifs sociaux de qualité, car ceux-ci constituent une solution indispensable dans le parcours de vie de nos concitoyens, mais il faut les construire ailleurs que là où il y en a déjà trop.

Madame la ministre, vous avez indiqué que 40 % des communes de la MGP ne remplissent pas leurs obligations : on voit bien où est le problème !
Par ailleurs, la proportion de foyers qui peuvent être accueillis dans le logement social est gigantesque. Pourquoi restreinte la proportion de logements sociaux à 40 % ? Le logement social peut accueillir des populations diverses.
Ce gouvernement, comme tant d’autres acteurs, doit sortir du misérabilisme à l’égard du logement social.

Le logement social peut aussi être une forme de logement accueillante et propice à la mixité.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis sa création, la métropole du Grand Paris soulève de nombreuses questions institutionnelles, juridiques et politiques, mais c’est bien le sens de la métropole du Grand Paris qui doit nous interroger ce soir.
Conçue pour réduire les inégalités entre les habitants et améliorer leur cadre de vie, la métropole du Grand Paris se confrontera dès demain aux défis d’aujourd’hui : la démographie, la transition énergétique, la mobilité durable et l’attractivité économique.
Néanmoins, ces défis ne pourront être relevés que si la population francilienne sait clairement à qui s’adresser pour telle ou telle situation.
Soyons lucides : force est de constater que la métropole du Grand Paris est un objet politique peu identifié et peu connu. À ce jour, 208 conseillers et conseillères siègent au conseil métropolitain, pour y représenter les 131 communes membres. Je doute que les Franciliens concernés connaissent l’identité de leurs élus et le fonctionnement de ce conseil. Au millefeuille administratif français déjà encombrant s’est ajoutée la métropole du Grand Paris, dont les compétences manquent de clarté.
En tant qu’élu provincial, je constate qu’il s’agit d’un nain politique aux compétences limitées et exercées de manière croisée avec les autres collectivités sur cinq couches administratives. Il s’agit aussi d’un nain budgétaire : comme le montre le compte administratif de 2019, la métropole dispose d’un budget qui n’est pas à la hauteur des enjeux.
Par ailleurs, la frontière entre la métropole et la région est opaque : la première est une intercommunalité, certes débutante, mais souffrant encore de son image de colosse aux pieds d’argile ; la seconde, agile sur le plan des compétences et connue de tous, s’est au contraire imposée progressivement comme un échelon politique essentiel.
Madame la ministre, ne doit-on pas travailler pour simplifier la question des objectifs, des moyens, des compétences et de leur périmètre, afin de dissocier distinctement la métropole du Grand Paris des autres collectivités et, ainsi, donner enfin corps à ce projet territorial, aujourd’hui en hibernation, dont nous attendons qu’il prenne son envol ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, je note avec intérêt qu’il y a autant de solutions que d’orateurs !
Sourires.

Vous avez raison, il y a deux façons d’envisager la question de la gouvernance en Île-de-France. La première consiste à créer des instances de coordination procédant, selon le modèle des intercommunalités, des collectivités qui doivent se coordonner. C’est le modèle de la MGP. On peut aussi imaginer une sorte d’interdépartementalité.
Quelles que soient les solutions retenues, les intercommunalités procèdent toujours des communes, et c’est à l’échelon de ces dernières que se jouent les scrutins. Chacun a ainsi pu constater que la MGP et les programmes des EPT n’étaient pas au cœur des débats du scrutin municipal de 2020 – c’est le moins que l’on puisse dire !
La légitimité d’une vaste intercommunalité pour trancher de grands enjeux stratégiques est, par nature, plus limitée que s’il s’agissait d’une collectivité à statut particulier. En effet, le conseil communautaire n’a pas été élu sur le fondement d’un programme électoral métropolitain clairement choisi par les électeurs.
La seconde méthode, qui peut être complémentaire de la première, consiste à donner à une institution la possibilité de mettre en œuvre un projet politique métropolitain clairement choisi par les électeurs : c’est le modèle des collectivités à statut particulier, qui peuvent être dotées de compétences accrues par rapport aux collectivités de droit commun, voire issues de la fusion de deux échelons.
Une collectivité est administrée par une assemblée élue au suffrage universel direct. Cette assemblée a sa propre légitimité dans l’hypothèse d’un scrutin de liste dans une circonscription unique. Elle peut se prévaloir de la claire validation par les électeurs du programme qu’elle met en œuvre.
Pour reprendre votre expression, monsieur le sénateur, les différents projets territoriaux portés par les diverses tendances politiques seraient périodiquement soumis aux électeurs qui choisiraient leur destin commun.
Il faut cependant être clair : une telle collectivité ne ressemblerait en aucune manière à une métropole des maires, ou à une métropole à un autre échelon, ni à une communauté de départements. Elle serait, comme vous l’indiquez, dissociée des autres collectivités dans le respect du principe de non-tutelle.

M. Jean-Claude Requier. Olivier Léonhardt, sénateur de l’Essonne, ne peut malheureusement pas être présent aujourd’hui. Il m’a donc demandé de bien vouloir lire sa question, ce que je vais faire avec un accent plus méridional que celui que l’on entend dans son territoire du Hurepoix.
Rires. – Mme Françoise Gatel, M M. Philippe Pemezec et Jean-Raymond Hugonet applaudissent.

Je donne donc lecture de sa question :
« À l’époque, la création de la métropole du Grand Paris avait déjà suscité de vifs débats sur la pertinence d’un nouvel échelon administratif et politique dans le millefeuille préexistant en Île-de-France.
« La création de ce nouvel échelon devait d’ailleurs s’inscrire dans une réflexion nécessaire, plus globale, sur la répartition des compétences entre la région, la ville de Paris, les départements de la petite et de la grande couronne avec leurs spécificités, les nouvelles intercommunalités issues de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation, la loi Maptam, et les communes.
« En 2014-2016, de nombreux élus de terrain de tous bords politiques avaient aussi alerté sur le risque d’une relégation des territoires les plus éloignés du centre de Paris à la suite de la création d’une hyperstructure telle que la MGP.
« Malheureusement, ces préoccupations se confirment aujourd’hui, car le rapport de force institutionnel déséquilibré conforte les inégalités territoriales au sein de notre région.
« Cette problématique est particulièrement frappante dans le domaine des transports, quand les collectivités de Paris et de la petite couronne accaparent une part disproportionnée des investissements publics, alors que le réseau RER est au bord de l’implosion.
« Pour rappel, ce sont bien les habitants de la grande couronne qui ont besoin de transports en commun de qualité pour éviter de se déplacer en voiture et répondre à l’urgence environnementale.
« Dans cette même logique, la création d’une zone à faible émission, décidée unilatéralement par la MGP pour limiter progressivement l’accès des véhicules dotés de moteurs diesel et essence à l’intérieur des frontières de l’autoroute A86, révèle un problème de gouvernance. Comment accepter de telles mesures qui pénalisent les habitants de la grande couronne ?
« Madame la ministre, ma question est simple : quelles réformes envisagez-vous pour rééquilibrer la gouvernance de la région Île-de-France et contribuer à réduire les inégalités au bénéfice de tous les Franciliens ? »

M. Léonhardt a raison : il faut sortir de la logique de réseau en étoile qui vise à faire passer tous les voyageurs par Paris. Vous parlez des Franciliens, mais on pourrait presque dire que cette problématique concerne les Français dans leur ensemble, puisque tel a longtemps été le cas.
Dans un rapport publié aujourd’hui, François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne, pointe le fait que les différents projets d’infrastructures de transport actuellement programmés desserviront principalement la première couronne. Je crois que nous pouvons nous en féliciter, parce que le besoin était évidemment criant.
Toutefois, celui-ci considère que cela n’est pas suffisant : il craint en effet que les inégalités ne s’accroissent entre habitants de la zone dense parisienne et de la deuxième couronne, alors même que ce sont ces derniers qui souffrent des conditions de transport les plus dégradées et les plus contraintes.
Je partage l’idée qu’il faut dépasser les clivages entre petite et grande couronne, zones denses et zones plus rurales. Tel est le sens des engagements de l’État, puisque, vous le savez, celui-ci s’est fortement engagé aux côtés de la région pour financer à hauteur de 1, 4 milliard d’euros, dans le cadre du contrat de plan État-région, le CPER 2015-2020, le plan de mobilisation pour les transports.
L’auteur du rapport insiste également sur le potentiel que représente l’aménagement des routes franciliennes, avec des voies réservées pour les transports en commun.
À la suite des dispositions de la loi d’orientation des mobilités, la LOM, permettant l’expérimentation de voies réservées sur les routes, plusieurs expérimentations ont été lancées sur le réseau des routes nationales en Île-de-France et sont en cours.
L’engagement de l’État pour l’amélioration des mobilités dans l’ensemble de l’Île-de-France se traduit également par la réunion, vendredi prochain, sur l’initiative du préfet de l’Île-de-France, d’une conférence stratégique sur les mobilités routières.

Le fait métropolitain n’est pas nouveau. Il n’a pas non plus fallu attendre la création administrative d’une métropole pour qu’une métropole existe – on peut tous en convenir ici.
En revanche, depuis sa création institutionnelle, nous traînons la question du statut de la métropole du Grand Paris : c’est un sujet et un enjeu politique et démocratique majeur, mais il est confisqué, détourné et instrumentalisé.
Craignant le conflit de pensées sur l’avenir institutionnel de la MGP, nous avons encore reporté son schéma de financement lors de l’examen du dernier budget. Certains se plaisent à dire que l’on peut se contenter d’expliquer ce casse-tête repose par un manque de consensus entre l’ensemble des acteurs. C’est une formule consacrée, qui passe bien. D’ailleurs, vous l’avez quasiment utilisée, madame la ministre…
M. Jean -Raymond Hugonet rit.

À nos yeux, la métropole est cependant un opérateur qui menace ses échelons départementaux et communaux. Or, eux se trouvent en première ligne et ont une grande proximité avec nos concitoyens.
Je pense en particulier aux communes, puisque ces dernières conservent la clause générale de compétence, ainsi qu’aux départements, qui, de par leurs prérogatives, constituent un pilier en matière de cohésion sociale et territoriale, autrement dit aux deux échelons de proximité qui sont pleinement engagés grâce à leurs services et leurs agents publics locaux.

Nous voulons sortir de cet imbroglio, de cette sorte de séparatisme métropolitain « métropolisé », qui ne trouve pas sa place dans le schéma territorial historique, car il est déconnecté des besoins des Franciliens et en apesanteur.
Madame la ministre, je ne sais pas si vous êtes d’accord, mais le mythe de l’utilité des fusions qui réduiraient les coûts a vraiment vécu. Si la métropolisation est une réalité que le redécoupage des régions a favorisée et installée, le fossé créé entre cette institution et nos administrés renforce une crise démocratique déjà manifeste dans notre pays.
Aux projets élaborés d’en haut, nous préférons fédérer de manière ascendante, en faisant de la réponse aux besoins l’ambition partagée de chaque échelon institutionnel. Face à l’impossibilité de la gouvernance d’un espace regroupant 131 communes, ne pensez-vous pas qu’il faudrait repenser cet échelon sous la forme d’une coopération polycentrique, d’un espace de coordination légitime, puisque désiré, n’effaçant ni les départements ni le bloc communal ?

M. le président. Merci, mon cher collègue : votre temps de parole étant terminé, c’était votre conclusion !
Sourires.

Monsieur le sénateur, je me souviens bien de cette question, puisque je siégeais sur ces travées quand on l’a abordée, notamment lorsque l’on a débattu de la disparition des départements ; j’ai compris que, au-delà ce que vous évoquiez, vous aviez en tête cet épisode. Dans l’esprit de certains, cela était et cela reste d’ailleurs une solution à explorer.
Cela étant, ce que vous décrivez correspond au fond à la troisième famille de scénarios que je mentionnais tout à l’heure, c’est-à-dire celle qui fait entrer les institutions de la région capitale dans le droit commun, en prévoyant d’octroyer le statut d’EPCI à fiscalité propre aux EPT, et non plus à la MGP.

Je ne sais pas si c’est exactement ce que vous vouliez dire lorsque vous avez affirmé que vous vouliez « fédérer de manière ascendante », mais cela y ressemble assez.
Au fond, la MGP serait alors réduite à un syndicat mixte de la zone dense réunissant autant que de besoin Paris, les EPT, les départements de la petite couronne et la région Île-de-France. C’est du moins ce que j’ai cru comprendre dans votre proposition.
Ces scénarios ont évidemment des variantes, mais ils peuvent être une première étape permettant d’envisager plus sereinement une réforme institutionnelle plus ample.

Paul Delouvrier disposait d’un droit exorbitant du droit commun, de leviers puissants, de prérogatives de puissance publique et des outils qu’étaient les opérations d’intérêt national ou les projets d’intérêt général, ainsi évidemment que des moyens d’investir, notamment à l’époque dans les transports, ce qui permettait d’aboutir à un certain équilibre.
Par la suite, nous avons continué à produire des logements, à densifier, y compris en grande couronne, tandis que la logique d’investissement structurant à l’échelon de la région n’a pas suivi.
Aujourd’hui, ces instruments ne sont plus dans l’air du temps, et les élus des territoires sont les plus légitimes pour faire des propositions. Néanmoins, on voit bien que leur enthousiasme est assez modéré après cinq ans de réformes – je pense aux lois NOTRe et Maptam, qui nous ont tous bien occupés –, particulièrement dans l’unité urbaine de Paris.
Le consensus parmi les élus sur les solutions à apporter aux problèmes constatés de manière consensuelle est aussi assez relatif. On sent bien par ailleurs que l’intérêt de nos concitoyens pour cette réforme institutionnelle est également assez limité.
La campagne des régionales permettra-t-elle de faire avancer le sujet ? Je n’en suis pas certain : on voit bien que le projet n’est pas mûr.
Cela nous interdit-il pour autant d’envisager rapidement, faute de consensus sur la réforme institutionnelle, un outil assez souple qui nous permette de dégager quelques objectifs, un calendrier, des pistes de financement, et pourquoi pas un contrat régional d’intérêt national permettant de fédérer et de répondre aux attentes de nos concitoyens franciliens, et pas seulement en petite couronne, en matière d’investissements nécessaires à leur qualité de vie au quotidien ?

Monsieur le sénateur Arnaud de Belenet, je suis d’accord avec vous. Ce qui est essentiel, bien sûr, c’est de répondre aux besoins de nos concitoyens. Il faut éviter de nous perdre dans des débats institutionnels, donc essayer d’avancer sur les projets ; c’est en gros ce que vous dites, si j’ai bien compris.
Je sais la sensibilité qui est la vôtre en tant que sénateur de la Seine-et-Marne. Je rappelle que votre département représente 50 % de la superficie totale de l’Île-de-France. Il est pleinement intégré dans son bassin de vie
M. Vincent Éblé fait un signe de dénégation.

De plus, la Seine-et-Marne comprend des territoires absolument stratégiques pour la vie de la métropole : Val d’Europe, Eurodisney, sites universitaires, etc. On voit bien qu’elle fait partie de ce grand ensemble.
D’ailleurs, le département de la Seine-et-Marne, je tiens à le dire, siège au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités ou au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, par exemple.
Les schémas régionaux comme le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement incluent naturellement la Seine-et-Marne. Les outils pour travailler sur les projets existent donc. La Seine-et-Marne est par exemple pleinement intégrée dans les projets de modernisation des infrastructures de transport, comme celui de l’électrification de la ligne ferroviaire 4.
L’État a également veillé à ce que le département soit pleinement partie prenante des échanges sur la programmation des chantiers de l’axe nord, …

… dans le cadre des travaux de modernisation du RER B et de la construction de la ligne Charles-de-Gaulle Express.
En résumé, des choses existent déjà, mais il faut amplifier le mouvement !

Je profite des quelques secondes qu’il me reste pour affirmer ici que la création de richesses, de valeur, d’emplois en Île-de-France et pour la métropole du Grand Paris peut passer par la grande couronne, grâce à quelques investissements.
Il existe de nombreux potentiels de développement en grande couronne, qui sont singuliers et nécessaires à la métropole urbaine et dense. Je me tiens à la disposition de chacun pour en suggérer quelques-uns.

Je formulerai un constat, une remarque et deux questions.
Tout d’abord, je constate que, si nous sommes ici ce soir, c’est parce que le candidat Macron, qui se présentait comme un réformateur de l’architecture institutionnelle en Île-de-France, est finalement devenu un président assez conservateur, sinon silencieux.
Sourires.

Je fais donc le constat d’une sorte d’immobilisme du Président de la République : ce quinquennat n’aura servi à rien pour notre région, si j’en crois vos déclarations de ce soir, madame la ministre.
En tant qu’élu de la grande couronne, je m’intéresse à la fois à la métropole et à la région. Aujourd’hui, je remarque qu’il faudrait dépasser le clivage entre le fait métropolitain et le fait régional.
Quand on vous entend nous présenter vos trois scénarios, quand on s’intéresse à vos différentes interventions, madame la ministre, on a le sentiment que vous oubliez que la moitié des 12 millions de Franciliens vivent dans les quatre départements de la grande couronne. Il ne faudrait pas que votre volonté de densifier et de créer de la valeur ajoutée au sein de la métropole se fasse au détriment de ces habitants.
D’où mes questions, madame la ministre : que proposez-vous dans vos scénarios pour la grande couronne ? Comment envisagez-vous de favoriser un rééquilibrage en matière d’investissements et de création de richesses, d’emploi et de logement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire que les problèmes n’ont pas commencé avec Emmanuel Macron.
Exclamations.

Il n’est pas le seul responsable de l’évolution de la situation de la métropole.

Par ailleurs, j’ai participé de très près aux discussions qui ont eu lieu sur le sujet, que ce soit ici, au Sénat, ou au sein de ce gouvernement. Or il n’y a jamais eu de consensus parmi les élus.

Nous avons essayé, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord.
Bien entendu, nous pensons aussi aux citoyens de la grande couronne. D’ailleurs, parmi les propositions que j’ai formulées, certaines englobent la grande couronne.

Au demeurant, tout ce que j’ai dit ce soir n’est que le reflet des principales propositions mises en avant. Il ne s’agit pas du projet du Gouvernement, mais des suggestions dont nous entendons parler.
Enfin, il existe des syndicats, beaucoup de syndicats ! Vous parlez des déchets : je connais des syndicats dont le rayon d’action dépasse les frontières des intercommunalités de la petite couronne, intervenant parfois jusqu’en grande couronne. On observe aujourd’hui fréquemment une superposition des structures institutionnelles sur ce territoire. C’est pourquoi il importe de simplifier l’ensemble. Et pour ce faire, il faut que tout le monde s’y mette.
Pour finir, monsieur le sénateur, je me souviens d’un texte qui était reparti d’ici, au Sénat, sans aucune proposition à l’intérieur. Peut-être vous en souvenez-vous ?
M. Philippe Dallier acquiesce.

Vous le voyez, tout n’est pas si simple. Cessons donc de nous accuser les uns les autres et essayons de construire !

Je suis très étonné de votre ton, madame la ministre, car la réalité que j’évoque est factuelle.
J’ai bien compris que, avec les partisans du macronisme, tout est toujours très simple : quand cela va bien, c’est grâce à eux. Quand cela ne va pas, c’est la faute des autres !
Protestations sur les travées du groupe RDPI. – Rires sur des travées du groupe Les Républicains.

Je dis simplement que le Président de la République portait des projets ambitieux. Or, trois ou quatre ans plus tard, il n’en reste rien. Ce constat étant factuel, il est inutile de s’énerver. Chacun doit pouvoir défendre sa position.
Par ailleurs, vous nous dites que, puisqu’il n’existe aucun consensus, il faut patienter. Je ne sais pas ce que vous attendez, parce qu’il n’y en aura jamais de toute façon ! Il aurait peut-être été agréable ou souhaitable que vous formuliez une proposition au cours de ce débat.

Le Parlement aurait alors pu jouer son rôle. Vous auriez ainsi obligé le Parlement à avancer. Sinon, c’est l’Arlésienne ! Comme personne ne veut bouger, nous serons encore à nous demander comment progresser lors de la prochaine élection présidentielle.
J’ajoute, madame la ministre, que je n’ai toujours pas entendu vos propositions concrètes pour les habitants de la grande couronne, notamment dans le Val d’Oise.

Pour compléter l’excellent exposé de ma collègue Lavarde, je dirai que, depuis que la Ve République existe, tous les Présidents de la République ont apporté leur contribution et une attention particulière à la région Île-de-France et à la capitale : le général de Gaulle, comme certains l’ont souligné ; Valéry Giscard d’Estaing, en donnant un maire à Paris ; François Mitterrand, en associant les villes de Paris, Lyon et Marseille ; Jacques Chirac, sous la forme d’une contribution locale ; Georges Pompidou, dans le domaine culturel.
Le président Macron avait bien commencé, en présentant une feuille de route et en prononçant un discours dans lequel il nous disait qu’il verrait chacune et chacun d’entre nous, qu’il travaillerait avec le Premier ministre, que l’organisation actuelle de notre région était trop complexe, néfaste, non institutionnelle et déstructurée, qu’une compétition internationale était prévue et qu’il était par conséquent important d’agir.
Ce discours date de quelques mois après son élection. J’aimerais savoir qui travaille avec le Président de la République aujourd’hui ! Il dit travailler avec le Premier ministre, mais nous avons changé de Premier ministre et nous n’avons toujours pas les réponses à nos questions.
Il a aussi déclaré qu’il rencontrerait des personnalités, mais lesquelles ? En trois ans, quand s’est-il exprimé sur la région capitale, sur le sort de Paris et sur tous les problèmes qui s’y posent ?
Vous nous proposez des solutions, madame la ministre. En réalité, je plains votre situation, parce que nous avons compris que nous ne parlons pas de l’avenir de la métropole du Grand Paris.
Vous évoquez trois solutions, autrement dit vous n’en avez aucune ! Après trois années de législature, vous auriez pourtant pu égrener un chapelet de propositions. Or on voit bien, au travers de ces trois scénarios, qu’aucun travail n’a vraiment été accompli et qu’aucune réflexion n’a été menée. Je dirais même que vous n’avez manifesté aucun intérêt pour la région francilienne.
Je reviens donc sur la question de Philippe Dallier : quel est votre agenda ? Et qui travaille sur ce sujet ?

Monsieur le sénateur Dominati, j’ai déjà répondu au sujet du calendrier. Je n’y reviendrai donc pas.
Le Président de la République reçoit et consulte évidemment les grands élus. Je ne vous citerai que quelques noms – pas tous –, ne serait-ce que parce que je ne connais pas tous ceux qu’il rencontre.
Ainsi, il aborde régulièrement le sujet qui nous intéresse avec la présidente de la région, Valérie Pécresse, avec Patrick Ollier et avec les présidents des départements de la petite couronne, ainsi qu’avec ceux de la grande couronne. Il rencontre également certains maires.
Après que le préfet Cadot a rendu ses propositions, le Président de la République a pensé que la question institutionnelle n’était sûrement pas la bonne porte d’entrée pour parvenir à une solution équilibrée pour Paris. Il en est sûrement arrivé à l’idée que c’était par le biais des projets qu’il fallait construire la future métropole du Grand Paris.
J’ai tâché d’exposer le plus précisément possible la philosophie et les idées qu’essaie de diffuser le Président de la République aujourd’hui. Cela étant, je le reconnais, nous n’avons encore fixé aucun calendrier s’agissant des réponses législatives nécessaires à la métropole du Grand Paris.

Madame la ministre, vous avez malheureusement confirmé la tonalité du débat.
En réalité, le Président de la République ne s’intéresse pas tellement à la région capitale. On l’a d’ailleurs vu aux élections municipales à Paris avec les deux candidats de la majorité : aucun portage politique, pas de projection, pas de gouvernance pour incarner ce projet métropolitain.
Emmanuel Macron est le seul Président de la République, depuis 1958, à n’attacher aucune importance à ce qui représente un tiers de l’économie de notre pays ; on peut en effet s’intéresser à cette région pour d’autres raisons que le problème institutionnel.
Nous souhaiterions avoir des solutions !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Même si ce n’est pas la règle, madame la ministre, je vous donne la parole pour trente secondes supplémentaires.

Monsieur Dominati, je voudrais tout de même vous dire que la métropole du Grand Paris existe bel et bien et qu’elle a des élus.
Sourires.

… mais simplement qu’il y existait des élus métropolitains.
On ne peut pas toujours tout faire reposer sur les autres : à un moment, il faudrait que ceux qui siègent à la métropole du Grand Paris prennent position.

Au début de ce quinquennat, le Président de la République annonçait vouloir réformer le Grand Paris en cent jours. Il s’agissait d’une priorité… À plusieurs reprises, un discours-programme nous a été annoncé et, à plusieurs reprises, il a été reporté. Puis, comme l’écrivait Louis XVI dans son journal à la date du 14 juillet 1789, rien !

En un sens, ne rien faire quand on ne sait que faire n’est pas la plus mauvaise option.
En revanche, ne rien faire après avoir annoncé une réforme rapide et affirmer qu’un échelon du système territorial du Grand Paris devait disparaître, puis laisser entendre que cet échelon serait le département, et laisser penser que la région serait le bon échelon pour faire fonctionner la métropole du Grand Paris, tout en demandant à cette dernière de prendre davantage de responsabilités, notamment en matière de qualité de l’air, de lutte contre les inondations – c’est d’actualité ! – ou de relance économique constitue sans doute une très mauvaise option et traduit une pratique du pouvoir totalement délétère pour l’action publique.
Pour agir, les institutions ont besoin de temps et de stabilité. Or, par votre volontarisme sans dessein et votre ardeur réformatrice dépourvue de contenu, vous avez mis la métropole du Grand Paris en attente ; vous l’avez enfoncée dans l’instabilité.
M. Julien Bargeton proteste.

Est-ce le bon jour ou le bon endroit pour réformer ? Peut-être le bon moment est-il passé ? Que faire en attendant ? « Allons-y », dit l’un et, finalement, il ne bouge pas. Comme l’a fait Beckett pour ces deux héros, nous pourrions ainsi résumer votre action pour la métropole du Grand Paris.
Ce théâtre d’ombres serait comique s’il n’était joué au mépris des besoins des habitants de la région et du pays, dont la métropole est le cœur battant politique et économique.
Les liens de la Seine-et-Marne et du Grand Paris et ceux de l’ensemble de la grande couronne sont trop forts et trop essentiels pour que nous ne nous alarmions pas, au-delà des frontières de la métropole du Grand Paris, de cette situation préjudiciable au développement de toute la région et du pays.
Alors que tous les acteurs s’accordent à dire qu’une réforme était nécessaire, vous n’avez pas su rassembler. Pouvez-vous, madame la ministre, nous expliquer les raisons de cet activisme immobile ?

Et vous, quelle est votre position ? Êtes-vous pour plus ou moins de métropole ?

Monsieur Éblé, j’entends très bien ce que vous dites, mais je voudrais tout de même vous rappeler que la métropole du Grand Paris est née ici.
Vous en avez voté le principe, avant de rendre une feuille blanche à l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi Maptam. Ensuite, les députés ont voté un schéma, qui ne faisait évidemment pas consensus. Puis, des débats à n’en plus finir ont eu lieu lors de l’examen de la loi NOTRe ; nous étions un certain nombre à être présents.
Je ne puis donc pas vous laisser dire qu’un choix extrêmement clair a été fait ou qu’une construction tout à fait limpide a été décidée par les précédents gouvernements : si nous en sommes là et si cela ne fonctionne pas, c’est que l’on n’est jamais parvenu à prendre des mesures claires depuis 2010 et la première loi votée à ce sujet. Et je n’accuse personne.
Sourires sur les travées du groupe SER.

Nous ne sommes pas parvenus à élaborer un schéma assez clair, soit. Il faut désormais essayer de sortir par le haut de cette affaire.
Mme Françoise Gatel proteste.

Il était une fois un vieux pays, dont l’administration territoriale s’appuyait sur trois strates : la commune, le département et la région.
Pendant deux siècles, cela a plutôt bien fonctionné, jusqu’au jour où nos technocrates se sont emparés du problème et ont voulu le simplifier – doux euphémisme, puisqu’ils ont ajouté deux strates : l’intercommunalité et la métropolisation. Depuis lors, nous, les élus, déployons une énergie folle pour tenter de réduire ce millefeuille indigeste !
Rendez-vous compte, mes chers collègues, de ce que nous vivons en région Île-de-France : une ville-centre, Paris, ignorant les communes qui l’entourent ; une métropole qui prétend à des fonctions stratégiques, mais qui n’inclut pas le neuvième aéroport mondial, ni le plateau de Saclay, un des plus grands centres de recherche au monde ; à l’intérieur, des maires étouffant sous quatre couches d’administration et ayant perdu ce qui faisait le cœur de leur métier, à savoir répondre aux aspirations quotidiennes de leurs habitants.
Aussi, madame la ministre, ne cherchez plus ! Je vous amène, avec humilité, la solution ! Ce qu’il faut faire, c’est supprimer une couche – et même, rêvons un peu, deux couches –, pour redonner de l’air aux communes.
Pour cela, on fusionnerait la métropole et la région en une région métropolitaine, qui conserverait toutes les fonctions stratégiques d’une métropole mondiale, avec, évidemment, schéma de cohérence pour les transports et compétences en matière de développement économique. La disparition de l’actuelle métropole entraînerait de facto celle des établissements publics territoriaux de la petite couronne, qui ne servent pas à grand-chose.
Là où l’on entre dans le domaine du rêve, madame la ministre, c’est sur le point suivant : pourrait-on, pour une fois, faire confiance aux maires et laisser aux communes le libre choix de leur organisation ?
Certaines pourraient fusionner pour constituer des communes nouvelles ; d’autres pourraient poursuivre leur démarche de fusion – je pense à l’établissement Grand Paris Seine Ouest, le GPSO, autour de la ville de Boulogne-Billancourt ; d’autres pourraient retrouver leur liberté d’action, parce qu’elles ont la taille et la compétence nécessaires pour assumer toutes les fonctions essentielles, notamment l’aménagement urbain et l’urbanisme.
Madame la ministre, ne pensez-vous pas que notre région capitale mérite d’accéder, enfin, au rang de grande métropole mondiale, en changeant de statut et de taille ?
Par ailleurs, ne serait-il pas temps d’offrir aux maires de la première couronne un véritable choix d’organisation et la possibilité de retrouver une vraie liberté, au service de leurs administrés ?

Le moins que l’on puisse dire, monsieur Pemezec, c’est que votre proposition a le mérite d’être claire !
Si j’ai bien compris, vous fusionnez la métropole avec la région pour créer un ensemble ayant, bien évidemment, les compétences de la région et certaines compétences en matière d’aménagement du territoire, puis vous maintenez comme seul échelon subsistant les communes.

D’accord ! Vous maintenez donc les départements et les communes. Il n’y a plus d’intercommunalités, mais vous jouez sur les fusions de communes, pour qu’émergent éventuellement des communes nouvelles. Ai-je bien compris ?

C’est une proposition claire et intéressante, qu’il faut verser au débat. Je l’enregistre comme telle.
Cela étant – je vous livre un avis personnel –, quand je siégeais dans cet hémicycle, je me suis toujours demandé pourquoi on avait fait de Paris un cas particulier aussi longtemps. Quand on discutait de l’intercommunalité, cela devait s’appliquer partout en France, sauf à Paris. À mon sens, cela a été une erreur stratégique très importante des gouvernements successifs.

Si l’on avait envisagé des intercommunalités comme pour le reste du territoire – intercommunalités qui se sont d’ailleurs souvent construites de manière volontaire au début, peut-être moins ensuite –, on n’en serait pas là aujourd’hui. Mais, à nouveau, c’est un avis tout à fait personnel.

Pour cette seconde intervention, j’ai le privilège de représenter ma collègue Céline Boulay-Espéronnier, qui, sur avis médical, a été précipitamment mise à l’écart du débat cet après-midi.
Ma collègue souhaitait évoquer trois points, madame la ministre : la situation de la place financière de Paris ; la sécurité en Île-de-France, où le périmètre de la préfecture de police et celui de la métropole du Grand Paris ne correspondent pas ; enfin, l’anarchie qui règne dans l’organisation des transports franciliens, avec ce statut hybride un peu particulier et la place des sociétés nationales de transport – on vient d’en voir un avatar avec l’appel d’offres impliquant Alstom et Bombardier.
Dans ces trois domaines, les Franciliens connaissent des difficultés, lesquelles sont liées, dirai-je, à la permanence d’un ancien système régalien, jacobin, où l’État entend tout décider, au détriment des élus et de la décentralisation.
La place financière de Paris constitue un sujet important, car, depuis la sortie de Londres de l’Union européenne, c’est la seule place financière européenne qui peut rivaliser avec Francfort. Or, sur ce sujet, pas de discours, pas de projet, pas d’ambition !
L’insécurité à Paris, tous les Parisiens la vivent. Ils ont désormais l’habitude de voir la police nationale occupée par d’autres missions, certes nécessaires, mais différentes de celles qui sont strictement liées à la capitale, de sorte que toutes les forces politiques locales ont dû admettre la nécessité d’une police municipale. Il faut adapter le périmètre de la préfecture de police à celui de la métropole du Grand Paris : il est anormal, par exemple, que les prérogatives du préfet de police ne s’appliquent pas à une ville comme Argenteuil.
Telles sont les questions, madame la ministre, que souhaitait vous poser Céline Boulay-Espéronnier.

Votre évocation de la plateforme financière de Paris, monsieur le sénateur Dominati, me rappelle les dernières conversations que j’ai eues avec Patrick Devedjian. Anticipant déjà le Brexit, il y voyait pour Paris une chance, peut-être historique, de développer son rôle de métropole attractive et financière.
Le rayonnement de Paris, il faut s’en rendre compte, ne se dément pas. Métropole la plus attractive d’Europe pour les investissements étrangers, elle est de très loin la plus riche de France. Elle concentre 30 % du produit intérieur brut national – mais il y a, je tiens à le dire, l’effet redistributif de la péréquation – et 40 % des activités de recherche et développement, avec, notamment, le pôle de Paris-Saclay.
Tout cela contribue à son positionnement avantageux sur le plan international. S’y ajoute un certain nombre de projets structurants, qui progressent bien, comme le Grand Paris Express ou la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Paris, métropole d’envergure, a donc une très grande puissance d’attraction pour le monde entier. Naturellement, j’en conviens avec vous, il faut renforcer cette dernière, mais, dans le même temps, il faut traiter les très grandes inégalités qui caractérisent ce territoire. Nous avons ces deux enjeux à relever de front.

La création du Grand Paris est le résultat d’une juxtaposition de textes qui représentent un véritable cauchemar législatif, dont le dernier avatar a été la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

La multiplicité des strates, l’enchevêtrement des compétences, des financements et des circuits de décision débouchent sur un système totalement inefficace.
La complexité de la gouvernance de la métropole du Grand Paris contraste avec ses compétences limitées et exercées de manière croisée avec d’autres acteurs territoriaux, dont l’État. Son budget d’investissement – 50 millions d’euros – est lilliputien. Le périmètre territorial actuel, soit 7, 3 millions d’habitants, ne correspond à aucune logique fonctionnelle.
La métropole est un Grand Paris de l’État, non un Grand Paris des élus et des citoyens.
Le déficit de légitimité démocratique et de notoriété auprès des citoyens a un effet dévastateur. Le dispositif ne répond ni à la diversité des territoires ni à leur identité, encore moins aux besoins de participation des élus et des habitants à la coconstruction des projets. Pourtant, jamais les enjeux n’ont été aussi importants ; jamais la complexité n’a été aussi forte.
Il y a donc une immense contradiction qu’il faut résoudre, faute de quoi la première région européenne perdra des batailles au plan international et au plan local.
Puisque vous êtes en responsabilité, madame la ministre, peut-on connaître votre position ? Voilà des lustres que l’on réfléchit à ces questions… Faudra-t-il attendre la création d’un énième comité Théodule de Franciliens tirés au sort pour avoir la réponse ?…
MM. Philippe Dallier et Rachid Temal s ’ esclaffent.

Monsieur Hugonet, je ne vois pas du tout le rapport avec la loi Engagement et proximité de décembre 2019…

Je puis vous assurer qu’aucune mesure concernant la métropole du Grand Paris ne figure dans ce texte, qui, d’ailleurs, je le dis en passant, est plutôt apprécié des élus locaux.

Il faut aussi rappeler un point que j’ai déjà évoqué, car il est important : les élus de la métropole du Grand Paris ont raté certaines occasions, comme le Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, qui n’a pas été réalisé, le schéma de cohérence territoriale métropolitain, …

Même au sein de la métropole, on ne parvient pas à faire aboutir les dossiers. C’est un constat que, je crois, nous avons tous dressé au début de notre discussion.
Puisque vous me demandez mon avis, il me semble qu’il faut vraiment s’accrocher aux grands projets pour engager une réflexion pouvant aboutir à des changements institutionnels. On le voit bien, lorsqu’il s’agit de construire des équipements ou des moyens de transport en vue de l’accueil des jeux Olympiques, les choses se font ! Pourquoi ne pas procéder de même dans un cadre plus large et construire la métropole du Grand Paris à partir des projets ?
Je ne me prononcerai pas pour tel ou tel périmètre, monsieur Hugonet. Je vous dirai simplement : partons des projets, et réfléchissons ensuite à ce à quoi il semble le plus intelligent d’aboutir.

Avec beaucoup de respect, madame la ministre : une fois encore, c’est trop court !

Vous êtes ministre du Gouvernement et, dans d’autres domaines, le Gouvernement sait parfaitement imposer des choses.
Qu’il commence par le dire : cette métropole est une singerie !

Il y a la région Île-de-France, et il est évident que, sans la grande couronne, la métropole ne pourra jamais être efficace. Jamais ! Dites-le donc !

Je vous écoute avec attention depuis une bonne heure, madame la ministre. Vous avez expliqué n’avoir pas de calendrier pour des réponses législatives. Or, aujourd’hui, un texte est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, porté par pratiquement tous les députés de votre majorité concernés par ce territoire. Le Gouvernement poussera-t-il son inscription à l’ordre du jour ?
Vous nous avez également dit qu’il était essentiel de répondre aux besoins de nos concitoyens, en évitant de se perdre dans des débats institutionnels.
Madame la ministre, allez-vous prendre certaines mesures de nature réglementaire, par exemple pour aligner les compétences des agents des communes limitrophes de la ville de Paris sur celles de ses propres agents ? Ainsi, l’on pourrait mettre un terme à certains phénomènes d’évitement au niveau du recrutement des personnels de la petite enfance ou faire en sorte que des agents de surveillance de la voie publique n’aient pas des compétences différentes d’une rue à l’autre.
Enfin, vous nous avez expliqué que la loi Engagement et proximité ne comprenait pas de mesures sur la métropole du Grand Paris. Mais c’est de la responsabilité du Gouvernement, madame la ministre, car nous avions porté des amendements de bon sens sur ce texte !
Les EPT, par exemple, ne peuvent pas créer de police intercommunale, car ils ne sont pas dotés de la fiscalité propre. Il aurait été possible de prévoir une exception, mais le ministre qui se trouvait à l’époque au banc du Gouvernement, M. Sébastien Lecornu, nous avait proposé d’attendre la loi dite « 3D », qui contiendrait un titre spécifique à la métropole du Grand Paris.
Je comprends aujourd’hui que, dans cette loi « 3D » devenue « 4D », il n’y aura rien sur la métropole du Grand Paris… Accepterez-vous donc, madame la ministre, que nous adoptions dans ce cadre des mesures de bon sens, permettant d’apporter des réponses à des problèmes du quotidien ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Voilà pourquoi il faut toujours être prudent quand on dit quelque chose, madame Lavarde… Ensuite, on vous le reproche !
Sourires.

Une proposition de loi a effectivement été déposée par des députés qui pensent, eux aussi, que les choses doivent bouger ; ce n’est pas parce qu’ils sont dans la majorité que cela doit les en empêcher. C’est aussi simple que cela !
Toutefois, il faut voir leur démarche comme celle qui a consisté, ce soir, à provoquer ce débat : il s’agit, si je puis dire, de faire avancer le schmilblick.

En tout cas, de faire avancer le débat, cher Philippe Dallier.
Par ailleurs, même en l’absence de réformes d’ampleur, nous sommes toujours prêts à apporter des réponses. Nous n’avons pas cessé de le faire sur le plan financier, en faisant en sorte, chaque année, dans la loi de finances, de sauvegarder les équilibres entre les EPT et la métropole. Nous sommes bien sûr disposés à étudier toute évolution qui s’inscrirait sur le plan réglementaire, et non législatif.
Une police vient d’être créée à Paris, par exemple. Est-ce de cela que vous souhaitiez me parler, Mme Lavarde ?… Quoi qu’il en soit, nous reparlerons de tous les points dont vous souhaitiez m’entretenir.

Je vous ai bien entendue, madame la ministre, et je reviendrai donc avec mes problèmes précis, si j’en ai la possibilité, dans le cadre de l’examen de la loi « 4D ». Cette fois, vous ne me renverrez pas à un texte à venir !
En ce qui concerne les équilibres financiers, j’ai tout de même l’impression, à chaque projet de loi de finances, de devoir proposer, avec le soutien du Sénat, d’ailleurs, la correction de problèmes liés à une rédaction trop rapide, d’erreurs dans les calculs qui pénalisent certaines communes.
On me répond alors qu’il faut une réforme globale. En attendant, ces erreurs perdurent, la direction générale des collectivités locales les connaît et, pour autant, rien n’est fait !

En conclusion de ce débat, la parole est à M. Philippe Dallier, pour le groupe auteur de la demande.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne vais pas revenir sur ce qui fait manifestement consensus : la critique du modèle actuel. Nous sommes à peu près tous d’accord sur le fait que les choses ne peuvent rester en l’état !
Je vais plutôt essayer, et c’est ce sur quoi je travaille avec Didier Rambaud pour la délégation aux collectivités territoriales – nous rendrons un rapport sur ce sujet en mars prochain –, de vous proposer une méthode pour avancer.
Quelles sont les questions qui structurent le débat ? Vous en avez énuméré un certain nombre, madame la ministre.
Quel doit être le périmètre ? Cette question, je crois, se résume aujourd’hui à choisir entre la métropole actuelle ou la région – à un certain moment, on parlait de l’aire urbaine, totalisant 10 millions d’habitants sur les 12 millions que compte la région, mais ce n’est plus d’actualité.
Quelle doit être la nature de la métropole, et comment les conseillers métropolitains doivent-ils être élus ?
La situation actuelle est celle d’une métropole des maires, comptant 131 maires. Imaginez-vous, mes chers collègues, que l’on puisse envisager un tel fonctionnement dans une métropole-région qui compterait plus de 1 200 maires ? Non ! Il faudrait alors – que les choses soient claires – un mode d’élection différent, à la proportionnelle.
Quel peut être le statut de la métropole ? Faut-il en rester à un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, à statut particulier, comme c’est le cas aujourd’hui, ou opter pour une collectivité à statut particulier, à l’image de la métropole de Lyon ? On n’en parle pas assez, de cette métropole de Lyon, qui s’est substituée à la communauté urbaine, mais également au département du Rhône…
On pourrait ainsi imaginer faire de la métropole du Grand Paris une sorte de « commune-département », un peu comme à Lyon, de « super-département », comme le préconisait mon rapport de 2008, ou alors de « super-région » avec un statut à inventer.
Certains ont proposé ce soir d’en faire un simple syndicat mixte, autrement dit un pôle métropolitain sans véritables moyens. Ayons le courage de le dire, mes chers collègues, cette thèse est celle de ceux qui ne veulent pas de métropole !

En effet, et je ne démordrai jamais de ce point-là, cette question est corrélée à celle du partage de la richesse fiscale. Avec un pôle métropolitain, il n’y a aucun partage !
Qui peut imaginer, ici, que nous réglions les problèmes de la métropole qui est la plus riche d’Europe et de France, mais aussi la plus inégalitaire, sans une mutualisation des moyens issus de cette richesse économique ?

Cette question du partage de la richesse économique est fondamentale, car, sans mutualisation des moyens budgétaires, il n’y aura pas de métropole. Ceux qui proposent des solutions du type « pôle métropolitain » – j’ai constaté avec effroi que c’était tout de même un peu le cas des députés En Marche à l’Assemblée nationale – doivent le dire clairement.
Enfin, il faut parler de la redistribution des compétences, que pratiquement personne n’a évoquée ce soir. C’est un sujet pourtant fondamental. On a ajouté deux couches au millefeuille – quelle erreur, mais c’est fait ! –, en discutant à peine de la redistribution des compétences. La problématique a été traitée entre ce qui est devenu le bloc communal – communes et EPT – et la métropole, mais les départements et la région sont restés à l’écart.
Or, si l’on veut penser un modèle pour les trente ans à venir, il faut repartir des compétences et voir, pour chacune d’entre elles, le périmètre qui convient pour l’exercer et les moyens budgétaires qu’il faut y consacrer.
Le triptyque « compétence, périmètre, moyens », telle est la bonne entrée dans le débat !
Sans cela, nous l’avons encore constaté avec Didier Rambaud lors de nos récentes auditions, tous les acteurs agissent de même – de nouveau, je ne vais pas le leur reprocher, car c’est humain, et j’aurais sans doute la même réaction à leur place. Les présidents de département défendent leur département, la présidente de région défend la région, les présidents des EPT défendent les EPT et les maires défendent les communes.

Personne ne veut envisager de lâcher de bon cœur une partie de son pouvoir et, encore moins, de ses moyens. Là est le problème !
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous ne pouvons pas attendre que cela monte des territoires, comme je l’ai entendu si souvent. Rien ne montera des territoires, rien !

Si ce n’est, effectivement, la volonté de ne rien changer. Un peu comme Mme du Barry suppliait sur l’échafaud : « Encore un instant, monsieur le bourreau », on fera tout pour conserver sa richesse économique.
Alors que ce débat se termine, je dois dire, madame la ministre, que vous m’avez quelque peu perturbé.
Le Président de la République me semblait convaincu qu’il fallait une réforme de la gouvernance… Pour ma part, je suis convaincu qu’il n’y a pas de bons projets sans outils de gouvernance ! Qu’a fait le général de Gaulle en 1958 ? Il a doté la France d’un outil de gouvernance, la Ve République, et il a réformé le pays.
Je m’inquiète de vous entendre dire qu’il faut reprendre les choses par le projet. Non, madame la ministre ! En matière d’inégalités territoriales, les écarts sont immenses ; la Seine-Saint-Denis s’enfonce ; en dépit de la puissance de la région, la ségrégation territoriale progresse. Si nous voulons lutter contre toutes ces inégalités, pour le bien de la métropole et du pays, il nous faut une réforme de cette gouvernance !
Très bien ! et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec le débat sur l’avenir de la Métropole du Grand Paris.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 10 février 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Débat sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête pour l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion ;
Débat sur le thème : « Le fonctionnement des universités en temps covid et le malaise étudiant » ;
Débat sur le thème : « Respect des libertés publiques, protection de la vie privée : un nécessaire état des lieux des fichiers dans notre pays ».
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures quarante.
Le groupe Les Indépendants - République et Territoires a présenté une candidature pour la commission des affaires européennes.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Franck Menonville est proclamé membre de la commission des affaires européennes, en remplacement de M. Pierre Médevielle, démissionnaire.
Le groupe Les Indépendants - République et Territoires a présenté une candidature pour l ’ Office parlementaire d ’ évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Pierre Médevielle est proclamé membre de l ’ Office parlementaire d ’ évaluation des choix scientifiques et technologiques, en remplacement de M. Franck Menonville, démissionnaire.