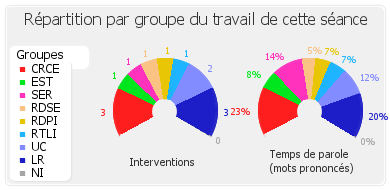Séance en hémicycle du 24 mars 2021 à 22h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, sur le thème : « Quelles perspectives de reprise pour une pratique sportive populaire et accessible à tous ? »
Dans le débat, la parole est à M. Jérémy Bacchi, pour le groupe auteur de la demande.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le sport transcende les clivages, y compris dans cet hémicycle. Sa portée universelle nous permet, un temps, de mettre de côté nos différends. Son utilité sociale n’est plus à démontrer. Alors que de plus en plus de personnes s’inquiètent d’un délitement de la société, il fait partie de ces outils essentiels à la République émancipatrice que nous souhaitons. C’est d’autant plus vrai qu’il permet souvent aux populations les plus fragiles socialement et économiquement de sortir la tête de l’eau et d’échapper aux difficultés du quotidien. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que l’on constate, en même temps que la fermeture des lieux sportifs, une augmentation de 80 % des troubles d’ordre psychologique chez les jeunes de moins de 15 ans.
Il y a encore peu, la France s’était donné comme cap d’accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avec une progression de trois millions de pratiquants sportifs. Sans même entrer dans le débat autour de la dénomination de ces pratiquants, la pandémie nous oblige à revoir nos plans.
Aujourd’hui, ce sont 180 000 clubs et 108 fédérations qui sont en souffrance. Clubs de danse, de gymnastique, d’arts martiaux, de basketball, de rugby, etc. : plus de 70 000 structures craignent de ne jamais pouvoir rouvrir.
Au mois d’octobre dernier, la baisse des licenciés était estimée aux alentours de 30 %, ce qui représente autant de personnes ne faisant plus vivre l’idéal émancipateur du sport. C’est aussi quelque 260 millions d’euros de cotisations en moins pour les structures.
Ce constat est d’autant plus accablant qu’il existe de fortes disparités selon les territoires et les disciplines. J’étais lundi dernier dans les quartiers nord de Marseille, ma commune, au comité de veille de La Busserine. Là-bas, 65 % des licenciés ne sont pas revenus, alors même que le confinement a été particulièrement éprouvant pour eux et que la pratique libre du sport n’est plus possible.
Pire, la fermeture des locaux a entraîné une occupation des lieux par des dealers. Or les bénévoles ne savent pas s’ils pourront les faire partir une fois l’activité sportive relancée.
À cela, il faut ajouter près de 120 millions d’euros de pertes de recettes issues des événements et du sponsoring.
Je salue l’engagement important des collectivités territoriales : premier financeur du sport français, elles ont maintenu, voire augmenté leur contribution pour 92 % d’entre elles.
Face à cette situation cataclysmique, les pouvoirs publics doivent être en mesure de répondre à trois questions. Qu’a-t-il été fait jusqu’à présent ? Quelles réponses apporter dans les semaines et les mois qui viennent ? Quelles leçons tirer de la situation ?
Madame la ministre, je ne doute pas un seul instant de votre attachement à la pratique sportive, qui fait votre quotidien depuis tant d’années. Force est toutefois de reconnaître que, jusqu’à présent, les réponses à la crise de votre ministre de tutelle et du Gouvernement ne sont pas satisfaisantes. J’y vois d’ailleurs un nouvel effet indésirable du rattachement forcé de votre ministère à celui de Jean-Michel Blanquer.
Premièrement, ces réponses ont brillé par leur insuffisance en direction du sport amateur : 900 000 euros via le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et l’Agence nationale du sport (ANS) en 2020, auxquels s’ajouteront 20 millions d’euros pour l’année à venir pour compenser les pertes de licences, 15 millions d’euros d’aides d’urgence et 100 millions d’euros pour le Pass’Sport.
Voilà, en substance, la réponse apportée pour le gros des associations sportives. Pour être tout à fait exhaustif, il faut citer également l’accompagnement des 30 000 associations sportives employeuses, qui peuvent bénéficier du chômage partiel et des prêts garantis par l’État (PGE).
Deuxièmement, ces réponses ont été ressenties par le mouvement sportif comme particulièrement déséquilibrées, et ce en tous points. Un président de club s’exprime ainsi : « Il faut différencier le sport spectacle-business, où il y a de gros intérêts en jeu. Celui-là, il est visiblement plus important que les autres, on ne l’a pas sacrifié. L’économie prime sur tout, on l’a tous bien compris. »
Bien sûr, les pertes à assumer pour le sport professionnel, ainsi que sa place dans le paysage économique du pays, sont d’un tout autre ordre. Les chiffres sont connus : des pertes de recettes dépassant allègrement le milliard d’euros, près de 350 000 emplois directs concernés et plusieurs milliards d’euros de retombées fiscales en temps normal.
Toutefois, force est de constater que la réponse publique aux difficultés des clubs professionnels a été d’une tout autre dimension. Rien que les prêts garantis par l’État contractés par les clubs rattachés à la ligue de football professionnelle (LFP) dépassent les 600 millions d’euros.
Même en matière sportive, on ressent une sorte de « deux poids, deux mesures » qui interroge. À ce titre, est-il pertinent d’avoir relancé et maintenu avec tant d’ardeur les compétitions professionnelles, tout en laissant au placard les compétitions amatrices ? J’évoquerai deux cas qui, à mon sens, illustrent les paradoxes de la situation.
Martigues est une commune des Bouches-du-Rhône située à 35 kilomètres de Marseille et à 150 kilomètres de Sète. Malgré cette proximité, et les échanges entre les trois villes, un seul des trois clubs est interdit de compétitions, alors que les protocoles sanitaires sont appliqués partout. C’est d’autant plus incompréhensible que certains clubs de National 2 sont au moins aussi structurés que certains clubs professionnels. Le club de Martigues compte ainsi deux fois plus de contrats professionnels qu’une majorité d’équipes de National 1, la division supérieure.
De cet exemple découle le sentiment d’une coexistence de deux politiques sanitaires sportives et d’une prise en compte différenciée des risques selon que le club est sous régime de contrat professionnel ou sous régime de contrat fédéral.
D’un côté, les amateurs, qui ne rapportent pas d’argent, sont mis en extinction. De l’autre, les professionnels, pour qui « le jeu en vaut la chandelle », bénéficient d’un régime d’exception.
Madame la ministre, quelles perspectives à court terme pouvez-vous donner au monde amateur sportif ? Peut-on espérer une reprise progressive des compétitions en extérieur et en salle dans les semaines qui viennent ? Ce ne sera manifestement pas le cas en National 2, puisqu’il vient d’être mis fin à la saison.
La mise sur le marché la semaine dernière du masque fabriqué par Salomon peut-elle constituer une porte de sortie de crise pour les associations sportives ? Si oui, votre ministère s’engagera-t-il financièrement et matériellement pour aider les fédérations et les clubs à se doter en matériel ?
De façon moins immédiate, cette crise montre que notre modèle sportif a atteint ses limites.
On pourrait presque se poser la question : le sport professionnel est-il devenu fou ? Le sportif et le supporter que je suis est parfois atteint, je le concède, d’une forme de schizophrénie : je voudrais tout à la fois voir les meilleurs joueurs évoluer tous les week-ends dans mon club de cœur, l’Olympique de Marseille
Sourires .

Ce printemps encore, certains clubs exprimaient leur volonté de renforcer leur indépendance vis-à-vis de l’État, tout en attendant de ce dernier un soutien financier important. On en revient à la privatisation des profits et à la mutualisation des pertes, qui prévaut déjà dans la gestion des stades.
Il faudra bien pourtant reposer la question des liens, d’une part, entre sport professionnel et État, d’autre part, entre sport professionnel et sport amateur.
Sur le premier point, j’évoquais à l’instant l’attitude ambiguë de certaines ligues professionnelles.
Sur le second, pendant des décennies, sport professionnel et sport amateur ont entretenu une forme de solidarité à double sens. D’un côté, les clubs amateurs accueillaient et préformaient des jeunes qui faisaient ensuite carrière dans les clubs professionnels. De l’autre, ces derniers aidaient financièrement les clubs amateurs pour les maintenir en vie et les aider à se développer, dans un contexte de désengagement de l’État. Cette solidarité existe-t-elle toujours pleinement aujourd’hui ?
Le scandale de Mediapro, s’il met grandement en difficulté le football professionnel, a une conséquence que l’on évoque trop peu souvent : il prive toutes les disciplines sportives amatrices d’une manne essentielle à leur survie.
Depuis plusieurs années, des économistes pointent le risque d’implosion de la bulle des droits télévisés et de celle des transferts, mais aussi le problème de l’endettement des clubs, et appellent à revoir le modèle sportif professionnel.
Il me semble qu’un chantier devrait être lancé autour du plafonnement des taxes liées au sport. Selon les documents budgétaires présentés par le Gouvernement, les taxes sur les paris sportifs, les jeux de loterie et la taxe Buffet représenteront en 2021 une recette d’environ 420 millions d’euros, pour un reversement à l’ANS estimé à 166 millions d’euros à peine.
L’Assemblée nationale a discuté la semaine dernière d’une proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Madame la ministre, Laura Flessel, votre prédécesseure, nous parlait déjà de ce texte en 2017. Il est donc heureux qu’il arrive enfin. Toutefois, je me joins à la colère de ma collègue Marie-George Buffet qui, me semble-t-il, a une certaine légitimité en matière sportive.
Comment démocratiser le sport sans avancer sur le dossier de la régulation du monde professionnel, qui tout à la fois apporte les moyens nécessaires au monde amateur, mais capte une part non négligeable des ressources publiques ?
Comment démocratiser le sport sans s’atteler à la question de l’engagement de l’État dans la pratique sportive, alors même que votre ministère ne représente que 0, 14 % du budget de l’État ?
Comment démocratiser le sport sans évoquer la question du sport scolaire, qui constitue un outil essentiel à l’épanouissement des enfants comme une porte d’entrée à la pratique licenciée ?
Comment, enfin, démocratiser le sport sans s’atteler à tous les freins à la pratique, notamment économiques ?
En cette période de crise, les sports amateurs et professionnels ressemblent de plus en plus à un champ de ruines. Si la situation est catastrophique, elle offre aussi l’opportunité de repartir sur de bonnes bases.
Ce débat, qui préfigure d’une certaine manière la discussion sénatoriale sur la proposition de loi de Céline Calvez, doit être l’occasion de proposer des solutions pour un avenir sportif populaire et accessible à toutes et tous. Je sais que, sur toutes les travées de cet hémicycle, se trouvent des amatrices et des amateurs de sport qui auront à cœur de faire vivre les valeurs sportives.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la ministre, il y a trois semaines, vous nous annonciez une bien mauvaise nouvelle.
La reprise du sport amateur au sens large n’aura pas lieu avant plusieurs semaines, certainement pas à Pâques, compte tenu du presque reconfinement, peut-être à la Trinité, voire aux calendes grecques – ironie du sport à la veille des jeux Olympiques, dont il n’est certes pas question ici, quoique…
Pas plus tard que ce week-end, plusieurs fédérations ont en effet déjà annoncé l’arrêt du sport amateur pour cette saison. Or c’est bien une pratique sportive, populaire et accessible à tous, en d’autres termes la reprise d’une activité essentielle en termes de santé physique, d’hygiène mentale, de bien-être individuel du corps, mais aussi d’équilibre collectif, qui doit guider notre responsabilité politique.
Nous devons préserver nos infrastructures sportives et nos pratiques si essentielles, du point de vue économique, certes, mais surtout des points de vue sanitaire et social.
Il est heureux que le plan de relance décidé à l’automne dernier ouvre des perspectives, là où le sport figurait dans l’angle mort du déconfinement et du retour vers une vie en société.
Nous ne sommes pas seulement dans l’insuffisance moribonde, nous sommes dans la suffisance d’une majorité gargarisée par de belles paroles qui n’engagent à rien quand elles ne sont pas confrontées à la réalité.
Certes, de nombreux efforts ont été accomplis en complément des aides de droit commun déjà mises en place par le Gouvernement : Fonds d’urgence pour les fédérations sportives, Pass’Sport, Fonds de compensation de pertes de billetterie, etc.
En l’espèce, dans un souci d’exigence et c’est désormais une préoccupation d’urgence, ce sont plus que jamais les plus jeunes citoyens qui doivent être la priorité. C’est vers ces jeunes en quête d’identité, d’ouverture et d’équilibre, que l’on doit déployer appui, solidarité et facilitation, parce qu’il est attesté qu’ils subissent ces restrictions plus que d’autres.
Aussi, alors qu’un pan entier du socle de nos valeurs communes est en train de s’effondrer, qu’en est-il concrètement de votre projet à leur endroit ?
« Le réel, c’est quand on se cogne », n’est-ce pas ? Madame la ministre, quelles nouvelles alarmes de santé publique faudra-t-il attendre pour que votre gouvernement se projette réellement dans une approche prospective, cesse le stop and go insupportable, accélère la mise en œuvre de ses projets et leur inscription dans une société si violemment heurtée ? L’heure n’est plus aux pansements sur des jambes de bois – ce que les jeunes ne sont d’ailleurs pas !
On le sait, la sédentarité et l’inactivité prolongée ne sont pas qu’un spectre fantasmé aux contrecoups hypothétiques : c’est une entaille profonde et attestée dans l’idée même de santé publique, dont les conséquences sont trop bien déterminées. Les plus jeunes sont en première ligne de cette démoralisation de masse, quand la vie sociale n’est plus possible à l’âge des possibles.
On parle de « génération sacrifiée »… J’aimerais tant que l’on puisse ici se permettre de dire que cette expression est galvaudée, mais qu’en est-il en réalité ?
Nous devons nous projeter dans une nouvelle donne de reconstruction et de rééquilibrage, et non dans une simple reprise. En effet – faut-il le préciser ? –, dans la vie d’un jeune, une année compte bien plus qu’une seule année !
Madame la ministre, au-delà des mesures au coup par coup, que nous saluons, qu’en est-il réellement de votre projet sur l’activité sportive des jeunes, qu’il s’agisse de sport à l’école ou à l’université, dans un cadre public ou privé, à l’échelle d’un petit d’homme ou d’un jeune citoyen à l’esprit sain dans un corps sain ?
Quid de votre volonté, de votre agenda, des moyens, et pas seulement pour les trois prochaines semaines ?
Qu’en sera-t-il de la mise en œuvre du plan 2020 et de ses belles idées, « véritable enjeu de santé, d’épanouissement, d’égalité et de réussite pour les élèves », selon vos propres mots ? Madame la ministre, comment comptez-vous dépasser l’horizon funeste et pénible de la sédentarité et de la perspective d’anomie.
Quel est votre projet au-delà d’un sport pour la jeunesse enfin ressuscitée ? Y a-t-il au plus haut niveau l’idée et les moyens d’en faire une priorité crédible ?
C’est en effet à se demander si le sport trouve encore une place dans la politique de ce gouvernement !
Enfin, je remercie Jérémy Bacchi et le groupe CRCE d’avoir pris l’initiative de ce débat.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains et CRCE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai par féliciter nos collègues du groupe CRCE d’être à l’origine de ce débat auquel la conjoncture actuelle apporte un écho démultiplié. Ne nous berçons pas d’illusions, le sport sortira sérieusement affaibli de la crise sanitaire : le nombre de licenciés aura régressé dans des proportions inquiétantes ; des bénévoles resteront à la maison ; des clubs amateurs disparaîtront ; des structures professionnelles connaîtront une adaptation difficile ; certains événements auront du mal à renaître.
Les loisirs sportifs marchands enregistrent d’ores et déjà des pertes financières considérables. Par exemple, l’Union Sport & Cycle annonce une perte de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires cette saison pour les commerces et fournisseurs d’équipements de ski.
Bref, tout l’écosystème sportif se trouve affecté par une crise inédite. Dans ce contexte, je salue les efforts déployés par Mme la ministre et ses services, ainsi que par les fédérations, notamment afin de proposer des protocoles sanitaires adaptés à chaque situation.
Rendre l’activité physique accessible au plus grand nombre justifie l’existence d’un service public du sport, qui est un bien collectif à partager. En d’autres termes, la promotion d’un authentique sport pour tous nécessite une politique publique affirmée et globale, en phase avec les évolutions contemporaines. Pour donner de la respiration financière aux clubs sportifs, au moins trois mesures exceptionnelles doivent être envisagées jusqu’à l’été 2024 : d’abord, rehausser de 60 % à 80 % le plafond de réduction fiscale des dons aux associations sportives pour encourager le mécénat ; ensuite, transformer une partie du coût des adhésions et licences en dons donnant lieu à crédit d’impôt pour réduire l’hémorragie du nombre d’adhérents ; enfin, relever le plafond des taxes affectées au financement de l’Agence nationale du sport.
Toutefois, le premier rendez-vous à ne pas manquer, dès le mois de juin prochain, est celui du Pass’Sport, afin d’aider à la reprise d’activité pour les plus jeunes générations. Je formule le souhait que celui-ci devienne d’ailleurs l’outil privilégié d’une orientation structurelle de notre politique sportive. Une enquête réalisée par l’Association européenne des professeurs d’éducation physique et sportive montre que 40 % des élèves présentent une augmentation de leur masse graisseuse et une diminution de 16 % de leurs capacités aérobies. Les tests réalisés à l’issue du premier confinement indiquent une perte de capacité physique des élèves de CE2 de l’ordre de 20 %.
La proposition de loi débattue la semaine dernière à l’Assemblée nationale aurait pu être l’occasion de redonner ses lettres de noblesse à l’éducation physique et sportive. Le rapprochement ministériel entre l’éducation nationale et le sport restera de l’ordre du symbole tant que ne sera pas augmenté le nombre d’heures d’EPS de la maternelle à l’université et qu’un continuum sport éducatif-sport fédéral ne sera pas effectif.
Si le retour à une vie normale s’accompagnera probablement d’une soif d’expression corporelle sous toutes ses formes, mais particulièrement au travers des activités physiques de pleine nature, un soutien public se révélera nécessaire notamment par l’intermédiaire de l’ANS. Il est urgent de doter les politiques sportives d’un financement durable reposant équitablement sur le rendement financier produit par l’activité sportive elle-même, d’où le slogan : « Le sport doit financer le sport ! »
Si l’engagement de l’État doit être consolidé, il faut encourager d’autres sources de financement : mécénat, financement participatif, obligations à impact social des investisseurs privés, etc.
Lever les freins à la pratique des activités physiques et sportives (APS) en renforçant l’accompagnement du public spécifique et en assurant l’égalité d’accès aux pratiques est un enjeu majeur. Des efforts doivent ainsi être conduits pour promouvoir la mixité dans l’éducation sportive et pour lutter plus efficacement contre le sexisme et l’exclusion dont font l’objet les jeunes filles et les femmes dans l’exercice d’activités, dont l’offre n’est pas toujours adaptée et suffisamment diversifiée. Une plus grande inclusion et une meilleure accessibilité des personnes en situation de handicap constituent également un objectif vers lequel nous devons tendre en modernisant les équipements et en développant des politiques plus ambitieuses de promotion du handisport.
Conséquence d’un sous-investissement chronique et persistant, l’état de notre parc d’équipements sportifs, y compris scolaire, doit faire l’objet d’un plan global de modernisation. Le problème se pose, en particulier, pour les piscines, qui n’ont pas fait l’objet de financement d’envergure depuis le grand plan d’équipement lancé en 1971. Depuis de nombreuses années, lors de chaque débat budgétaire est rappelée l’urgence de lancer un ambitieux plan de rénovation-construction d’installations et équipements, avec une recherche de mixité des usages, pour que puissent y cohabiter des sportifs pratiquant dans un cadre institutionnel, mais aussi des personnes venues pratiquer une activité de loisir.
La montée en puissance des exigences environnementales et territoriales est à intégrer, au-delà de la prise en compte impérative des zones dites carencées, notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale (ZRR).
La problématique d’une pratique sportive populaire et accessible à tous pose la question du droit au sport. Depuis les années 1980, nous connaissons une croissance des activités autonomes dans l’espace public, des pratiques libres ou encadrées dans des structures commerciales.
S’il reste élevé, le nombre de licences sportives, près de 19 millions selon Les Chiffres clés du sport 2020 – 16, 4 millions de licences et 2 millions d’autres titres de participation –, tend à stagner, voire à diminuer depuis quarante ans dans de nombreuses fédérations. Les inégalités territoriales, socioculturelles, économiques, genrées demeurent élevées. À l’aune de la réduction de ces inégalités, la gestion de l’après-covid représentera une période test pour la nouvelle gouvernance du sport français, pour le rôle de l’ANS et de ses déclinaisons territoriales.
En effet, les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs, qui se mettent progressivement en place sur le terrain, ont pour mission d’associer plus étroitement l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer au développement de l’offre d’activités physiques et sportives : parcours sportif des enfants, pratique des populations adultes dans leur diversité, etc.
L’intitulé de notre débat de ce soir rappelle l’importance du sport de masse ou du sport pour tous. Il sous-entend que l’accès au sport doit être considéré comme un droit, à l’instar de l’accès à la santé, à l’éducation ou à la sécurité, ce qui suppose d’envisager l’activité physique et sportive comme un élément de la citoyenneté. Cela implique des exigences éminemment concrètes : assurer un accès pour tous aux équipements, favoriser un développement équilibré des pratiques sur l’ensemble du territoire national et tout au long de la vie, diversifier les métiers de l’accompagnement sportif. Sur ce dernier point, les chiffres de Parcoursup parlent d’eux-mêmes : aucun autre secteur de recrutement ne connaît une telle saturation en matière d’orientation.
Aussi le moment est-il sans doute venu de conduire une réflexion sur une nouvelle diversification des métiers du sport. En matière d’encadrement, le recul de 80 % en trois ans des emplois aidés du secteur associatif est fortement préjudiciable à son dynamisme. Le rebond de la pratique passe par une relance de l’emploi sportif qualifié dans les clubs, lesquels demeurent la cellule de base institutionnelle dans un univers de pratiques différenciées. Ces structures doivent se penser comme étant au centre d’une articulation de tout un ensemble de pratiques publiques : sport et éducation, sport et santé, sport et entreprise, sport et développement économique, sport et aménagement du territoire, sport et environnement, sport et tourisme, sport et réinsertion sociale, etc. Au cœur de cette transversalité se distingue une mission : proposer des services à la population et à un territoire comme illustration de l’utilité sociale du sport.
Ainsi le sport d’après-covid devra-t-il intégrer davantage la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans le fonctionnement des acteurs concernés, qu’ils soient une composante de l’économie sociale et solidaire ou une entreprise marchande.
Au-delà des mesures d’urgence, le sport français a besoin d’un nouveau cadre et d’objectifs réactualisés. La proposition de loi visant à démocratiser le sport en France a commencé à tracer des perspectives. Les réactions qui ont suivi son adoption sont révélatrices de manques qu’il reste à combler. Un quotidien du soir titrait hier : « La proposition de loi sur le sport provoque frustration et regrets. » Puisse l’examen prochain de ce texte au Sénat contribuer à donner contenu et rayonnement au titre ambitieux qui est le sien.
La première priorité d’une politique sportive nationale doit être de développer le nombre de pratiquants, ce qui suppose une forte capacité d’action de la part de l’État, avec un ministère doté de moyens financiers supplémentaires, à un moment où le sport français est en danger.
Par ailleurs, n’oublions pas qu’il peut fortement contribuer à renforcer la cohésion sociale et éviter les dérives populistes menaçant notre société. L’héritage olympique était censé amener une augmentation de 10 % du nombre de pratiquants en 2024, un objectif exprimé par le Président de la République. Ayons le courage de dire que cette ambition est devenue caduque.
Notre intention de court terme est plutôt de retrouver la situation d’avant-covid. Depuis un an, nous n’avons jamais autant entendu parler de facteurs de comorbidité, mais également de l’apport de l’activité physique pour faire face à ces facteurs, dans le domaine tant préventif que curatif. Cette réalité doit nous encourager à poursuivre collectivement ce combat pour le développement de la pratique sportive.
Je termine sur ce message d’espoir, qui doit susciter une meilleure prise en compte du sport dans notre société et, plus largement, du corps dans notre vie.
Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie à mon tour le groupe CRCE d’avoir pris l’initiative de ce débat.
Depuis plus d’un an, une crise sanitaire sans précédent s’est abattue sur notre pays. Depuis plus d’un an, nos espaces de vie sociale sont profondément modifiés : nombre d’activités sont à l’arrêt, l’activité physique et sportive ne faisant malheureusement pas figure d’exception.
Durant le premier confinement, 38 % des Français ont diminué leur pratique sportive. Ce chiffre est loin d’être négligeable, même si, sur l’année 2020, la part de pratiquants reste relativement stable, puisque 65 % des Français ont pratiqué au moins une activité sportive dans l’année écoulée, contre 66 % en 2018.
Il convient également de souligner que, durant ce premier confinement, contrairement aux idées reçues, quasiment aucun non-pratiquant ne s’est mis à la pratique sportive.
Le secteur du sport amateur en club et association a lui aussi connu un coup d’arrêt brutal. Après la stupeur des premiers instants, les acteurs ont tout fait pour organiser une reprise dans les meilleures conditions. Las, depuis un an, la pratique en club n’a été autorisée que durant quelques semaines entre les mois de juin et d’octobre derniers.
Les inquiétudes quant à la reprise de ces activités sont aujourd’hui nombreuses. En effet, les clubs, mais également les fédérations, font face à des difficultés logistiques, humaines et financières sans précédent.
Certes, ces structures ont pu accéder aux dispositifs de droit commun, mais il est regrettable qu’aucun véritable plan ambitieux pour le sport n’ait été présenté à ce jour pour bien préparer la reprise.
Les pertes financières sont là et elles seront très difficiles à surmonter.
Du point de vue humain, de nombreux clubs craignent aussi de souffrir d’un désengagement des bénévoles, qui sont pourtant la ressource clé de la majorité de ces structures.
Il est un autre sujet d’inquiétude. Les clubs retrouveront-ils tous leurs licenciés lorsque la situation redeviendra normale ? Une baisse drastique du nombre de licenciés est à craindre pour plusieurs fédérations. Pour certaines, selon les derniers chiffres, cela peut aller de 10 % à 25 %.
Afin d’assurer une reprise de la pratique sportive populaire et accessible à tous, le Président de la République a annoncé, au mois de novembre dernier, la création d’un Pass’Sport, à hauteur de 100 millions d’euros. Si nous pouvons saluer cette idée, de nombreuses questions restent malheureusement en suspens, et j’espère que nous pourrons avoir des réponses ce soir.
Tout d’abord, comment ce Pass’Sport sera-t-il financé ? Nous avons proposé une solution de financement dans le projet de loi de finances pour 2021, mais vous l’avez refusée, madame la ministre. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Qui pourra en bénéficier ? Sous quelle forme et pour quel montant ?
Il est également regrettable que ce Pass’Sport ne soit pas universel, à l’instar du Pass’Culture. Encore une fois, cela souligne malheureusement la différence de traitement entre le sport et la culture.
Un autre moyen de soutenir la reprise sportive serait de permettre aux licenciés et adhérents des salles de sport de voir leur adhésion considérée comme un don ouvrant droit à une défiscalisation. Cette proposition aurait le mérite de bénéficier à un public différent de celui qui sera concerné par le Pass’Sport, étant donné que celui-ci serait soumis à des conditions de ressources. Madame la ministre, que pensez-vous d’une telle initiative ?
Je tiens à rappeler que de nombreux pratiquants en club comme dans les salles de sport privées ont pris leur licence ou leur adhésion lors de la rentrée 2020. Depuis, la plupart d’entre eux n’ont quasiment jamais pu pratiquer dans ce cadre et beaucoup se posent la question de la rentrée prochaine.
Si certaines fédérations ont d’ores et déjà annoncé vouloir renoncer à leur part, toutes ne peuvent pas se le permettre et l’État doit prendre ses responsabilités pour accompagner et aider les acteurs.
La reprise de la pratique sera difficile, nous le savons tous, mais cette crise sanitaire a également fait émerger une pratique libre ou digitale renforcée. À une époque où les individus sont demandeurs d’une pratique plus simple et sans contrainte, le développement de ce type d’activité, qui passe notamment par la digitalisation des organisations sportives, est un enjeu déterminant. Si certaines fédérations ont d’ores et déjà entamé un véritable travail sur le sujet, il est indispensable de renforcer le soutien de l’État à ces évolutions rapides. Or l’effort annoncé par le plan de relance n’est pas à la hauteur.
Aussi, madame la ministre, que comptez-vous faire concrètement pour soutenir les clubs et associations lors de la reprise de la pratique ? Avez-vous pour eux un réel plan ambitieux, financé, concret et prêt à l’emploi ?
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Madame la ministre, la pratique sportive est fortement fragilisée par la crise sanitaire. Le financement du sport professionnel par la vente de billets et le sponsoring est en chute libre, tandis que le sport amateur connaît une forte diminution du nombre de ses adhérents et, surtout, de ses bénévoles. Pourtant, le sport est plus que jamais indispensable pour améliorer la santé physique et mentale des Français.
Nos habitudes sont bouleversées par les confinements et couvre-feux successifs. La sédentarité s’installe dans nos vies avec le télétravail. Dans un tel contexte, à trois ans des jeux Olympiques, ce débat sur l’activité et la popularité de la pratique sportive arrive à point nommé.
Il s’agit d’une question essentielle, tant la pratique sportive est un facteur déterminant de santé publique, d’intégration et de cohésion sociale.
Le premier objectif de la politique publique du sport, pilotée par l’État dans le cadre de la nouvelle Agence nationale du sport, devrait être l’accessibilité des lieux sportifs pour tous et la promotion du sport au quotidien.
La situation actuelle est préoccupante : notre pays arrive en 119e position pour ce qui est du respect des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la pratique physique régulière des jeunes. D’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), une grande partie des adolescents français seraient en surpoids.
Pour lutter contre la sédentarisation, il nous faut nécessairement renforcer la pratique sportive à l’école, d’autant plus que l’exercice physique améliore sensiblement les résultats scolaires.
Or, sur les trois heures hebdomadaires de sport dispensées dans les écoles, la Cour des comptes observe que seule la moitié est effectivement consacrée à la pratique sportive. Et que dire de l’apprentissage de la natation, qui souffre d’un manque de structures ?
Des initiatives intéressantes sont menées à l’étranger, notamment en Finlande. Favorisons les initiatives locales pour diffuser une culture du sport dès le plus jeune âge, dans le cadre scolaire ou périscolaire, et gardons à l’esprit que les temps extrascolaires sont la plupart du temps consacrés à des activités sédentaires. La lutte contre les dispenses de complaisance d’éducation physique et sportive ou les disparités d’accès aux pratiques sportives entre les hommes et les femmes sont aussi des points importants. Nous en débattrons prochainement en séance.
Par ailleurs, la pratique sportive est un facteur essentiel de la santé au travail. Nous pourrions utilement l’intégrer dans notre politique de prévention des affections et maladies professionnelles. Il me semble que les prochains débats sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail seront bénéfiques à ce sujet.
L’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France constituera un autre rendez-vous législatif important, en ce qu’il sera l’occasion d’évoquer l’accessibilité des équipements sportifs des établissements scolaires au grand public en dehors des heures de classe. Nous devons également réfléchir à l’accessibilité de ces infrastructures pour les enfants scolarisés en famille.
Le sport étant parfois le meilleur des remèdes, dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous ne pourrons faire l’économie d’une réflexion sur la prise en charge par la solidarité nationale de séances d’activité sportive dans le traitement des affections de longue durée. Une expérimentation pourrait être menée à ce sujet. La pratique sportive aurait aussi toute sa place dans nos politiques de prévention de la perte d’autonomie et dans l’offre d’accompagnement des personnes en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou Ehpad.
Enfin, la pratique sportive peut constituer un premier pas vers l’insertion en milieu carcéral, en lien avec les éducateurs sportifs. Nous devons encourager ces initiatives, tout en renforçant notre vigilance pour prévenir les phénomènes de radicalisation, qui s’étendent bien au-delà de l’univers carcéral et touchent le monde du sport à bien des niveaux.
Les auditions sur la radicalisation en milieu sportif menées par notre collègue Nathalie Delattre au mois de janvier 2020 sont édifiantes. La proximité entre certains clubs, le communautarisme et la radicalisation n’est plus à démontrer.
Pour reprendre les recommandations du Conseil d’État, promouvoir la pratique du sport pour tous nécessite avant tout d’instaurer un cadre sécurisé et d’étendre les contrôles réalisés par les services de l’État aux éducateurs sportifs.
Pour conclure, je souligne que la politique du sport irrigue l’ensemble de l’action publique, de la santé à la cohésion nationale. Les prochaines échéances législatives seront autant d’occasions de renforcer l’accès au sport pour tous dans les meilleures conditions possible.
Avant d’être la recherche de performances et de victoires, le sport est avant tout une école de la volonté, de la confiance et du vivre ensemble.
Pour toutes ces raisons, nous espérons que la reprise des activités sportives en intérieur est imminente, avec des protocoles sanitaires adaptés aux différentes pratiques. Nous serons particulièrement attentifs à leur développement dans le cadre scolaire. Il faut aimer le sport et surtout le faire vivre !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre Ouzoulias applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie à mon tour le groupe CRCE d’avoir proposé ce débat.
Le monde d’après… Depuis un an, chacun s’y projette : un monde plus solidaire, plus local, plus durable, plus libre, un monde qui revient à l’essentiel.
Dans ce monde, le sport, notamment le sport-loisir, le sport-santé, le sport populaire, doit avoir une place centrale.
Dès le premier confinement, l’activité physique, même extrêmement contrainte, a souvent été le seul moment de liberté. Beaucoup ont enfilé leurs baskets pour s’évader, se libérer, y compris dans le kilomètre autorisé.
Après le premier confinement, le club Vélo et Territoires a constaté une hausse de près de 28 % de la pratique du vélo par rapport à 2019.
Il s’agit là d’une tendance profonde, mais fragile. Besoin de santé, besoin de vivre mieux : selon une étude de l’Université de Glasgow, réalisée en 2017 sur un échantillon de 200 000 individus, les personnes se rendant au travail à vélo voient leurs risques cardio-vasculaires ou de cancer diminuer de 40 % à 50 %. Bien entendu, cette tendance est difficilement mesurable aujourd’hui pour tous les sports.
La pratique sportive en club est en chute libre, et ce pour des raisons faciles à comprendre. Dès le mois de septembre dernier, les reprises de licence étaient extrêmement variables selon les disciplines et les clubs étaient alors déjà très inquiets.
Cette soif de sport reviendra. Notre rôle de parlementaires et le vôtre, madame la ministre, sont d’accompagner ce mouvement. Nous sommes convaincus que c’est un écosystème entier qui doit être préservé et dynamisé.
J’aborderai principalement deux points : le soutien aux milliers de bénévoles qui font vivre le sport et le renforcement de l’aspect éducatif de la pratique sportive.
En ce qui concerne le soutien aux bénévoles, le Gouvernement a déployé plusieurs mesures importantes. Ainsi, pour les clubs employeurs, aux dispositifs généraux de chômage partiel et d’allégement de cotisations viennent s’ajouter des mesures spécifiques pour l’économie sociale et solidaire en général, et pour le sport en particulier. Je pense ainsi aux emplois Fonjep, pour Fonds jeunesse et éducation populaire, supplémentaires ou à l’aide annoncée pour la rénovation des équipements sportifs ; cela va dans le bon sens.
Hélas, madame la ministre, comme dans beaucoup de domaines, dès que votre gouvernement fait un pas en avant dans la bonne direction, celui-ci est quasiment immédiatement remis en cause par un recul majeur.
Dans le projet de loi confortant le respect des principes de la République, que nous examinerons la semaine prochaine, les articles 25 et suivants imposent un grand nombre de nouvelles contraintes et obligations aux associations sportives, ainsi que plusieurs nouvelles restrictions, notamment dans la mise à disposition des équipements.
Dans un contexte de crise sanitaire où les associations sportives sont presque toutes à l’arrêt, où leurs dirigeants se démènent chaque jour pour la survie de leur structure, où les vocations des bénévoles s’amenuisent, alors que la vivacité du secteur sera la clé de la sortie de crise, le Gouvernement préfère ajouter à toutes ces difficultés des obligations aberrantes, jetant ainsi une suspicion détestable sur l’ensemble du monde sportif et associatif.
En ce qui concerne l’éducation, là aussi, beaucoup reste à faire. Je le répète, l’aspiration à un mieux-être physique recouvre de nombreuses réalités, notamment dans le domaine des déplacements.
La pratique du vélo nous semble ainsi particulièrement représentative de cette nouvelle réalité. Il suffit de se promener dans les artères des grandes villes ou sur les véloroutes le week-end pour le constater : jamais autant de vélos n’ont parcouru nos villes et nos campagnes. Il s’agit d’un moyen de transport et d’activité physique en plein boom, qui pourrait bientôt devenir le mode de transport urbain le plus utilisé, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays du nord de l’Europe.
Pour une réelle pratique populaire du vélo, le rôle de l’éducation nationale doit être de préparer les enfants au monde de demain. Il est ainsi logique qu’elle se saisisse de ces sujets.
C’est à ce titre que la loi d’orientation des mobilités de 2019 prévoit un programme d’apprentissage du vélo pour tous, afin de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, nous avons été plusieurs, de tous les bords politiques, à proposer des amendements pour prolonger dans le budget de l’État cette mesure déjà votée par le Parlement. Depuis, rien n’a bougé.
Madame la ministre, à ce stade, nous vous demandons plus que des promesses. Nous demandons simplement que cette mesure soit dotée du budget qu’elle mérite, dès maintenant, d’autant que votre ministère est désormais rattaché à celui de l’éducation nationale.
Pour conclure, mes chers collègues, les Écologistes appellent à une politique globale en faveur du sport pour toutes et tous, une politique qui soutient ces acteurs financièrement et qui ne jette pas une suspicion permanente sur les milliers de bénévoles qui animent le sport populaire pratiqué par des milliers de Françaises et Français.
Redonnons-leur des libertés, des marges de manœuvre. Nous militons en faveur d’une politique inclusive dès le plus jeune âge et dotée d’un budget réel pour accompagner les changements profonds de notre société.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Anne Ventalon applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, parce qu’il recouvre une large variété de disciplines, qu’il peut être pratiqué en intérieur ou en extérieur, individuellement ou collectivement, en amateur ou en professionnel, le sport est peut-être le secteur dont on entend le moins parler depuis le 17 mars 2020. Pourtant, le sport traverse la crise la plus importante de son histoire.
Depuis un peu plus d’un an, la pandémie de la covid-19 a bouleversé la vie des sportifs, en particulier celle des amateurs. Habituellement rythmée par l’organisation de plusieurs entraînements en semaine et de compétitions le week-end, la vie sportive ne peut plus se dérouler comme avant.
Nous le déplorons tous.
Face à l’impossibilité de se rendre dans leurs lieux de pratique habituels et face à l’arrêt des compétitions, les 18 millions de licenciés sportifs n’ont pas tous renouvelé leur licence lors du changement de saison.
La perte de licenciés est estimée à 25 %, ce qui a pour conséquence la remise en cause de l’équilibre financier des associations sportives, les adhésions représentant une part importante des recettes, mais aussi la mise en danger de la vie associative des clubs, la mobilisation des bénévoles risquant de s’essouffler. Or, sans eux, cette vie sportive locale aussi riche, qui constitue le véritable « poumon » de nos communes, n’existerait pas.
Face à cette situation, ces bénévoles et ces dirigeants sportifs continuent à se mobiliser pour garder le contact avec leurs adhérents grâce aux visioconférences ou aux réseaux sociaux. Ils font aussi preuve d’innovation pour extérioriser leurs activités sportives.
Les collectivités locales ne sont pas en reste pour aider leurs clubs et associations sportives. Le conseil départemental de l’Yonne, où je siège, a ainsi voté jeudi dernier un budget de plus de 2 millions d’euros en faveur du sport.
Alors que notre pays continue à être dans la tempête de la covid-19, il est plus que jamais nécessaire de donner des perspectives de reprise aux sportifs amateurs et à leurs clubs, de réfléchir à la place que nous souhaitons donner au sport de demain dans notre société et à la manière dont nous souhaitons l’ouvrir au plus grand nombre.
Avec la crise de la covid-19 et les confinements, l’activité sportive est apparue comme essentielle.
Ce n’est pas un hasard si, parmi les mesures renforcées annoncées le 18 mars dernier par le Premier ministre pour freiner la troisième vague, figurent la possibilité de se déplacer dans un rayon de 10 kilomètres pour faire du sport, sans limitation de temps, la reprise normale de l’éducation physique et sportive sur le temps scolaire, ainsi que le maintien des activités extrascolaires en plein air pour les mineurs.
Vecteur de lien social, la pratique du sport est bonne pour le physique et le moral. Avec la crise sanitaire et la progression de la sédentarité, la nécessité de rester actif est devenue une évidence pour demeurer en bonne santé.
Pour bâtir le sport de demain, nous devons continuer à faire preuve d’agilité et à innover tout au long de cette crise.
Pour cela, il est nécessaire que les associations sportives puissent continuer à bénéficier du soutien de l’État. Il faut le reconnaître : même si ce n’est jamais assez, le monde sportif en France est soutenu comme nulle part ailleurs dans le monde.
Au-delà du plan de relance, de son volet relatif au sport, doté de 120 millions d’euros, et du déploiement du Pass’Sport en 2021, il faut continuer à lever les freins pour permettre une pratique sportive populaire et accessible à tous, mais aussi faire de la France une véritable nation sportive, comme le Président de la République s’y est engagé dès 2017.
Cet objectif ne pourra pas être atteint sans l’aide des collectivités locales. Je le dis par expérience, en tant qu’ancienne maire adjointe de la ville de Migennes, dans l’Yonne, chargée des sports pendant treize ans.
L’accueil de la Coupe du monde de rugby en 2023, puis des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, constitue de véritables occasions à saisir pour donner un nouveau souffle au monde sportif local. Nos territoires l’ont bien compris. Ces événements permettront de fédérer toutes les énergies locales autour d’actions variées et festives.
Labélisée « Terre de Jeux 2024 » en 2019, l’Yonne a ainsi décidé récemment d’accentuer son engagement pour se positionner en tant que terre de jeux et d’accueil.
Libérer les énergies sportives aura un impact positif pour nos territoires, mais aussi pour la France entière, dans le cadre de la relance.
Aussi, madame la ministre, je souhaite savoir de quelle manière vous comptez encourager et amplifier la mobilisation des collectivités locales et des acteurs locaux dans le domaine du sport, dans la perspective de ces événements sportifs internationaux, et donner ainsi à nos sportifs amateurs de nouvelles perspectives positives et résolument tournées vers un avenir meilleur.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens d’abord à remercier le groupe CRCE d’avoir demandé l’inscription de ce débat à l’ordre du jour de nos travaux.
Comme l’écrivait Jean Giraudoux en 1928 dans son ouvrage Le Sport, « il y a des épidémies de tout ordre ; le goût du sport est une épidémie de santé ».
La crise liée à la covid-19 rythme nos vies depuis plus d’un an maintenant. Pour tenter de contenir la propagation du virus, des mesures drastiques ont été mises en œuvre. Elles ont eu des conséquences dramatiques pour nombre d’acteurs économiques, culturels ou associatifs sur l’ensemble de notre territoire. Le monde sportif a ainsi été lourdement touché.
On ne compte plus le nombre d’événements annulés, reportés ou restreints au strict minimum, les championnats stoppés, qui s’ajoutent à la fermeture des lieux de rassemblement : les salles de sport, les stades, les gymnases, les piscines.
Si rien n’est fait rapidement, les difficultés pourraient perdurer bien après la réouverture des infrastructures accueillant du public.
Nombreuses sont les associations sportives qui font face à une évaporation du nombre de leurs licenciés et à des situations financières compliquées engendrées par le manque d’événements. Leurs adhérents, notamment les plus jeunes, les ont financées par une adhésion ou l’acquisition d’une licence, mais sans qu’aucune compétition soit organisée.
Aujourd’hui, sans aucune assurance de reprise des championnats, tous ces amateurs sont dans l’expectative ; ils ne s’acquitteront pas forcément d’une nouvelle adhésion à leur club de sport. Déjà mises en difficulté par le manque de bénévoles, les associations sportives redoutent aujourd’hui des défections d’adhérents en grand nombre.
Comme un problème ne vient jamais seul, l’absence de manifestations, source de recettes, et de compétitions auront aussi pour effet de faire baisser les ressources provenant des sponsors, qui peuvent représenter une part importante de la trésorerie des clubs amateurs.
Les associations sportives redoutent également une chute importante du nombre de licenciés, ce qui aurait pour conséquence de mettre à mal bon nombre de championnats, notamment pour les sports d’équipe. La crainte existe aussi que les adhérents demandent un remboursement de leur cotisation.
Au vu de l’ensemble de ces difficultés, le risque n’est pas nul qu’un grand nombre de ces structures ne puissent y faire face et disparaissent.
Par le lien social que leur tissu facilite, par les valeurs qui y sont transmises et les effets bénéfiques que la pratique a sur la santé des adhérents, les associations sportives sont indispensables au vivre ensemble sur tout le territoire national.
Pour qu’un retour des championnats amateurs soit possible, au-delà de l’amélioration sanitaire attendue, il faut être en mesure d’agir sur le coût de l’adhésion annuelle des licenciés. Plusieurs pistes sont à l’étude. Parmi elles, on peut citer le travail autour du dispositif Pass’Sport, qui pourrait apporter une aide à la prise en charge des licences sportives de 1, 8 million de jeunes, à hauteur de 50 à 80 euros ; cela va évidemment dans le bon sens.
S’assurer que la pratique du sport soit accessible à tous est d’autant plus primordial que bon nombre de jeunes basculent dans la précarité du fait de la crise.
D’autres actions doivent certainement être envisagées. Dans cette perspective, et toujours afin de limiter le coût des licences et de favoriser la trésorerie des associations, pourrait-on réfléchir à un crédit d’impôt sur les frais d’adhésion ou à une déduction fiscale supplémentaire pour les dons aux associations ?
Par ailleurs, une part du coût de la licence sportive couvre les frais d’assurance. Or, depuis l’arrêt des championnats, il n’y a plus de risque d’accident sur les terrains de sport. Dès lors, une nouvelle proposition peut être faite : les assureurs ne pourraient-ils pas être mis à contribution, en supprimant leur appel à cotisations, pour favoriser la reprise des licences sportives amateur ?

Madame la ministre, depuis un an, la pratique sportive est entravée. Les différents règlements et protocoles qui se sont succédé au fil des confinements et des couvre-feux ont créé beaucoup d’incompréhensions. Il est même arrivé que les parcs et les plages soient interdits d’accès, ce qui a découragé la pratique sportive libre et de plein air. Tout cela malmène considérablement les responsables d’associations, les bénévoles, les familles et les enfants qui pratiquent une activité physique et sportive.
C’est encore plus vrai aujourd’hui, alors que débute dans seize départements un troisième confinement, même si l’on a pu reprendre l’activité physique et sportive à l’intérieur dans les établissements scolaires, dont beaucoup avaient vécu des situations tout à fait ubuesques. Tant mieux, mais cela ajoute de la confusion à la confusion – c’est malheureusement une constante dans la gestion de la crise par ce gouvernement –, d’autant qu’en sens inverse, il y a quelques semaines à peine, l’interdiction de la pratique d’activités en salle avait été annoncée sans préavis, ce qui a par exemple affecté la danse.
En dépit des efforts financiers des clubs pour se conformer à la réglementation sanitaire, de leur réactivité pour adapter la pratique aux nouvelles règles encadrant les lieux et les publics autorisés, et de leur capacité à démontrer leur sérieux dans la lutte contre la propagation du virus dans le milieu du sport amateur, le risque est grand aujourd’hui de voir de plus en plus de personnes s’éloigner du sport.
Déjà plus de 30 % des licenciés semblent se détourner de leurs clubs. C’est pourquoi il y a aujourd’hui unanimité pour réclamer le droit de pratiquer son sport favori.
Jason Lorcher, ancien hockeyeur de haut niveau à Rouen, a ainsi lancé une pétition, voilà quelques jours. Les « sportifs en détresse » qu’il a rassemblés sont aujourd’hui plus de 30 000 à témoigner des méfaits de l’interruption de l’activité sportive : amateurs, enfants, jeunes ou adultes, bénévoles ou dirigeants de clubs, tous expriment leur besoin vital de renouer avec la pratique sportive.
Du point de vue de la santé, chacun sait ici combien l’activité sportive est importante pour la prévention, y compris maintenant, face au covid-19. La rupture de la pratique risque aussi de créer de nouvelles problématiques de cohésion sociale. De l’avis des professionnels de santé, les conséquences de cette interruption peuvent en effet être graves sur le bien-être, mais également sur l’équilibre psychologique ou psychique de la personne. De plus, dans cette période particulièrement anxiogène, qui expose au repli sur soi, on manque cruellement du partage qui se noue autour du sport, ce qui exacerbe les inégalités sociales et isole les pratiquants les plus en difficulté.
Cette rupture risque aussi, à terme, d’avoir des conséquences sur le sport de haut niveau, en asséchant le vivier dans lequel l’élite sportive puise ses ressources. Nous avons tous plaisir à regarder de grandes compétitions internationales, de beaux matchs de sport professionnel, mais ceux-ci prennent sens parce qu’ils s’appuient sur un sport amateur et populaire : ils le font rayonner, mais la réciproque est tout aussi vraie.
Comment comprendre, dès lors, qu’aujourd’hui même, il y a quelques heures, les compétitions départementales et régionales de football aient été stoppées par la Fédération française de football, alors même que débutent les éliminatoires de la Coupe du monde de 2022 ?
Tout cela suscite des questions sur le modèle sportif qui perdurera après cette crise ; elles ont été posées par Jérémy Bacchi.
Nous sommes pour notre part convaincus que le sport est un véritable outil d’éducation, d’inclusion, d’épanouissement et de solidarité. Il est de ce fait encore plus utile en ce moment même que d’ordinaire.
Il faut donc créer les conditions de la reprise de la pratique sportive, bien évidemment dans le respect des règles sanitaires, et soutenir les clubs comme les collectivités, dont l’implication en la matière n’est plus à démontrer.
Le Pass’Sport est un outil qui peut contribuer à lever les obstacles financiers pour tous ceux qui, dans le contexte de crise sociale actuelle, auront des difficultés à payer leur licence. Nombre de collectivités auront à cœur d’y participer.
N’oublions pas cependant qu’elles aussi sont lourdement affectées, financièrement, par la crise sanitaire et toutes ses conséquences ! Il faut le prendre en compte. Il faut que les financements de l’État soient au rendez-vous si nous voulons que le Pass’Sport suscite véritablement la reprise de licences par le plus grand nombre.
La situation que nous connaissons doit être l’occasion de revoir en profondeur le financement de notre modèle sportif et de porter un plan ambitieux en matière de sport.
Je salue à mon tour l’ensemble des propositions qui ont été émises sur toutes les travées de notre assemblée à l’occasion de ce débat. Vous avez là, madame la ministre, des propositions à la fois précises, solides et concrètes qui peuvent permettre de redonner un nouveau souffle au mouvement sportif dans notre pays, ou de le relancer, puisque l’on parle beaucoup du plan de relance en ce moment. Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer ce soir à ce débat.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et GEST, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Madame la ministre, le sport est un enjeu de société. Il représente aussi un enjeu économique. On lui consacre 0, 14 % du budget de l’État et il représente 1, 7 % du PIB de la France. Le sport est encore un enjeu populaire : on compte 10 millions de licenciés dans les différentes fédérations sportives ; deux Français sur trois pratiquent toutes les semaines une activité sportive régulière.
Eu égard à ces éléments, pendant longtemps, on a opposé dans notre pays le sport d’élite, professionnel, au sport amateur, sport de masse. Aujourd’hui, nous serons tous d’accord ici pour reconnaître qu’il est plus important de mettre en avant les schémas de complémentarité que les oppositions.
Dans ma bonne ville de Castres, au temps où cela était possible, 10 000 personnes se réunissaient tous les quinze jours pour assister à un match de rugby, soit un quart de la population de la ville. Aucun autre événement ou mouvement social populaire ne peut rassembler autant de personnes aussi régulièrement : voilà la magie des sports !
Du reste, madame la ministre, je profite de cette occasion pour vous interpeller directement en tant que président de l’amicale parlementaire de rugby et vous rappeler combien il est important que vous continuiez à aider les clubs professionnels du Top 14, dont le modèle économique repose sur les hospitalités et les spectateurs, avec toutes les conséquences que l’on imagine. Ces clubs ont besoin de l’aide de l’État pour faire face au huis clos qui leur est imposé !
Au-delà, j’estime essentielle la capacité de notre pays à organiser de grands événements sportifs. Tous les ans, on a le Tour de France. En 2023, nous accueillerons la Coupe du monde de rugby, pour laquelle 310 000 billets ont été vendus en quelques heures, ce qui montre toute l’attente qu’il peut y avoir en la matière. Enfin, on prépare les jeux Olympiques de 2024, eux aussi essentiels à bien des égards.
La réussite sportive, dans ses différentes manifestations, dépend aussi de la capacité de fonctionner du socle sur lequel elle repose, c’est-à-dire le sport amateur. De ce point de vue, la pandémie à laquelle nous devons faire face risque d’avoir à terme des effets dévastateurs, comme cela a déjà été rappelé. Les enjeux du sport en matière de santé publique sont particulièrement forts et importants.
J’ai rencontré ces dernières semaines de nombreux maires de mon département. Ils m’ont fait part de leurs plus profondes inquiétudes au regard du fait que certains jeunes qui avaient une pratique sportive sombrent aujourd’hui dans certaines addictions : l’alcool, le tabac, la drogue peut-être pour certains d’entre eux ! Il y a lieu d’être particulièrement vigilant.
Il faut donc se donner la possibilité d’une reprise de l’activité sportive qui soit la plus massive et la plus rapide possible.
J’ai consulté bien des élus, notamment des maires et des adjoints chargés des sports, parmi lesquels je citerai ceux de Gaillac, de Mazamet et de Saint-Sulpice-la-Pointe. Il ressort de ces entretiens un élément fondamental, madame la ministre : il faut donner aux acteurs locaux la capacité d’adapter un certain nombre de règles nationales, de manière à favoriser la reprise la plus rapide possible de l’activité sportive ! Il faut leur apporter des éléments de souplesse, de sorte que des protocoles spécifiques puissent être expérimentés dans nos collectivités, nos départements et nos territoires. C’est un enjeu majeur.
Je terminerai mon propos par une citation de Jean Giraudoux : « Il y a des épidémies de tout ordre ; le goût du sport est une épidémie de santé. » Puisse cette épidémie de santé durer le plus longtemps possible !
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre Ouzoulias applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la ministre, le monde sportif souffre depuis près d’un an. À ce jour, il n’a aucune perspective de reprise ; seuls les clubs professionnels sont pleinement autorisés à pratiquer avec contact et à prendre part à des compétitions à huis clos. Ce n’est pas idéal, mais c’est adapté et proportionné à la situation sanitaire.
En revanche, le sport amateur, la grande majorité des clubs semi-professionnels et les salles de sport restent sur la touche. Les clubs semi-professionnels et amateurs sont tous soumis au même régime, qu’ils prennent ou non part à des compétitions nationales ou continentales. D’après les consignes qu’ils ont reçues de la part de la direction des sports, seuls les clubs comptant plus de 70 % de sportifs professionnels peuvent s’entraîner sans distanciation et prendre part à des compétitions. Ce critère n’est absolument pas adapté à la réalité du monde sportif et met de côté un grand nombre de clubs qui évoluent dans des compétitions de haut niveau.
Madame la ministre, je vous ai envoyé un courrier pour vous alerter de la situation dans laquelle se trouvent ces clubs qui rassemblent à la fois des sportifs de haut niveau, qui sont autorisés à s’entraîner avec contact, et des sportifs amateurs, qui ne peuvent s’entraîner que sans contact et en dehors du couvre-feu. En raison de ce critère de 70 %, la plupart de ces clubs ne peuvent pas prendre part à des compétitions ni s’entraîner de façon adaptée pour celles-ci.
Je vous ai alors proposé de fixer différemment les critères, en autorisant les compétitions et les entraînements sans distanciation uniquement pour les clubs évoluant à l’échelle nationale ou européenne. Ceux qui ne prennent part qu’à des compétitions départementales ou régionales n’y seraient pas autorisés.
Dans votre courrier de réponse, vous m’avez indiqué que permettre la reprise des entraînements avec contact pour l’ensemble du sport amateur n’était pas adapté à la situation sanitaire. Il ne s’agit absolument pas de permettre une reprise pour tous, cette demande concerne les seuls clubs prenant part à des compétitions de haut niveau et ayant de ce fait des budgets importants que les aides actuelles ne peuvent compenser.
Cette règle des 70 % a des conséquences désastreuses pour les clubs. La majorité des fédérations ont dû annuler les championnats de France et plusieurs devront rompre les engagements qu’ils avaient pris dans le cadre des championnats européens. Plusieurs clubs voient leurs membres les quitter pour d’autres, situés dans des pays étrangers où les compétitions amateurs ou semi-professionnelles sont autorisées, tels que la Suisse, l’Italie, la Finlande, l’Espagne ou encore l’Allemagne.
Malheureusement, il est déjà trop tard pour rattraper cette situation. Il faut donc maintenant tout miser sur la saison prochaine. Les clubs sont conscients de la situation sanitaire et leurs revendications sont proportionnées à celle-ci.
D’une part, ils souhaitent une reprise des sports collectifs avec contact avant l’été, en priorité pour les jeunes. Cela leur permettra de sécuriser leurs inscriptions pour la rentrée de septembre prochain.
D’autre part, si d’ici à l’été la situation sanitaire n’est pas suffisamment stabilisée pour permettre une reprise du sport pour tous, les clubs souhaitent que le sport sans distanciation et les compétitions soient possibles uniquement pour ceux d’entre eux qui évoluent dans des compétitions nationales et européennes, pour les jeunes comme pour les adultes.
Si par malheur l’épidémie venait à se prolonger jusqu’à la prochaine saison, madame la ministre, il est absolument indispensable que vous ne reconduisiez pas cette règle absurde de 70 % de professionnels au sein des clubs, sans quoi nombre d’entre eux ne se relèveront pas. Vous engagez-vous de ce fait à ne pas laisser le sport collectif à l’abandon et à étudier leurs propositions raisonnables et sensées ?
Enfin, j’en viens à la situation des salles de sport. Déjà fermées durant le premier confinement, elles le sont de nouveau depuis le mois d’octobre dernier. Elles sont aidées au titre du fonds de solidarité, mais celles qui enregistrent moins d’un million d’euros de chiffres d’affaires par mois ne sont pas éligibles à l’indemnisation de leurs charges fixes. Cela changera au début du mois d’avril prochain, mais seuls les mois de janvier, février et mars seront indemnisés de façon rétroactive, alors que les charges sont supportées depuis de nombreux mois. Plus de 300 salles ont déjà déposé le bilan et il a fallu plus d’un an pour que leurs alertes soient entendues. Quel gâchis !
Le sport participe pourtant à la lutte contre la pandémie, puisque les personnes en bonne santé et pratiquant une activité physique régulière ont moins de chances de souffrir d’une forme grave de la covid-19.
La plupart des études prouvent en outre que, si le sport sans masque en milieu fermé favorise la propagation du virus, une pratique sportive en intérieur avec masque, distanciation et aération présente très peu de risques. Si l’interdiction d’ouverture peut se comprendre dans les départements confinés ou en surveillance, elle est loin d’être proportionnée dans ceux où les taux d’incidence sont bas.
Le Gouvernement a commencé à territorialiser les mesures de lutte contre l’épidémie, mais il faut aller plus loin et faire de même pour l’ouverture des salles de sport. Des critères supplémentaires peuvent être fixés, tels qu’une surface suffisante pour pratiquer la distanciation et des moyens d’aérer la salle.
Interdire à toutes les salles d’ouvrir sur tout le territoire n’est pas proportionné. Aussi, madame la ministre, comptez-vous défendre la réouverture des salles de sport dans les départements où le virus circule peu ?
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Pierre Ouzoulias applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

En écoutant vos propos, mes chers collègues, qui font écho aux témoignages des licenciés que j’ai rencontrés, évoquant les risques qui pèsent sur leurs fédérations et leurs clubs, une évidence apparaît : le rôle du sport dans nos sociétés. Cela nous oblige à mesurer la portée civilisationnelle du terme de « culture physique ».
En m’entretenant notamment avec les professionnels des salles de sport de l’Ardèche, au-delà du désarroi, j’ai perçu un sentiment d’incompréhension et de gâchis.
Plutôt que l’interdiction brutale, l’État aurait dû et pu instaurer avec eux un protocole adapté à la crise. En effet, non seulement aucun cluster n’est apparu dans ces établissements, mais des mécanismes d’identification à l’entrée permettent de tracer l’heure d’arrivée des adhérents et d’identifier les personnes croisées.
Plus généralement, les gérants et les responsables associatifs qui assurent le fonctionnement des équipements sportifs connaissent mieux que quiconque les gestes et les déplacements qui y sont pratiqués. Hélas, ils n’ont pas été consultés, alors qu’ils auraient pu être des auxiliaires précieux pour éliminer le virus sans détruire le sport.
Il faudra s’en souvenir demain. Il faudra aller chercher des solutions innovantes.
Je veux en prendre un exemple relatif aux masques, qui sont indispensables dans l’attente de l’immunité collective, mais peu compatibles avec l’exercice physique. Devons-nous pour autant continuer à renoncer totalement à nos activités sportives, avec les conséquences que chacun a déplorées ici ? Non !
Concentrons plutôt nos efforts sur la diffusion de masques adaptés à un large éventail de disciplines, notamment les sports collectifs. Une entreprise ardéchoise, Chamatex, développe justement de tels masques, qui n’entravent pas la respiration et permettent une mobilité impensable avec les modèles basiques. Soutenons-la ! Encourageons ainsi partout le génie du pragmatisme, ce French flair qui sifflera la fin de cet interminable arrêt de jeu.
Au-delà de cette épidémie dont nous finirons par venir à bout, le temps est déjà venu de réfléchir aux crises de demain. Je pense à notre future capacité à passer, en cas de nouvelle alerte épidémique et dans un délai minimal, à une organisation adaptée à nos pratiques sportives, individuelles ou collectives.
Les orateurs précédents l’ont souligné : faute d’anticipation, nous découvrons brutalement les conséquences de la privation de sport sur la population.
Il faut donc, madame la ministre, que vos services travaillent dès à présent sur un modus operandi qui serait directement efficient en cas de nouvelle crise. Il permettrait aux associatifs, aux professionnels, aux élus et aux sportifs de basculer immédiatement dans un fonctionnement de crise, avec des règles du jeu connues, puisque déjà définies en amont.
Les acteurs du secteur, comme le collectif événementiel sportif Outdoor, très actif dans mon département, proposent des expérimentations encadrées pour sauver des événements sportifs grand public en plein air. Accompagnons-les !
En 2020, nous avons été surpris et désemparés. Aujourd’hui, nous devons prévenir un futur épisode pandémique avec l’état d’esprit des athlètes de haut niveau, c’est-à-dire en nous jurant d’être prêts le jour de l’épreuve.
Pour paraphraser une devise célèbre, je dirais que nous devons passer à ce format adapté plus vite, avec des niveaux de maintien de la pratique plus hauts, et que nous en sortirons plus forts.
Madame la ministre, à vous qui avez en votre temps prononcé le serment olympique, il appartient de prendre ce soir devant nous ce nouvel engagement !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jérémy Bacchi et Claude Kern applaudissent également.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-trois heures dix, est reprise à vingt-trois heures quinze.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie tout d’abord le groupe CRCE d’avoir proposé l’inscription de ce débat thématique autour du sport à l’ordre du jour de vos travaux.
Comme certains d’entre vous l’ont souligné, je pense que ce débat témoigne de votre motivation à traiter de ce sujet prochainement, peut-être au sein de cette assemblée. J’espère qu’il préfigure l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France que l’Assemblée nationale a discutée et adoptée la semaine dernière.
Pourquoi cette proposition de loi est-elle importante ? Permettez-moi de faire le lien entre ce texte et les propos que vous avez tenus de ce soir, mesdames, messieurs les sénateurs.
D’abord, ce texte se place au cœur d’une actualité dominée par la crise sanitaire et des préoccupations des associations sportives et des collectivités, soucieuses de l’état et de l’avenir de ce monde associatif sportif, qui est tellement important pour la cohésion sociale, pour la santé physique et psychologique des Françaises et des Français, mais aussi, tout simplement, pour le vivre ensemble, ce vivre ensemble qui nous manque tant aujourd’hui.
Il est essentiel que ce texte ouvre de nouveaux champs d’action au monde associatif pour que celui-ci vienne en appui à des politiques publiques dépassant le seul cadre du sport en France, notamment à l’échelon local : auprès des personnes handicapées, à l’école… Il importe de créer davantage de liens entre le monde associatif sportif et le monde économique afin de promouvoir l’attractivité des territoires. Dans le cadre du volet sport-santé, les associations sportives peuvent devenir de véritables outils pour sensibiliser nos concitoyens à cette thématique.
Il s’agit également, comme vous le demandez, d’ouvrir des perspectives de reprise pour la pratique sportive populaire et accessible à tous. Pour ce faire, nous devons parvenir à structurer différemment le monde associatif, qui joue un rôle majeur.
Vous avez cité le nombre d’emplois que le sport génère et le nombre de personnes impliquées en France, je ne reprendrai pas ces chiffres que nous connaissons tous. Le monde du sport est important pour notre économie. Nous savons aussi combien il est déterminant pour les enfants et les adolescents, car il leur permet d’exprimer une passion, un engagement personnel, voire de définir un projet de vie. Il faut donc que les collectivités et l’ensemble des responsables publics soient aux côtés de ces jeunes qui mettent le sport au cœur de leur existence.
Le titre Ier de cette proposition de loi a pour objet d’ouvrir davantage le champ d’intervention du monde associatif pour lui permettre de se structurer, d’aller chercher de nouveaux publics, d’être plus en lien avec des politiques locales – communes, agglomérations, régions – ou nationales.
Le titre II traite du renouveau du monde sportif. Lorsque je suis arrivée à la tête de ce ministère, une réforme était déjà en cours, engagée par Laura Flessel, dont l’ambition était de nouer une relation différente avec le mouvement sportif. Il s’agissait également de porter une attention particulière à ce qui se passait en matière sportive sur nos territoires et dans nos collectivités, en associant différemment le monde économique à la politique du sport afin de trouver de nouveaux financements.
Le Sénat a voté la création d’un groupement d’intérêt public, l’Agence nationale du sport, permettant d’instaurer une gouvernance partagée. Cette agence met en effet autour de la table l’ensemble les acteurs – collectivités, mouvements sportifs, État, entreprises – pour traiter sérieusement de la politique du sport, promouvoir des cofinancements et faire prévaloir l’utilité du sport pour la société.
En contrepartie d’un nouveau contrat passé entre l’État et le monde sportif, qui confère à ce dernier une autonomie accrue, nous attendons du mouvement sportif qu’il témoigne d’une responsabilité plus grande, qu’il se restructure, se repense et se renouvelle. Voilà pourquoi le titre II aborde la question de la parité dans les instances sportives – je sais que pour certaines et pour certains d’entre vous cela compte beaucoup. Il y est également question d’un lien plus fort entre l’instance fédérale, les clubs et les adhérents au travers des modalités de vote au sein des instances dirigeantes des fédérations. Il pose également la question de la limitation du nombre de mandats pour les présidents de fédération afin de promouvoir le renouvellement des générations et la mixité. Il s’agit d’apporter au monde associatif des perspectives nouvelles de développement.
Enfin, le titre III traite du modèle économique que vous avez évoqué à plusieurs reprises ce soir. Comment protéger le modèle économique du sport en France ?
Vous l’avez souligné dans certaines de vos interventions, le Gouvernement assume tout à fait l’idée que le sport ne se résume pas à la pratique amateur. Certes, le sport amateur constitue la base de la pratique sportive en France, mais tout cela conduit au sport professionnel, c’est-à-dire à des carrières et à des métiers. C’est un aspect fondamental que nous souhaitons affirmer et protéger, de la même manière que le monde amateur et son modèle économique doivent être structurés pour mieux être préservés.
Je suis donc ravie que nous puissions ce soir, en préambule des discussions qui auront lieu dans cet hémicycle sur la future loi Sport, aborder tous ces sujets ensemble.
J’appelle également votre attention sur une autre échéance, à savoir l’article 25 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Le ministère des sports, en accord avec le mouvement sportif, a prévu d’y inscrire cette relation nouvelle et importante qui lie l’État aux fédérations sportives. Il faut aller encore plus loin et affirmer une relation renouvelée entre le monde fédéral, le sport amateur et le sport professionnel.
Les contrats de délégation qui figurent à l’article 25 sont un point important, car c’est dans ce cadre qu’il sera question des thématiques que vous avez évoquées, qu’il s’agisse de la performance sociale du sport et de toutes les externalités positives du sport. Tout cela pourra se trouver inscrit dans les contrats de délégation, non pas pour contrôler davantage les fédérations ou les contraindre, mais au contraire pour valoriser ce qu’elles font déjà bien, avec engagement et passion. Je pense en particulier à la participation aux valeurs de la République, à la protection des publics, ainsi qu’à la protection de l’éthique et de l’intégrité du sport.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je me suis autorisée à faire un peu de publicité autour de ces deux textes, car ils sont d’une importance majeure dans la gestion de cette crise. J’aimerais vous expliquer maintenant comment a été gérée cette période, qui a été très compliquée pour moi en tant que ministre des sports.
Le sport se situe, en effet, dans la zone dangereuse : on le pratique sans masque, en intérieur, où le virus se répand beaucoup plus facilement qu’en extérieur, dans une pratique collective. Nous sommes donc confrontés à un phénomène de groupe, que l’on soit spectateur, pratiquant d’un sport collectif ou d’un sport de contact. Certes, les manières de pratiquer le sport sont diverses et variées, mais il me revient de défendre de la même manière tous les sports, ainsi que l’écosystème associatif et fédéral afin de maintenir, durant cette période très compliquée, un minimum d’activité.
Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, le secteur économique du sport, qu’il s’agisse des salles de sport privées ou des magasins de sport, se tourne vers nous pour que nous défendions sa cause. Nous le faisons avec grand plaisir, car nous sommes tous dans le même bateau, si vous me permettez l’expression.
Nous sommes aussi tous embarqués dans la même aventure, qui nous mènera aux deux grands événements qui scanderont le rayonnement du sport et de notre pays à l’international : la Coupe du monde de rugby en 2023 et les jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Malgré la crise que nous traversons aujourd’hui, il importe que nous soyons à la hauteur de cette responsabilité que nous avons prise en postulant et en gagnant ces candidatures.
C’est pourquoi il m’a paru dans un premier temps essentiel de préserver la pratique sportive de ceux qui en ont fait leur métier. Nous avons nous aussi été pris par surprise par ce virus. Au mois de mars 2020, quand il s’est agi de préserver la santé des sportifs et des professionnels du sport, il nous a semblé indispensable de leur demander de cesser leur pratique pour les mettre à l’abri, pour les protéger jusqu’au moment où nous en saurions davantage sur cette épidémie. Ensuite, dès le mois de septembre dernier, nous avons fait le choix de les placer au rang de public prioritaire. Nous l’assumons, car il s’agit, je le répète, de personnes pour qui la pratique du sport constitue le métier : elles doivent donc pouvoir exercer leur métier comme tous ceux qui sont aujourd’hui autorisés à travailler.
Nous avons donc décidé qu’il leur serait possible de continuer à pratiquer leur sport. Ce n’est pas facile, car ils doivent subir des tests tous les deux jours et sont contraints à faire davantage attention à la circulation du virus que le reste de la population. En effet, ce qui est en jeu, c’est leur corps, qui est leur outil de travail !
Nous devons accompagner les sportifs, les clubs professionnels et les ligues professionnelles dans la mise en place de tous ces protocoles. Nous travaillons au quotidien avec le monde professionnel pour qu’il maintienne l’activité de ces sportifs afin que ceux-ci n’aillent pas, comme vous l’avez souligné, à l’étranger. Nous voulons aussi qu’ils restent motivés en vue des grandes échéances qui auront lieu en France ou à l’international ; je pense aux jeux Olympiques qui auront lieu dans quelques mois et à ceux qui se tiendront à Paris en 2024.
L’autre aspect essentiel était d’aider les organisateurs d’événements sportifs. Nous les avons accompagnés pour qu’ils puissent nous proposer des protocoles et avons validé un certain nombre d’exceptions dans le cadre des déplacements – je pense à l’ouverture et à la fermeture des frontières. Il importe également d’assurer l’équité des compétitions sportives internationales. C’est donc un public auquel nous avons évidemment fait très attention et que nous soutenons au quotidien.
Pour autant, le sport professionnel n’est pas notre seul public prioritaire, puisque nous sommes également très attachés au sport-santé. Comme vous l’avez rappelé, le sport est bon pour la santé : c’est d’autant plus évident à l’heure actuelle.
Bien avant la crise, le Président de la République a pris l’engagement de valoriser le sport-santé par la création de 500 maisons sport-santé en France, d’ici à la fin de son mandat. Il s’agissait de repérer, de financer et d’accompagner les territoires déjà engagés en ce sens, afin d’aider à faire de sortir de terre de telles structures. Nous y sommes presque, puisque leur nombre s’élève aujourd’hui à 300 sur l’ensemble du territoire. Nous venons d’annoncer la deuxième vague de labellisation et nous avons débloqué une ligne financière de 3, 5 millions d’euros pour accompagner les territoires qui financent le sport-santé, thème sur lequel Olivier Véran et moi-même souhaitons mettre l’accent.
C’est pourquoi, lorsque c’est possible, nous préservons au maximum la pratique sportive pour les enfants, dans le cadre scolaire ou dans le cadre associatif. C’est pourquoi nous faisons en sorte, là encore lorsque c’est possible, que la pratique sportive puisse reprendre pour les adultes. C’est le cas aujourd’hui puisque toutes les associations sont autorisées à fonctionner. La seule restriction concerne le sport à l’intérieur.
Comme vous l’avez rappelé, nous comptons beaucoup sur le masque dit sportif. En réalité, il s’agit d’un masque de deuxième génération que tout le monde pourra utiliser. Je pense notamment aux métiers du bâtiment ou aux métiers où l’on parle beaucoup. C’est un masque qui protégera aussi efficacement que les anciens masques contre le virus tout en permettant une respiration plus facile. Nous misons sur ce masque pour que les adultes ou les enfants puissent reprendre le sport en intérieur.
Dans le cadre de l’éducation physique et sportive, ou EPS, lorsque les enfants demeurent dans le même groupe, dans la même classe, il est déjà possible de reprendre une activité sportive. L’arrêt de la pratique pour les enfants depuis le 15 janvier dernier était un élément d’inquiétude pour le Gouvernement.
Si la pratique libre est envisageable pour les adultes, qui peuvent courir et faire leur jogging seuls, elle est plus difficile pour les enfants, qui ont besoin de l’encadrement des éducateurs sportifs et des bénévoles des associations. Ces derniers, qui font de la pédagogie autour de la crise sanitaire, sont les relais du Gouvernement pour faire respecter le protocole. Au travers des enfants, ils font aussi passer des messages aux adultes et aux parents.
La reprise se dessine avec un échéancier bien précis. Les enfants, dans le cadre associatif et périscolaire de l’exercice d’une pratique sportive à l’intérieur, sont maintenant le public prioritaire. Aujourd’hui, les adultes et les enfants sont autorisés à pratiquer un sport, mais uniquement à l’extérieur. Nous incitons d’ailleurs toutes les associations indoor à se rapprocher de celles qui pratiquent en extérieur. Nous demandons également aux collectivités de mettre à disposition des associations leurs équipements sportifs d’extérieur, les cours d’école et leurs espaces publics municipaux afin qu’elles puissent déployer à l’extérieur leur savoir-faire.
Je ne vous cache pas que le fait d’avoir repoussé d’une heure le couvre-feu est une source de motivation supplémentaire par rapport à cet espace de liberté qu’est le sport – c’est ainsi que vous l’avez qualifié et nous en sommes d’accord. Tout cela nous incite à privilégier la pratique sportive jusqu’à dix-neuf heures, après le travail ou l’école.
Nous solliciterons les collectivités et nous leur demanderons, grâce à la mise en place d’une aide financière via une ligne spécifiquement dédiée à l’Agence nationale du sport, d’ouvrir dès maintenant les équipements d’été, par exemple les piscines. J’ai besoin que vous passiez ce message aux collectivités avec lesquelles vous êtes en lien. Le Gouvernement soutiendra le fonctionnement de ces équipements sportifs d’extérieur pour permettre des ouvertures en avance de phase.
Nous voulons découvrir dès à présent des terrains de tennis ou des piscines pour offrir un maximum d’espace à ces associations, qui déploient déjà, depuis le début de la semaine, des activités à l’extérieur pour leurs adhérents.
Nous sommes conscients que la crise est difficile dans le champ sportif comme elle l’est dans d’autres secteurs d’activité. C’est pourquoi le Gouvernement a débloqué un certain nombre d’aides. Vous en avez cité quelques-unes, je les rappelle toutefois.
Depuis le début de la crise, toutes les associations ont pu profiter des mêmes aides que les entreprises. À partir du moment où elles avaient des salariés, elles ont pu bénéficier du fonds de solidarité de la direction générale des finances publiques, la DGFiP, à hauteur de 10 000 euros par mois, et du chômage partiel.
Les associations qui n’ont pas d’employés et qui ne fonctionnent que grâce au bénévolat ont, plus spécifiquement, eu accès à deux enveloppes de 15 millions d’euros – une l’année dernière et une cette année – via le budget de l’Agence nationale du sport : 8 000 associations sportives ont bénéficié de ce fonds d’urgence. Cela peut paraître peu, comparé aux 380 000 associations sportives en France, mais il faut savoir que l’État, en temps normal, n’accorde de subventions qu’à 20 000 associations.
À l’heure actuelle, en effet, l’État n’est pas le principal financeur des associations : il finance l’emploi, il finance en partie les équipements sportifs dans les territoires, il finance partiellement les associations. Quoi qu’il en soit, 8 000 associations, ce n’est pas rien par rapport aux 20 000 associations financées habituellement. Je crois donc que nous avons rempli notre part du contrat !
Nous avons souhaité trouver un équilibre entre l’aide apportée au secteur amateur et l’aide apportée au secteur professionnel. Nous y sommes parvenus, puisque nous avons débloqué 107 millions d’euros pour compenser la perte de billetterie due au huis clos. Une deuxième vague d’aide est aujourd’hui en discussion avec Bercy ; elle sera débloquée prochainement pour soutenir les clubs.
Ce sont des aides considérables, puisque certains clubs ont pu toucher jusqu’à 5 millions d’euros de compensations. Tous les sports qui accueillent habituellement du public ont été concernés, qu’il s’agisse du football, du rugby, du handball, du basket, du volley ou du hockey sur glace : ils ont été aidés à la hauteur de leurs besoins et des pertes qu’a entraînées ce huis clos. Nous continuerons de les aider.
Comme dans tous les autres secteurs d’activité, nous n’avons pas pu aller jusqu’à un remboursement de 100 % des pertes. La compensation a été plafonnée, à l’instar de ce qui a été prévu pour les magasins et les restaurants. En tout état de cause, le secteur du sport n’a pas été traité différemment des autres. Au contraire, il a bénéficié, d’une part, des aides de droit public et, d’autre part, de l’aide spécifique du ministère des sports.
Le plan de relance prévoit des aides supplémentaires, à hauteur de 50 millions d’euros, en faveur de la rénovation des équipements sportifs – il revient aux collectivités de soumettre ces projets aux préfets de région. Un autre budget spécifique de 30 millions d’euros sera consacré aux équipements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).
Nous aiderons également, grâce au Pass’Sport, les Françaises et des Français les plus en difficulté financièrement à prendre des licences à la rentrée. Nous sommes très attachés à ce dispositif.
Vous m’avez interrogé sur le public bénéficiaire. Il concerne les enfants âgés de 6 à 16 ans, voire à 20 ans pour les jeunes en situation de handicap. Cette mesure concernera environ 2 millions de Français. Encore une fois, cette aide de 100 millions d’euros viendra compléter les mesures déjà mises en place par les collectivités pour faciliter les adhésions à un club sportif.
Le cofinancement existait bien avant la crise. Il a été structuré différemment par la nouvelle gouvernance du sport afin d’être au plus près des besoins des citoyens et des territoires. À l’heure actuelle, y compris dans la gestion de cette crise, nous voulons travailler main dans la main avec les collectivités.
Les associations et leur survie ne concernent pas que l’État, elles concernent également les villes et l’ensemble des citoyens. Le Gouvernement répondra présent pour soutenir le sport amateur et les structures associatives.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je compte sur vous et sur votre engagement en faveur du sport et des associations sportives. Il importe que nous puissions travailler ensemble sur les thématiques relatives au mouvement sportif soulevées dans le cadre de cette proposition de loi. Il reste encore des modifications à apporter, ainsi que des concertations à mener avec le monde fédéral et le monde professionnel.
Tout comme vous, je suis très attachée à la régulation du modèle économique du sport. Je suis également très attachée à la solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel. Ayant été moi-même sportive de haut niveau, je connais le parcours et le circuit que suit tout sportif qui « naît » dans une association. Cette dernière l’aide à devenir quelqu’un, à trouver sa place dans la société. J’en suis d’autant plus consciente que je ne suis pas Française d’origine. Le sport m’a permis de trouver ma place en France, il m’a enseigné ce qu’étaient la République et ses valeurs, et m’a permis d’y adhérer. Je ne méconnais donc pas le rôle du sport de ce point de vue.
Le sport ouvre vers des métiers, vers une carrière de sportif, il permet de s’exprimer professionnellement peut-être plus tôt que dans d’autres secteurs. Il faut encourager les talents et la pratique sportive. Il faut surtout soutenir cette dernière dans les moments de difficulté, c’est ce que nous faisons en collaboration, encore une fois, avec les territoires, les mouvements sportifs et toutes les entreprises, qui sont aussi convaincues que le sport est essentiel au bien-être physique et psychologique des Français.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie encore de la tenue de ce débat. J’espère avoir prochainement l’occasion de discuter de nouveau de sport avec vous !
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC.

Nous en avons terminé avec le débat sur le thème : « Quelle perspective de reprise pour une pratique sportive populaire et accessible à tous ? »

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 25 mars 2021 :
À quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
Débat sur le thème « Veolia-Suez : quel rôle doit jouer l’État stratège pour protéger notre patrimoine industriel ? » ;
Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste (texte de la commission n° 468, 2020-2021) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (texte de la commission n° 473, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures quarante.
La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. François-Noël Buffet, Marc-Philippe Daubresse, Étienne Blanc, Loïc Hervé, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Hussein Bourgi et Thani Mohamed Soilihi ;
Suppléants : Mme Brigitte Lherbier, M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacky Deromedi, Françoise Gatel, MM. Jean-Yves Leconte, Jean-Yves Roux et Mme Éliane Assassi.