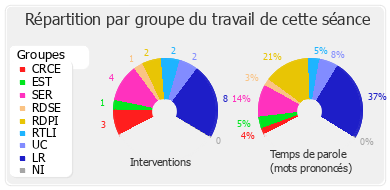Séance en hémicycle du 1er février 2022 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande de la mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et leurs incidences, sur les conclusions du rapport Mieux protéger notre patrimoine scientifique et nos libertés académiques.
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je rappelle que la mission d’information dispose d’un temps de présentation de huit minutes, le Gouvernement lui répondant pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, la mission d’information disposera d’un droit de conclusion de cinq minutes.
Dans le débat, la parole est M. André Gattolin, rapporteur de la mission d’information qui a demandé ce débat.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quatre mois après l’adoption du rapport de la mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français, je suis heureux que les conclusions de nos travaux fassent, ce soir, l’objet d’un débat public avec le Gouvernement.
Avant d’en venir aux constats et aux principales recommandations de la mission, je tiens tout d’abord à remercier mon groupe, le Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, qui a accepté de consacrer son droit de tirage à ce sujet.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement chacun des membres de cette mission de sa participation, en me félicitant de l’adoption à l’unanimité de ce rapport, tout particulièrement le président Étienne Blanc, dont la rigueur et l’ouverture d’esprit nous ont permis d’œuvrer ensemble dans une totale relation de confiance.
Enfin, madame la ministre, je vous remercie de votre présence parmi nous. Vous aviez accepté que vos services apportent leur contribution à nos travaux et vous nous avez livré plusieurs pistes de réflexion, dont certaines ont nourri nos recommandations.
L’intérêt de ce débat est à présent de vous entendre sur les suites que vous entendez leur donner. J’ai la conviction sincère que ce rapport a déjà fait bouger des lignes. Sur un sujet encore peu documenté en France, il aura au moins contribué à alerter assez largement sur un phénomène longtemps ignoré dans notre pays : celui des influences et des ingérences étrangères qui menacent notre patrimoine scientifique et nos libertés académiques.
Lorsque nos travaux ont commencé, en juillet 2021, nous nous sommes appuyés sur des exemples étrangers, plutôt alarmants, notamment dans les pays anglo-saxons. En effet, les mondes académiques australien et britannique sont depuis plusieurs années en première ligne, notamment, il faut bien le dire, en raison de leur dépendance aux droits d’inscription des étudiants étrangers et des éventuelles pressions exercées par les pays dont ceux-ci sont originaires.
Il peut s’agir du contrôle des diasporas, de la censure qui s’exerce sur les chercheurs, du façonnage de l’image ou de la réputation d’un État en assurant la promotion d’un « narratif » officiel par l’instrumentalisation des sciences humaines et sociales.
Il faut noter que, dans ces États, c’est sous l’impulsion de leurs parlements, avec lesquels nous avons beaucoup échangé, que les universités et les gouvernements ont commencé à étudier la mise en œuvre d’un cadre juridique et de lignes directrices pour protéger leur enseignement supérieur et leur recherche.
Qu’en est-il de la situation en France ?
Notre premier constat est celui d’une menace bien réelle, mais encore largement sous les radars. Le monde académique français se caractérise par sa culture d’ouverture et par son niveau d’excellence. Ce qui fait de notre pays une cible de choix, c’est bien sûr le haut niveau de notre recherche scientifique – la France figure au troisième rang du classement de Shanghai –, mais aussi, malheureusement, le relatif manque de moyens de sa recherche, tant publique que privée.
Lors des auditions, il nous a été rapporté plusieurs exemples préoccupants d’ingérence, mais seulement dix cas jugés sérieux ont, semble-t-il, fait l’objet d’un signalement en 2020.
L’identification des tentatives d’influence reste cependant assez problématique : celle-ci est peu organisée et ne fait pas l’objet d’un recensement exhaustif.
Autre phénomène inquiétant et qui demeure largement hors des radars : celui de l’autocensure croissante des chercheurs, par crainte de mesures de représailles – je pense ici notamment au chantage au visa ou à l’interdiction d’accès à certaines sources.
Notre second constat concerne notre dispositif de protection de la recherche, qui demeure insuffisamment connu au sein même des institutions universitaires et académiques.
Pourtant, il existe bel et bien un dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation tout à fait structuré et organisé, qui s’articule entre, d’une part, le Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’enseignement supérieur, et, d’autre part, le réseau des fonctionnaires de sécurité et de défense désignés au sein de chaque établissement.
Toutefois, ces différents échelons nous sont apparus peu connus des principaux intéressés, à savoir les chercheurs, et insuffisamment coordonnés.
Par ailleurs, le dispositif actuel de protection se limite au domaine des sciences et technologies, et sur des niveaux de risques particulièrement élevés. De fait, les menaces qui pèsent sur les sciences humaines et sociales sont exclues de la vigilance et de la chaîne de remontée d’information vers le ministère. Cela explique l’incapacité actuelle à fournir un état des lieux et une cartographie exhaustive du problème.
Venons-en à présent nos principales recommandations.
Compte tenu du temps qui m’est imparti, j’irai à l’essentiel des objectifs majeurs que nous avons identifiés, qui se déclinent en vingt-six propositions.
Le premier objectif est de promouvoir la question des interférences étrangères au rang de priorité politique. C’est une étape indispensable, à notre sens, pour dresser un état des lieux et surtout coconstruire avec le monde universitaire des réponses adaptées. Il est essentiel que les réponses et les procédures à mettre en œuvre soient largement acceptées par le monde universitaire, soucieux de son indépendance et de son autonomie.
Nous préconisons la constitution d’un comité scientifique, prenant la forme d’un « Observatoire des influences étrangères et de leurs incidences sur l’enseignement supérieur et la recherche ». Il associerait universitaires et spécialistes des ministères pour élaborer une étude scientifique de référence récurrente sur l’état des menaces constatées en France.
Le deuxième objectif est d’aider les universités à protéger leurs valeurs de libertés académiques et d’intégrité scientifique dans le respect de leur autonomie. Il ne s’agit nullement de brimer la recherche ou de décourager les partenariats, mais d’ériger, au niveau national, la transparence et la réciprocité en principes cardinaux de toute coopération universitaire internationale.
Enfin, il nous faut promouvoir aux niveaux national et international – en particulier au niveau européen – l’adoption d’un référentiel de normes et de lignes directrices pour encadrer la compétition toujours plus forte qui s’établit au détriment de l’Europe dans le domaine de la recherche et de la propriété intellectuelle.
Pour conclure, je veux indiquer que ce rapport n’a pas épuisé le sujet. C’est un « rapport vigie » destiné à alerter la communauté universitaire et les pouvoirs publics.
Nos travaux ont été très largement relayés dans la presse française. À l’étranger, une vingtaine de sites d’information turcs ont lancé une campagne de presse très virulente contre une chercheuse qui avait accepté de témoigner devant la mission sur des tentatives d’intimidation. Nous avons dû alors effectuer un signalement au Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Enfin, ce rapport a contribué à accélérer le calendrier de plusieurs ministères sur le sujet des ingérences étrangères.
Le Premier ministre a ainsi lancé une mission interministérielle, tandis que le ministère de l’intérieur, à travers la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le ministère des affaires étrangères, ainsi que l’inspection générale de l’enseignement supérieur et de la recherche (IGESR) se sont beaucoup intéressés à notre rapport.
Je gage, madame la ministre, que votre ministère s’est également emparé du sujet et qu’il mettra en œuvre les mesures appropriées.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes SER et UC.
Madame la présidente, monsieur le président de la mission d’information, cher Étienne Blanc, monsieur le rapporteur, cher André Gattolin, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet été, sur l’initiative du groupe RDPI, le Sénat a décidé de consacrer une mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde académique.
C’est une question évidemment cruciale et, à cet égard, permettez-moi de me réjouir que nous puissions avoir ce débat en séance publique au Sénat, tant la question qui est posée est déterminante à la fois pour notre souveraineté et nos libertés.
La recherche et l’enseignement supérieur sont par essence ouverts sur l’international, et la science ne doit pas connaître de frontière. Pour autant, les établissements d’enseignement supérieur et le monde académique sont au cœur d’échanges internationaux nombreux. Cette richesse, nous devons la développer avec ambition, mais sans naïveté face à d’éventuelles menaces. C’est également vrai s’agissant de l’innovation, avec un enjeu supplémentaire : celui de la compétition économique internationale.
Nos établissements sont désormais beaucoup plus visibles sur les radars d’acteurs dont les intentions ne sont pas conformes à nos valeurs, ce qui doit nous inciter à une plus grande vigilance.
L’organisation de la surveillance et la prévention des éventuelles influences étatiques étrangères au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est articulée avec la structuration des acteurs qui en constituent le paysage. Des acteurs de l’administration centrale sont chargés de la stratégie et de la vigilance, qui se déclinent au sein de chaque établissement et opérateur autonome dans sa gouvernance, avec l’ensemble des acteurs territorialement compétents.
On ne saurait prétendre protéger notre potentiel et notre patrimoine scientifiques sans y associer pleinement les chercheurs et les enseignants-chercheurs eux-mêmes, qui doivent s’approprier ces enjeux et être, à leur niveau, acteurs de la préservation tant des établissements que des activités de recherche et d’enseignement.
L’intégrité scientifique constitue un formidable levier en la matière. C’est pourquoi notre action a aussi porté sur cette dimension.
Grâce aux remontées spontanées des chercheurs, des directeurs de laboratoire ou des 160 fonctionnaires de sécurité et de défense (FSD) ou FSD adjoints, le ministère est constamment informé des principales interactions internationales, ainsi que des éventuelles menaces et risques d’ingérence qui pourraient affecter l’écosystème de l’enseignement supérieur.
Le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation est piloté par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Il vise à protéger les savoirs, les savoir-faire et les technologies les plus sensibles des établissements localisés sur le territoire national.
Nous sommes également acteurs du dispositif de gouvernance interministérielle de la politique de sécurité économique, au travers notamment du comité de liaison en matière de sécurité économique (Colisé).
Régionalement, l’accompagnement des référents et l’animation de ce réseau sont copilotés par les délégués à l’information stratégique et à la sécurité économiques (Disse) et les délégués régionaux académiques à la recherche et à l’innovation (Drari).
Le déploiement de ces dispositifs se poursuivra en 2022 au sein des pôles de compétitivité, puis dans toutes les autres structures d’écosystèmes de valorisation de l’innovation.
Au-delà des structures, le Gouvernement est animé d’une ferme volonté : renforcer le dispositif de protection de notre potentiel scientifique et notre souveraineté dans les technologies clés, et cela dans tous les champs qui bénéficient d’un soutien financier de l’État.
Certains financements publics sont désormais explicitement soumis à la prise en compte des impératifs de souveraineté nationale face aux risques d’ingérence. Tel est le cas, par exemple, des soutiens aux projets de France Relance. La protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST) est également une exigence pour la mise en œuvre des programmes prioritaires de recherche du programme d’investissements d’avenir (PIA).
Qu’il s’agisse de la recherche ou de l’enseignement supérieur, nous avons poursuivi et amplifié ce travail depuis la publication du rapport de votre mission d’information.
Tout d’abord, la circulaire du Premier ministre du 11 octobre 2021, relative au renforcement de la transparence des actions d’influence étrangère conduites auprès des agents publics de l’État, a été relayée auprès de chaque établissement.
Ensuite, le 28 janvier dernier, les modalités pratiques de communication au ministère des projets d’accords de partenariats internationaux des établissements d’enseignement supérieur français ont été rappelées et réaffirmées à tous les chefs d’établissement et présidents d’organisme de recherche par voie de circulaire.
Affirmer ces règles, établir des process et des procédures est une chose ; les faire vivre et permettre aux acteurs de se les approprier est un autre travail. Nous le conduisons notamment avec la DGSI, dans le cadre de sa mission de sécurité économique.
Ainsi, un certain nombre de préconisations établies conjointement ont été adressées aux établissements, assorties d’exemples pratiques permettant à chacun de mieux identifier et comprendre les tentatives d’ingérence ou les points de vulnérabilité constatés. Il s’agit là de réponses opérationnelles face aux risques d’influence et d’ingérence étrangères.
En cohérence avec la réaffirmation des priorités gouvernementales, nous avons aussi porté une attention toute particulière aux enjeux de sécurité numérique.
Un travail conjoint avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) et le ministère de l’éducation nationale nous a permis de nous doter d’une feuille de route stratégique et opérationnelle dans le domaine de la sécurité numérique. Un comité stratégique de sécurité numérique sera ainsi installé au cours de ce mois de février.
J’ai récemment rencontré le directeur général de l’Anssi pour traiter avec lui de l’état de la menace cyber et lui exposer les avancées du ministère dans la réponse aux risques y afférents. De son côté, il est intervenu au début de cette année devant l’ensemble des recteurs et des délégués régionaux académiques à la recherche et à l’innovation (Drari). Nous le savons : une réponse appropriée aux risques passe nécessairement par une compréhension commune des enjeux et implique donc des actions de sensibilisation sur le terrain.
Lors de mon audition, j’ai aussi évoqué la désignation de référents de sécurité économique par le président de chaque société d’accélération du transfert de technologies (SATT). Ces nominations sont désormais effectives.
Enfin, la protection de notre potentiel scientifique n’est évidemment pas d’ordre strictement national : c’est un véritable enjeu de souveraineté européenne, qui suppose une cohérence communautaire. À cet égard, la Commission européenne a présenté le 18 janvier dernier une boîte à outils à destination de l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de l’Union européenne. Il s’agit, une nouvelle fois, de les aider à se prémunir des influences étrangères.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris : le sujet traité par votre mission d’information est pris au sérieux, non seulement en France, par l’ensemble des autorités de l’État, mais à l’échelle européenne. Cette question fait l’objet de travaux continus, et je tiens à féliciter la Haute Assemblée, qui, par ce rapport, a mis en lumière un enjeu majeur pour notre souveraineté et le respect de nos valeurs.
M. Julien Bargeton applaudit.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question et son éventuelle réplique.
Le Gouvernement dispose pour répondre d’une durée équivalente. Il aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de répondre à une réplique pendant une minute. L’auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute.
Dans le débat interactif, la parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, certaines vérités sont d’une évidence telle que l’on a tendance à les oublier. Ce soir, je tiens à rappeler l’une d’elles : il n’y a pas de grande nation qui ne soit une nation scientifique.
Nombre d’entre nous en sont convaincus dans cet hémicycle : pour une large part, la souveraineté d’une nation se fonde sur ses performances scientifiques, c’est-à-dire sur sa capacité à découvrir, à créer des savoirs, à les transmettre, à les convertir en atouts économiques et en innovations industrielles.
La mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français, à laquelle j’ai eu l’honneur de participer, l’a rappelé, et je remercie son rapporteur, André Gattolin, d’avoir placé ce sujet stratégique au cœur de nos débats.
L’un des nombreux volets abordés me tient particulièrement à cœur : mieux protéger notre patrimoine scientifique et nos libertés académiques, c’est avant tout mieux valoriser la recherche et les chercheurs.
La recherche doit redevenir la filière d’excellence qu’elle était, sans quoi nous financerons sur les deniers publics les futures innovations industrielles des États-Unis et de la Chine. Mais elle ne doit surtout pas devenir une autoroute, imposant un sens unique et n’offrant que de rares sorties. Au carrefour des universités, des laboratoires et des industries, la recherche se protège aussi en devenant un tremplin vers l’entrepreneuriat et le marché.
À cet égard, la loi de programmation de la recherche (LPR) a fixé un cadre ambitieux. Elle renforce l’attractivité de la recherche en rehaussant les rémunérations et en donnant aux chercheurs des moyens plus importants pour conduire leurs travaux.
Madame la ministre, le chemin tracé me paraît bon. Nous devons désormais nous y engager à vive allure, et encore plus massivement, pour rester dans la course. Au-delà des crédits votés, quels indicateurs avez-vous mis en place pour évaluer l’attractivité des métiers de la recherche, à court et moyen termes ?
Madame la sénatrice Paoli-Gagin, vous avez raison : nous devons réinvestir en faveur d’une recherche d’excellence, pour transformer ses résultats dans le domaine de l’innovation au bénéfice de la société tout entière. C’est précisément l’un des objectifs de la connaissance : améliorer, grâce au progrès, les conditions de vie de chacun.
Vous avez mentionné les crédits prévus à cette fin par la loi de programmation de la recherche. S’y ajoutent les fonds du plan France Relance. D’ailleurs, pas plus tard que cette après-midi, j’assistais au côté du Premier ministre à l’installation du comité de suivi du plan France 2030.
Ce comité associe l’ensemble des parties prenantes, qu’il s’agisse des parlementaires, bien entendu, des responsables d’entreprises ou encore des collectivités territoriales : c’est ensemble que nous devons reconstruire notre souveraineté économique et industrielle, en la fondant sur la recherche.
En parallèle, il faut creuser beaucoup plus en profondeur la question des compétences.
Bien sûr, le sujet de l’évaluation a été abordé à cette occasion. Quand on parle d’innovation, on ne saurait présupposer que l’échec est forcément négatif : au contraire, il faut le considérer comme une expérience. Nous développons d’ores et déjà l’esprit d’entreprise chez les jeunes étudiants via le plan « L’esprit d’entreprendre ». Nous devons évidemment continuer à le soutenir.
Notre nation est déjà scientifiquement forte : en matière de recherche et d’enseignement supérieur, la France figure au troisième rang mondial. Toutefois, plus nous serons forts, …
… plus nous risquons d’être la cible d’ingérences, dont nous devons nous prémunir.

Madame la ministre, les élus de notre groupe ont récemment lancé une mission d’information sur un sujet connexe.
Il s’agit de mieux documenter ce paradoxe si français : comme vous l’avez rappelé, notre recherche est excellente, mais nous n’avons que trop peu de nouveaux champions économiques européens ou mondiaux.

En matière d’ingérence étrangère, nous connaissons depuis longtemps l’espionnage industriel et économique, avec les nombreuses techniques de captation d’information sur lesquelles il se fonde. Nous disposons d’ailleurs d’un certain nombre d’exemples récents.
En revanche, les stratégies d’influence dans le monde universitaire sont plus insidieuses et n’ont encore été que peu analysées. Avant tout, je me félicite que le Sénat se soit saisi de ce sujet, qui représente un enjeu de taille pour notre pays. Le rapport de notre mission d’information l’a confirmé, et je saisis cette occasion pour remercier nos collègues Étienne Blanc et André Gattolin de leur travail de qualité.
Nous sommes face à une menace réelle, reposant sur des stratégies nouvelles et planifiées à long terme.
Nos établissements d’enseignement supérieur, notamment nos universités, obéissent aussi à un objectif d’ouverture et de rayonnement international. Or ils ne semblent pas suffisamment armés face aux pratiques de désinformation, de propagande ou d’intimidation.
Madame la ministre, lors de votre audition devant notre mission d’information, vous avez souligné que plusieurs dispositifs existaient, et c’est exact. Vous avez notamment mentionné les fonctionnaires de sécurité et de défense (FSD) désignés au sein de chaque établissement, ainsi que les collaborations entre les responsables des universités et le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) pour l’instruction des partenariats.
Toutefois, le rapport de la mission d’information montre clairement la mauvaise coordination de tous ces acteurs et la nécessité de former l’ensemble de la communauté académique face aux risques liés aux influences extra-européennes.
Aussi, pouvez-vous nous dire s’il est possible d’envisager un dispositif spécifique et, surtout, coordonné pour former non seulement les membres des instances de gouvernance universitaire, mais aussi les doyens, les directeurs de laboratoires et même l’ensemble des chercheurs ?
Monsieur le sénateur Piednoir, vous soulignez avec raison l’une des conclusions majeures de la mission d’information : les relais existent, mais leur coordination reste à améliorer.
Il est essentiel de mettre en réseau tous les fonctionnaires de sécurité de défense avec le HFDS ; il est tout aussi nécessaire que le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale (SGDSN) travaille en lien étroit avec l’Anssi.
J’ai évoqué les cyberattaques. À ce titre, nous travaillons précisément avec le SGDSN et avec l’Anssi pour concevoir des formations communes dispensées en cascade, en commençant par les chefs et responsables d’établissement et en poursuivant avec l’ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs. En effet, ce sont eux qui, en général, noueront des contacts avec les homologues : ce sont donc eux qui, les premiers, pourront déceler des attitudes inamicales, en tout cas s’interroger sur la réciprocité des collaborations scientifiques engagées.
Enfin, votre mission d’information préconise une meilleure prise en compte des sciences humaines et sociales. Il faut le reconnaître : pour l’heure, on s’attache essentiellement à la protection scientifique et technologique. Or, vous le rappelez avec raison, à l’instar de M. Gattolin, ces influences peuvent aussi s’exercer par le biais d’intimidations dont sont victimes les sciences humaines. Nous avons attiré l’attention du HFDS et des FSD sur ce point.

La mission d’information sur les ingérences étatiques extra-européennes à l’université a eu le mérite d’explorer un nouveau champ de réflexion pour l’action gouvernementale : la protection des universités contre ces manœuvres.
Les mots ont un sens, tout particulièrement celui d’« ingérence ». Notre rapporteur l’a clairement rappelé, il s’agit là d’une zone grise entre, d’une part, l’influence, laquelle est parfois légitime, et, de l’autre, l’intrusion, la captation, le vol ou la trahison, qui sont, eux, déjà sévèrement punis par notre droit national.
C’est de cet entre-deux que le danger semble provenir. Si le Gouvernement se décide à contrer ces dérives, il devra suivre une ligne de crête entre protection de notre souveraineté et préservation des libertés académiques.
En effet, ces libertés sont une richesse pluriséculaire de notre pays. Nos universités ont tout loisir de nouer des partenariats et de dialoguer scientifiquement avec les établissements d’autres pays. Elles sont autant de ponts qui relient les cultures ; elles constituent les vecteurs de notre influence nationale et de l’enrichissement du patrimoine scientifique mondial. Cette richesse doit être préservée.
Madame la ministre, voilà pourquoi il me semble important de ne pas surréagir : il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal.
À cet égard, j’attire votre attention sur la vingtième préconisation de notre rapport : soumettre les projets d’accords internationaux des universités à l’avis des ministères concernés. J’insiste sur ce point : il s’agirait d’un avis simple et non d’une autorisation. C’est un impératif si l’on ne veut pas rogner un certain nombre de libertés, fondamentales pour notre pays.
Dès lors, ma question est simple. Si une politique gouvernementale est indispensable en la matière, quelles garanties pouvez-vous nous donner qu’elle ne se traduise pas, dans les faits, par le renforcement du contrôle de l’État sur les universités ?
Pour ce qui concerne les sciences humaines et sociales, les propos tenus en début d’après-midi par votre collègue Sarah El Haïry comme par les membres du groupe Les Républicains ne m’ont pas rassuré : on peut bel et bien craindre que l’État n’entreprenne de soutenir une recherche autorisée, face à une autre jugée déviante.
Monsieur le sénateur Dossus, je tiens à vous rassurer : l’avis simple est d’ores et déjà la règle.
Chaque fois qu’un établissement souhaite signer un accord de coopération avec un autre établissement, il le signale au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. La plupart du temps, cette procédure ne pose aucune difficulté, si bien que le projet d’accord ne reçoit pas de réponse à ce titre.
J’ajoute que la mention d’une difficulté n’est en aucun cas synonyme d’interdiction. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pointe simplement le risque auquel un tel accord nous expose ; mais en aucun cas il ne prononce une autorisation ou une interdiction, et c’est bien normal.
Les collaborations entre chercheurs ne faisant pas l’objet d’une convention entre établissements sont encore plus libres : elles se nouent au gré des rencontres, lors de colloques, d’écoles d’été, ou encore à la faveur de relations interpersonnelles.
C’est pourquoi il est très important de former jusqu’à la base les chercheurs et les enseignants-chercheurs : personne n’a intérêt à voir de telles ingérences prospérer.
Un grand nombre de chercheurs reçus au titre des programmes d’accueil aux scientifiques en exil nous décrivent les pressions qu’ils peuvent subir dans leur pays. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), nous consacrerons d’ailleurs, à Marseille, deux journées de travail aux moyens permettant de préserver les libertés académiques, de soutenir les échanges universitaires et la diffusion de la connaissance. Il est bel et bien essentiel de s’assurer que les partenariats conclus obéissent à un esprit de réciprocité et respectent nos valeurs.
S’ils prennent pleinement conscience de ces risques, les chercheurs et les enseignants-chercheurs seront les mieux placés pour s’en prémunir : en ce sens, je le répète, les formations ont toute leur importance.

M. Pierre Ouzoulias. Mes chers collègues, en début d’après-midi, nous avons débattu du woke. À présent, nous en venons aux ingérences chinoises à l’université : je perçois une certaine continuité dans l’ordre du jour du Sénat !
Sourires.

Madame la ministre, André Gattolin le souligne dans le rapport qu’il a établi au nom de notre mission d’information, la fragilité du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche peut provenir d’une trop grande dépendance des institutions aux financements fournis par les droits d’inscription des étudiants étrangers et par les relations avec des entreprises dont l’origine des fonds n’est pas toujours connue avec précision.
Vous connaissez ma passion pour le classement de Shanghai… §Les services que nous avons auditionnés – vous devinez à qui je fais référence – nous l’ont certifié : de toute évidence, il s’agit là d’un outil de repérage et de ciblage destiné à recueillir les informations les plus intéressantes.
La modicité des droits d’inscription et l’octroi de financements publics annuels assurés sont des outils forts pour protéger notre indépendance. Le modèle de l’université à la française, que l’on déclare souvent dépassé ou archaïque, pourrait donc être un outil majeur au service de notre souveraineté nationale.
Dès lors, je vous propose cette formule : remplacer le classement de Shanghai par le classement Leclerc de l’indépendance nationale !
Sourires.
Monsieur le sénateur Ouzoulias, j’ai plusieurs fois eu l’occasion de rappeler l’origine de ce classement, créé à Shanghai par l’université Jiao Tong à la demande du gouvernement chinois : ce dernier entendait mesurer l’effet des investissements massifs qu’il s’apprêtait alors à consentir en faveur de la recherche et de l’enseignement supérieur sur la visibilité des universités chinoises.
Dès lors qu’un tel classement devient mondial, suivre la progression des universités chinoises, c’est scruter l’évolution de l’ensemble des universités retenues dans ce cadre.
Évidemment – c’est d’ailleurs un combat que je mène à l’échelle européenne –, nous devons préserver notre système universitaire, majoritairement financé par des fonds publics.
Je puis parler du cas français en connaissance de cause : plus des trois quarts, et même généralement près de 80 %, des financements de nos universités proviennent de l’État, auxquels s’ajoutent les financements des collectivités territoriales, les ressources liées à la formation continue et à l’apprentissage. Si des financements privés sont apportés, ils passent par le biais de fondations extérieures aux établissements, lesquelles disposent d’une comptabilité particulière et sont soumises à des contrôles spécifiques.
Bien sûr, ce modèle nous protège. En revanche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs eux-mêmes restent parfois quelque peu naïfs quant aux liens interpersonnels qu’ils peuvent nouer avec leurs collègues. À ce titre, ils doivent conserver une vue d’ensemble : c’est tout le sens de ce rapport sénatorial, et ce sera l’objet de l’information qui leur sera adressée.

Madame la ministre, à l’instar de mon collègue André Gattolin, j’en suis convaincu : il faut absolument promouvoir un autre classement dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.
Un tel outil permettrait de mesurer précisément, d’une part l’intégrité scientifique, de l’autre la qualité de l’expertise : il faut s’assurer que cette dernière est dégagée de tout conflit d’intérêts.

Madame la ministre, l’excellent rapport établi par notre collègue André Gattolin, au nom de la mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français, met en lumière les travaux du chercheur Antoine Bondaz. Ce dernier a souligné la priorité donnée en Chine, depuis les années 2010, à l’intégration civilo-militaire. Il met l’accent sur les échanges d’informations entre les laboratoires chinois de recherche civile et leurs équivalents militaires.
Dans le rapport qu’il a consacré, l’an dernier, aux opérations d’influence chinoises, l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire (Irsem) relève que de nombreuses universités civiles chinoises contribuent à la recherche militaire, voire à certaines activités : « Au moins quinze universités civiles ont été impliquées dans des cyberattaques, des exportations illégales ou de l’espionnage. » C’est Xi Jinping lui-même qui préside la commission centrale pour le développement de la fusion civilo-militaire !
L’entreprise des technologies de l’information et de la communication Huawei a ouvert en France six centres de recherche de pointe. En 2018, cette société a déposé un brevet pour une technologie permettant d’identifier des personnes d’origine ouïghoure. Or les doctorants, qui, pour certains, relèvent de conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre), signent une clause de confidentialité au profit de l’entreprise.
Quels garde-fous a-t-on prévus pour que les universités et les chercheurs entretenant des liens avec la Chine ne puissent contribuer à des applications militaires ou à l’élaboration de technologies de surveillance, de contrôle et d’oppression de la population chinoise ?
Enfin, lors de votre visite à Shanghai en 2018, vous aviez été informée de la coopération stratégique engagée entre l’Institut Pasteur de Shanghai et le laboratoire P4 de l’institut de virologie de Wuhan. Le P4 jouit désormais d’une notoriété mondiale, puisqu’il est au centre des interrogations sur les origines du virus de la covid-19.
Qu’a décidé, à l’époque, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation quant à la suite de ces coopérations ? Ces dernières se poursuivent-elles ?
Monsieur le sénateur Cadic, tout d’abord, il faut garder à l’esprit que, lorsque vous vous rendez en Chine pour rencontrer des responsables d’université, notamment leurs présidents, ils sont toujours accompagnés d’un membre du parti.
Sourires.
La liberté académique n’y est pas tout à fait conçue dans les mêmes termes qu’en Europe ; c’est une réalité.
Je vous le confirme, un certain nombre d’universités civiles chinoises sont impliquées dans les dossiers militaires. Mais, de même, plusieurs laboratoires de nos universités concluent des contrats avec l’armée. La recherche duale existe aussi en France, par exemple au Centre national d’études spatiales (CNES), comme dans de très nombreux pays.
Il s’agit évidemment d’un champ extrêmement protégé et surveillé. D’ailleurs, dans les universités, les premières zones à régime restrictif (ZRR) ont été créées pour les laboratoires dédiés à la recherche duale.
Vous évoquez également les Cifre, qui peuvent être passés avec des entreprises. Un référent sécurité s’y consacre tout particulièrement au sein de l’association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT). De plus, l’avis du haut fonctionnaire de sécurité et de défense est sollicité en amont, lorsque les bourses Cifre soulèvent telle ou telle interrogation. Tous les travaux sensibles sont bien sûr pris en compte au titre de la PPST.
L’Institut Pasteur de Paris collabore avec l’Institut Pasteur de Shanghai et le P4 de Wuhan n’a rien à voir avec lui. À l’origine, une coopération visant à former les personnels du P4 de Wuhan a été menée avec le P4 de Lyon. Toutefois, faute de réciprocité, elle s’est éteinte d’elle-même. L’Institut Pasteur de Shanghai travaille, lui, sur des souches virales locales, sans transfert de souche – nous y avons veillé.

Le partage des connaissances est vital pour le travail scientifique. Il permet des progrès qui bénéficient à l’humanité tout entière : nous ne pouvons que le réaffirmer en ces temps de pandémie, la collaboration scientifique internationale ayant permis le développement d’un vaccin en un temps record.
Si la circulation des idées est essentielle, on ne peut occulter les luttes d’influence que subit actuellement notre monde académique.
Ces stratégies sont pensées sur le long terme et orchestrées par des États extérieurs à l’Union européenne, qui, à cette fin, mettent en œuvre des moyens parfois colossaux. Elles dépassent le cadre de la diplomatie d’influence – celui du soft power –, qui n’est pas une activité anormale pour un pays. Au contraire, il s’agit ici d’offensives visant à instrumentaliser certains enseignements et à s’emparer de données sensibles.
Dans son rapport d’information, notre collègue André Gattolin, dont je tiens à saluer le travail, recommande l’adoption d’un référentiel de normes et de lignes directrices, afin de mieux sanctionner ces interférences. Il s’agirait de dispositions de valeur nationale, européenne et internationale. Il suggère à ces fins de mettre à profit la présidence française de l’Union européenne.
Madame la ministre, est-ce une solution qu’envisage le Gouvernement ? Ce sujet donne-t-il lieu à une concertation entre, d’une part, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et, de l’autre, le secrétaire d’État chargé des affaires européennes ?
Monsieur le sénateur Fialaire, la Commission européenne a d’ores et déjà formulé un certain nombre de propositions au titre de la boîte à outils que j’évoquais précédemment.
Au sein de l’Union européenne, de grandes différences nationales demeurent, qu’il s’agisse du système universitaire ou du monde de la recherche. Il est important que les uns et les autres puissent s’approprier les dispositifs qui correspondent le mieux à leurs besoins.
Ce que nous avons prévu dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, ce sont deux journées de travaux, à Marseille, au début du mois de mars prochain.
La première réunira les différents ministres de l’Union européenne chargés de ces questions ; la seconde s’ouvrira aux représentants de pays avec lesquels l’Union européenne a l’habitude de collaborer.
Il est absolument essentiel de réaffirmer le principe de la liberté académique : il s’agit de l’une des valeurs défendues par toutes les universités où la recherche peut être menée sans entrave, partout dans le monde. À cet égard, il faut bien sûr garantir l’intégrité scientifique : certaines manœuvres d’ingérence peuvent contraindre telle ou telle personne à y renoncer. Il faut donc réaffirmer ces principes très clairement.
Nous devons aussi définir dans quel cadre il nous paraît opportun de développer ce que l’on appelle des « coopérations équilibrées ».
Il est extrêmement difficile de maintenir des liens scientifiques avec des pays dans lesquels la liberté académique est mise à mal, mais c’est aussi parfois la seule corde de rappel pour nos collègues qui travaillent dans ces pays. Ils peuvent ainsi compter sur la mobilisation de la communauté scientifique si, par malheur, il leur arrive quelque chose dans leur pays d’origine.
Nous devons en permanence rechercher un équilibre.

Madame la ministre, le 20 octobre 2020, à l’occasion d’une conférence consacrée à l’Espace européen de la recherche, la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique a été adoptée par les ministres de la recherche des vingt-sept États membres de l’Union européenne.
Le texte décrit notamment la liberté scientifique comme « le droit de définir librement les questions de recherche, de choisir et de développer des théories, de rassembler du matériel empirique et d’employer des méthodes de recherche universitaires solides ».
Cette définition implique également le droit de « partager, diffuser et publier ouvertement les résultats, y compris par le biais de la formation et de l’enseignement ». La déclaration affirme par ailleurs la liberté des chercheurs d’exprimer leur opinion sans être désavantagés par le système dans lequel ils travaillent.
Ce texte engage bien évidemment les gouvernements à mettre en place un système européen de surveillance de la liberté académique et de protection de la recherche contre toute intervention politique.
Force est de constater que cette déclaration a eu peu d’écho en France, où, à l’exception d’un communiqué du ministère des affaires étrangères, elle n’a pratiquement pas été relayée dans les milieux universitaires ; mais peut-être me démentirez-vous, madame la ministre.
Les auteurs du rapport préconisent, dans leurs recommandations 24 et 26, de mettre à profit la présidence française de l’Union européenne pour proposer une stratégie ambitieuse de diplomatie scientifique, à la fois défensive et offensive, dans la lignée du début de prise de conscience de nos partenaires, mais aussi de promouvoir une norme européenne et internationale de clarification des échanges universitaires.
Madame la ministre, au-delà des journées de travail de Marseille, qui permettront de réaffirmer ce cadre, irez-vous plus loin ? Qu’attendez-vous très concrètement de cette présidence de l’Union européenne ?
Monsieur le sénateur Houllegatte, vous avez raison de le rappeler, la déclaration de Bonn a proposé une définition consensuelle des libertés académiques que nous devons a minima préserver dans le cadre de l’Union européenne.
En revanche, je ne vous suis pas quand vous prétendez que cette déclaration n’a pas eu d’écho. La majorité des organismes et des universités ont décliné cette déclaration dans des chartes, ce qui montre qu’elle a également été adoptée sur le terrain, et pas seulement au niveau gouvernemental.
Au-delà, une université du nord de l’Europe, en lien avec des universités canadiennes, me semble-t-il, a proposé de mettre en œuvre une surveillance mondiale de la question des libertés académiques au sein de l’Observatoire mondial des libertés académiques.
L’Europe a adhéré à cet observatoire, qui, à partir d’un certain nombre de critères, évalue le niveau des libertés académiques dans les différents pays. La note maximale est égale à 1 et, de mémoire, la France affiche un score de 0, 881. Je me réjouis certes que nous fassions partie des pays classés entre 0, 8 et 1, mais c’est tout de même la moindre des choses.
Nous avons donc encore des progrès à faire pour mieux défendre les libertés académiques.

Je précise, madame la ministre, que la déclaration de Bonn est disponible sur internet en anglais, mais pas en français…

Cela m’ennuie un peu de vous le dire, madame la ministre, mais je reste sur ma faim. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour produire ce rapport en deux mois. Quatre mois après, on nous égrène quelques orientations de propositions dans des circulaires qui rappellent l’existant. C’est certes important, mais nous attendons de l’État français qu’il mette en œuvre une vraie politique.
J’ai passé mon temps, après la publication de ce rapport, dans des comités interministériels et des réunions pour expliquer la situation. Et l’on se contente de rappeler aux gens qu’ils doivent respecter la déclaration de Bonn dans le cadre de leurs partenariats et coopérations !
Nous avons dit explicitement que le délai d’un mois dont disposent les pouvoirs publics pour s’opposer à un accord n’était pas acceptable. Comment expliquer qu’une université aussi renommée que ParisTech ait signé en août dernier deux partenariats avec des établissements chinois liés à l’armée populaire de libération chinoise, alors qu’elle avait été alertée plusieurs fois par les services ?
Nous attendons donc une véritable politique publique, coordonnée, en la matière. Bien sûr, vous n’engagez ici que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. D’autres administrations sont impliquées, et je sais qu’un rapport a été remis au Premier ministre.
Dans les mois qui viennent, assisterons-nous vraiment au déploiement d’une palette d’instruments permettant de répondre aux problèmes que nous avons posés ? En l’état, j’ai l’impression que c’est business as usual…
La boîte à outils contenue dans le rapport de la Commission européenne du 18 janvier dernier fait soixante pages. Ce ne sont certes que des recommandations et des orientations, mais elles sont détaillées. Nous aimerions avoir une vision plus panoramique.
Monsieur le sénateur Gattolin, oui, je le disais dans mon propos introductif, il est important de rappeler les principes, mais cela ne suffit pas.
C’est pourquoi nous avons travaillé à l’élaboration d’un plan de protection, conjointement avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) et la DGSI. Des référents ont par ailleurs été nommés dans les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT).
Nous avons commencé des cycles de formation de tous les recteurs et délégués régionaux académiques, avant de nous adresser aux présidents d’université et aux directeurs d’établissement.
Nous allons enfin travailler sur la question des délais de réponse que vous avez évoqués, mais il faut un peu de temps pour cela.
Quoi qu’il en soit, je vous assure que les rappels effectués n’ont pas été inutiles.
Quant au point spécifique que vous soulevez, si vous évoquez la fondation ParisTech, c’est un organisme de droit privé, qui n’a pas à demander au ministère avec qui elle doit passer des accords. Malheureusement, je n’ai pas été sollicitée par la fondation ParisTech, qui n’a aucun lien avec le ministère.

Madame la ministre, je voudrais souligner la cohérence de nos débats aujourd’hui : celui sur le wokisme cet après-midi, puis celui sur les travaux de la mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire.
Les frontières sont ténues entre diplomatie culturelle, coopération scientifique, influences ou interférences – si l’on adopte un point de vue anglo-saxon – et ingérence. Saupoudrez le tout avec un hard power diplomatiquement appelé « narratif puissant » dans un contexte de sharp power, et vous comprendrez que l’exercice n’est pas aisé et qu’il appelle de la part des élus et de tous les acteurs une forte mobilisation.
La question qui m’importe est notre degré de conscience des différentes formes d’influence, leurs risques en termes de souveraineté et les politiques que nous y opposons.
Nous avons abordé dans le rapport le sujet du financement étranger d’établissements éducatifs privés. Les réponses australiennes à ce phénomène sont très instructives. Les questions des fonds d’investissement dans l’éducation et les nouvelles technologies dans l’enseignement supérieur imposent une forte vigilance.
Le cas du rachat par le fonds chinois Weidong Cloud Education de la Brest Business School en 2016 en est un exemple criant : le choix de cette ville n’est pas anodin, alors même qu’elle est un point stratégique de défense, avec une base militaire, un lycée naval et un centre d’instruction. À l’époque, le groupe avait mis en avant sa philosophie d’ancrage territorial fort. En tant qu’élus des territoires, nous ne pouvons qu’être interpellés.
Ces investissements dans la matière grise de très haut niveau, dont l’objectif est de développer des normes techniques et scientifiques en Occident, constituent un élément essentiel de la politique des nouvelles routes de la soie.
Cela se traduit aussi par la stratégie Made in China 2025, qui, à terme, vise non pas une pénétration des marchés, mais une intégration globale de tous les échelons. Concrètement, le but pour la Chine est la création, la diffusion et l’imposition de ses propres normes de production sur tous les marchés.
Quelles mesures peuvent-elles être prises pour recenser ces investissements dans le supérieur ? Comment mieux adapter la réponse existante, mais insuffisante, que constitue la politique interministérielle de protection du potentiel scientifique et technique ?
Monsieur le sénateur Courtial, vous m’interrogez sur les raisons qui nous empêchent de contrôler les financements du secteur privé, qui peuvent parfois se faire par des puissances étrangères avec des buts non amicaux.
Dans la loi de programmation de la recherche, j’avais proposé une ordonnance pour mieux encadrer le financement de l’enseignement privé en France, mais cette disposition a été retirée à la demande du Sénat…
Quand le Gouvernement formule des propositions, on a souvent l’impression qu’elles vont à l’encontre des intérêts du secteur privé.
Je tiens à le rappeler devant vous ce soir, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons besoin d’un système d’enseignement supérieur mixte. Certaines structures privées, notamment les établissements privés à but non lucratif ou d’intérêt général, font partie intégrante de notre modèle d’enseignement supérieur.
Toutefois, il suffit de disposer d’un local susceptible d’accueillir du public pour créer une structure d’enseignement supérieur privée et se prévaloir du titre « d’école ». Aucune règle ne l’interdit !
C’est pourquoi j’avais souhaité, dans la loi de programmation de la recherche, que ces créations soient mieux encadrées. À l’époque, on m’avait rétorqué que j’étais contre l’installation du privé en France. Je serais ravie que vous portiez aujourd’hui un regard différent sur cette proposition.
Il faut bien entendu savoir résister aux investissements étrangers. C’est vrai pour l’université comme pour les collectivités, et c’est la raison pour laquelle nous devons développer un réseau de surveillance solide de toutes les installations effectuées en France qui, in fine, pourraient nuire à notre pays.

Madame la présidente, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier André Gattolin de ce rapport.
Madame la ministre, l’université est assurément un haut lieu de la République, qui participe à la construction des futures générations ; la liberté d’expression doit bien entendu y régner. Or, la présente mission d’information l’a démontré, l’université est un lieu de conflits où la recherche d’influence peut devenir une véritable stratégie d’interférence.
Aussi, je soutiens pleinement le deuxième objectif avancé par la mission : il faut aider les universités à protéger leurs valeurs de libertés académiques et d’intégrité scientifique. La connaissance est assurément une question d’intérêt général !
Une première mesure concrète consiste à lutter contre la censure d’intervenants ou de conférenciers, notamment via le bénéfice de la protection fonctionnelle ou la possibilité d’actions en justice. On doit pouvoir laisser s’exprimer l’ensemble des opinions, dans le respect de la loi qui fixe des limites – diffamation, injure, provocation à la haine, etc.
Une seconde mesure consiste à réaffirmer l’autonomie de la recherche par un impératif renouvelé de neutralité axiologique, notamment via la possibilité d’une évaluation contradictoire des résultats d’une soutenance. La recherche doit transmettre des connaissances, et non traduire un jugement moral ou politique.
Dès lors, madame la ministre, comment le Gouvernement entend-il renforcer les libertés académiques afin que l’université bénéficie de la variété de ses ressources conceptuelles ? Et comment se protéger des risques d’influence et d’ingérence étrangère, notamment en ce qui concerne la sécurité numérique ?
Monsieur le sénateur Moga, l’université est un lieu non pas de conflits, mais de débats, car débattre empêche de se battre. L’échange d’arguments permet de se forger des opinions, au-delà des idées préconçues.
L’apport de l’université, c’est précisément de faire prévaloir la méthode scientifique et le principe de l’évaluation contradictoire.
Nous avons tous observé, au cours de cette pandémie, comment se construit un consensus scientifique. Au début, chacun dit : « Je pense que… » À la fin, le pluriel l’emporte, car, sur certains points, nous pouvons dire « Nous savons », et, sur d’autres, « Nous restons dans l’ignorance et nous cherchons encore ». C’est ainsi que la science fonctionne.
Il est essentiel de préserver le débat contradictoire. Pour cela, chacun doit, dans le respect de son champ de compétences, être capable de proposer des hypothèses, de porter des idées et d’en débattre de manière argumentée, sans invectives ni disqualification préalable.
Si, à l’occasion d’un travail de recherche, vous ne trouvez que des éléments qui confortent vos hypothèses de départ, c’est probablement que votre bibliographie est mal construite ou que vous travaillez, non sur une question controversée, mais sur un sujet qui fait l’objet d’un consensus scientifique.
Quant aux problèmes de cybersécurité, ils sont bien réels. Nous y travaillons avec l’Anssi pour former les acteurs et les aider à se protéger au mieux. Nous effectuons notamment des tests grandeur réelle, au cours desquels nous mimons des attaques et nous observons la manière dont les acteurs réussissent à se protéger.

Madame la ministre, ma question porte sur la sécurisation des données nécessaires à la recherche scientifique.
Les attaques dans l’espace numérique se sont multipliées, partout dans le monde, à un rythme quasi exponentiel ces deux dernières années. Tous les experts font part de leurs inquiétudes et confirment que la situation sécuritaire dans l’espace numérique est désormais particulièrement préoccupante et devrait continuer à se dégrader dans les années qui viennent. La capacité des cybercriminels à commettre leurs forfaits croît plus rapidement que celle de leurs victimes à se protéger.
L’une des recommandations du rapport de la mission est de généraliser la réalisation par l’Anssi d’un audit sur la sécurité des systèmes informatiques des universités, afin d’identifier les failles existantes.
Je pense notamment aux rançongiciels, qui ont pris d’assaut les systèmes informatiques de certaines entreprises, mais aussi d’hôpitaux, de laboratoires de recherche ou d’universités. Ces derniers font peser un risque, par la copie, voire la perte de données sensibles, et ce risque s’accroît avec l’essor des data lake s, qui permettent de stocker sans garanties sérieuses des données sensibles, ainsi sujettes aux attaques extérieures.
Quant à nos moyens de protection, dans son rapport d’avril 2021, la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) recommandait au Gouvernement de développer et de renforcer les liens entre les acteurs politiques publics et les industriels du numérique, afin de faire émerger des solutions de cloud de confiance.
Cette solution souveraine s’avère d’autant plus pertinente depuis que le Cloud Act, adopté au Congrès américain en 2018, permet un accès extraterritorial aux données stockées chez des fournisseurs de service établis sur le territoire des États-Unis.
Pourtant, un mois après la remise du rapport de la CSNP, votre gouvernement annonçait que « certaines des données les plus sensibles de l’État français et des entreprises peuvent être stockées en toute sécurité en utilisant la technologie cloud développée par Google et Microsoft, si elle est concédée à des entreprises françaises ».
Plus récemment, ce sont les opérateurs du nucléaire français qui annonçaient recourir au service cloud Azure de Microsoft pour stocker des données.
Dès lors, ma question est la suivante : le Gouvernement a-t-il pris conscience de la vulnérabilité des infrastructures informatiques de la France, en particulier s’agissant du stockage des données dédiées à la recherche scientifique, à l’heure où les principales puissances numériques sont au bord du cyberaffrontement ?
Monsieur le sénateur Redon-Sarrazy, le sujet que vous évoquez est pris extrêmement au sérieux ; nous y travaillons avec l’Anssi.
Comme le préconise le rapport, les audits des systèmes d’information des opérateurs du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont commencé, avec notamment les tests grandeur nature que j’évoquais précédemment, qui permettent de mesurer si les préconisations de l’Anssi fonctionnent et si les établissements sont capables d’éviter quelques pièges classiques des cybercriminels. J’ai rencontré le directeur de l’Anssi pas plus tard que la semaine dernière pour travailler sur cette question.
Tous les centres de calcul sont aussi protégés de manière très spécifique, comme vous pouvez l’imaginer.
La question du cloud de confiance se pose au niveau européen. Malheureusement, il reste là encore un peu de travail avant de parvenir à un accord sur cette question. Mais, nous le savons, c’est collectivement que nous devrons trouver une solution.
Il faut aussi que tout un chacun s’informe et comprenne la situation. Les gens n’hésitent pas à communiquer de très nombreuses informations, dont certaines sont extrêmement précieuses, via leur téléphone portable. Ils ne comprennent pas que si celles-ci venaient à tomber entre des mains malveillantes, elles permettraient que l’on fasse pression sur eux ou sur notre pays.
L’éducation à la cybersécurité est donc essentielle, pour tous nos concitoyens.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer l’excellent travail, mené en un temps record, par la mission d’information présidée par notre collègue Étienne Blanc, dont André Gattolin était le rapporteur.
Madame la ministre, les conclusions de ce rapport sont sans appel : la menace est réelle. La France est une cible pour les influences étrangères. Au-delà de la simple influence culturelle, certains États comme la Chine semblent réorienter leur stratégie autour de l’économie.
Tel est le cas de certains instituts Confucius, qui recentrent leurs activités sur la coopération économique en ciblant spécifiquement les entrepreneurs et les cadres dirigeants, avec la mise en place d’un réseau et de partenariats.
Si un partenariat universitaire n’est pas en soi une mauvaise chose, il doit être réalisé en toute transparence, et non sans une certaine vigilance. Les recommandations formulées dans le rapport tendent à sécuriser ces partenariats en permettant notamment la saisine des ministères concernés, l’économie, l’intérieur ou encore les armées.
Les auteurs proposent également que les accords passés avec les filiales françaises des entreprises étrangères extra-européennes soient systématiquement soumis à une procédure d’examen préalable.
Quelles suites allez-vous donner à ces recommandations, madame la ministre ?
Monsieur le sénateur Bouloux, des dispositions réglementaires s’appliquent déjà à tous les partenariats internationaux établis par les établissements d’enseignement supérieur. C’est évidemment le cas des partenariats noués entre les instituts Confucius et les établissements d’enseignement supérieur, qui entrent dans la catégorie des partenariats internationaux.
Il est essentiel de préserver l’accès au système d’information de l’établissement, en veillant concrètement à l’existence de systèmes d’information séparés. Des personnes non autorisées ne doivent pas, en toute légalité, car on leur en aurait donné l’accès, s’introduire dans le système d’information.
Les actions de coopération sont menées sous la responsabilité des présidents ou des directeurs d’établissement. Ils en assurent la mise en œuvre dans le cadre de leur autonomie, mais doivent évidemment respecter les dispositions réglementaires, notamment celles qui concernent la protection du patrimoine scientifique et technique.
Toutefois, vous avez raison de le souligner, monsieur le sénateur, nous devons aller encore plus loin, en intégrant les sciences humaines et sociales à la protection de ce patrimoine scientifique et technologique. Pour le moment, les actions étaient centrées sur l’intelligence économique et les technologies. Mais nous devons aussi nous prémunir contre les ingérences intellectuelles.
Chaque fois qu’ils rencontrent un problème spécifique, les établissements se retournent vers le ministère. Nous leur apportons des conseils et leur suggérons parfois de rompre leurs accords avec les instituts Confucius.

Je ne doute pas de votre travail sur ce sujet, madame la ministre, mais j’insiste : dans un monde toujours plus dur, nous devons instamment protéger notre patrimoine.

Lorsque nous débattons des conclusions de ce rapport sur la meilleure manière de protéger notre patrimoine scientifique et nos libertés académiques, nous ne devons jamais oublier que le fondement même de l’université reste la circulation et le partage des connaissances, des idées, des hypothèses et des doutes ; vous l’avez d’ailleurs rappelé, madame la ministre.
Deux sortes de menaces peuvent finalement être identifiées : l’espionnage et la captation d’information, tout d’abord – en la matière, le rapport formule de nombreuses propositions ; l’influence, ensuite, une menace plus complexe, qui va de pair avec la circulation des idées.
Si nos chercheurs sont bons, on peut espérer qu’ils parviendront à déjouer les influences que certaines puissances souhaiteraient avoir sur eux. Mais il subsiste les pressions directes, qui, par le biais des menaces, peuvent peser sur les orientations de la recherche.
Je citerai en exemple les travaux de Mme Cécile Vaissié, consacrés aux réseaux du Kremlin en France, sur lequel notre mission d’information ne s’est pas particulièrement penchée d’ailleurs. En 2019, cette universitaire a dû faire face à des attaques en diffamation d’origines variées, dignes des meilleures procédures bâillons.
Il a fallu qu’elle trouve la force de se défendre et de contrer les menaces qui pesaient sur ses travaux. La justice lui a finalement donné raison, en confirmant le caractère sérieux et documenté de son travail, mais ce combat fut difficile, et elle s’est trouvée très isolée pour le mener.
Madame la ministre, quelles conséquences avez-vous tirées de cette expérience ? Comment, trois ans plus tard, proposez-vous de lutter contre ces menaces de procédures bâillons – il est beaucoup question de lanceurs d’alerte actuellement –, afin de prémunir nos chercheurs contre de telles opérations ? Il y va de la liberté académique et de la liberté de la recherche.
Monsieur le sénateur Leconte, vous avez raison de distinguer, d’une part, ce qui relève de l’espionnage – autrement dit de la captation de résultats obtenus dans des laboratoires français et de leur transfert non consenti vers d’autres laboratoires –, et, d’autre part, ce qui relève de l’influence.
S’agissant de l’influence, il convient également de séparer deux aspects. En matière de recherche, les idées circulent naturellement. Par définition et par principe, des chercheurs français ont pu influencer des chercheurs d’autres pays, et réciproquement.
Il y va autrement lorsque l’on contraint un chercheur à braver l’interdit et que l’on touche à son intégrité scientifique. Il est inadmissible de forcer un chercheur à renoncer à son intégrité, c’est-à-dire à publier, sous la pression, des résultats contraires à ses travaux.
Si la justice s’est mêlée du cas que vous rapportez, le monde académique, en général, se protège en réalité lui-même. Les autres chercheurs confirment ou infirment la validité de l’hypothèse scientifique qui a été émise, puis démontrée ou discutée par les pairs.
C’est en cela que réside la force de la recherche. C’est cela qui la rend internationale : elle est indépendante de toute action en justice, puisque c’est l’évaluation par les pairs qui fait foi, et cela dans le monde entier.
Dans le cas spécifique que vous mentionnez, rappelons encore et toujours la nécessité absolue de demander la protection fonctionnelle et de ne jamais rester seul dans ce genre de circonstances. L’institution est là pour protéger la liberté académique, donc protéger le chercheur.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier nos collègues membres de la mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire et académique français, en particulier André Gattolin, de ses travaux très bien documentés.
Madame la ministre, beaucoup s’inquiètent des importantes opérations d’influence, voire d’ingérence étrangère, dont la France fait l’objet. Dans tous les domaines, des efforts particuliers sont déployés pour déstabiliser notre pays.
Les travaux issus de la mission d’information ont permis de mettre en exergue cette réalité, longtemps ignorée et peu documentée : les influences étrangères sur le monde académique constituent aujourd’hui à l’évidence une menace réelle pour notre souveraineté nationale.
Ainsi, des États comme la Chine, la Russie, la Turquie ou encore certains États du Golfe persique s’emploient, dans nos universités, à détourner délibérément les valeurs de liberté et d’intégrité scientifique à des fins de politique intérieure ou d’ingérence.
Les travaux de la mission d’information soulignent que ces ingérences sont le fruit d’une combinaison d’au moins trois facteurs : premièrement, l’influence des ressources budgétaires, qui se matérialise, pour les chercheurs français, par des rémunérations et des conditions de travail moins favorables que dans les autres pays ; deuxièmement, la faiblesse administrative d’établissements, certes autonomes dans leur gestion, mais soumis à des injonctions souvent contradictoires ; troisièmement, et enfin, la culture d’ouverture d’un monde de la recherche par nature réticent à penser son activité dans un contexte de conflits et d’intérêts nationaux.
Madame la ministre, dans ces conditions, pourriez-vous nous indiquer les mesures que vous envisagez de prendre afin de pallier, ou tout au moins de corriger, ces trois fragilités majeures de notre système d’enseignement supérieur ?
Comment comptez-vous, par là même, aider les universités à faire face à ces ingérences et, finalement, mieux protéger notre patrimoine scientifique et notre liberté académique ?
Monsieur le sénateur Bonhomme, s’agissant de la première des trois raisons que vous avancez, nous avons la chance, je le répète, d’avoir un système protecteur de ce point de vue.
En effet, l’immense majorité des ressources budgétaires des établissements publics vient du secteur public, c’est-à-dire de l’État, des collectivités territoriales ou des fonds alloués à la formation continue, à la formation professionnelle ou encore à l’alternance. Ces établissements ne sont donc pas concernés par le financement massif par des puissances étrangères. Cela peut être le cas, parfois, de certains établissements privés ; il convient alors de faire preuve d’une extrême vigilance.
S’agissant, ensuite, de l’autonomie des établissements – la loi d’autonomie ayant été portée par Mme Pécresse, vous ne sauriez la remettre en cause, monsieur le sénateur –, il n’y a pas d’injonction contradictoire. Les établissements publics répondent aux politiques publiques et choisissent eux-mêmes la voie à suivre pour y répondre. Pour avoir été moi-même à la tête d’un établissement, je vous confirme que certains laboratoires doivent être mieux protégés que d’autres ; chaque chef d’établissement concerné le sait.
Enfin, vous évoquez la « naïveté » de certains chercheurs, qui estiment bien plus important de partager que de protéger et qui parfois, d’ailleurs, ne voient pas très bien en quoi leurs recherches peuvent intéresser au-delà de leurs collègues travaillant sur les mêmes sujets.
En la matière, précisément, nous devons faire preuve de persuasion et de pédagogie. Nous devons communiquer sur des exemples de recherches qui pouvaient paraître extrêmement conceptuelles ou fondamentales à l’origine et qui ont été néanmoins captées au bénéfice d’autres puissances. Cela suppose une certaine force de conviction, comme souvent dans l’université.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de remercier à mon tour Étienne Blanc et André Gattolin, respectivement président et rapporteur de la mission d’information sur les influences étatiques extra-européennes dans le monde universitaire.
Les travaux auxquels j’ai eu l’honneur de participer montrent à quel point les enjeux sont forts et notre situation préoccupante.
Nous péchons par naïveté. Ni notre souveraineté ni notre liberté académique ne peuvent être conditionnées au moindre compromis ou à de petits ajustements offerts ou concédés, sous l’influence méthodique de nations étrangères.
Toute relation diplomatique nous expose assez logiquement à des stratégies d’influence dans un cadre officiel. En revanche, des agissements nettement plus offensifs révèlent une ingérence et une volonté d’infléchir notre liberté académique, par des formes de censure, de pression, d’incitation financière ou de désinformation.
En l’état, force est de constater que notre réponse institutionnelle n’est pas adaptée, particulièrement en matière de sciences humaines et sociales. De plus, la tradition d’ouverture des établissements français prépare peu les universitaires et les chercheurs à prendre conscience de l’existence même de ces stratégies étrangères.
C’est pourquoi notre mission propose au Gouvernement de réaffirmer l’autorité et l’expertise des fonctionnaires de sécurité et de défense, en leur confiant un rôle de formation et de sensibilisation de l’ensemble de la communauté académique à ces risques d’influence.
Notre rapport préconise également d’associer les collectivités territoriales, particulièrement les régions, qui disposent du réseau et de la connaissance de terrain susceptibles de garantir une capacité de réaction importante et reconnue sur le territoire.
Madame la ministre, je souhaiterais vous entendre sur ces deux derniers points, en particulier sur le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans ce travail que nous devons mener en commun contre l’ingérence des États étrangers. Je vous remercie de bien vouloir nous éclairer sur la position du Gouvernement.
Monsieur le sénateur Vial, nous en revenons toujours à cette question de la formation et de la sensibilisation.
Les fonctionnaires de sécurité et de défense (FSD) seront bien sollicités pour mettre en place des formations. Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) préparent, je le répète, des formations communes. Certaines ont déjà été dispensées auprès des recteurs ou des délégués régionaux. Elles sont sur le point d’être élargies aux chefs d’établissement.
Les FSD assurent également un relais sur le terrain, en adaptant les formations selon les disciplines, puisque toutes ne sont pas exposées aux mêmes risques. Certains risques sont transversaux, d’autres pèsent en particulier sur certaines disciplines.
Ainsi le SGDSN envisage-t-il des évolutions spécifiques aux sciences humaines et sociales. Ces dernières sont prises en compte dans les recommandations de la Commission européenne, qui englobent la recherche dans son ensemble et ne se limitent pas aux questions de souveraineté économique ou de protection scientifique et technologique.
Il est important que tout le monde s’y mette. Si les régions ont des compétences particulières dans la surveillance du territoire, en complément de la surveillance exercée au niveau national, pourquoi ne pas les mettre à contribution ?
L’essentiel à mes yeux est de travailler à la sensibilisation de tous. Comme toujours, on a l’impression que cela n’arrive qu’aux autres, jusqu’au moment où cela nous arrive. Cela passe souvent par des exemples. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.

Madame la ministre, j’ai participé aux travaux de la mission d’information dont les conclusions font l’objet du présent débat.
À ce titre, j’ai été frappée par les témoignages de personnalités étrangères, dont les pays sont plus vigilants et plus impliqués que le nôtre vis-à-vis des influences extérieures. En effet, l’Australie, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, le Canada et même les États-Unis ont vu apparaître avant nous ces stratégies d’influence offensives que nous évoquons aujourd’hui.
Certes, le phénomène y est amplifié par la situation de dépendance de ces pays à l’égard des droits d’inscription des étudiants étrangers ; les moyens de pression des puissances étrangères s’en trouvent facilités.
Le rapport de notre mission d’information montre bien néanmoins que le problème se développe en France également. Pour concevoir la bonne réponse, il faut pouvoir évaluer le niveau de la menace et savoir la repérer.
Faisant le constat du manque d’informations disponibles sur les faits en question, notre mission propose un ensemble de mesures visant à établir un état des lieux.
Par ailleurs, force est de constater que le dispositif de sécurité français concerne uniquement les risques élevés d’atteinte aux intérêts économiques ou défensifs de la Nation réprimés par le code pénal, comme l’intrusion dans des lieux stratégiques ou le vol de documents.
Ce dispositif fait l’impasse sur les sciences humaines et sociales. Pour protéger notre enseignement supérieur et notre recherche, il faudrait donc étudier la mise en œuvre d’un cadre juridique spécifique, d’ordre administratif, voire pénal, visant à sanctionner les atteintes aux libertés académiques.
Qu’en pensez-vous, madame la ministre ? Compte tenu de la dimension mondiale de la question, ne serait-il pas pertinent, par ailleurs, de prévoir une coordination entre pays concernés ?
Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, nous pourrions imaginer une action forte, visant à faire de la déclaration de Bonn un texte fondateur de l’Union en matière de recherche, promouvant tant l’intégrité scientifique que la transparence. Il me semble en effet important d’inscrire notre stratégie à l’échelon européen.
Madame la sénatrice Gosselin, vous avez cité un certain nombre de pays, dont vous avez entendu des personnalités. Celles-ci vous ont expliqué à quel point leur pays prenait à bras-le-corps, comme le nôtre, les questions d’ingérence de puissances étrangères.
Toutefois, vous l’avez dit aussi, et, croyez-moi, cela fait une énorme différence, ces pays sont dans une situation de dépendance.
Quand, dans certaines universités australiennes, 70 % des ressources proviennent des droits d’inscription des étudiants internationaux et quand ces derniers sont à 90 % chinois, vous imaginez bien que le jour où ces étudiants exigeront un droit de regard sur la façon d’enseigner, ces universités seront confrontées à un sérieux problème de financement.
Là, nous pourrions parler d’influence ou d’ingérence. Là, des enseignants pourraient être poussés à renoncer à leur intégrité scientifique. Là, cela deviendrait très problématique.
C’est la raison pour laquelle tous les pays qui fondent le modèle économique de leurs établissements sur des droits d’inscription très élevés sont aussi particulièrement attentifs à se protéger des ingérences étrangères. Ils y parviennent, en réalité, avec plus ou moins de succès.
S’agissant de la question juridique, je le répète : la meilleure protection des libertés académiques, c’est le monde académique lui-même.
On n’attaque pas un chercheur au motif qu’il a publié des résultats contestables. On le conteste sur le terrain de la science et de la recherche. Ses confrères peuvent l’interpeller, le questionner, démontrer que ses conclusions ne sont pas partagées et, ainsi, l’amener à s’interroger de nouveau. C’est ainsi en réalité que naissent les débats et les écoles de pensée, qui peuvent s’affronter pendant très longtemps.
La liberté académique me semble très bien protégée par le monde académique. Il faut lui laisser la main.

En conclusion du débat, la parole est à M. Étienne Blanc, président de la mission d’information qui a demandé ce débat.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous venons d’assister à un débat particulièrement riche et complet.
L’un des mérites que notre assemblée retiendra sans doute des travaux de cette mission sera d’avoir mis au cœur du débat politique cette question essentielle, à laquelle le Gouvernement et les pouvoirs publics au sens large ont donné le sentiment, jusqu’à aujourd’hui, d’avoir répondu de manière insuffisante.
Si nos travaux - nous regrettons de n’avoir disposé que de huit semaines - n’ont pas été facilités par la pause estivale, nous avons pu tout de même auditionner, grâce au rapporteur André Gattolin, un grand nombre d’universitaires.
Nous avons également élargi le périmètre de notre mission à un certain nombre de pays qui connaissent les mêmes problèmes que nous, même si c’est dans des circonstances un peu différentes - vous l’avez rappelé, madame la ministre, à propos de l’Australie.
À cet égard, l’audition de M. James Paterson, sénateur et président de la commission conjointe du parlement australien sur le renseignement et la sécurité, a été d’une grande richesse et d’une grande densité. Elle nous a informés précisément sur les actes que commet la Chine à l’encontre des libertés académiques en Australie.
Oui, nous avons eu le mérite de lancer un débat nécessaire sur un sujet absolument essentiel ! Sans reprendre l’intégralité des vingt-cinq propositions, raisonnables et réalistes, mais aussi ambitieuses, que contient le rapport, je retiendrai trois idées principales.
La première est le concept de zone grise. Notre collègue Leconte l’a très bien dit : l’université se fait un honneur de partager et d’échanger ses résultats, avec d’autres établissements et centres de recherche de l’ensemble de la planète. C’est une vieille tradition française, d’ailleurs, que ces échanges. C’est aussi la tradition que de faire connaître sa langue, sa culture, son histoire, pour qu’elles puissent rayonner sur le monde.
D’un autre côté, il y a l’utilisation de ces recherches par des pays qui ne fonctionnent pas, comme nous, de manière démocratique. Ceux-ci cherchent à capter les informations, à les confisquer et à peser sur certains enjeux qu’ils jugent essentiels. Et ils refusent toute liberté d’analyse ou toute intelligence susceptible d’apporter des réponses qui leur déplaisent.
Nous pensons tous à la situation du peuple ouïghour ou aux événements qui surviennent dans nos universités lorsque nous voulons aborder le drame du génocide arménien ou tant d’autres sujets.
Entre ces deux conceptions, il existe une zone grise, que nous ne connaissons pas et qui mérite d’être mieux analysée. Aussi, nous demandons au Gouvernement de favoriser les échanges universitaires, afin de nous aider à mieux comprendre cette zone grise et à mieux lutter contre les influences.
Ma deuxième observation porte évidemment sur les méthodes qui sont désormais utilisées par ces pays. Nous avons parlé de procédures judiciaires. Elles sont assez inédites et se répandent. Pour mieux lutter contre ces méthodes, nous devons mieux les comprendre, et pour mieux les comprendre, il faut faire travailler en réseau tous les services de renseignement, parfois militaires.
À cet égard, l’audition du représentant de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem) a été particulièrement intéressante, bien que le chapitre consacré à l’université et à l’académie fût peut-être par trop réduit. Un certain nombre de propositions du rapport s’inspirent ainsi des expériences qui nous ont été présentées.
Enfin, le troisième point sur lequel j’insisterai est la faiblesse de la volonté politique. Madame la ministre, en réponse à un certain nombre de questions, vous nous avez affirmé que des circulaires étaient diffusées et qu’une prise de conscience était en cours. Après avoir mené ces travaux, nous pensons que de telles réponses ne sont pas encore à la hauteur de l’enjeu.
En effet, et je conclurai par là, l’enjeu est considérable. Bien au-delà de la captation et des questions purement matérielles, les pays qui se comportent de la sorte s’attaquent à une liberté essentielle, contenue dans les dispositions de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales de 1950. Je veux parler de la liberté d’enseigner et de son corollaire, la liberté de pensée. C’est à ces libertés que ces pays s’attaquent.
C’est pour cela que la mission d’information nous dit dans son rapport qu’il est grand temps de réagir, et puissamment.
Applaudissements sur toutes les travées, à l ’ exception de celles du groupe CRCE.

Nous en avons terminé avec le débat sur les conclusions du rapport Mieux protéger notre patrimoine scientifique et nos libertés académiques.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 2 février 2022 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente :
Débat d’actualité sur le thème « Énergie et pouvoir d’achat : quel impact de la politique du Gouvernement ? ».
De dix-huit heures quinze à vingt heures trente puis de vingt-deux heures à vingt-trois heures quarante-cinq :
Ordre du jour réservé au groupe UC

Proposition de loi tendant à redonner un caractère universel aux allocations familiales, présentée par M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 400, 2021-2022) ;
Débat sur le thème « L’amélioration de la prise en charge des personnes atteintes du trouble du déficit de l’attention ».
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinq.