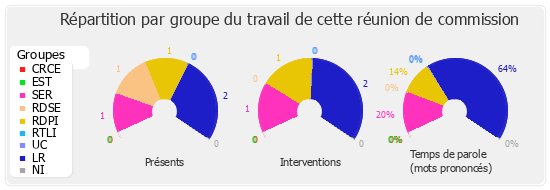Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 15 juin 2022 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Audition de M. Fabrice Leggeri ancien directeur exécutif de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes frontex ne sera pas publié
Audition de M. Fabrice Leggeri ancien directeur exécutif de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes frontex ne sera pas publié

président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale. - Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle d'auditions dans le cadre de la mission d'information relative à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Nous avons engagé nos travaux immédiatement après le scrutin du 12 décembre 2021. La commission des lois a désigné quatre rapporteurs : Hervé Marseille, Jean-Pierre Sueur, Philippe Bas et moi-même. Nous nous rendrons en Nouvelle-Calédonie du 22 au 29 juin prochains.
Nous réfléchissons à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie à la suite des consultations d'autodétermination prévues par l'accord de Nouméa. De nouvelles discussions entre les parties sont prévues par le point 5 de l'accord de Nouméa. Je rappelle également que le précédent ministre des outre-mer avait annoncé un référendum dit « de projet » pour juin 2023.
Nous travaux sont complémentaires de ceux menés par le groupe de contact relatif à la Nouvelle-Calédonie créé il y a plusieurs mois par le président Larcher.
Dans ce cadre, nous souhaitons connaître votre vision de la situation institutionnelle actuelle et future de la Nouvelle-Calédonie.
Avant de vous céder la parole, je salue la présence de plusieurs de nos collègues ultramarins conviés en leur qualité de membres de la délégation sénatoriale aux outre-mer du Sénat et en particulier de M. Stéphane Artano, président de la délégation.
J'ai participé, non à la discussion des accords de Matignon, mais, comme directeur de cabinet de Le Pensec, à ce qui a suivi : l'accord Oudinot, qui, au cours de l'été 1988, a mis en oeuvre les accords de Matignon, pour aboutir au projet de loi qui a été soumis à référendum.
La difficulté première de l'exercice, c'est la répartition de la population : au recensement de 2019, 41 % de personnes se sont déclarées kanaks, 24 % se sont déclarées européennes, les autres, métisses ou non, se déclarant calédoniennes par refus d'être assignées à une telle répartition.
L'espoir exprimé dès les accords de Matignon et renouvelé avec l'accord de Nouméa, c'était précisément de sortir d'un déterminisme ethnique opposant les Kanaks, pour l'indépendance, et tous les autres, contre.
Ainsi, en 1988, on avait prévu un référendum pour 1998. Mais, en 1991, Jacques Lafleur, leader des non-indépendantistes, a proposé d'y renoncer pour rechercher un accord consensuel. Cette proposition, à la fois très audacieuse et visionnaire - c'était la marque de fabrique de son auteur -, a fini par convaincre le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) et le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR). Dès lors, le Gouvernement lui-même a été convaincu.
On a bien avancé sur les voies d'un accord consensuel sous le gouvernement de M. Juppé, avant d'achopper sur la question du nickel. Le gouvernement de M. Jospin a résolu le préalable minier, puis a participé à l'accouchement de cet accord, qui, comme l'a dit M. Jospin à Nouméa lors de sa signature, s'inscrit dans les pas des accords de Matignon.
À cet égard, les corps électoraux distincts du corps électoral général ont toute leur importance. Il existe en effet un corps électoral restreint pour les élections provinciales et donc pour l'élection du Congrès.
Au départ, cette idée figure dans les accords de Matignon. En vertu du point n° 6 du texte n ° 2, « les électeurs et les électrices de Nouvelle-Calédonie qui seront appelés à se prononcer sur ce projet de loi référendaire, ainsi que leurs descendants accédant à la majorité, constituent les populations intéressées à l'avenir du Territoire. Ils seront donc seuls à participer, jusqu'en 1998, aux scrutins qui détermineront cet avenir : scrutin pour les élections aux conseils de province et scrutin d'autodétermination ».
Cette disposition n'a pas été mise en oeuvre : lors de la discussion de l'accord Oudinot, elle a été jugée contraire aux principes constitutionnels. Toujours est-il qu'elle figurait explicitement dans les accords de Matignon.
Voilà pourquoi, lorsque la négociation de l'accord de Nouméa s'est engagée, le principe de restreindre le corps électoral pour les élections locales a été validé sans difficulté. Restait à savoir si ce corps électoral « glisserait » ou non : je ne reviens pas sur ce point, parfaitement connu de vous.
J'ajoute que la raison invoquée a toute son importance : il s'agit des scrutins qui sont qualifiés juridiquement comme ceux qui « détermineront » l'avenir du Territoire. Cette disposition est donc liée dès le départ à l'autodétermination. Ce point me paraît essentiel.
En 1998, cette restriction du corps électoral pour les élections provinciales a été liée à un nouveau concept : celui de citoyenneté, qui, lui, n'était pas directement lié à l'autodétermination. On estimait à ce titre qu'au-delà des délais légaux imposés au corps électoral national, un certain laps de temps était nécessaire pour comprendre les particularités calédoniennes.
Au terme des trois référendums, le pari initial - à savoir sortir à terme du clivage ethnique - n'a pas vraiment été tenu, même si, quand on analyse les motivations de vote, comme l'ont fait certains groupes d'universitaires, on constate la variété de motivations du vote indépendantiste, qu'il s'agisse du type d'indépendance, du lien avec la France ou, surtout, du corps de citoyens appelé à participer au nouvel État.
Les trois référendums ayant eu lieu, l'accord de Nouméa est révolu. Mais, juridiquement, la situation de l'accord de Nouméa est plus compliquée. Certains juristes soutiennent que les dispositions du titre XIII de la Constitution, fondements d'autres dispositions de la loi organique, ne peuvent disparaître de ce simple fait. À leurs yeux, il faut une révision constitutionnelle pour modifier ce titre ou le supprimer, afin que la Nouvelle-Calédonie rentre dans le droit commun de l'outre-mer.
Le Gouvernement avait sollicité le Conseil d'État sur ce point controversé, avant de retirer sa demande d'avis...
Les rapporteurs avaient été désignés et avaient eu de premiers échanges avec les commissaires du Gouvernement...
Évidemment, compte tenu de la date de sa remise, cet avis aurait pu interférer avec les débats électoraux.
On annonce à présent un référendum dit « de projet » que l'accord de Nouméa ne prévoyait bien sûr pas. On parle également d'un référendum institutionnel pour Mayotte.
Conscient de la situation, le précédent ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, avait en tête l'hypothèse d'une révision constitutionnelle pour soumettre un référendum de projet à un corps électoral restreint, qui ne serait peut-être pas celui de l'accord de Nouméa, mais qui ne serait pas en tout cas le corps électoral général. En effet, il ne sera pas facile de convaincre les indépendantistes, selon qui le troisième référendum n'a pas vraiment eu lieu, sinon juridiquement, du moins politiquement, de participer à une négociation portant sur le référendum « de projet » ; si ce référendum est présenté au corps électoral général, on se heurtera d'emblée à un blocage.
On revient donc à cette question : la fin de l'accord de Nouméa exige-t-elle une révision constitutionnelle explicite ? A titre d'exemple, le préambule de l'accord mentionnait le peuple kanak. Or la Constitution ne reconnaît pas de peuple corse ; elle ne reconnaît pas non plus de peuple kanak. Sans base constitutionnelle, le concept de peuple kanak disparaîtrait, alors même qu'il est maintenant admis par tous ; ce serait fâcheux.
Certains acquis des accords de Matignon et de Nouméa restent, cependant, bien ancrés dans la population. Je pense à l'institution provinciale, même si, bien sûr, on ne peut pas aller jusqu'à lui transférer tous les pouvoirs. Je pense à la notion de citoyenneté elle-même, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un corps électoral totalement figé. À ce titre, les obstacles juridiques sont en partie solubles, même au plan conventionnel - je vous renvoie à l'arrêt Polacco et Garofalo c/ Italie de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de 1997. De plus, même si la clef de répartition créée en 1988 et maintenue, l'idée de 1998 a un peu vieilli selon certains et l'idée de rééquilibrage reste présente.
Telle est, selon moi, la base sur laquelle il faut s'appuyer : un préambule, une charte des valeurs reconnaissant l'histoire, ses ombres et ses lumières, ainsi que le peuple kanak ; une certaine forme de citoyenneté ; et la nécessité d'un rééquilibrage pour mieux partager les fruits d'une économie très cyclique, car liée au nickel.
Le dernier point difficile de ces discussions, si elles peuvent s'engager, c'est l'exercice du droit à l'autodétermination.
En juin 2021, au cours de discussions auxquelles participaient certains indépendantistes, notamment ceux de l'Union calédonienne, le principe du droit à l'autodétermination a été rappelé. Bien sûr, le moment de son exercice posera difficulté. Il n'est pas envisageable de déclencher un quatrième, un cinquième référendum avec le seul tiers de voix que les indépendantistes détiennent nécessairement au Congrès.
Plus fondamentalement, beaucoup considèrent qu'il faut se garder de fixer de nouvelles dates pour l'autodétermination, même à horizon de quarante ans, notamment du fait des difficultés économiques du territoire. On peut imaginer des mécanismes d'autodétermination sans date fixe, ce qui ne serait évidemment pas sans difficulté.
J'y insiste, le sujet est lié à l'éventuelle restriction du corps électoral pour les élections provinciales : déconnectée du référendum d'autodétermination, une telle restriction n'est plus réellement justifiée.
Enfin, si l'on a proposé la date de 2023 pour le référendum de projet, c'est parce que le renouvellement du Congrès aura lieu en 2024. Il faudra décider au préalable la composition du corps électoral : on revient donc une nouvelle fois à la question constitutionnelle. Or le précédent gouvernement entendait bien qu'une révision constitutionnelle mette clairement fin à l'accord de Nouméa, donc au corps électoral très restreint et non glissant pour les élections provinciales et au Congrès, et pose les soubassements d'un autre corps électoral, applicable dès 2024.
Les accords de Matignon, qui constituent le compromis historique de départ, ont été conclus dans des circonstances dramatiques, moins de deux mois après l'affaire d'Ouvéa. L'opinion publique et monde politique avaient alors considéré qu'ils relevaient du miracle.
Le premier pilier de ces accords, c'est la reconnaissance de deux légitimités. Les indépendantistes avaient accepté que tous les électeurs présents sur le territoire en 1988 puissent voter au référendum prévu dix ans plus tard. C'était une avancée notable, par rapport aux discussions précédentes, menées sous l'égide du ministre Georges Lemoine à Nainville-les-Roches. À l'époque, les indépendantistes n'entendaient parler que des « victimes de l'histoire », concept que l'on peut comprendre intellectuellement, mais dont la définition juridique est tout de même difficile à établir.
On aurait tort de minimiser cette avancée, au regard du processus de décolonisation mené dans le cadre des textes de l'Organisation des Nations unies (ONU) postérieurs à 1960 : le fait qu'un peuple autochtone accepte de partager le droit à l'autodétermination n'a pas beaucoup d'équivalents, même si, en l'occurrence, c'est pragmatiquement la reconnaissance d'une réalité démographique.
Le second pilier des accords, c'est le fait que tout ne se décide pas à la majorité. Voilà pourquoi l'on y a introduit la notion de clef de répartition, pondérant la représentation de la province Nord et de la province des îles Loyauté au Congrès d'une manière un peu particulière.
Aujourd'hui, on entend parfois dire qu'en vertu de cette pondération le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à majorité indépendantiste, et la présidence du Congrès, indépendantiste elle aussi, ne sont pas à l'image de la Nouvelle-Calédonie, qui, au moins lors de deux référendums sur trois, a voté pour le maintien dans la France.
Pour s'en tenir à l'analyse électorale stricto sensu, notons que la division du camp non-indépendantiste et l'unité du camp indépendantiste ont autant agi pour aboutir à ce résultat que la clef de répartition elle-même. Quoi qu'il en soit, ce point fait partie du compromis négocié à l'origine.
D'ailleurs, au sujet de la représentation politique de la Nouvelle-Calédonie, je rappelle un fait dont peu de gens s'émeuvent : depuis 1986, les deux députés du Territoire sont non-indépendantistes. Or, entre 1978 et 1986, il y avait un député indépendantiste et un député non indépendantiste, ce qui semble plus conforme à la réalité politique de la Nouvelle-Calédonie.
Quoi qu'il en soit, la question fondamentale est la suivante : peut-on remettre en cause l'un des termes de ces accords sans remettre en cause l'autre ? À l'époque, le président de la République avait estimé qu'un référendum national suffisait et qu'il ne fallait pas y ajouter une révision constitutionnelle, compte tenu des difficultés à faire aboutir celle envisagée précédemment.
On peut imaginer de revoir les clefs de répartition entre provinces, qu'il s'agisse des dotations de fonctionnement, des dotations d'investissement ou de l'attribution des sièges ; mais l'on ne peut pas procéder autrement que par la négociation. Agir de manière unilatérale, ou même passer par une décision majoritaire, ce serait implicitement remettre en cause la reconnaissance des deux légitimités par les accords de Matignon, sur laquelle repose aujourd'hui l'essentiel de la paix civile.
En parallèle, les exceptions constitutionnelles comptent parmi les points essentiels de l'accord de Nouméa, qu'il s'agisse des lois du pays, du corps électoral restreint ou encore de la préférence pour l'emploi local.
Or ces exceptions faisaient sens tant que l'on s'inscrivait dans un processus d'autodétermination. Pour le regretté Guy Carcassonne, le titre XIII de la Constitution était, en ce sens, la matrice de la Constitution d'un État en devenir : c'est ainsi qu'il justifiait les exceptions constitutionnelles héritées de l'accord de Nouméa.
Le problème, c'est que les Calédoniens en ont pris l'habitude. Aujourd'hui, les lois du pays paraissent tout à fait normales. Elles s'inscrivent dans le processus démocratique et, d'une certaine manière, fonctionnent assez bien. Le contrôle de constitutionnalité, tel qu'il s'est exercé, n'a rien mis au jour d'extravagant. Certains rapporteurs de la section de l'intérieur du Conseil d'État assurent même que, sur divers sujets, le gouvernement calédonien est sensiblement plus respectueux des avis du Conseil d'État que d'autres autorités.
J'en viens au corps électoral restreint pour les élections provinciales. Certes, le fait que 35 000 à 40 000 personnes soient exclues du vote du fait de leur date d'arrivée sur le territoire peut sembler saugrenu. Mais, lors de la mission sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, que le gouvernement de Manuel Valls nous avait confiée entre 2014 et 2016, nous n'avons pas rencontré de représentants des forces politiques proposant de revenir, pour les élections provinciales, au corps électoral général.
Parmi les candidats aux prochaines élections législatives, même le président de l'association Un coeur, Une voix, qui prétend fédérer les « exclus » du suffrage universel, ne défend pas une telle mesure. Ce qu'il propose, c'est que la durée d'exclusion soit la plus courte possible.
Toutes les forces politiques du territoire admettent le corps électoral restreint, pour différentes raisons.
La première est, sinon cynique, du moins purement politique ou pragmatique : même les non-indépendantistes en ont conscience, le fait de revenir au corps électoral général pour les élections provinciales serait un casus belli majeur avec les indépendantistes.
La deuxième est d'ordre culturel. Les Calédoniens installés de longue date n'ont pas envie de voir un électorat métropolitain fraîchement débarqué bousculer les équilibres politiques locaux. À cet égard, un phénomène est assez intéressant à observer : le taux de participation aux deux premiers référendums a été très élevé dans la population d'origine européenne, de même que pour le « non » au troisième référendum ; mais plus d'un tiers des électeurs qui se sont exprimés pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France n'ont pas jugé utile de se déplacer pour élire le président de la République française. C'est révélateur d'un certain attachement à la France, d'une certaine insertion dans l'ensemble français.
La troisième, qui n'est pas négligeable, a trait à l'emploi local, dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Beaucoup de Calédoniens sont attachés aux dispositions en vigueur : ils ne veulent pas voir leurs enfants coiffés au poteau après avoir accompli des études supérieures.
Si, à l'issue de trois référendums, on se contente de dire : « La Nouvelle-Calédonie, c'est la France », comment justifier le maintien, même atténué, encadré ou réduit, de ces trois exceptions à des principes généraux d'un point de vue constitutionnel ? Que direz-vous à Édouard Fritch quand il viendra demander les mêmes lois du pays pour la Polynésie française ? Aujourd'hui, les lois du pays en vigueur dans ce territoire sont purement cosmétiques - il s'agit en fait de dispositions réglementaires, baptisées ainsi pour complaire à son prédécesseur. Que direz-vous à Gilles Simeoni quand il viendra demander un corps électoral restreint pour un certain nombre de questions foncières ? Et je ne reviens pas sur la question de l'emploi local.
Nous sommes donc face à la quadrature du cercle. En supprimant ces acquis, l'on se dirige d'une manière ou d'une autre vers une crise politique majeure dont personne ne connaît l'issue. En les maintenant, même sous une forme aménagée ou réduite, l'on s'expose à des difficultés d'ordre politique et juridique assez importantes.
Voilà pourquoi il faudra nécessairement reconnaître à la Nouvelle-Calédonie un statut complètement spécifique dans l'ensemble juridique français, comprenant une part de souveraineté partagée. C'est d'ailleurs déjà assez largement le cas, même pour les compétences régaliennes. La reconnaissance de la coutume en matière juridique est un point tout à fait essentiel ; en vertu de la loi organique actuelle, le Haut-Commissaire informe le président du gouvernement des décisions qu'il prend en matière d'ordre public ; de même, on trouve des représentants de la Nouvelle-Calédonie dans les ambassades de France de la région.
Quant aux grandes difficultés, elles portent deux noms : taxonomie - si l'on veut faire entrer la Nouvelle-Calédonie dans les cases existantes, on ne s'en sortira pas - et nominalisme : en Nouvelle-Calédonie, rien n'est plus piégé que les mots.
Les Calédoniens de tous bords ont instauré une forme de terrorisme du vocabulaire. Ainsi, en vertu des accords de Matignon, les provinces devaient constituer une organisation fédérale de la Nouvelle-Calédonie. Puis, lors de l'examen du projet de loi référendaire, les présidents Marceau Long et Michel Bernard avaient plaidé pour que l'on supprime cet adjectif, même si, la réalité, c'est bien une forme de fédéralisme interne ; et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la réalité, c'est une forme de fédéralisme externe. Reste qu'en utilisant ces mots on plombera d'avance la discussion : les catégories juridiques et la terminologie renverront à des préjugés ou à des a priori.
Enfin, j'ai lu dans les professions de foi de candidats de la majorité présidentielle aux élections législatives de 2022 la volonté d'aboutir à « un statut de consensus définitif dans la République française ». J'y vois un double oxymore. En effet, cette expression signifie qu'il n'y aurait plus d'indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. La méthode australienne permet certes d'aboutir à ce résultat, mais personne en France n'y songe. De plus, pour qu'il y ait consensus, il faut reconnaître la situation actuelle telle qu'elle s'est construite. Elle est assortie d'un certain nombre d'exceptions ; elle n'est pas simple ; mais il faut concilier le maximum de garanties à la Nouvelle-Calédonie, de la part de la France, et le maximum de reconnaissance de la spécificité calédonienne.

Je veux revenir sur le nouveau référendum envisagé voilà quelques mois par M. Lecornu. Quelles sont les données juridiques du problème ?
Il y a eu une réunion en juin 2021 autour de M. Lecornu, qui a été source d'ambiguïtés : il s'agissait de fixer la date du troisième référendum et d'envisager les différentes perspectives en fonction des résultats possibles. L'Union calédonienne (UC) a d'abord donné son accord sur la date, puis est revenue dessus.
M. Lecornu a envisagé les deux hypothèses : soit le oui à l'indépendance l'emportait et des négociations de mise en oeuvre devaient avoir lieu ; soit le non l'emportait et il fallait alors également entamer un cycle de négociations pour déterminer ce qui allait succéder aux accords de Paris et de Nouméa, sachant que rien n'était prévu dans lesdits accords.
L'accord de Nouméa a-t-il cessé d'exister ? Si oui, à quel moment ? Faut-il envisager une révision constitutionnelle ?
Avec ce référendum de projet tel qu'il a été évoqué, il me semble que l'on se situe dans l'hypothèse d'une fin de l'accord de Nouméa. On peut comprendre que celui-ci a pour objet de proposer un nouveau statut dans la République pour la Nouvelle-Calédonie.
Pour déterminer ce nouveau statut, une loi organique suffira, adoptée au besoin par référendum national. Je ne pense pas qu'une telle solution soit retenue. Néanmoins, ce statut aurait une légitimité plus forte s'il s'accompagnait d'une consultation locale de la population.
On peut aussi imaginer le même scénario que pour l'accord de Nouméa : consultation de la population locale, avec un corps électoral à définir, puis une révision constitutionnelle qui en prendrait acte. Seulement, à l'époque, il y avait un consensus politique local.
Autre solution envisageable : pas de révision constitutionnelle. À ce moment-là, peut-on organiser une consultation locale de la population sur une évolution institutionnelle ? Je sais que ce n'était pas possible pour la Corse. Peut-on se fonder sur l'article 72 de la Constitution alors que la Nouvelle-Calédonie n'en relève pas ?
À mon sens, si l'on envisage une consultation locale, celle-ci ne peut se faire qu'avec le corps électoral général, mais il m'apparaît impossible d'obtenir l'accord des indépendantistes sur ce point.

Je pense que le génie de l'accord de Nouméa a été d'éviter la violence en embrayant sur un processus démocratique. Les trois référendums pouvaient apparaître baroques, mais cela a fonctionné jusque-là.
Pensez-vous qu'il soit possible d'arriver à une issue définitive ? Le statu quo ne serait-il pas préférable ? Il me semble difficile d'imaginer un nouveau référendum. Ne vaut-il pas mieux une ambition plus modeste ?
Je suis pour ma part sceptique sur l'idée qu'il y aurait un plan définitif à moyen ou long terme.
En politique, je me méfie toujours de l'emploi des termes « définitif » et « immédiatement ». La force des deux accords, celui de Paris et celui de Nouméa, a été de permettre au temps de faire son oeuvre. Il faut savoir que les positions ont évolué dans chacun des deux camps. Il en est ainsi du FLNKS sur la composition du corps électoral. J'accorde une vertu majeure à cette temporalité.
Du point de vue institutionnel, il n'est pas difficile de trouver un compromis sur la pérennité de l'accord de Nouméa. Cependant, la question du gel du corps électoral va se poser au regard de la jurisprudence de la CEDH et des pactes des Nations Unies relatifs aux droits civils et politiques. Le Congrès et les assemblées provinciales restent des éléments centraux du processus d'autodétermination. C'est la raison pour laquelle le gel du corps électoral leur a été étendu.
Pourquoi les indépendantistes vont-ils le rester ? J'y vois plusieurs raisons.
Tout d'abord, il y a eu une lutte armée, avec des morts ; donc, ils ne peuvent pas donner le sentiment de trahir la cause.
Ensuite, la crainte existe d'une submersion démographique, alors qu'en pratique, c'est l'inverse qui se produit.
Enfin, pour les Kanaks, il n'y a pas eu d'accord sur la décolonisation, donc il faut dénouer symboliquement la chose.
En fait, j'ai coutume de faire une analogie avec l'Irlande, où la situation paraît figée pour l'éternité entre deux camps irréconciliables, alors qu'une troisième voie semble faire son chemin dans les esprits.
D'où ma question : les indépendantistes sont-ils toujours indépendantistes ? Il faut savoir qu'il y a des contradictions dans chaque camp. À mon sens, il y a des marges de manoeuvre sur la ligne de l'autonomie et les indépendantistes sont prêts à conserver des liens forts avec la France.
Sur la base de la jurisprudence Polacco et Garofalo c/ Italie de la CEDH de 1997, qui excipe de la particularité linguistique du Trentin-Haut-Adige afin de justifier la condition de résidence de quatre ans pour avoir le droit de voter, il me semble de ce point de vue que la restriction du corps électoral en Nouvelle-Calédonie n'est pas illégitime.
Certains indépendantistes préfèrent rester indépendantistes qu'être indépendants, peut-on entendre en Nouvelle-Calédonie...
Il y a deux associations de maires en Nouvelle-Calédonie, dont l'une est indépendantiste. Ses représentants nous ont demandé comment allait se dérouler le contrôle de légalité par l'État en cas d'indépendance...

Les membres de la délégation aux outre-mer sont très attentifs aux perspectives d'évolution institutionnelle des territoires ultramarins, sujet sur lequel mon prédécesseur Michel Magras a proposé des pistes dans le cadre de son rapport sur la différenciation territoriale outre-mer de septembre 2020.
Depuis, la délégation a tenu plusieurs réunions sur le sujet. Nous organisons, le 29 juin, une réunion commune avec l'Association des juristes en droit des outre-mer (Ajdom), durant laquelle une séquence sera exclusivement consacrée au statut de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'a souhaité son président, Ferdinand Mélin-Soucramanien.
Le titre XIII de la Constitution relatif à la Nouvelle-Calédonie prévoit que ces dispositions sont transitoires. Aussi, ce cycle d'auditions nous semble particulièrement opportun pour préparer les débats, décisifs pour l'avenir de ce territoire, sur le meilleur cadre juridique constitutionnel possible.
Ma question est simple : trouvez-vous opportun de mettre en place une nouvelle mission d'écoute et de conseil, sur le modèle de celle dont vous étiez chargés et qui avait abouti aux accords de Matignon ? Comment mobiliser, selon vous, les forces constructives et de dialogue qui existent sur place ? Selon quelle méthode et avec quel calendrier, dans l'idéal ?

Pouvez-vous aller plus loin sur la contrainte juridique que font peser les textes des Nations Unies ? Pourquoi la Nouvelle-Calédonie entre-t-elle dans la liste des territoires à décoloniser, et pas la Guyane ? Quels sont les critères retenus par l'ONU ?
Pour moi, une révision constitutionnelle s'impose, car je crains qu'un incident ne conduise un juge à constater que les dispositions sont caduques et qu'il en faut d'autres.
Il y a deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui cheminent actuellement.
La première a été soulevée devant le tribunal administratif de Nouméa : elle porte sur le consentement à l'impôt s'agissant d'une personne qui n'est pas électrice du Congrès, lequel vote l'impôt. Le tribunal l'a refusée, mais un appel a été formé contre ce refus.
La seconde question, transmise à la Cour de cassation par le tribunal judiciaire de Nouméa, porte sur la non-inscription sur la liste électorale spéciale.
La mission qui nous avait été confiée était apparue légitime du fait de sa composition pluraliste. Je crains qu'il ne soit difficile de renouveler l'expérience, car il y aura une forme de lassitude. Il faudrait sans doute plus d'intervenants locaux ayant une expertise extérieure.
Je suis d'accord, ce genre de mission a atteint ses limites. À mon sens, il conviendrait d'inverser le processus en interrogeant la société calédonienne sur des sujets précis, les réponses apportées déterminant le cadre constitutionnel le plus approprié. Mais la solution ne pourra apparaître que si l'État dit vraiment ce qu'il veut pour la Nouvelle-Calédonie.
Selon les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU de 1960, il y a trois manières de sortir de la colonisation : l'accession à l'indépendance ; l'association du territoire avec la puissance administrante ; le maintien du statut au sein de la puissance administrante. Les trois référendums en Nouvelle-Calédonie répondent juridiquement à ces exigences, mais pas politiquement. De toute façon, la France s'est engagée pour l'instant à ne pas demander que la Nouvelle-Calédonie soit retirée de la liste des pays à décoloniser.
Pour ce qui concerne la Guyane, la réponse est dans la Constitution et elle résulte d'une demande des forces politiques locales.
Lorsque le général de Gaulle a proposé la mise en place de la Communauté en 1958, il n'y avait pas d'États indépendants. Ce n'est qu'après l'indépendance du Mali et du Sénégal, en 1961, qu'une révision constitutionnelle a permis que la Communauté comprenne des États ayant accédé à l'indépendance.
Je rappelle que des observateurs de l'ONU ont supervisé les trois référendums. Ils ont pu attester de leur qualité.
Je conclurai avec ces mots d'Edgard Pisani, ancien ministre du général de Gaulle : « Il n'y a pas de présence française durable, paisible et utile dans la région du Pacifique Sud sans l'accord de tous. Il n'y a pas l'accord de tous si n'est pas accompli l'acte politique qui consacre la naissance d'une nouvelle souveraineté. [...] Voilà pourquoi l'indépendance ! Pourquoi la France ? Parce qu'elle avait un intérêt légitime à défendre ; parce que beaucoup de Calédoniens exigent qu'elle demeure ; parce que tous les Calédoniens le souhaitent ; parce qu'elle a accompli sur ce territoire une oeuvre sans doute imparfaite, mais utile, qu'elle doit prolonger. Aucun responsable de la République n'a considéré les choses autrement. »

Je vous remercie de votre participation.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 11 h 40.